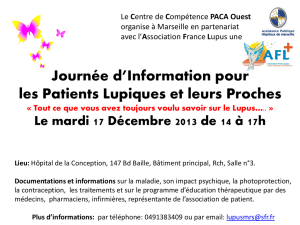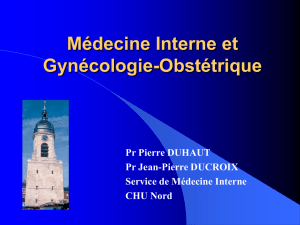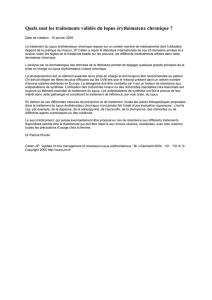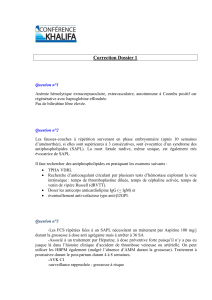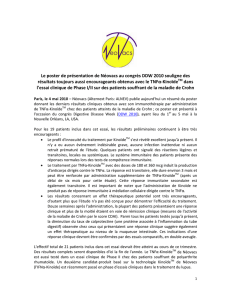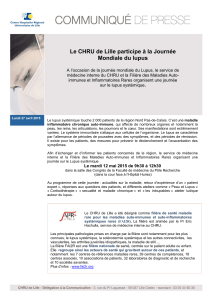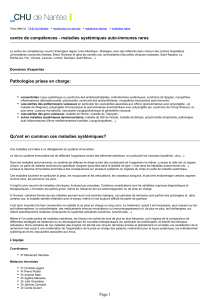Lire l'article complet

La Lettre du Rhumatologue - n° 278 - janvier 2002
30
MALADIES AUTO-IMMUNES
ET SYSTÉMIQUES
T-BET (T-BOX TRANSCRIPTION FACTOR) :
UN NOUVEAU FACTEUR DE RÉGULATION
T- Bet : un facteur de régulation isotypique des lym-
phocytes B
T-Bet est impliqué dans la régulation transcriptionnelle des
facteurs permettant la transformation des lymphocytes T CD4
auxiliaires ou helper indifférenciés (Th0) en lymphocytes
T CD4 Th1, sécréteur d’interleukine 2 et d’interféron gamma.
Jusqu’à ce jour, le rôle de ce facteur de transcription dans l’im-
munité humorale n’était pas connu.
En étudiant des souris déficientes en T-Bet (T-Bet -/-), il a été
observé un défaut de production d’IgG 2a et, à un degré
moindre, d’IgG 2b et d’IgG 3. T-Bet est donc un facteur de
transcription, permettant la régulation isotypique des IgG 2.
L’expression de ce facteur peut être augmentée par l’interfé-
ron gamma produit par les lymphocytes Th1 via l’activation
du facteur de transcription STAT 1 (Peng et al., 286).
Des anomalies de T-Bet peuvent avoir un rôle dans
les maladies auto-immunes
L’étude de souris lupiques MRL/Lpr déficientes en T-Bet
(T-Bet -/-) a permis d’observer qu’elles développent, comme
les souris MRL/Lpr “sauvages”, un syndrome lymphoproli-
fératif avec un infiltrat de la peau et du foie, mais pas de com-
plication humorale. Ces souris ne produisent pas d’IgG 2a, ce
qui explique qu’elles ne développeront pas une néphropathie
glomérulaire à immun-complexes comme les souris MRL/Lpr
“sauvages” (Peng et al., 286).
Maladies auto-immunes et systémiques
!J. Sibilia
"T-Bet est un facteur de commutation isoty-
pique des IgG impliquées dans les maladies
auto-immunes.
"Des autoanticorps qui interfèrent avec la bio-
logie du TNFα: les anti-TIA-1, TIAR, TTP (pro-
téines stabilisatrices de l’ARNm du TNFα).
"L’expression du CD40 Ligand plaquettaire
pourrait être un facteur thrombogène dans le
syndrome des antiphospholipides.
"Un inhibiteur spécifique de la C3 convertase :
un traitement efficace des complications
thrombotiques et obstétricales dans un modè-
le murin de syndrome des antiphospholipides
primaires.
"Des anticorps antiphospholipides thrombo-
gènes (anti-ß2 GP1) induits par des infections
bactériennes ou virales.
"L’ostéoporose : une complication fréquente
du lupus ... mais un traitement hormonal sub-
stitutif peut être prescrit sans risque majeur
de poussée de la maladie.
"Les analogues de la LH-RH peuvent être des
protecteurs ovariens efficaces en cas de trai-
tement par le cyclophosphamide.
"L’infliximab (Remicade®) : un traitement effi-
cace des vascularites systémiques et des mala-
dies de Still réfractaires.
"L’hypertension artérielle dans la sclérodermie.
Des espoirs thérapeutiques : le sildénafil
(Viagra®) et le bonsentan.
Points forts
"Les traitements antiviraux (interféron - ribavi-
rine) efficaces dans les complications extra-
articulaires de l’infection par le virus de l’hé-
patite C.

La Lettre du Rhumatologue - n° 278 - janvier 2002
31
MALADIES AUTO-IMMUNES ET SYSTÉMIQUES
T- Bet : un facteur impliqué dans les déficits immu-
nitaires humoraux
T-Bet pourrait aussi être un facteur impliqué dans les déficits
immunitaires humoraux primitifs, en particulier dans les défi-
cits en sous-classe d’immunoglobulines. Pour l’instant, cette
hypothèse n’a pas été vérifiée, mais des travaux sont en cours.
DES AUTOANTICORPS QUI INTERFÈRENT
AVEC LA BIOLOGIE DU TNFα
Différents stimulus pro-inflammatoires induisent la trans-
cription des gènes du TNF via les deux principales voies de
signalisations intracellulaires (voie de NF-κB et voies des
MAP kinases). La transcription du gène en ARN est une étape
fondamentale dans la synthèse du TNFα. Cette étape primor-
diale est régulée par des protéines (TIA-1,TIAR, TTP) qui sont
des éléments clés de la régulation post-transcriptionnelle. Ces
protéines se fixent sur des séquences particulières appelées
AURE (riche en uridine), caractéristiques de l’ARN messager
de différentes cytokines, dont le TNFα. À l’état basal, ces pro-
téines vont stabiliser l’ARN, bloquant ainsi sa traduction en
TNFα. Lors de l’activation de la cellule, ces protéines sont
phosphorylées par les MAP kinases, libérant ainsi l’ARN mes-
sager du TNFα, qui est alors traduit en TNFα(figure 1).
Jimenez-Boj et al. (130) ont démontré qu’il existait des
autoanticorps dirigés contre ces protéines régulatrices TIA-1
et TIAR chez 67 % des lupus, 50 % des sclérodermies, 30 %
des myosites, 15 % des syndromes de Gougerot-Sjögren et
10 % des polyarthrites rhumatoïdes, mais pas chez les sujets
sains (sauf exception). Ces autoanticorps pourraient être pro-
duits en réponse à la libération “immunogène” de grandes
quantités de TNFαtissulaires, mais ils pourraient également
avoir un rôle en bloquant leur protéine cible. Si ce blocage est
effectif, l’ARN du TNFαest libéré, facilitant ainsi la synthèse
en plus grande quantité de TNFα. L’étude de l’interférence de
ces autoanticorps avec la voie du TNFαest un sujet passion-
nant, qui pourrait être développé ces prochaines années et peut-
être ouvrir des perspectives thérapeutiques.
LE SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLI-
PIDES (SAPL) : MÉCANISMES ET TRAITE-
MENTS
Le CD40 Ligand (CD 40 L) plaquettaire : un facteur
d’activation qui intervient dans les thromboses
Les plaquettes peuvent exprimer le CD 40 L (CD154), qui est
une structure de la famille du TNF décrit initialement à la sur-
face des lymphocytes T. La voie CD 40/CD 40 L est une des
deux grandes voies de costimulation permettant le “dialogue”
entre les lymphocytes T et les cellules présentatrices de l’an-
tigène. Les plaquettes qui expriment le CD 40 L peuvent inter-
agir avec l’endothélium en fixant le CD 40 des cellules endo-
théliales. Cette interaction intervient vraisemblablement dans
la formation du “clou” plaquettaire. Pour démontrer le rôle du
CD 40 L plaquettaire dans le SAPL, Perniok et al. (276) ont
étudié son expression en cytométrie de flux après agrégation
en présence de thrombine ou d’ADP. L’expression du CD 40 L
plaquettaire des lupiques est comparable à celle de patients
témoins. En revanche, les plaquettes de sujets atteints de SAPL
ont une expression de CD 40 L très supérieure à celle des lupus
et des témoins (p < 0,0001). En conséquence, il est possible
que dans le SAPL, cette hyperexpression de CD40L plaquet-
taire puisse être un facteur intervenant dans la survenue des
thromboses (figure 2).
5'UTR
État basal
Activation
cellulaire
5'
5'
X
AURE CPE/APE
X
AURE CPE/APE
3'UTR
ADN TNFα
ARN TNFα
ARN TNFα
MK 2 (P38)
Polyadénylation
AUUUA
AUUUA
TIAR/TIA-1
action “silencer”
TIAR/TIA-1
stop action “silencer”
P
Figure 1. La régulation post-transcriptionnelle du TNFαpar les protéines
“silencer” TIAR, TIA-1, TTP...
"
Cette régulation est liée aux séquences AURE de l’ARNm de TNF qui pro-
voque, à l’état basal, une stabilisation ou une dégradation de cet ARN dans
le cytoplasme (dans le protéasome).
En cas d’activation cellulaire, le besoin en TNF
α
va entraîner une inacti-
vation de ces séquences AURE, ce qui va se traduire par une synthèse mas-
sive de TNF
α
par la cellule.
"
À l’état basal, la régulation de ces séquences AURE semble liée à la fixa-
tion de protéines régulatrices AURE appelées AURE Bb (aurich elements
binding protein) : TIA-1, TIAR, TTP, Hel-N1, HUR, AUF1.
Lors de l’activation cellulaire, la phosphorylation de ces protéines, notam-
ment par des kinases de la voie P38, inhibe leur action. Ainsi, il n’y aura
plus de stabilisation ou de dégradation par les séquences AURE de l’ARNm
du TNF
α,
qui sera alors libéré en grande quantité.
CD 40
CD 40 Ligand (CD 154)
Plaquettes Endothélium Thrombose ?
Figure 2. Étude de l’expression de CD 40 L plaquettaire après activation par la
thrombine ou l’ADP : lupus = témoins sains (NS) ; SAPL > lupus/ témoins sains
(p < 0,0001).
Le CD 40 Ligand plaquettaire est un facteur d’activation pouvant faciliter les
thromboses au cours du SAPL.

La Lettre du Rhumatologue - n° 278 - janvier 2002
32
MALADIES AUTO-IMMUNES ET SYSTÉMIQUES
Le rôle du complément dans le SAPL : un facteur de
thrombose et de complications obstétricales !
Le rôle de l’activation du complément avait déjà été évoqué
pour expliquer les complications thrombotiques du SAPL, en
particulier en cas de lésion cérébrale (Davis et al. Clin Exp
Rheumatol 1922; 10 : 455-60).
Au cours de ce congrès, le rôle du complément a été démon-
tré par différents arguments, obtenus à partir d’un modèle de
SAPL murin.
Ce modèle de SAPL murin est une souris à laquelle on a injecté
des antiphospholipides humains (IgG anticardiolipides) et chez
laquelle on étudie l’apparition de thromboses veineuses fémo-
rales “induites” par un traumatisme, mais aussi les complica-
tions obstétricales (retard de croissance et perte fœtale). Les
thromboses des veines fémorales “induites” sont cinq fois plus
importantes chez les souris auxquelles on a injecté des anti-
phospholipides humains comparées aux souris auxquelles des
immunoglobulines humaines non spécifiques ont été injectées.
Dans ce modèle, l’injection d’antiphospholipides humains
s’accompagne aussi d’une réduction du poids fœtal de 34 %
et de quatre fois plus de perte fœtale. L’étude du placenta per-
met d’observer l’existence d’importants dépôts de C3 qui
n’existent pas chez les souris auxquelles on a injecté des IgG
humaines non spécifiques.
Les souris déficientes en fraction C3 du complément (C3 -/-)
sont protégées des thromboses induites par l’injection d’un
anticorps antiphospholipide humain (IgG anticardiolipides).
L’étude de ces souris montre non seulement l’absence de
thrombose veineuse fémorale, mais également l’absence
d’anomalie fœtale (retard de croissance et avortement).
L’utilisation d’un inhibiteur spécifique de la C3 convertase, le
Crry-Ig, dans un modèle murin du SAPL permet la même
observation. Cet inhibiteur de la C3 convertase est une pro-
téine de fusion recombinante formée de deux portions extra-
membranaires d’une enzyme inhibitrice de la C3 convertase
et d’un fragment d’immunoglobuline humaine (figure 3).
"Les thromboses, mesurées en millimètre, sont significati-
vement moins importantes chez les souris traitées par un inhi-
biteur spécifique d’un C3 convertase (Crry-Ig), comparé à l’in-
jection de contrôle d’IgG murines non spécifiques (p < 0,0004)
(1 509 ± 387 mm vs 3 577 ± 119 mm) (Girardi et al., 660).
"L’étude des anomalies et de l’hypotrophie fœtale confirme
que l’injection du Crry-Ig s’accompagne d’une réduction
significative des pertes fœtales (p < 0,005) et d’une améliora-
tion du poids fœtal par rapport à des souris contrôles aux-
quelles on a injecté des IgG murines non spécifiques (Salmon
et al., 961) (figure 4).
L’activation du complément, en particulier de la fraction C3,
semble donc avoir un rôle pathogénique important dans les
complications thrombotiques et obstétricales du SAPL. Cela
permet d’expliquer potentiellement l’efficacité des immuno-
globulines intraveineuses car cette préparation a la capacité
d’inhiber l’activation du complément.
Le développement de nouvelles thérapeutiques bloquant
l’activation du complément est peut-être une voie d’avenir
dans la prise en charge du SAPL.
Le SAPL : une cohorte européenne (Euro SAPL)
Treize pays européens, dont la France, ont mis en place une
cohorte incluant 1 000 patients atteints du SAPL défini par les
critères de Sapporo. Cette cohorte comprend 53 % de SAPL
primaires, 41 % de SAPL associés à un lupus et 6 % de formes
associées à d’autres maladies auto-immunes. Elle a inclus
820 femmes et 80 hommes dont l’analyse et le suivi ont été
particulièrement intéressants. Elle a déjà permis d’évaluer la
prévalence des formes de l’enfant (< 15 ans), qui représente
2,8 % de cette population de SAPL. Ces formes juvéniles sont
caractérisées par la fréquence du livedo (26%) et de l’épilep-
sie (14 %), alors que ces deux manifestations sont significati-
vement plus rares chez les sujets de plus de 50 ans (respecti-
vement 13 % et 1 %) (p < 0,05) (Cervera et al., 1321).
Le SAPL primaire existe-t-il ?
C’est un sujet controversé car pour certains, le SAPL primaire
n’est que la première manifestation d’un lupus systémique.
Pour répondre à cette question, Gomez et al. (562) ont suivi,
Enzyme
Inhibiteur de C3 convertase
Protéine de fusion recombinante
Ig (Fc)
Figure 3. Le Crry-Ig : un inhibiteur spécifique de la C3 convertase.
Figure 4. Effet préventif des complications obstétricales d’un inhibiteur de la C3
convertase (Crry-Ig).
0
100
200
Poids fœtal (mg)
300
400
500
APL IgG
+
Crry-Ig
*p < 0,05
APL IgG
contrôles
*
0
5
10
Avortements (%)
15
20
25
APL IgG
+
Crry-Ig
APL IgG
contrôles
*
*p < 0,05

La Lettre du Rhumatologue - n° 278 - janvier 2002
33
MALADIES AUTO-IMMUNES ET SYSTÉMIQUES
pendant 10,2 ans en moyenne (2-15), 90 SAPL (74 femmes et
16 hommes) considérés comme primaires (critères de Sapporo
1999). Cette étude rétrospective a permis de démontrer que
seuls 12 patients (13 %) ont développé un lupus au cours de
ce suivi, après une durée d’évolution moyenne de 8,2 ans. Un
autre patient a développé une myasthénie, mais tous les autres
(85 %) sont restés des SAPL primaires.
LE LUPUS : MÉCANISMES ET TRAITEMENTS
Le rôle du TNFαdans l’apparition de lésions de
lupus cutané
Le rôle du TNFαdans le lupus est un sujet de controverse.
Dans plusieurs modèles de lupus murins, il a été observé un
excès de synthèse de TNFα. De même chez l’homme, plu-
sieurs travaux ont démontré le rôle délétère du TNFα,notam-
ment dans les atteintes rénales. Le TNFαest un immunoré-
gulateur des lymphocytes T et B, mais il agit aussi comme
effecteur lésionnel dans les glomérules ou pour d’autres cel-
lules comme les kératinocytes. Ruppert et al. (907) et Host-
mann et al. (906) ont démontré que le TNFαpouvait aug-
menter l’expression de l’ARN messager des antigènes
Ro/SS-A 52 et 60 KD produits par des kératinocytes humains
ou des lignées kératinocytaires (HaCaT). Cette expression est
encore augmentée si les kératinocytes sont préincubés avec
des estrogènes (17ß-estradiol). Cette hyperexpression des
autoantigènes Ro/SS-A induits par le TNFαpeut expliquer
l’apparition d’autoanticorps anti-Ro/SS-A, mais il reste à com-
prendre comment s’effectue l’auto-immunisation. Schémati-
quement, on peut décrire deux hypothèses (figure 5) :
"les kératinocytes stimulés par le TNFαpeuvent exprimer à
leur surface des antigènes Ro/SS-A 52 et 60 KD qui seront
alors potentiellement immunogènes, car ils seront devenus
“accessibles” au système immunitaire ;
"le TNFαpeut aussi entraîner l’apoptose de ces kératino-
cytes, qui vont alors “relarguer” de petites vésicules formées
de membranes cytoplasmiques (appelées blebs); celles-ci
expriment à leur surface les autoantigènes Ro/SS-A, qui
deviennent alors accessibles au système immunitaire.
Ces deux mécanismes expliquent, au moins en partie, l’im-
munisation contre des protéines a priori intracellulaires. Reste
à savoir quels sont les phénomènes qui vont induire une syn-
thèse excessive de TNFαpar ces kératinocytes. Des travaux
ont démontré que cette synthèse pourrait être induite par dif-
férentes agressions cellulaires, dont les ultraviolets (UVB).
Ainsi, ce modèle très séduisant permet de comprendre l’ap-
parition des lésions cutanées lupiques induites par les ultra-
violets, très souvent associées à des anticorps anti-SS-A.
Comme le suggèrent ces données expérimentales, une hyper-
estrogénie (contraception, grossesse) peut amplifier ce phé-
nomène, favorisant ainsi l’évolution du lupus.
Peut-on traiter les lésions cutanées du lupus par un
anti-TNFα?
Si le modèle décrit préalablement est pertinent, l’utilisation
d’anti-TNFαpourrait permettre d’améliorer les lésions cuta-
nées, et peut-être même d’éviter l’immunisation anti-Ro/
SS-A. Cette hypothèse peut paraître audacieuse depuis que
l’on a observé l’apparition d’anticorps anti-ADN natif et de
quelques lupus sous anti-TNFα. Néanmoins, différents tra-
vaux ont démontré l’efficacité parfois spectaculaire de cer-
taines molécules “ancêtres” des anti-TNFα,comme le thali-
domide. Cuadrado et al. (1362) ont présenté les résultats
d’une étude ouverte de 30 lupus cutanés réfractaires à diffé-
rents traitements (hydroxychloroquine, mépacrine, azathio-
prine et prednisone), traités par des doses décroissantes de tha-
lidomide (50 à 100 mg/j le premier mois puis 50 à 25 mg/j les
mois suivants). Il s’agissait de lésions cutanées chroniques iso-
lées (n = 7) ou apparues au cours d’un lupus cutané subaigu
(n = 5) ou systémique (n = 18). Après quatre mois de traite-
ment, une amélioration significative a été observée chez 91 %
des patients avec 60 % (n = 18) de rémission complète et 33 %
(n = 10) de rémission partielle. L’action du traitement sur la
synthèse d’anti-Ro/SS-A n’a pas été précisée. Il n’y a eu que
deux échecs thérapeutiques, et assez peu d’effets indésirables.
Les effets indésirables les plus fréquents liés directement au
UVB TNFα
Ro 60 KD
Ro 52 KD
Kératinocytes en apoptose
Ro 60 KD
Ro 52 KD
TNFαmARN
Kératinocytes "normaux"
UVB
Les UVB induisent (via le TNFα) la synthèse de Ro
#expression de Ro/SS-A 60 et 52 KD à la membrane
cellulaire des kératinocytes humains
Les UVB induisent (via le TNFα) l’apoptose
des kératinocytes humains
#expression de Ro/SS-A 60 et 52 KD dans les blebs d’apoptose
Figure 5. Rôle du TNFαsur la synthèse des antigènes Ro/SS-A 52 et
60 KD.

La Lettre du Rhumatologue - n° 278 - janvier 2002
34
MALADIES AUTO-IMMUNES ET SYSTÉMIQUES
thalidomide sont les neuropathies : six formes symptomatiques
confirmées à l’électromyogramme, dont trois formes irréver-
sibles. Les autres effets indésirables sont la somnolence (30 %
des cas) et les douleurs abdominales (15 % des cas). Le tha-
lidomide est donc un traitement particulièrement efficace des
lésions cutanées réfractaires du lupus. Cette efficacité pour-
rait s’expliquer par son activité anti-TNFα. L’avenir repose
probablement sur l’utilisation prochaine d’analogues du
thalidomide qui auront l’avantage d’être mieux tolérés.
L’ostéoporose : une complication importante du
lupus
L’ostéoporose a été longtemps sous-estimée au cours du lupus,
plusieurs études s’y sont récemment intéressées (tableau I).
Dans une étude canadienne (Pineau et al., 1689, 1690), une
analyse densitométrique a permis d’observer parmi
205 femmes lupiques (âge moyen : 45 ± 12 ans) 48 % (n = 100)
d’ostéopénie (– 2,5 < T score lombaire < – 1) et 18 % (n = 37 %)
d’ostéoporose (T score lombaire < – 2,5). L’âge moyen de ces
ostéoporotiques est de 50,6 ± 13 ans et 67 % d’entre elles
(n = 24) sont ménopausées. Cette ostéoporose s’est manifes-
tée dans 30 % des cas par une fracture périphérique. Dans cette
étude, il est intéressant d’observer que l’apparition d’ostéo-
porose est surtout liée à l’âge, au statut ménopausique et à la
durée d’évolution et la sévérité du lupus. En revanche, il n’y
a pas de relation avec la dose moyenne (10,9 à 12,3 mg/j de
prednisone) ou cumulée (38,8 à 41 g) de corticoïdes.
Une étude anglaise qui a analysé 240 patientes lupiques (âge
moyen : 39,9 ans [18-80]) a démontré l’existence d’une ostéo-
pénie (– 2,5 < T score lombaire < – 1) chez 41 % (n = 98)
d’entre elles et une ostéoporose (T score lombaire < – 2,5)
chez 10 % (n = 22) d’entre elles (Gordon et al., 691). Dix
pour cent de ces patientes ont fait une fracture ostéoporotique.
Dans cette étude, qui inclut 45 % de femmes ménopausées,
le meilleur facteur prédictif est l’âge, comme dans l’étude
précédente. En revanche, les corticoïdes n’apparaissent
pas comme un facteur de risque majeur.
Ces deux études démontrent ainsi le poids non négligeable de
l’ostéoporose dans l’histoire naturelle du lupus.
Peut-on prescrire un traitement hormonal substitu-
tif (THS) de la ménopause dans le lupus ?
Pour différentes raisons, en particulier pour prévenir les com-
plications ostéoporotiques, il serait justifié de prescrire un trai-
tement hormonal substitutif (THS) de la ménopause au cours
du lupus. Cependant, différentes études ont suggéré une aug-
mentation des poussées lupiques postménopausiques chez les
patientes traitées par un THS, mais des résultats controversés
ont justifié la planification d’une grande étude (étude
SELENA) qui est en cours. Sanchez-Guerrero et al. (1261)
ont présenté une étude randomisée de 106 patientes lupiques
ménopausées traitées soit par THS (estrogènes équins à
0,625 mg + médroxyprogestérone à 5 mg), soit par placebo
pendant deux ans. Les patientes des deux groupes ont pour-
suivi leur corticothérapie à doses équivalentes (5 à 10 mg/j)
ainsi que la prise de calcium (1,2 g/j). Les patientes ayant des
antécédents thromboemboliques ou de cancer hormonodé-
pendant et celles souffrant d’un lupus évolutif (indice d’acti-
vité SLEDAI > 20) n’ont pas été incluses. Après deux ans de
traitement, 37 patientes du groupe THS et 38 patientes du
groupe placebo ont été analysées, démontrant que le THS n’a
pas entraîné plus de poussées, de thromboses ou de décès que
le placebo (tableau II).
Un THS peut probablement être prescrit chez une femme
ménopausée sans lupus actif et sans antécédent thromboem-
bolique (SAPL). Le risque de poussée semble réduit, mais les
faibles effectifs de cette étude randomisée incitent à la pru-
dence. Nous attendons prochainement les résultats de l’étude
SELENA, qui devraient permettre de répondre formellement
à cette question.
Une protection ovarienne chez la femme traitée par
cyclophosphamide : les analogues de la LH-RH
Dans le lupus, mais également dans d’autres affections systé-
miques, le cyclophosphamide (Endoxan®) est responsable
d’aménorrhée et de stérilité définitive. Ce risque augmente
avec la dose de cyclophosphamide (en particulier au-delà de
20 g dose totale) et avec l’âge des patientes. Néanmoins, quels
que soient l’âge et la dose, le risque existe. Pour le réduire, il
est possible d’envisager un blocage de l’axe hypophyso-ova-
rien pour obtenir une “mise au repos” des ovaires pendant la
* 115 non ménopausées ; ** 126 non ménopausées
n = 205* (Canada) n = 242** (Grande-Bretagne)
Normal (T ≥ -1) 68 (33,2 %) 119 (49 %)
Ostéopénie (-2,5 < T ≤ -1) 100 (48,8 %) 98 (41 %)
Ostéoporose (T ″-2,5) 37 (18 %) 22 (10 %)
Tableau I. Prévalence de l’ostéopénie et de l’ostéoporose au cours du
lupus.
NS : non significatif
Analyse à 2 ans n = 37
THS Placebo
n = 38
Poussées (SLEDAI + 3) 80 82 NS
Poussées sévères (SLEDAI + 12) 4 7 NS
Thromboses 3 1 NS
Décès 2 4 NS
Tableau II. Tolérance du THS au cours du lupus : étude prospective
randomisée THS (estrogènes équins + médroxyprogestérone) versus
placebo.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%