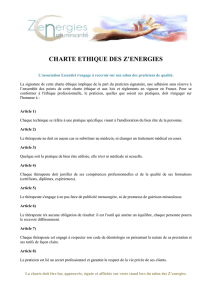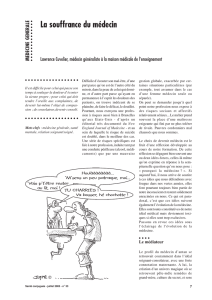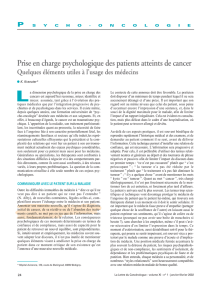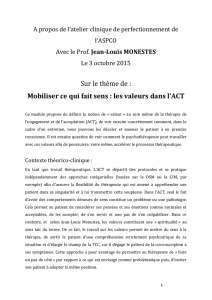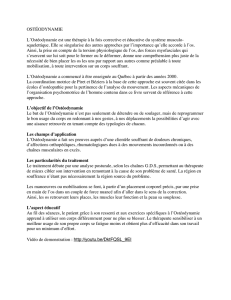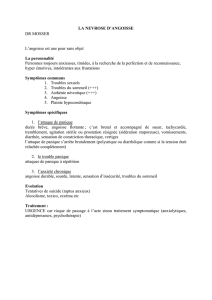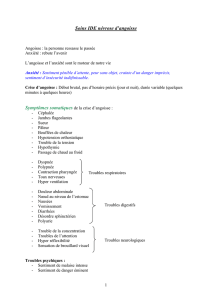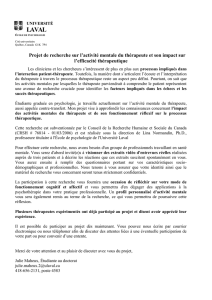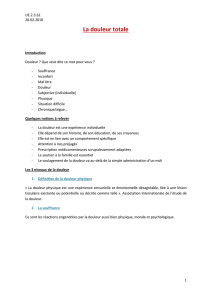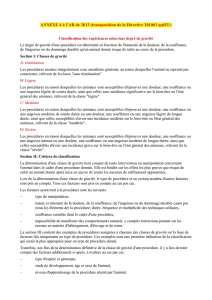Relation médecin-malade : comment trouver la bonne distance ? V

VIE PROFESSIONNELLE
La Lettre du Cardiologue - n° 386 - juin 2005
42
D
ès que deux personnes se trouvent en présence
l’une de l’autre, une communication s’instaure,
même dans le silence. “Nous ne pouvons pas ne
pas communiquer”, disait Watzlawick. Les mots, mais plus
encore les attitudes, les gestes, les regards, le ton et les inflexions
de la voix disent quelque chose de nous et de notre façon d’être
présent à l’autre, à notre insu le plus souvent. Le point essentiel
de la relation thérapeutique ne consiste pas à affirmer : “Il faut
communiquer avec le malade”, mais de savoir comment com-
muniquer avec lui, dans quels buts et jusqu’où, ce qui revient à
s’interroger sur la “bonne” distance à trouver avec le patient.
Il existe une distance sociale, amicale, amoureuse. Il existe aussi
une distance thérapeutique. Elle dépend de la personnalité du
médecin et de celle du patient, du contexte pathologique, des évé-
nements de vie que traverse chacun. Cette bonne distance fait
partie intégrante de la relation de soins. Elle peut s’avérer très
difficile à instaurer, et plus encore à maintenir ou à adapter. C’est
au praticien qu’il appartient d’en garder la maîtrise, autant qu’il
est possible, en s’appuyant sur le cadre de la consultation et de
ses règles et sur son aptitude personnelle à entendre la demande
du patient, à y répondre, tout en se préservant lui-même d’une
relation trop envahissante.
La bonne distance médecin-malade impose de se sentir proches
l’un de l’autre, mais pas trop. Elle doit permettre un climat de
confiance qui autorise le malade à s’exprimer librement tout en
respectant un écart qui évite les projections massives de l’un et
de l’autre. La relation entre le praticien et le malade doit main-
tenir chacun à sa place, dans ce rapport fondamentalement asy-
métrique entre une personne en souffrance et une autre supposée
détenir à la fois le savoir et le pouvoir de soulager et de guérir.
La relation thérapeutique conduit le médecin à se positionner par
rapport au malade, mais aussi par rapport à lui-même en fonc-
tion de ses ressources et de ses limites personnelles. La bonne
distance, celle qui permet à la relation de jouer pleinement son
Relation médecin-malade :
comment trouver la bonne distance ?
I. Moley-Massol*
D’après une interview du Dr Joëlle Jansé-Marec, chef du service de gynéco-obstétrique à l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret.
rôle thérapeutique, reste celle où chacun accepte de recevoir de
l’autre, de la place où il est attendu. Le malade peut alors se sen-
tir reconnu dans sa souffrance, entendu dans ses attentes, main-
tenu par et dans une relation de confiance. Le médecin peut s’en
trouver enrichi, sans se sentir menacé dans son être et son inti-
mité psychique et affective.
LA BONNE DISTANCE
PAR RAPPORT AU MALADE
La tentation est grande de confondre communication, qualité rela-
tionnelle et relation sur le mode amical. Cette dernière ne résout
rien dans le cadre thérapeutique, bien au contraire. Elle ne répond
pas aux exigences d’une relation médicale adaptée aux besoins
du patient et peut entraîner des effets pervers. Le malade n’at-
tend pas de son médecin qu’il devienne un ami, uni à lui par un
échange symétrique et équilibré dans lequel chacun donne et
reçoit de l’autre à part égale.
La relation thérapeutique n’a rien à voir non plus avec l’apitoie-
ment, l’identification massive, la compassion (définie comme une
souffrance partagée). Le malade ne veut pas voir son médecin
souffrir avec lui, ce qui ne manquerait pas de majorer son angoisse,
son insécurité et sa douleur. L’empathie, présentée comme la qua-
lité essentielle du thérapeute dans la relation médicale, se définit
comme l’aptitude à entendre et à reconnaître la souffrance et les
difficultés du malade. Elle n’est pas de la compassion. L’identifi-
cation du médecin au malade comporte également un risque
important pour la relation médecin-malade, dans la mesure où elle
lui fait quitter sa place de thérapeute pour prendre celle du patient.
La plupart des patients n’apprécient guère que le médecin fasse
référence à sa propre histoire : “Moi aussi, j’ai connu cela quand
j’ai dû me faire opérer…” Ils veulent préserver une image rassu-
rante de leur médecin et, à ce titre, n’ont aucune envie d’imagi-
ner celui-ci malade, fragile, identique à eux-mêmes.
Les patients ne souhaitent pas pénétrer la vie intime du médecin.
Ils ont besoin qu’une distance relationnelle et affective soit pré-
servée, maintenue. C’est elle qui permet la position réconfortante
du thérapeute à laquelle le malade peut s’ancrer.
* Médecin psychothérapeute, praticienne attachée à l’hôpital Cochin à Paris.
Elle est l’auteur de L’annonce de la maladie. Une parole qui engage
aux Editions DaTeBe (2004). [email protected]
@ La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 2 - mai-juin 20005.

La Lettre du Cardiologue - n° 386 - juin 2005
43
VIE PROFESSIONNELLE
Le médecin peut toutefois avoir recours à des références per-
sonnelles, d’ordre général, qui montrent au patient toute la valeur
qui lui est accordée : “C’est le traitement que je préconiserais
pour ma fille ou une personne de ma famille…” Le médecin
montre ainsi la qualité de son implication, tout en maintenant une
distance acceptable avec le malade. Il exprime une position réflé-
chie, adaptée au patient, et non plaquée comme une simple appli-
cation théorique et impersonnelle d’un savoir universitaire.
La propension du médecin à adopter une attitude “paternaliste”
ou “maternante” le pousse souvent à rassurer à tout prix le malade,
ce qui pourrait être louable en soit mais ne devrait pas occulter
pour autant la nécessité pour le malade d’exprimer son angoisse,
ses doutes, ses interrogations. Les mots du thérapeute qui cou-
pent court à la plainte du malade ne constituent qu’une fausse
réassurance, dans la mesure où ils empêchent le malade de se
libérer de ses peurs et permettent surtout au médecin de se sous-
traire à l’angoisse du malade, qui lui est alors insupportable. Le
médecin doit pouvoir entendre l’angoisse et la peur, sans la juger,
sans interrompre le flot des mots libérateurs ; il doit pouvoir accu-
ser réception des douleurs du patient et y répondre dans un dia-
logue authentique et sincère.
LA BONNE DISTANCE
PAR RAPPORT À SOI-MÊME
Le temps et l’expérience permettent souvent au médecin de mieux
percevoir ses limites propres, celles au-delà desquelles il se sent
menacé soit par l’angoisse du patient, qui le “contamine”, soit
dans son propre psychisme. Il y a des limites à ne pas dépasser,
car elles renvoient trop massivement à son histoire personnelle.
C’est au nom de ce principe qu’il paraît déraisonnable de prendre
en charge médicalement sa famille ou ses amis.
Choisir de devenir médecin, n’est-ce pas une façon de mettre en
scène ses propres peurs, ses propres angoisses, ses propres inter-
rogations fondamentales sur la mort, la vie, la sexualité ? N’est-
ce pas une façon de jouer sa propre corrida ?
On s’engage dans la médecine pour comprendre le corps humain,
guérir, repousser les limites de la mort. Rapidement, on se
confronte à ses limites techniques et humaines. Il faut peu à peu
transformer son désir de guérir l’autre à tout prix (de conjurer la
mort ?) en exigence de soins pour le malade, en mettant en œuvre
tous les moyens dont on dispose, mais sans illusion sur sa toute
puissance. La guérison est un objectif possible, mais pas absolu.
Cette difficulté du médecin à reconnaître ses propres limites face à
la maladie est en partie responsable de sa souffrance et de son
angoisse lorsqu’il doit annoncer un diagnostic de maladie grave, et
plus généralement toute mauvaise nouvelle médicale. Le médecin
peut alors être confronté à l’agressivité des patients ou de leur famille
et, dans ce cas encore, il n’est pas préparé à cette épreuve, souvent
ressentie comme une terrible injustice, un désaveu massif, une mise
en cause globale de ses capacités médicales et humaines. Il reçoit
avec violence les propos accusateurs du patient : “Tout cela aurait
pu être évité si vous aviez fait correctement votre travail…”
Il faut beaucoup de temps au médecin pour comprendre que la
colère exprimée par le malade en souffrance a le plus souvent un
autre objet que lui-même, mais qu’à cet instant, c’est lui, le méde-
cin, qui doit être pris pour cible, non pas dans sa personne réelle,
mais dans ce que sa figure d’autorité représente symboliquement
pour le malade.
Comment, pour le médecin, trouver la bonne distance pour ne
pas se sentir menacé par les griefs du patient, les accusations,
comment relativiser, recadrer, sans pour autant tout accepter sans
limites, au risque de se faire déborder et d’en subir des consé-
quences morales et psychiques parfois graves ?
Comment, pour le médecin, poser le cadre qui définit à la fois ce
qui pour lui est acceptable et ce qui sert l’intérêt du malade ?
Comment éviter le burn out, la démotivation, la désespérance
parfois ?
Le chirurgien et l’obstétricien occupent une place particulière
dans la relation médicale, souvent très investie par les patients et
parfois par leurs proches. Leur fonction les dote d’un pouvoir
considérable : ils enlèvent le “mal”, mais aussi “coupent”, “sépa-
rent”, “castrent”, “donnent la vie” et “touchent” à la sexualité de
l’être. Ils pénètrent le territoire de l’intime du sujet d’une façon
incomparable, dans ses aspects physiques, psychiques et sexuels.
C’est dire l’intensité des affects en jeu dans la relation qui lie le
patient, la patiente, au médecin chirurgien ou obstétricien, avec
son cortège de projections, de transferts et de sentiments ambi-
valents ! Il est important que le médecin réalise qu’il ne peut être
présent à toutes les places et qu’il doit parfois “passer la main”,
quand une difficulté psychologique survient, par exemple. Il ne
peut être à la fois celui qui coupe, qui agit sur le corps, dans l’in-
timité du corps, et celui qui répare les blessures infligées au psy-
chisme du malade par cet acte castrateur.
Cela ne signifie pas pour autant que la communication entre un
chirurgien et son patient est impossible, bien au contraire, mais
elle présente des limites, une approche, des expressions particu-
lières, liées à la nature même de l’acte.
LA BONNE DISTANCE PAR RAPPORT
AUX ACTES ET AUX PERFORMANCES
Il existe enfin un type de rapport rarement évoqué et pourtant
d’une grande importance, celui qu’entretient le médecin, et plus
précisément le chirurgien, avec le geste médical. L’expérience
fait apparaître une fois encore la nécessité d’une réflexion autour
de la prévention, afin d’éviter autant que possible d’agir dans
l’urgence. Le geste devient plus modéré au fil du temps, et l’on
ne recherche plus l’exploit de l’acte comme dans les premiers
temps de la pratique médicale, où la réalisation d’interventions
délicates procurait un plaisir extrême. Avec l’expérience, la
“sagesse” du thérapeute l’amène à penser autrement le geste, à
l’évaluer, à anticiper, à faire appel aussi aux confrères au moindre
doute, à se mutualiser dans le partage des savoirs.
Pour les plus jeunes médecins, il est difficile de réaliser que l’on
ne peut être infaillible, qu’il n’existe pas de certitude et que tout
n’est pas prévisible. Plus tard, le praticien expérimenté perçoit
autrement tous les dangers possibles, les limites du geste et ses
risques, et ses propres limites. Il relativise, et la prudence prend
le pas.
La question de la place de chacun et de la bonne distance à trou-
ver entre le médecin, le patient et la maladie est essentielle en

VIE PROFESSIONNELLE
médecine. Aucun praticien ne peut faire l’économie de cette
réflexion, tout en sachant qu’aucune place, qu’aucune distance
n’est immuable ; toutes deux varient en fonction du temps, des
circonstances, des personnalités en présence, des pathologies,
des événements de vie que chacun traverse.
Mais, en posant cette question fondamentale du besoin du patient,
des ressources et des limites du médecin et du cadre de la relation
thérapeutique, le médecin se donne les moyens de mieux se déployer
dans toute son efficience médicale, en s’autorisant dans le même
temps à reconnaître ses limites, sans culpabilité ni sentiment de
dévalorisation, et à se faire aider dans sa pratique par ses pairs quand
cela est nécessaire, dans l’intérêt du malade et le sien propre. O
Valsartan bandeau, p. 44
1
/
3
100%