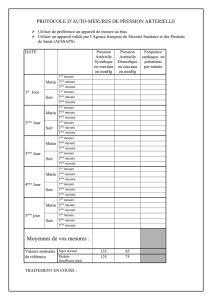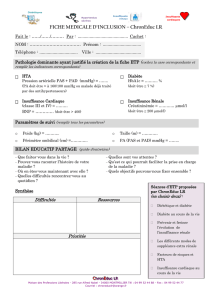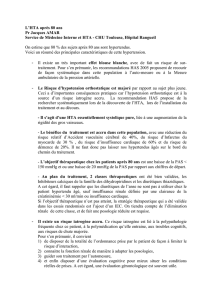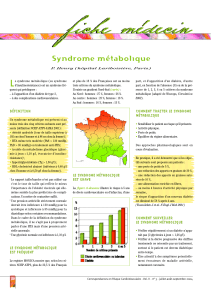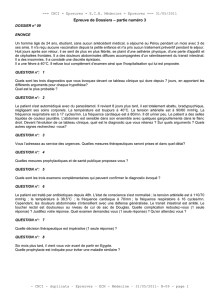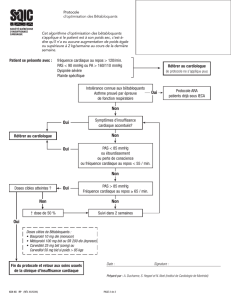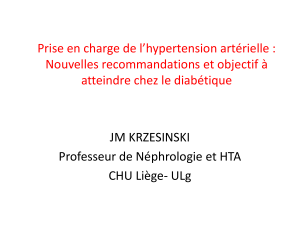L’ Dénervation rénale par radiofréquence dans l’HTA résistante

12 | La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011
CoNgRèS
RÉUNIoN
ESH 2011
17-20 juin 2011
Milan
Dénervation rénale
par radiofréquence
dans l’HTA résistante
(d’après les communications de M.P. Schlaich, M.D. Esler, F. Mahfoud, C. Ott,
C. Ukena)
M. Azizi*
* Unité d’hypertension artérielle et
Inserm CIC9201, hôpital européen
Georges-Pompidou et université
Paris-Descartes, Paris.
L’
hypertension artérielle (HTA) est l’un des
principaux facteurs de risque cardiovasculaire
(CV). C’est un facteur de risque fréquent : plus
du quart de la population adulte de plus de 20 ans
est hypertendue. Malgré les recommandations
concernant la prise en charge de l’HTA, le contrôle
chez les hypertendus traités reste très insuffisant.
Dans les pays occidentaux, ce dernier, défini par
une pression artérielle (PA) cible inférieure à 140 et
90 mmHg chez les patients traités, est compris entre
31 et 66 %. Cette proportion ne tient pas compte du
score de traitements (nombre de traitements anti-
hypertenseurs pris) ni de leur nature. L’HTA résistante
(HTAR) est définie dans les recommandations 2007
de l’ESH par une pression artérielle clinique supé-
rieure ou égale à 140 et/ou 90 mmHg (supérieure
ou égale à 130 et/ou 80 mmHg chez le diabétique
ou l’insuffisant rénal) chez un patient traité par
une trithérapie antihypertensive comprenant un
diurétique. Sa prévalence représenterait entre 5 et
25 % du recrutement des centres spécialisés. Les
patients ayant une HTAR sont à haut risque CV. Les
recommandations de l’ESH préconisent la prise en
charge par un centre spécialisé, un renforcement de
l’intensité des traitements (notamment diurétiques,
ainsi que l’ajout d’un antagoniste des récepteurs
minéralocorticoïdes comme la spironolactone et
celui d’antihypertenseurs centraux, etc.), l’utilisa-
tion des combinaisons d’antihypertenseurs en un
seul comprimé et un suivi renforcé, en particulier
par l’automesure tensionnelle (AMT). De nouvelles
options thérapeutiques médicamenteuses ou non
médicamenteuses sont recherchées pour les HTAR.
On voit ainsi apparaître, pour les cas d’HTAR les plus
sévères, des traitements fondés sur la stimulation
baroréflexe ou la dénervation rénale (DR). L’effica-
cité en prévention et la sécurité à long terme de ces
techniques restent encore à démontrer.
Le développement d’un cathéter spécifique, dans
le but de permettre une ablation des fibres sympa-
thiques rénales afférentes et efférentes par un
courant de radiofréquence (RF) de faible intensité
après un cathétérisme artériel sélectif de chacune
des artères rénales, a relancé la DR, approche théra-
peutique réalisée par voie chirurgicale de 1950 à
1970, puis abandonnée en raison de son taux élevé
de complications et de l’avènement des médica-
ments antihypertenseurs. Le courant de RF est
délivré consécutivement dans les 2 artères rénales
par une électrode de dispersion située à l’extrémité
d’un cathéter spécifique à usage unique, introduit par
voie transfémorale. Testée dans une étude de faisa-
bilité non contrôlée chez des hypertendus résistants
à une trithérapie antihypertensive, la DR a entraîné
une baisse importante de la PA clinique, avec un
risque faible de complications locales au point de
ponction artériel et une dissection artérielle rénale
traitée par endoprothèse.
L’efficacité antihypertensive et la sécurité de la DR
ont été évaluées dans un essai international multi-
centrique contrôlé, randomisé, ouvert (Symplicity
HTN-2). Les patients ayant une HTAR avec une PA
systolique (PAS) supérieure ou égale à 160 mmHg
malgré une trithérapie antihypertensive, un débit de
filtration glomérulaire estimé à plus de 45 ml/ mn
et une anatomie artérielle rénale favorable (1 seule
artère rénale principale pour chacun des 2 reins de
diamètre supérieur à 4 mm et de longueur supérieure
à 20 mm) ont été sélectionnés, inclus, puis rando-
misés soit dans un bras DR, soit dans un bras trai-
tement médical seul non standardisé. Le traitement
médical devait être poursuivi à l’identique pendant
6 mois dans les 2 bras. Cent quatre-vingt-dix patients
ont été inclus dans l’étude, dont 106, soit 56 %,
randomisés dans les 2 bras de l’étude (52 patients
dans le groupe DR, dont 49 [94 %] évaluables à
6 mois, et 54 patients dans le groupe contrôle, dont
51 [94 %] évaluables à 6 mois). La baisse de PAS/
PAD clinique à 6 mois (critère d’évaluation primaire)
dans le groupe DR a été de 32 ± 23/12 ± 11 mmHg,
contre 1 ± 21/0 ± 10 mmHg dans le groupe contrôle.
À 6 mois, 34 % des patients du groupe DR ont

La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011 | 13
CoNgRèS
RÉUNIoN
affi ché une PAS inférieure à 140 mmHg avec un
traitement inchangé ou légèrement allégé, et 84 %
d’entre eux ont affi ché une baisse de PAS supérieure
à 10 mmHg, contre 35 % dans le groupe contrôle.
Les résultats de la mesure ambulatoire de la pression
artérielle et de l’AMT ne sont disponibles respecti-
vement que pour 45 patients (n = 20 patients du
groupe DR, n = 25 patients du groupe contrôle)
et 72 patients inclus (n = 32 patients du groupe
DR et n = 40 patients du groupe contrôle).
L’amplitude de la baisse de PA est nettement
moindre en AMT (DR : − 20 ± 17/− 12 ± 11 versus
contrôle : + 2 ± 13/0 ± 7 mmHg) et en MAPA
(DR : − 11 ± 15/− 7 ± 11 versus contrôle : −
3 ± 19/− 1 ± 12 mmHg) entre les 2 groupes de
patients. La différence de variation de PA en MAPA
entre les 2 groupes est de 8 mmHg en PA systo-
lique. Aucun événement indésirable grave en relation
avec la DR n’est survenu au cours des 6 mois de
l’essai. Quarante-trois des 49 patients ont eu une
imagerie artérielle rénale non invasive à 6 mois, qui
ne montrait pas d’anomalie anatomique secondaire
au geste de DR. Les complications rapportées sont
des complications locales, situées au point de ponc-
tion artériel fémoral. La fonction rénale est restée
stable 6 mois après la DR. Chez 153 patients de la
cohorte initiale traités en ouvert, 4 complications
artérielles (1 dissection artérielle rénale et 3 faux
anévrismes de l’artère fémorale) ont été obser-
vées. Deux patients de cette cohorte sont décédés
(1 infarctus du myocarde et 1 mort subite) au cours
du suivi. Ces décès n’ont pas été attribués à la procé-
dure de DR par un comité de suivi des événements
indésirables indépendant.
Compte tenu du faible nombre de patients ayant
eu la DR (n = 205 au total), on ne peut tirer aucune
conclusion fi able sur la fréquence réelle des compli-
cations attendues ou non attendues liées à la procé-
dure, en particulier celles inférieures à 5 %. À l'avenir,
le risque dépendra aussi de l’entraînement à la tech-
nique du radiologue/cardiologue interventionnel et
de la sélection rigoureuse des cas.
Le devenir tensionnel à long terme demeure mal
connu. L’expérience de la DR chirurgicale a montré
que la diminution de la pression artérielle pouvait
se maintenir dans le temps, mais l’extrapolation à
la DR par radiofréquence est discutable. En effet,
la conservation des rapports anatomiques rend
possible une réinnervation sympathique, phéno-
mène bien documenté après une transplantation
rénale. Cependant, un maintien de la réduction de
PA clinique a été rapporté dans un petit sous-groupe
de patients suivis à plus long terme : − 23 mmHg
pour la systolique et − 11 mmHg pour la diastolique
à 12 mois (64 patients), − 32/− 14 mmHg à 24 mois
(18 patients). Ces données, qui ne tiennent compte
ni du nombre ni des classes de traitements anti-
hypertenseurs utilisés, sont sujettes aux biais inhé-
rents aux mesures cliniques réalisées en ouvert. Chez
les 153 patients de la cohorte traités par dénervation
en ouvert, une PA basale plus élevée et l’utilisation
d’antihypertenseurs centraux étaient signifi cative-
ment associées à une meilleure réponse tensionnelle
clinique en analyse multivariée.
Enfi n, la réponse cardiorespiratoire à l’exercice est
aussi modifi ée après une DR. Trente-sept patients
ont eu une DR bilatérale et 9 ont été assimilés au
groupe contrôle. La réponse à l’exercice a été évaluée
avant et après 3 mois de suivi. Dans le groupe DR,
la PA au repos et la pression maximale à l’exercice
après 3 mois sont signifi cativement réduites de
respectivement 31/9 mmHg et de 22/5 mmHg. La
charge à l’effort a augmenté de 4 watts alors que la
VO2max restait inchangée (+ 0,2 l/mn/kg). La PA après
2 minutes d’exercice était réduite de 29/8 mmHg par
rapport à la valeur de base. La fréquence cardiaque
au repos diminuait après la DR, mais la fréquence
cardiaque maximale à l’effort et l’augmentation de
la fréquence cardiaque n’étaient pas différentes. En
revanche, la récupération était améliorée de 4 bpm
après la dénervation. Dans le groupe contrôle, il n’y
avait aucune variation signifi cative de l’ensemble des
paramètres (pression, fréquence, charge ou venti-
lation). La DR réduit la PA au repos, mais aussi à
l’effort, et permet une meilleure récupération sans
compromettre la compétence chronotrope chez
les patients ayant une hypertension résistante. La
fréquence cardiaque au repos et la récupération
sont améliorées après la procédure.
Effet de la DR sur l’activité
du système nerveux
sympathique, le système
rénine-angiotensine,
la perfusion rénale
et l’insulinorésistance
L’activité sympathique rénale a été quantifi ée par
mesure de la clairance tissulaire de la noradrénaline
au niveau rénal (évaluation du relargage tissulaire
de la noradrénaline, ou spillover, quantifi é par dilu-
tion isotopique) chez 10 patients de l’étude pilote.
Les résultats témoignent d’une diminution de
50 % de l’activité sympathique 15 à 30 jours après
la procédure. La DR module également l’activité
Annoncez
vous !
Contactez Valérie Glatin
au 01 46 67 62 77
ou faites parvenir
votre annonce par mail

14 | La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011
CoNgRèS
RÉUNIoN
sympathique globale de l’organisme. Cet effet est
probablement expliqué par la destruction des fibres
afférentes d’origine rénale, qui cessent de stimuler
les centres végétatifs. La mesure de l’activité sympa-
thique au niveau musculaire par microneurographie
du nerf sciatique poplité externe chez un unique
patient ayant une HTA résistante à une heptathé-
rapie a objectivé la diminution, puis une normalisa-
tion de celle-ci après 1 an de suivi. Une réduction de
la fraction rénale et totale du spillover de la nora-
drénaline et une normalisation progressive de l’acti-
vité sympathique musculaire au cours du temps ont
aussi été observées chez un patient en insuffisance
rénale terminale. Ces modifications étaient accom-
pagnées d’une baisse de la PA de 155/95 mmHg à
131/80 mmHg après 33 mois de suivi, malgré une
réduction du nombre de médicaments antihyper-
tenseurs (de 5 à 1).
Dans une étude pilote ayant inclus 8 patients qui
présentaient une hypertension résistante au trai-
tement et qui avaient bénéficié d’une DR, aucune
modification du débit plasmatique rénal n’a été
observée immédiatement et après 3 mois de suivi.
Il n’y avait pas non plus de modification de l’activité
rénine plasmatique ou de la concentration d’angio-
tensine II. En revanche, une réduction immédiate
et significative de la concentration d’aldostérone,
associée à une augmentation du rapport sodium/
potassium urinaire, a été constatée. Après 3 mois, ces
modifications n’étaient plus observées. L’excrétion
urinaire d’angiotensinogène, considérée comme un
paramètre d’activité rénale du système rénine-angio-
tensine, était très fortement réduite après 3 mois.
Enfin, des résultats très préliminaires laissent penser
que la DR peut avoir un effet bénéfique sur l’insu-
linorésistance.
Commentaires
Les résultats de l’étude Symplicity HTN-2 suggèrent
un très probable effet antihypertenseur de la DR
dans une population de patients ayant une HTAR
hautement sélectionnée pour l’essai. Toutefois,
compte tenu des limitations méthodologiques
(traitement médical non standardisé) et de la possi-
bilité non écartée de biais dans l’interprétation des
résultats (essai ouvert, critère clinique de réponse
tensionnelle), il est vraisemblable que, d'une part,
cet effet est plus modeste que celui rapporté, en
particulier en situation de “vie réelle”, et surtout,
d'autre part, que l’innocuité à court et à moyen
terme de la procédure et de la DR reste à évaluer
sur un plus grand nombre de patients. Enfin, une
limite inhérente à la technique est l’impossibilité
de conclure, sur des paramètres cliniques ou para-
cliniques, au succès technique primaire de la DR
au cours et au décours immédiat de la procédure
et à moyen terme. Considérant enfin qu’aucun
résultat de morbimortalité n’est disponible, les
études publiées à ce jour doivent encore être consi-
dérées comme préliminaires, en particulier dans
le cas d'un traitement invasif. Dans l’état actuel
des connaissances, et en dehors d’un contexte de
recherche clinique, il apparaît injustifié de proposer
la procédure de DR à un patient hypertendu sans
s’être préalablement assuré :
➤➤
de la vraie résistance à une trithérapie antihy-
pertensive synergique incluant un diurétique par
une AMT ou une MAPA ;
➤➤
de l’absence d’HTA secondaire après enquête
étiologique complète ;
➤➤
d’une réponse tensionnelle insuffisante après
addition de spironolactone, qui a montré un effet
du même ordre de grandeur que la DR dans l’HTA
résistante ;
➤➤ de la présence d’une anatomie artérielle rénale
favorable ;
➤➤ d’une consultation préanesthésique ;
➤➤
et, enfin, d’une consultation avec un cardiologue/
radiologue interventionnel ayant une solide expé-
rience dans le cathétérisme des artères rénales.
De nouveaux essais cliniques sont encore néces-
saires afin de situer la place de la DR dans l’arsenal
thérapeutique et d’en évaluer le rapport coût/
efficacité. ■
1
/
3
100%