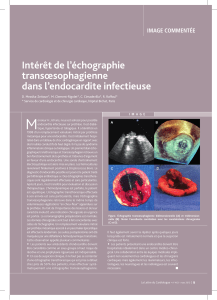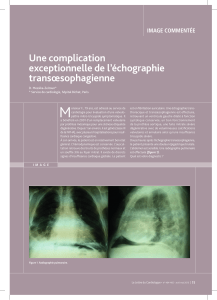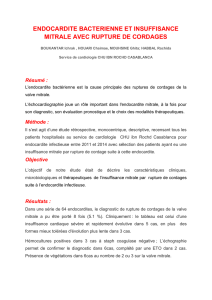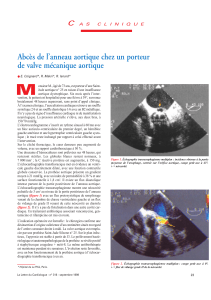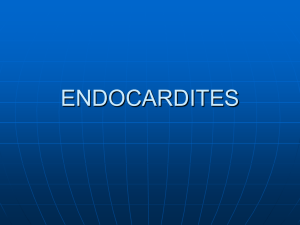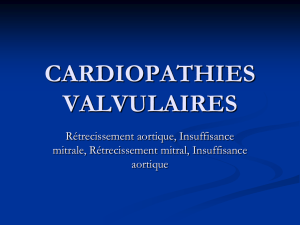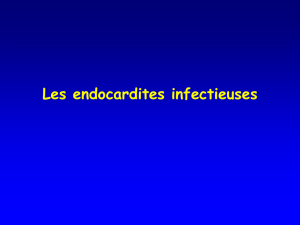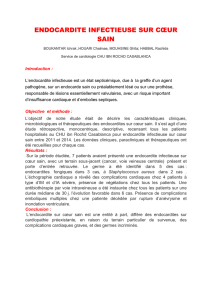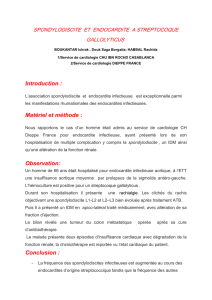Lire l'article complet

A
C
E
G
B
D
F
H
OG
OG
OG
OG
**
*
**
VG VG
VG
VD
OD
AO
La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012 | 27
Dans le respect total de l’indépendance scientifique et éditoriale.
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
Cette rubrique a été réalisée
avec le soutien institutionnel
dulaboratoire AstraZeneca
ale.ale.
Cette rubrique a été réalisée
Cette rubrique a été réalisée
Cette rubrique a été réalisée
Cette rubrique a été réalisée
avec le soutien institutionnel
avec le soutien institutionn
avec le soutien institutionne
avec le soutien institutionn
dulaboratoire AstraZeneca
oire Astra
toire Astra
toire Astra
Conception : Pr G. Steg
Coordination : Dr D. Messika-Zeitoun
Endocardite infectieuse
D. Messika-Zeitoun*
* Département de cardiologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris
Figure 1. Végétations.
A et B : végétation aortique sur valve native aortique (A) et mitrale
(B) en échographie transœsophagienne. Noter le caractère fi liforme
des végétations mitrales (patient hospitalisé pour une endocardite
fongique).
C et D : endocardite sur bioprothèse aortique (échographie trans-
œsophagienne en mode biplan).
E et F : endocardite sur bioprothèse mitrale en échographie
trans œsophagienne bidimensionnelle (E) et tridimensionnelle
(F). L’étoile indique l’anneau prothétique mitral.
G et H : endocardite sur sonde de pacemaker au niveau ventricu-
laire en échographie transthoracique (G) et au niveau auriculaire
en échographie transœsophagienne (H). L’étoile indique la sonde
de pacemaker.
Les végétations sont des masses mobiles pédiculées ou sessiles de
taille et de mobilité variables appendues à la face ventriculaire des
valves aortiques et à la face auriculaire des feuillets mitraux. Elles
constituent un élément déterminant du diagnostic positif d’endo-
cardite. Leur risque principal est l’embolie. Les principaux facteurs
de risque embolique sont la taille de la végétation (supérieure à
10 ou 15 mm) +++, la mobilité de la végétation +++, la période des
15 premiers jours de l’infection, un antécédent embolique, la localisation mitrale plus qu’aortique et le micro-organisme (staphylocoque,
Candida, etc.). Les diagnostics différentiels (parfois impossibles sur le plan échographique, le contexte est alors déterminant) sont
les thrombi, le prolapsus avec rupture de cordage pour la localisation mitrale, le fi broélastome et les endocardites non infectieuses
comme associées au lupus/syndrome des antiphospholipides ou marastiques.
L’endocardite infectieuse est une pathologie relativement
rare (1 000 à 1 500 cas en France) qui reste grevée
d’une lourde mortalité (20 à 30 % à 30 jours),
malgré l’amélioration des méthodes diagnostiques
et de la prise en charge médicale et chirurgicale.
L’échographie est la méthode de référence. Une
échographie transœsophagienne doit être effectuée
au moindre doute et répétée quelques jours plus
tard si la suspicion clinique est forte. L’échographie
guide la prise en charge thérapeutique et constitue
un examen clé dans la surveillance des patients.
Dans cet article, nous présentons les différentes
lésions cardiaques et neurologiques (1).

28 | La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
Endocardite infectieuse
Figure 2. Abcès.
A : délabrements majeurs autour d’une bioprothèse aortique
(étoile) avec multiples logettes en communication avec
l’aorte (échographie transœsophagienne coupe petit axe).
B et C : endocardite après une intervention de Bentall (la
cavité aortique est indiquée par l’étoile). Noter l’existence
d’une collection quasi circulaire autour du tube qui, lors de
la réintervention, s’est révélé être du pus.
Les abcès correspondent à des néocavités d’origine infec-
tieuse en communication ou non avec la circulation sanguine.
Ils sont le plus souvent observés au niveau aortique et
constituent une indication chirurgicale en urgence.
Figure 3.
Perforations.
A : patient hospi-
talisé pour une
septicémie à bacilles
à Gram négatif
d’origine digestive.
Perforation de la
petite valve mitrale
dans la région de la
commissure externe.
Noter l’épaissis-
sement des feuillets
et le fl ux de couleur
traversant la zone
infectée. À droite,
la perforation est
clairement visible
en échographie
transœsophagienne
tridimensionnelle
(vue chirurgicale :
l’aorte est en haut,
la commissure
externe, à gauche, la
commissure interne,
à droite).
B : volumineuse masse bourgeonnante dans la région interne de la valve également perforée, en échographie transœsophagienne
bidimensionnelle et tridimensionnelle. Les régurgitations de localisation commissurale doivent systématiquement évoquer une
origine infectieuse.
A
**
B
**
C
**
A
OG
VG
B
OG
VG

La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012 | 29
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
UNE PATHOLOGIE
EN IMAGES
Figure 4. Anévrismes.
Endocardite aortique compliquée d’une
lésion de jet sur la valve mitrale avec faux
anévrisme, lui-même perforé. La fl èche
indique les végétations aortiques avec
une fuite associée importante par perfo-
ration et un prolapsus de la sigmoïde
antérodroite. Le jet est dirigé vers la
grande valve mitrale également secon-
dairement infectée avec constitution d’un
faux anévrisme (étoile). Cet anévrisme,
lui-même perforé, est à l’origine d’une
régurgitation mitrale importante.
Figure 5. Désinsertion.
Prothèse aortique
mécanique désinsérée
avec mouvement de
bascule. Noter en A la
prothèse en position
normale et en B, sa
bascule dans l’aorte
en systole (échographie
transœsophagienne
incidence grand axe
à 120°).
Figure 6. Complications neurologiques.
A : IRM ; séquence T2* ; microsaignements
(fl èches noires).
B et C : ARM coupes axiales et sagittales
suggérant la présence d’un anévrisme
mycotique au niveau du microsaignement
frontal gauche (fl èches blanches).
D : confi rmation à l’artériographie de l’ané-
vrisme mycotique (d’après I. Klein, B. Iung,
M. Wolff et al. Silent T2* cerebral microbleeds:
a potential new imaging clue in infective
endocarditis. Neurology 2007;68:2043).
Les complications neurologiques font partie
des complications les plus redoutables de
l’endocardite infectieuse. Elles peuvent être
de type et de sévérité variables : embolie
(AVC ischémique), hémorragie intrapara-
chymenteuse ou méningée, faux
anévrisme mycosique, etc.
Référence
bibliographique
1. Habib G, Hoen B, Tornos P et al.
Guidelines on the prevention, diagnosis,
and treatment of infective endocarditis (new
version 2009): the Task Force on the Prevention,
Diagnosis, and Treatment of Infective Endocarditis of
the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J
2009;30:2369-413.
A
C
B
D
OG
VG
Ao
*
A B
OG
Ao
VG
1
/
3
100%