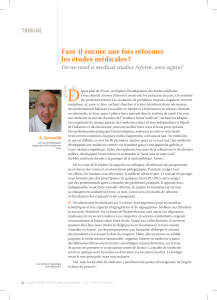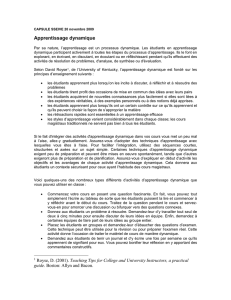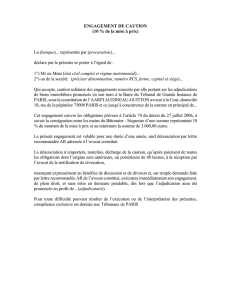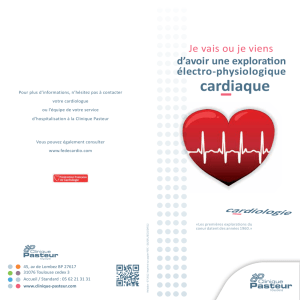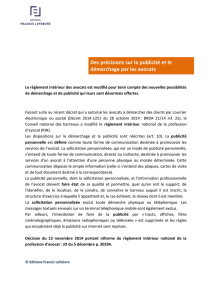D Faut-il encore une fois réformer les études médicales ?

4 | La Lettre du Cardiologue • n° 474 - avril 2014
ÉDITORIAL
Depuis plus de 20ans, on déplore l’inadéquation des études médicales
àleurobjectif : former d’abord et avant tout les praticiens du pays. On souhaite
des praticiens formés à la résolution de problèmes toujours singuliers, souvent
complexes, et, pour ce faire, sachant chercher et traiter les informations nécessaires,
desprofessionnels habitués à travailler en équipe et à fonctionner en réseaux (formels
ouinformels), et donc aptes à piloter leurs patients dans le système de santé. On veut
des médecins au fait des données de l’“evidence-based medicine”, sachant les adapter
àlasingularité de chaque patient, des médecins jaloux de leur indépendance à l’égard
del’industrie et des financeurs, pouvant justifier leurs actes et leurs prescriptions.
Desprofessionnels pratiquant l’autoévaluation, analysant les échecs rencontrés
etleserreurs commises, toujours avides d’apprendre, convaincus que, “en médecine,
cequi est difficile, ce sont les 80premières années, après ça va tout seul”, des médecins
développant unemédecine centrée sur le patient grâce à une approche globale et
àunerelation empathique. Enfin, des médecins soucieux de la collectivité et des deniers
publics, développant la prévention et pratiquant le “juste soin au juste coût”,
brefdesmédecins formés à la pratique de la santé publique. Amen !
On ne cesse de le répéter de rapports en colloques, de réformes des programmes
enrévisions des cursus et en rénovations pédagogiques. Pourtant, malgré tous
cesefforts, les résultats sont décevants : le meilleur côtoie le pire. Le constat est partagé :
nous formons plus des prescripteurs (et quelques futurs PU-PH à notre image)
quedesprofessionnels aptes à résoudre desproblèmes pratiques. Il apparaît donc
indispensable, avant toute nouvelle réforme, de repérer et d’analyser les verrous
auchangement souhaité par tous : ce sont, à mon sens, lesmodes de sélection
etd’évaluation des étudiants et des enseignants.
➤On sélectionne les étudiants sur 2 critères : leur appétence pour les matières
scientifiques et leur capacité d’ingurgitation et de régurgitation. Malheur aux littéraires
et aux lents ! Résultats : les victimes de l’hypersélection sont sujets à la dépression, tandis
que les reçus ont tendance à se comporter en anciens combattants, exigeant
reconnaissance et faisant valoir leurs droits. Quant aux collés fortunés, ils peuvent
toujours aller faire leurs études en Belgique ou en Roumanie et revenir ensuite s’installer
en France. Les doyens proposent, par humanité, d’abréger le calvaire despostulants en
avançant la date du couperet. Hélas, plus personne ne semble proposer la vieille solution
raisonnable : organiser l’entrée en médecine à partir desdifférentes filières universitaires,
scientifiques comme littéraires, sur la base dequotas en première et en deuxième année
de licence. La faculté de médecine serait enquelque sorte branchée en dérivation sur les
autres facultés. La biologie serait la voie principale, mais non exclusive.
Oui, mais les facultés de médecine y perdraient des postes d’enseignants, de l’argent
et donc du pouvoir !
➤Les étudiants, de façon pragmatique, apprennent comme on les interroge.
On les interroge par QCM, ils apprennent les réponses, comme au jeu des 1 000euros.
On les évalue par des mots-clés, ils en apprennent les listes. Peut-être faudrait-il
lesévaluer comme on souhaite qu’ils exercent leur futur métier. L’informatique permet
A. Grimaldi
Service de diabétologie,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris.
Faut-il encore une fois réformer
lesétudes médicales ?
Do we need a medical studies reform, once again?

La Lettre du Cardiologue • n° 474 - avril 2014 | 5
ÉDITORIAL
déjà, depuis uncertain temps, de remplacer les vrais patients par des cas virtuels, dont
ledéroulé progressif de l’histoire clinique permet d’évaluer à chaque étape la capacité
desétudiants àréaliser unraisonnement hypothético-déductif et à justifier des prescriptions
sur la base d’une analyse décisionnelle. De même, des enregistrements vidéo portant sur le
vécu despatients et en particulier sur la relation médecin-malade pourraient être soumis
àl’analyse des candidats. Ainsi, les stages dans les services cliniques retrouveraient
leurirremplaçable valeur de formation. Encore faudrait-il que les externes n’y soient plus
desimples “touristes” mais y soient immergés à plein temps, qu’ils voient les patients
enpremier et non après tout le monde, et qu’ils bénéficient du compagnonnage
deleursaînés. Quitte à ce que les stages hospitaliers soient plus courts durant 2mois,
alternant avec l’enseignement facultaire. Ce dernier gagnerait à être revu à l’aune
desnouvelles techniques decommunication. Tout cours prétendument magistral mais
serésumant enfait à la lecture commentée de diapositives devrait être remplacé
parsonenregistrement vidéo. C’est fait ou ça va l’être. L’examen national classant aurait
parailleurs intérêt à devenir régional, avecpossibilité, pour les étudiants, de présenter
plusieurs examens régionaux, encontrepartie d’un engagement à exercer pour une période
donnée dans la région qu’ilsauraient choisie pour effectuer leur internat.
➤Reste la clé de la réforme des études de médecine : la réforme des enseignants.
L’enseignement est aujourd’hui “la dernière roue du carrosse”, le dernier critère sur lequel
onrecrute les enseignants. Ni la quantité, ni la qualité de l’enseignement, ni les innovations,
ni les publications pédagogiques, ni l’avis des étudiants ne sont réellement pris en compte.
C’est la conséquence des modalités de recrutement des PU-PH, qui sont censés, depuis1958,
exercer personnellement une triple mission, devenue depuis quintuple
(soin, recherche, enseignement, gestion et santé publique), et en réalité recrutés
essentiellement, voire exclusivement, sur les publications de recherche. Il faudrait revenir
àunstatut unique de PH, avec des valences variables d’enseignement, de recherche,
degestion, pouvant fluctuer au fil des années mais traduisant la réalité de l’activité
dechacun. On peut difficilement faire bien plus de 2activités. Un grand chercheur
(publicateur) n’est pas forcément un grand clinicien ou un bon enseignant, ou un bon chef
de service. Lapolyvalence doit être celle de l’équipe.
Utopie ? Usine à gaz ? Peut-être… Mais pendant combien de temps encore peut-on
continuer à faire semblant ? On entend déjà dire qu’on n’apprend pas le métier de médecin
dans les CHU…
L’auteur n’a pas précisé
seséventuels liens d’intérêts.
…ET TOUJOURS SUR EDIMARK.TV
Le regard de l’avocat
Accédez à la rubrique “Le regard de l’avocat”,
afin de tout comprendre de l’actualité du droit médical.
Me Gilles Devers
(avocat à Lyon)
nous livre en vidéo son analyse
sur “l’affaire Vincent Lambert”.
Scannez ce fl ashcode
pour voir la vidéo
www.edimark.tv
“L’affaire Vincent Lambert” sur le vif !
14:28
© La Lettre du Neurologue 2014;
18(2):44-5.
1
/
2
100%