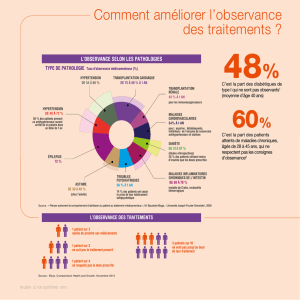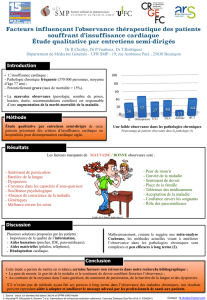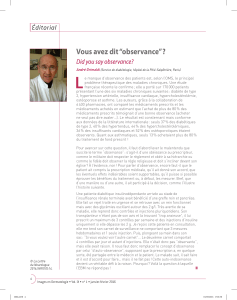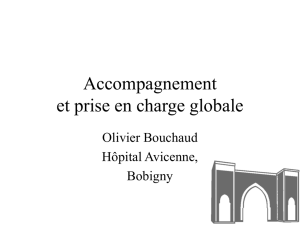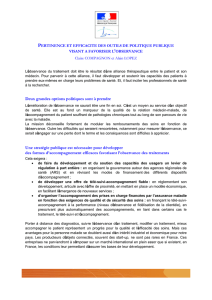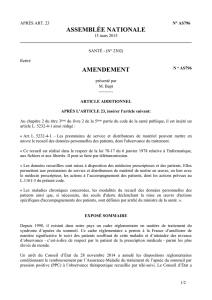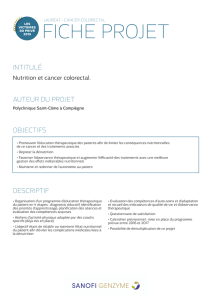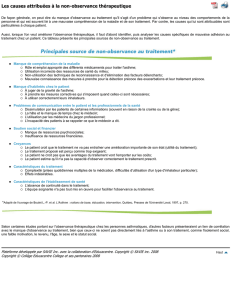Bibliographie C Le Courrier de l’Observance thérapeutique Revue de presse - Multimédia

Revue de presse - Multimédia
Le Courrier de l’Observance thérapeutique
15
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Bibliographie
Cette rubrique bibliographique sur l’observance et l’adhésion aux traitements médicamenteux
est destinée à présenter les publications et documents de toutes sortes,
quels que soient les supports (écrits, audiovisuels, télématiques), récents ou non,
témoignant de réflexions et d’expériences d’équipes médicales, soignantes, psychologues, sociologues, etc.
Les productions sont, dans ce large contexte, innombrables ;
nos choix sont donc sujets à discussion, voire à contestation : pourquoi pas ?
Nous sommes soucieux de présenter l’intérêt et le message du travail publié,
sa fiabilité (auteurs, équipes, références, méthodologie),
son adaptation au lecteur professionnel quelle que soit sa formation de base, en termes de ton, de justesse,
de synthèse, son utilité et ses applications pratiques potentielles.
Si le lecteur trouve des documents méritant une mention dans cette rubrique,
ou désire commenter certains aspects,
il peut envoyer ses remarques par e-mail à Agnès Certain :
Pour consulter les textes cités, il vous suffit également de vous adresser à A. Certain.
Bonnes lectures !
●A. Certain*
Assal JP.
Traitement
des maladies
de longue durée :
de la phase aiguë
au stade
de la chronicité.
Encycl Med Chir
(Elsevier, Paris)
Thérapeutique,
1996 ;
25-005-A-10,
18 pages,
38 références.
Cet article de l’Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC)
présente les fondements de la prise en charge des mala-
dies de longue durée. Écrit avant l’expression des diffi-
cultés d’observance des personnes infectées par le VIH
en traitement, il est d’autant plus intéressant ; en effet,
il fait le point sur l’expérience et les connaissances
acquises dans les maladies chroniques “classiques” (dia-
bète, asthme, etc.), sur les problématiques et les orienta-
tions à développer, les réformes à initier.
D’ailleurs, l’auteur introduit son sujet par ce biais : il
évoque la crise d’identité des médecins en Europe, dont
la formation initiale actuelle est particulièrement inadap-
tée à leur exercice dans un milieu libéral – où la grande
majorité des patients vient consulter dans la durée – dans
le cadre d’affections chroniques métaboliques, neurolo-
giques, rhumatologiques ou pulmonaires par exemple. Il
fait une synthèse remarquable des différences essen-
tielles entre les affections aiguës et chroniques, en
termes de caractéristiques des pathologies, des traite-
ments et des conséquences qui en découlent pour la per-
sonne atteinte et pour le médecin. Les tableaux récapitu-
latifs éclairent le lecteur néophyte.
L’auteur illustre tout d’abord son propos par l’évolution
de la prise en charge du diabète, de 1921 à nos jours ; il
cite, notamment, Miller, qui, en 1972, démontre pour la
première fois par une étude épidémiologique cas-témoins
le bénéfice clinique obtenu par ce que J.P. Assal appelle
“une approche biopsychosociale et pédagogique” des per-
sonnes diabétiques en traitement insulinique.
Ainsi, le modèle de médecine aiguë, bien qu’efficace
dans un contexte hospitalier, est inopérant dans le cadre
d’une prise en charge de malades de longue durée. De
telles personnes, face à des traitements chroniques,
passent par un certain nombre de phases psychologiques,
similaires à celles consécutives à l’annonce d’un
* Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris.
❶LES FONDATIONS

diagnostic létal : dénégation, révolte, marchandage et
réflexion. L’instauration de traitements médicamenteux
par le médecin doit respecter ces processus, ainsi que les
représentations et le vécu affectif et social de son affec-
tion par le patient, sous peine d’échecs successifs.
L’auteur développe ensuite largement les raisons et l’ur-
gence de former les médecins et les soignants pour une
prise en charge bénéfique des personnes affectées de
pathologies de longue durée. Médecin et pédagogue, il
expose différentes méthodes disponibles pour ses col-
lègues et les autres professionnels soignants (pharma-
ciens, infirmiers, autres) face à leurs malades.
D
evant un tel texte, aux références incontestables, si riche tout
en restant clair, synthétique et utilisable dans un contexte
occidental, non anglo-saxon[1], nous ne pouvons qu’en
recommander vivement la lecture, voire la méditation, car les
problématiques exposées sont celles retrouvées dans les
infections par le VIH et par le VHC, par exemple.
■
Le Courrier de l’Observance thérapeutique
16
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
[1] Une des grandes difficultés dans la problématique de l’ob-
servance et de l’adhésion aux traitements médicamenteux
est que nous disposons surtout de références anglo-améri-
caines, avec lesquelles il est difficile de faire des parallèles
pertinents aussi bien pour les mentalités des malades que
pour celles des médecins. Nous aurons l’occasion de revenir
sur ce point dans les prochains numéros.
Ce court article, signé par un psychanalyste, des psycho-
logues et un praticien immunologiste et clinicien, pré-
sente l’intérêt de définir les termes “compliance, obser-
vance, adhésion”, souvent utilisés sans nuances. Il en
découle des éléments de réflexion sur les facteurs facili-
tant ou compliquant la prise des traitements médica-
menteux, facteurs psychosociaux, affectifs et liés à la
présentation des médicaments et aux schémas de prises.
L’auteur insiste sur l’insuffisance de ces déterminants et
recentre le débat sur le patient et “le champ de ses
motivations, de ses inhibitions, de son désir et de l’obéis-
sance”. En effet, malgré toutes les recherches et ques-
tions en cours, celles-ci évitent souvent la considération
du sujet et sa singularité. Cela explique les difficultés, les
incertitudes et les résultats parfois contradictoires issus
des études d’évaluation de l’observance.
Le désir, reconnu comme altéré chez les personnes dépri-
mées ou dépendantes de l’alcool[2], sous-tend la motivation à
réaliser un comportement d’observance ; il dépend, notam-
ment, de l’engagement subjectif du sujet, fondé à la fois
sur sa volonté délibérée et sur ses motifs inconscients. En
découle alors l’importance des représentations et des
croyances de la personne sur la maladie et les médica-
ments, ainsi que sur sa propre image et ses projets vitaux.
Son engagement s’inscrit en outre au sein de la relation avec son
médecin et plus généralement avec la médecine,
dans une
dimension intersubjective, requérant l’“autre”, comme
“interlocuteur, garant et support” ; le médecin joue ce rôle
symbolique, derrière lequel se faufilent les membres de son
équipe soignante, venant renforcer au quotidien, et selon
leurs compétences, cet engagement du sujet. Ce transfert
doit être pris en considération, lorsque différentes tech-
niques d’amélioration de l’observance (telles que la sensibili-
sation, l’éducation, l’information) doivent être utilisées avec
l’espoir d’un certain impact.
Enfin, A. Abelhauser rejoint les considérations de
J.P. Assal, en rappelant que l’infection par le VIH, recon-
nue comme une maladie “chronique”, en appelle au
temps et à la durée, tels que vécus par la personne, dont
les comportements de routine et la capacité de projec-
tion dans le futur sont sollicités selon ses représentations.
Cette vision du débat sur l’observance est éclairante ; peu
osent le développer de cette manière ; pourtant, les élé-
ments du puzzle s’orientent pour laisser entrevoir les
vraies questions à poser et, peu à peu, quelques réponses
détenues consciemment ou non par la personne en trai-
tement elle-même. ■
Abelhauser A,
Lévy A, Goujard C,
Weill S. La prise
du traitement,
de l’obéissance
à l’appropriation.
J du Sida 1999 ;
116 : 11-4.
❷OBSERVANCE : LE CŒUR DU PROBLÈME ?
[2] Ces deux facteurs sont reconnus unanimement comme
des facteurs péjoratifs pour une bonne observance ; en réa-
lité, A. Abelhauser souligne que le fond du problème réside
dans ces deux cas singuliers, mais également dans d’autres
situations moins standardisées, dans l’altération du désir
vital interne du sujet, se déclinant consciemment ou incons-
ciemment.
Revue de presse - Multimédia

Le Courrier de l’Observance thérapeutique
17
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Revue de presse - Multimédia
❸INFORMATION DES PATIENTS
✔Coulter A,
Entwistle V,
Gilbert D.
Informing patients.
An assessment
of the quality
of patient
information
materials.
Ed. King’s Fund,
London 1998 :
219 pages.
✔Coulter A,
Entwistle V, Gilbert D.
Sharing decisions
with patients :
is the information
good enough ?
Br Med J 1999 ;
318 : 318-22
✔Broclain D.
Recommandations.
Critères de qualité
des documents
d’information
aux patients.
Prescrire 1999 ;
19, 200 : 788-91.
✔ANAES -
Information des
patients.
Recommandations
destinées
aux médecins.
Mars 2000.
elon votre disponibilité et l’accès aux sources citées, il
sera enrichissant de consulter l’une ou l’autre. L’article
de Prescrire (en français) fait une synthèse des travaux
du King’s Fund, organisme indépendant britannique
ayant une expérience de plusieurs années sur l’évalua-
tion des supports d’information à destination des per-
sonnes souffrant de diverses pathologies de longue
durée. Le King’s Fund a réalisé une étude sur les docu-
ments édités pour les patients dans dix pathologies chro-
niques. La méthodologie est rigoureuse ; elle implique
les patients et les experts pour réaliser les évaluations.
De manière unanime, les patients dénoncent l’insuffisance
des informations fournies par leurs médecins sur leur
maladie, les options de traitement et les effets indési-
rables. Ces derniers ont donné lieu à de nombreux
échanges entre les patients. Ce débat s’ouvre à peine en
France, dans l’infection à VIH, animé par les associations
de malades, par les médecins et les instances publiques ; il
sera utile de profiter des réflexions et des acquis des tra-
vaux anglais pour alimenter les nôtres, qui commencent à
prendre forme.
De même, à l’occasion de ces publications, les questions et
les inquiétudes des patients sont listées. Difficiles à résu-
mer, elles mettent néanmoins en évidence le souci du
patient de se situer dans le présent et le futur, face à l’an-
nonce d’un nouveau mode de vie avec une maladie, un
handicap, des médicaments quotidiens, face à ses possibi-
lités de choix, d’autonomie, de réactivité face à son
entourage. La “méditation” de ces questions remet en
cause notre regard et notre approche de la personne
concernée ; le dialogue et le contenu des supports d’in-
formations doivent certainement s’inspirer de cette
recherche des personnes pour reconstruire des repères
temporels et relationnels dans un nouveau contexte, vécu
intimement et avec émotion avant toute rationalisation.
Les experts anglais mettent en évidence un manque de
fiabilité des documents analysés (erreurs, omissions, par-
tialité, absence de références ou de mentions des
auteurs, de datation). Experts et patients s’accordent sur
le type de présentation des documents, devant adopter
un ton personnalisé, “non culpabilisant, ni paternaliste”,
sans jargon, dans un format clair, concis, structuré.
La relation de témoignages est souvent appréciée,
permettant aux personnes de se retrouver à travers une
difficulté rencontrée.
L’ensemble de ces travaux a mené le King’s Fund à pro-
poser des recommandations pour l’élaboration de docu-
ments d’information destinés aux personnes atteintes de
pathologies
diverses. Elles
sont énumé-
rées dans la
revue Prescrire
et peuvent
constituer des
éléments de
réflexion, de
recherche et
de construc-
tion pour les
nouveaux sup-
ports, notam-
ment dans le
cadre de l’in-
fection par le
VIH.
Au-delà de la qualité de l’information proprement dite,
ces textes discutent, particulièrement dans le British
Medical Journal, son utilisation comme élément de parti-
cipation du patient au du choix du traitement avec le
médecin. A. Coulter souligne l’insuffisance des données
transmises au patient, en particulier à propos des béné-
fices des différentes options thérapeutiques, et des
doutes et incertitudes subsistant. Le ton des documents
est la plupart du temps paternaliste, et peu d’entre eux
encouragent une participation active du patient au pro-
cessus de choix médical. Ce paragraphe peut paraître
provocant dans le contexte français ; la communauté
médicale, les pharmaciens, les soignants et les institu-
tions ne sont pas encore mûrs pour cette dynamique en
pratique, malgré la parution des recommandations de
l’ANAES en mars 2000.
Ce texte, “Information des patients[3]”, destiné aux
médecins, est une petite révolution. Il reprend un grand
nombre des recommandations du King’s Fund concer-
nant l’information à donner aux patients sur leur affec-
tion, les soins et les traitements proposés. Les buts expli-
cites de l’information sont de procurer à la personne,
dans le contexte de la relation de confiance avec son
médecin, les éléments lui permettant de prendre des
décisions en connaissance de cause. Il existe un écart
important en France entre les intentions de ce texte et les
pratiques médicales. Un tournant doit être pris, certes,
mais les mentalités, aussi bien celles des médecins que
celles des patients, évoluent lentement.
En outre, il est indispensable de ne pas perdre de vue les
principes qui sous-tendent l’information des personnes :
© Droits réservés
S

vérité et authenticité, efficacité, mise en action et auto-
nomie, enfin liberté et responsabilité. Ces principes sont
les bases fondamentales de la fiabilité et de la cohérence
de l’information, de son utilité et de son adaptation,
enfin de sa personnalisation et de sa gratuité. Ces consi-
dérations veulent prévenir les dérives prévisibles que
sont la protection juridique excessive de l’informateur (le
médecin) et les dédommagements revendiqués par le
patient insatisfait.
Q
uels rapports avec l’observance thérapeutique ?
Dans le respect des principes ci-dessus, les auteurs de
ces articles et de ces recommandations, logiques dans
leur démarche, ne réconcilient-ils pas d’une certaine
manière les paradoxes évoqués dans les précédents
articles ? Munie d’informations alimentant ses besoins
de repères et de compréhension, la personne affectée
d’une pathologie de longue durée est capable de
restructurer et de redonner mots et sens au processus
thérapeutique en collaboration avec le médecin et son
équipe. Alors le désir et la motivation peuvent activer
efficacement l’adhésion aux traitements et participer
à l’observance médicamenteuse.
■
Le Courrier de l’Observance thérapeutique
18
Vol.1 - n° 1 - octobre 2000
Revue de presse - Multimédia
❹IPPOTHES 2000
–Initiative Pratique Pour l’Observance THÉrapeutique dans le Sida –
Dans le prochain numéro, seront publiés des résumés de posters et communications à propos de l’observance,
des méthodes d’évaluation, des expériences.
❺CONGRÈS DE DURBAN (AFRIQUE DU SUD) – 2000
[3] Ces recommandations s’adressent exclusivement aux
médecins ; à leur lumière, il sera important de définir les
rôles que jouent les autres soignants dans l’information,
notamment à propos des médicaments et de leur bon usage.
Les comportements d’observance sont le fruit de la collabo-
ration des différentes compétences professionnelles. Il est
dommage que ces textes n’ouvrent pas naturellement sur la
nécessité de la pluridisciplinarité, clé de la prise en charge
des maladies de longue durée.
près le vif intérêt porté à l’étude IPPOTHES 1999,
menée sur le thème de l’observance au sein des popula-
tions multivulnérables, les Laboratoires DuPont Pharma
et le comité IPPOTHES ont décidé de renouveler leur
engagement dans l’observance à travers :
✓une étude IPPOTHES 2000 : “Femmes et Observance
dans le VIH” ;
✓une deuxième bourse IPPOTHES 2000, remise le
6 octobre 2000 par le Pr Christine Katlama à Nantes, dans
le cadre du congrès de la FNCLS (Congrès national sur l’ob-
servance thérapeutique dans les maladies chroniques : vers
de nouvelles stratégies). Le comité IPPOTHES est constitué
de Mme S. Lancrenon, des Drs F. Linard, H. Bideault et
P. de Truchis et des Prs C. Katlama, P.M. Girard et J.M. Lang.
●Pour tout renseignement concernant ces actions, vous
pouvez contacter le Dr Bruno Baconnet, DuPont Pharma,
137, rue de l’Université, 75334 Paris Cedex 07.
A
1
/
4
100%