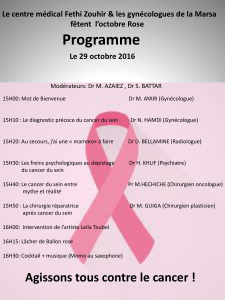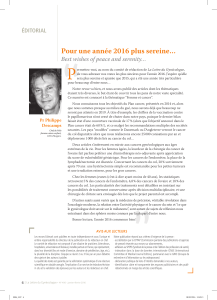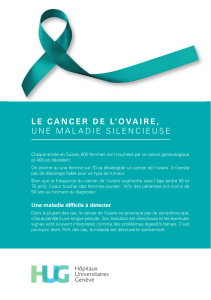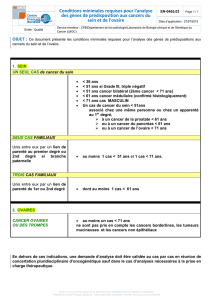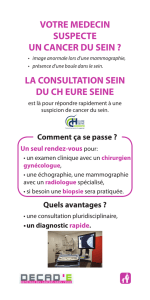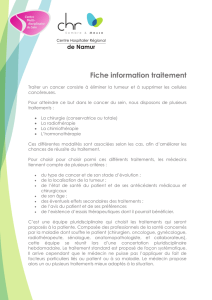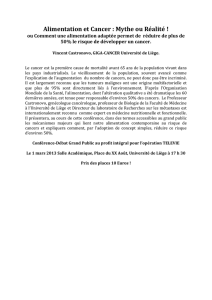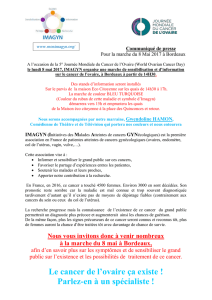ÉDITORIAL
5
La Lettre du Gynécologue - n° 245 - octobre 1999
a prise en charge des femmes atteintes d’un cancer
gynécologique est l’exemple même de ce que doit
être la prise en charge des patients atteints de cancer.
Aujourd’hui, il est démontré et admis par tous qu’elle doit être
pluridisciplinaire.
Elle allie en effet les indispensables connaissances et savoir-
faire d’une spécialité dite d’organe, la gynécologie, et ceux
d’une spécialité transversale, la cancérologie. Ces deux
conceptions ne se concurrencent pas, mais elles sont très com-
plémentaires, la seconde étant en quelque sorte au service de la
première, comme à celui de beaucoup d’autres spécialités
d’organe. La gynécologie oncologique réunit donc les compé-
tences d’un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels le gynéco-
logue compétent en oncologie a un rôle fondamental.
Il faut, de plus, souligner ce qui caractérise les cancers de
l’appareil génital féminin (sein exclu) : ils peuvent survenir à
tout âge et, outre le pronostic vital, ils menacent la fonction
endocrine, la fécondité, la vie sexuelle et aussi l’image corpo-
relle. Sur le plan social, ils menacent la conjointe, la mère, la tra-
vailleuse et l’image de la beauté et de la santé que notre société
a liée depuis longtemps à la femme. C’est dire que l’impact psy-
chologique, affectif et social est omniprésent et particulièrement
important en gynécologie oncologique, et qu’il doit impérative-
ment être pris en compte à chaque étape de la prise en charge.
La femme atteinte d’un cancer génital est le plus souvent
confiée au gynécologue, qui va en premier lieu confirmer le
diagnostic et évaluer l’extension de la maladie. Dès ces étapes,
il doit savoir s’entourer des spécialistes les plus compétents
dans ce domaine. L’imagerie est primordiale, et notamment
l’échographie, véritable prolongement de l’examen clinique,
dont la fiabilité et le rendement sont bien meilleurs si elle est
pratiquée par un radiologue spécialisé dans l’exploration du
pelvis. De même pour l’imagerie en coupes et notamment
l’IRM, particulièrement utile pour l’exploration des lésions
utérines (col et corps), surtout si elle répond à un cahier des
charges bien précis. L’anatomopathologiste doit aussi avoir
une expertise particulière dans la pathologie gynécologique ;
elle doit lui permettre de voir une “masse critique” de lésions
de ce type chaque année et de savoir en interpréter les formes
rares, qui sont variées, notamment en pathologie ovarienne.
Il est évident que de la fiabilité du diagnostic histologique et du
bilan d’extension vont dépendre en grande partie la qualité et
l’efficacité de la thérapeutique. Celle-ci est de plus en plus sou-
vent pluridisciplinaire, et il est important qu’elle soit discutée
d’emblée à la fois par le chirurgien gynécologue, par le radio-
thérapeute et par l’oncologue médical au cours d’une concerta-
tion qui permettra de définir une stratégie adaptée à chaque cas.
La chirurgie reste presque toujours indispensable au traitement
des cancers génitaux, et peut constituer, dans les cas favo-
rables, le seul temps thérapeutique. La qualité du geste chirur-
gical est capitale pour la réussite du traitement, mais aussi pour
le maintien d’une bonne qualité de vie. Le chirurgien gynéco-
logue possède certainement le plus d’aptitudes pour mener à
bien ces interventions. Il doit être un chirurgien complet,
formé à la rigueur des interventions cancérologiques pour réa-
liser une exérèse radicale de la tumeur, mais avec le souci de
l’adapter chaque fois que possible pour en minimiser les
conséquences fonctionnelles et donc l’impact psycho-affectif.
À cet égard, il est remarquable qu’en France, notamment, les
chirurgiens gynécologues aient su utiliser très rapidement la
cœliochirurgie pour le traitement des tumeurs gynécologiques.
Même si des questions se posent encore et doivent faire adap-
ter cette technique avec prudence aux protocoles thérapeu-
tiques, sa place incontestable est en train de se préciser. Elle
permettra aux femmes atteintes de pathologie maligne de
bénéficier des avantages qui ont permis à la cœliochirurgie de
s’imposer pour la pathologie bénigne.
Le chirurgien gynécologue compétent en cancérologie doit bien
connaître l’histoire naturelle et le comportement biologique des
tumeurs qu’il prend en charge, de manière à savoir appliquer, à
chaque stade de leur évolution, le traitement le plus juste.
Dans les formes débutantes ou précurseurs, il doit savoir,
chaque fois que possible, utiliser une technique conservatrice
de l’image corporelle mais aussi des fonctions endocrines,
sexuelles et de reproduction. C’est le cas, par exemple, des dys-
plasies ou néoplasies débutantes du col utérin, qui peuvent faire
l’objet de plusieurs techniques très conservatrices : laser, élec-
tro-résection à l’anse, conisation ou même, plus récemment,
trachélectomie élargie. Pour les cancers limités de l’ovaire, la
conservation de la fertilité est parfois possible, en tenant
compte des progrès de la procréation médicalement assistée.
En revanche, dans les formes évoluées encore fréquentes,
notamment pour les cancers de l’ovaire, mais aussi pour certains
cancers de la vulve ou pour les récidives locales des cancers uté-
rins, le chirurgien gynécologue doit maîtriser les techniques de
chirurgie lourde, parfois polyviscérale, et de reconstruction.
En effet, la réduction tumorale d’un cancer de l’ovaire évolué
nécessite dans 40 % des cas une exérèse digestive, le plus sou-
vent du rectosigmoïde, avec une anastomose colorectale basse.
Les hystérectomies élargies pour cancer du col peuvent, bien
qu’exceptionnellement, nécessiter une réimplantation urétéro-
vésicale. Les exentérations pelviennes sont, quant à elles, une
chirurgie majeure à laquelle il ne faut pas renoncer, car elles
peuvent procurer des survies prolongées dans 25 à 30 % des
cas. Elles doivent cependant être le plus souvent possible asso-
ciées à un temps de reconstruction urinaire, digestif ou vaginal
faisant appel à des techniques sophistiquées de dérivation uri-
Le modèle de la gynécologie oncologique
●
J. Dauplat*
* Directeur du centre Jean-Perrin, 58, rue Montalembert, 63000 Clermont-Fer-
rand. Président de la Société française d’oncologie gynécologique (SFOG).
L

naire continente, de plasties diverses utilisant le tube digestif,
le péritoine, l’épiploon ou des lambeaux musculo-cutanés. Cet
arsenal de techniques doit être connu des chirurgiens qui opè-
rent des cancers gynécologiques, ou ceux-ci doivent constituer
une équipe chirurgicale réunissant ces compétences. Dans ce
groupe, l’anesthésiste-réanimateur a une place capitale pour
prendre en charge les patientes dans des unités de soins post-
opératoires adaptées aux suites de cette chirurgie majeure.
Aujourd’hui cependant, le traitement des tumeurs solides, et en
particulier gynécologiques, est de plus en plus souvent pluri-
disciplinaire. Une série de publications récentes vient par
exemple de montrer l’efficacité de l’association radiothérapie-
chimiothérapie, préopératoire ou non, dans les cancers du col
volumineux et/ou envahissant les paramètres. La chimiothéra-
pie est indispensable au traitement des cancers avancés de
l’ovaire après l’opération. La combinaison des traitements
demande parfois la coopération directe et simultanée de deux
acteurs : c’est le cas, par exemple, de la radiothérapie ou de la
curiethérapie peropératoire, réalisée conjointement par le chi-
rurgien et le radiothérapeute, et qui peut se révéler intéressante
pour certains cancers du col avancés ou certaines récidives pel-
viennes. De même, la chimiothérapie ou l’immunothérapie
intrapéritonéale, séduisante pour les cancers de l’ovaire, néces-
site la collaboration étroite du chirurgien et de l’oncologue
médical. Même si l’efficacité réelle de ces traitements reste
difficile à mesurer, ils bénéficient très probablement à cer-
taines patientes et doivent être réalisés dans les meilleures
conditions de qualité et de sécurité.
Il est de la responsabilité du gynécologue qui reçoit les
patientes d’organiser cette pluridisciplinarité. C’est à lui de
regrouper les différents spécialistes compétents dans le
domaine des tumeurs gynécologiques. Il est important que le
radiothérapeute et l’oncologue médical aient une expertise par-
ticulière en gynécologie. Le radiothérapeute doit participer,
conjointement avec le gynécologue, à l’évaluation clinique ini-
tiale de l’extension locale d’une tumeur utérine et savoir
apprécier les caractéristiques anatomiques qui vont condition-
ner sa technique, et particulièrement l’application de la curie-
thérapie. L’oncologue médical doit savoir gérer les problèmes
hormonaux ou de fertilité qui peuvent résulter du traitement
anti-mitotique. Le chirurgien gynécologue doit organiser la
concertation de ces différents spécialistes. À partir de celle-ci,
des stratégies diagnostiques et thérapeutiques générales sont
définies conformément aux données scientifiques actuelles, et
sont adaptées à chaque cas particulier. Cette concertation per-
manente permet aussi la formation continue de l’équipe, cha-
cun des acteurs pouvant faire bénéficier les autres des progrès
de son domaine spécifique. En cancérologie, c’est une notion
capitale, car le caractère transversal de cette spécialité permet
d’appliquer à un type de tumeur une stratégie qui s’est révélée
bénéfique dans un autre domaine. C’est le cas, par exemple, de
l’association radio-chimiothérapie, reconnue pour le traitement
du cancer du canal anal, et qui se révèle intéressante pour les
cancers vulvaires évolués. C’est le cas aussi de l’intensifica-
tion de la chimiothérapie avec support hématopoïétique utili-
sée pour de nombreuses tumeurs solides chimiosensibles, et
applicable au cancer de l’ovaire.
Les traitements anticancéreux deviennent de plus en plus com-
plexes et ont tendance à s’éloigner de la spécialité d’organe. À
titre d’exemple, l’allogreffe de moelle osseuse a récemment
été proposée pour traiter certaines tumeurs solides chimiorésis-
tantes en comptant sur l’effet thérapeutique de la réaction
immunologique du greffon contre l’hôte : nous l’avons réalisée
chez une jeune patiente porteuse d’un cancer de l’ovaire réci-
divant et nous avons constaté une réponse spectaculaire, qui se
prolonge depuis plusieurs mois.
Ainsi, dans de nombreuses circonstances, il n’existe pas de
standard thérapeutique, et des essais cliniques sont nécessaires.
Il est important que la réflexion du groupe de gynécologie
oncologique envisage aussi ces essais, soit pour participer à
ceux qui sont proposés par d’autres, soit pour les élaborer et
les promouvoir. De l’adhésion du groupe à un essai dépendra
l’inclusion des patientes et le succès de celui-ci.
La réflexion du groupe doit également porter sur les stratégies
de diagnostic, de dépistage et de prévention, car il est certain
qu’un diagnostic précoce est une source de progrès capital per-
mettant des thérapeutiques plus simples, moins coûteuses,
moins agressives et plus efficaces.
Le groupe doit en outre envisager le suivi et la surveillance ulté-
rieure, ainsi que les soins palliatifs et le soutien psychologique,
qui peut être nécessaire à toutes les étapes de la maladie. Là
encore, une compétence particulière des intervenants en gynéco-
logie est souhaitable, et permet une prise en charge mieux adap-
tée. Il doit enfin réfléchir sur l’information des patientes et de
leur famille, qui doit, à chaque étape, être aussi claire et com-
plète que possible afin que, dans l’idéal, la femme puisse deve-
nir une véritable partenaire de sa prise en charge thérapeutique.
La gynécologie oncologique est donc une “sub-spécialité” aux
aspects multiples et parfois très complexes. Elle fait intervenir
de nombreux “sub-spécialistes”, organisés entre eux à l’initia-
tive du “gynécologue oncologue”. Elle se trouve au carrefour
d’une spécialité d’organe, la gynécologie, et d’une spécialité
transversale, la cancérologie, et le bon fonctionnement du
groupe doit permettre l’interpénétration des connaissances, des
techniques et du savoir-faire des deux spécialités.
Ce groupe peut fonctionner idéalement dans une institution ou
dans un regroupement d’institutions, mais c’est surtout la
capacité des femmes et des hommes qui le composent à tra-
vailler ensemble qui en fera le succès.
Le but de l’équipe spécialisée en gynécologie oncologique est
de prendre en charge les femmes atteintes de cancers génitaux
de façon continue et globale depuis la prévention jusqu’à la
guérison et la réinsertion ou aux soins palliatifs pour leur assu-
rer les soins les plus performants, les plus sûrs et la meilleure
qualité de vie possible. ■
POUR EN SAVOIR PLUS...
❒Piana L. Une conception actuelle de la lutte contre le cancer : la “cancéro-
logie de spécialité”. L’exemple de l’oncologie gynécologique et mammaire dans
les centres hospitaliers régionaux. Bull Cancer 1995 ; 82 : 97-100.
❒Philip T. Organisation de la cancérologie. Bull Cancer 1995 ; 82 : 101-5.
❒Hacker N.F. Organization of gynecological cancer care : a time for change.
Inst J Gynecol Cancer 1998 ; 8 : 1-5.
ÉDITORIAL
6
La Lettre du Gynécologue - n° 245 - octobre 1999
1
/
2
100%