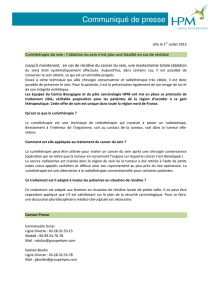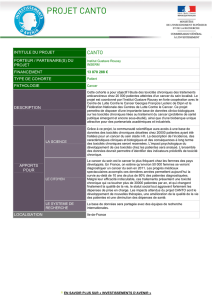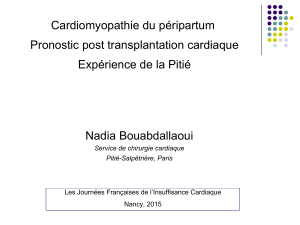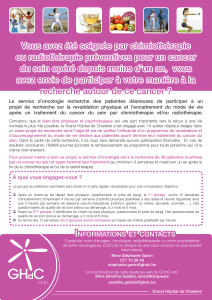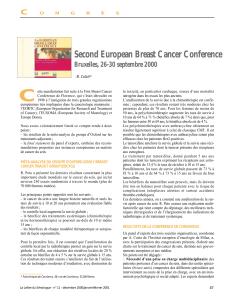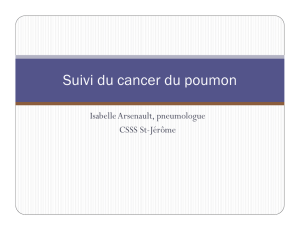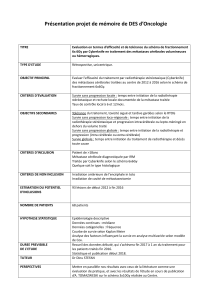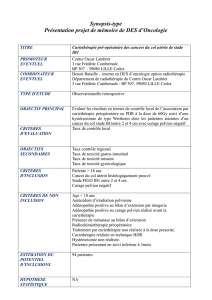EVOLUTION DES PRATIQUES ET INDEX THÉRAPEUTIQUES EN

Mémoire de DES d’Oncologie-Radiothérapie
Faculté de Médecine de Lille Henri Warembourg
Année 2013/2014
EVOLUTION DES PRATIQUES ET INDEX THÉRAPEUTIQUES EN
RADIOTHÉRAPIE DU CANCER DU COL UTÉRIN AU CENTRE
OSCAR LAMBRET DE 1998 À 2012
Frédérique VASSEUR
Tuteur : Pr. Philippe NICKERS
Centre Oscar Lambret
3, rue Frédéric Combemale
59000 Lille

1"
"
SOMMAIRE
INTRODUCTION"............................................................................................................................."4!
I. Les cancers du col utérin".................................................................................................................."4!
II. La place de la radio-chimiothérapie dans le traitement des cancers du col utérin".........................."5!
1)!Un gain en survie globale"........................................................................................................"5!
2)!Toxicités de la radio-chimiothérapie"......................................................................................."5!
III. La radiothérapie conformationnelle sans modulation d’intensité".................................................."6!
1)!Principes de la radiothérapie conformationnelle 3D"................................................................"6!
2)!Les résultats de cette technique"..............................................................................................."7!
3)!Les limites de cette technique".................................................................................................."7!
IV. La RCMI"......................................................................................................................................."9!
1)!Principes de la RCMI"..............................................................................................................."9!
2)!Apports de la RCMI dans les cancers du col utérin"..............................................................."10!
3)!Inconvénients de la RCMI"....................................................................................................."13!
V. La RCMI associée à l’IGRT : exemple de la Tomothérapie"........................................................."14!
1)!Principes techniques".............................................................................................................."14!
2)!Imagerie embarquée"..............................................................................................................."15!
3)!Correction du positionnement du volume cible"....................................................................."15!
VI. Objectifs du projet"......................................................................................................................."16!
MATERIELS ET METHODES"......................................................................................................."17!
I. Patientes"........................................................................................................................................"17!
1)!Première série : RCC conformationnelle 3D et curiethérapie PDR"......................................."17!
2)!Deuxième série : RCC par Tomothérapie et curiethérapie PDR"............................................"17!
II. Traitement par radiothérapie"........................................................................................................."17!
1)!RCC conformationnelle 3D et curiethérapie PDR"................................................................."17!
2)!RCC par Tomothérapie et curiethérapie PDR"........................................................................"18!
III. Suivi"............................................................................................................................................"19!

2"
"
IV. Statistiques".................................................................................................................................."20!
RESULTATS"..................................................................................................................................."21!
I. Patientes"........................................................................................................................................."21!
II. Traitement"....................................................................................................................................."22!
III. Survie globale".............................................................................................................................."23!
IV. Survie sans récidive"...................................................................................................................."24!
V. Toxicités"......................................................................................................................................."27!
DISCUSSION".................................................................................................................................."29!
I. Survie globale et survie sans récidive"............................................................................................"29!
1)!Survie globale"........................................................................................................................"29!
2)!Survie sans récidive"..............................................................................................................."30!
3)!Comparaison aux résultats de la littérature"............................................................................"30!
II. Toxicités"......................................................................................................................................."32!
1)!Amélioration de la tolérance digestive avec la RCMI"..........................................................."32!
2)!Comparaison aux données de la littérature"............................................................................"32!
III. Limites et intérêts de cette étude"................................................................................................."34!
CONCLUSION ET PERSPECTIVES"............................................................................................."36!
BIBLIOGRAPHIE"..........................................................................................................................."37!
ANNEXE 1 : CLASSIFICATION FIGO"........................................................................................."41!

3"
"
GLOSSAIRE
CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés
CTV : volume cible anatomo-clinique
FIGO : fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique
HDR : high-dose rate
HR : hazard ratio
IC : intervalle de confiance
IGRT : radiothérapie guidée par l’image
GTV : volume cible macroscopique
OAR : organes à risque
PDR : pulse-dose rate
PTV : volume cible prévisionnel
RCC : radio-chimiothérapie concomitante
RCMI : radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité
TDM : tomodensitométrie
TEP : tomographie par émission de positons
URC : unité de recherche clinique
VADS : voies aérodigestives supérieures

4"
"
INTRODUCTION
I. Les cancers du col utérin
Le cancer du col utérin représente la dixième cause de cancer chez la femme. Trois mille
nouveaux cas ont été recensés en 2008 en France. Le pic d’incidence se situe autour de 40
ans. Il est responsable de près de 1000 décès annuels avec un pic de mortalité à 50 ans (1).
La plupart des cancers du col utérin sont des carcinomes parmi lesquels (Figure 1) :
• 80 à 90 % sont des carcinomes épidermoïdes développés à partir de l’épithélium
malpighien de l’exocol.
• 10 à 20 % sont des adénocarcinomes développés à partir de l’épithélium cylindrique
qui recouvre le canal endocervical ou endocol.
Figure 1 : Coupes anatomopathologies d’un carcinome épidermoïde (A) et d’un adénocarcinome (B)
du col utérin.
La principale étiologie du cancer du col utérin est l’origine infectieuse à papillomavirus
(génotypes 16 et 18 dans 70% des cas). D’autres facteurs favorisent la persistance de
l’infection, comme le tabagisme et l’immunodépression acquise (VIH, traitements
immunosuppresseurs).
Du fait de son évolution lente et de l’existence de nombreuses lésions précancéreuses
curables, le cancer du col peut être dépisté à un stade précoce sur le frottis cervico-utérin. Le
dépistage des lésions précancéreuses a ainsi permis une diminution de moitié de l’incidence et
de la mortalité du cancer du col utérin depuis 20 ans. En termes de prévention, il existe deux
vaccins prophylactiques qui préviennent l’infection par les papillomavirus 16 et 18.
L’évolution du cancer du col utérin reste longtemps locorégionale. Le franchissement de la
membrane basale définit alors le stade invasif, avec extension possible aux paramètres, à
l’espace para-cervical, aux ganglions locorégionaux et dans 15% des cas une extension
métastatique à distance.
Le pronostic est conditionné par le stade tumoral, le diamètre maximal de la tumeur,
l’envahissement ganglionnaire et l’étalement du traitement qui ne doit pas dépasser 55
jours (2).
A
B
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%