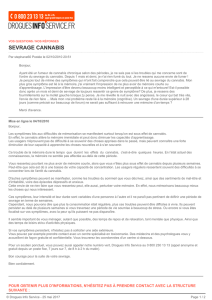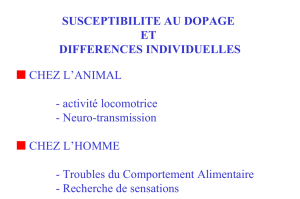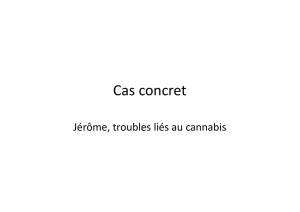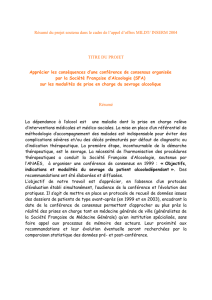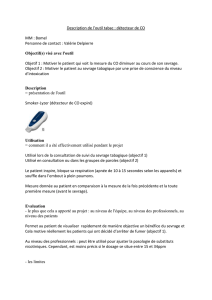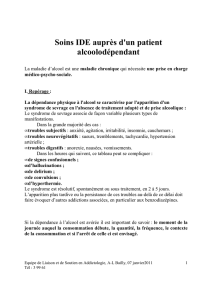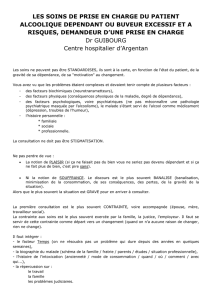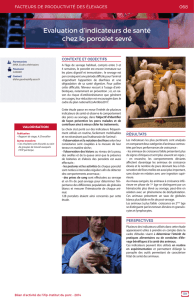Lire l'article complet

105
La démarche préventive a pour objectif de
prévenir l’initialisation de la consommation
de cannabis, d’évaluer et d’aider à une auto-
évaluation pour apprendre à gérer son usage
à moindre risque, et d’empêcher l’évolution
vers une dépendance et les dommages qui en
découlent. Ces objectifs sont pris en compte
dans les consultations cannabis avec comme
outils l’évaluation, l’information et l’orienta-
tion. Nous ne développerons pas cet aspect de
la prise en charge.
Des patients dépendants
en grandes difficultés
La démarche curative que nous souhaitons
aborder se situe plutôt en aval de la consom-
mation. Elle vise des patients dans une situa-
tion de dépendance, de souffrance ou de dom-
mages liés à un usage abusif.
La tranche d’âge des patients qui viennent
consulter et demander une aide au sevrage, va
de 15 à 45 ans. Ce sont plutôt des hommes,
bien que la proportion de femmes demandant
un soutien soit plus élevée que la proportion
connue de femmes consommatrices de can-
nabis. La dépendance est souvent importante
et ancienne : de quelques années à plus de 10,
voire 15 à 20 ans pour certains. La consom-
mation de joints est quotidienne, et peut aller
de 4 à 5 joints jusqu’à 25-30.
Un nombre important d’entre eux consomme
des “douilles”, des “bangs” (parfois 15 à
20 par jour), un mode de “défonce” au
caractère violent qui peut difficilement
durer longtemps. Aussi, en général, les
consommateurs reviennent-ils aux joints.
La situation sociale varie beaucoup en
fonction de l’intensité de la consommation,
de l’ancienneté de la dépendance et de
l’âge de début. Plus la consommation et la
dépendance sont importantes, plus la déso-
cialisation est avérée avec perte de travail
ou grande difficulté à le conserver ou inca-
pacité à avoir un projet professionnel.
Lorsque la dépendance est récente, avec une
consommation relativement contrôlée (4 à 5
joints par jour), on a affaire à des patients
insérés, conciliants, malgré les difficultés
(vie professionnelle, relationnelle et usage).
Si la dépendance est précoce, le jeune est
souvent en échec scolaire et, par la suite,
n’a pas de projet professionnel.
Conjointement à la dépendance, les premiers
dommages dont se plaignent les patients sont
les troubles de la mémoire, assez vite res-
sentis et pouvant être très gênants. Ils accu-
sent également un ralentissement général,
avec manque d’entrain, diminution des
réflexes et difficultés à élaborer un projet. On
observe un décalage par rapport à la réalité,
un isolement, une rupture sociale. La
consommation devient solitaire et les seules
personnes rencontrées ne sont que des
consommateurs. L’essentiel du temps est
passé à consommer et à dormir quand la
dépendance et la consommation sont impor-
tantes. Les troubles de la mémoire, la dépen-
dance et les difficultés professionnelles ou
scolaires sont les premières raisons amenant
les patients à consulter, ainsi que l’échec
répété des tentatives d’arrêt.
Il est utile bien sûr de resituer tous ces élé-
ments dans un contexte plus général. La
plupart des consommateurs de cannabis,
comme ceux d’alcool contrôlent leur
consommation et ne sont pas des usagers
abusifs. Seuls 10 à 20 % d’entre eux évo-
luent vers une dépendance (comme les
consommateurs d’alcool). Aussi, dans les
“consultations cannabis”, avons-nous à
faire à des patients en grandes difficultés,
ce qui n’est évidemment pas le cas de la
plupart des fumeurs de cannabis.
Ces patients dépendants savent, depuis des
années, qu’ils sont “accros” et éprouvent
de grandes difficultés à arrêter.
D’abord évaluer la dépendance
et les dommages induits
La première étape est une évaluation de la
consommation, de la dépendance, des dom-
mages et des pathologies associées, soma-
tiques et psychiatriques. L’approche est
importante et va permettre de poser un
cadre. La prise en charge va être longue et
souvent difficile. Plusieurs partenaires sont
nécessaires et une préparation au sevrage
est indispensable.
On considère en matière de cannabis une
dépendance psychologique, comportemen-
tale et pharmacologique. L’absence de
dépendance physique au cannabis est sou-
vent mise en avant car il n’existe pas de
signes physiques du manque, comme on peut
les observer dans les dépendances avérées à
l’alcool. Encore que beaucoup d’alcoolodé-
pendants ne présentent pas non plus ces
signes qui n’apparaissent que dans les formes
évoluées. Pour le tabac, on parle plus de
dépendance pharmacologique, nicotinique
que de dépendance physique, le syndrome de
manque au tabac ne ne manifeste pas par les
signes physiques de la dépendance à l’alcool
alors que la dépendance est majeure. Le syn-
drome de manque cannabique est assez
proche de celui du tabac avec parfois des
troubles du comportement qui peuvent être
importants (agitation...).
La prise en charge s’appuie sur un accom-
pagnement psychothérapique et comporte-
mental et agit sur l’aspect pharmacologique
de la double dépendance tabac-cannabis.
La place du soutien psycho-
logique et médicamenteux
Le soutien psychothérapique est un pilier
essentiel. Comme dans toutes les addictions,
le produit est un élément qui ne doit pas mas-
quer la personnalité de l’individu. Chez les
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
i
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
Elle s’inscrit dans une double démarche, l’une préventive et l’autre
curative. Les deux, bien que distinctes, ont des interfaces communes
et sont à la base des consultations cannabis des hôpitaux et des
centres spécialisés. Aujourd’hui, de nombreuses personnes, jeunes
ou moins jeunes, consultent et demandent une aide au sevrage.
C’est le premier motif de la consultation cannabis de l’hôpital Joseph-
Ducuing à Toulouse.
La prise en charge des usagers
de cannabis
G. Fontan*
* Hôpital Joseph-Ducuing, Toulouse.

106
Le Courrier des addictions (7), n° 1, janvier-février-mars 2005
plus jeunes pour lesquels la dépendance n’est
pas encore avérée, le produit fait souvent
écran. Il n’est souvent qu’un symptôme, et un
travail psychothérapique est nécessaire. Dans
tous les cas, un suivi doit être instauré et,
même si le travail est long, il est une des clés
du sevrage. Un intervenant spécialisé, psycho-
logue, psychiatre, est de ce fait un acteur indis-
pensable de cette prise en charge.
Un traitement médicamenteux a aussi sa place
dans le sevrage. La double dépendance tabac-
cannabis et le syndrome de manque (irritabili-
té, anxiété, agressivité, impossibilité à ne pas
consommer) le rendent nécessaire. On prescrit
en général un traitement anxiolytique ponctuel
pour la durée du sevrage, c’est-à-dire quelques
semaines. Il est rapidement dégressif. On
évite les produits pouvant induire une
dépendance.
Quand un patient a déjà présenté des symp-
tômes paranoïaques ou psychotiques, lors de
la consommation ou d’un sevrage (crises
d’angoisse, bad-trips, agitations patholo-
giques...), les neuroleptiques à petites doses
sont intéressants. Les antidépresseurs n’ont
pas une grande utilité, sauf bien sûr si l’on dia-
gnostique une dépression. Il faut également
évaluer la dépendance nicotinique qui est sou-
vent importante et sous-estimée par les usa-
gers. Ceux ayant déjà essayé d’arrêter le can-
nabis ont souvent découvert d’eux-mêmes
qu’ils devaient augmenter considérablement
le nombre de cigarettes au-delà de ce que leur
demande la compensation psychologique ou
comportementale. C’est la compensation
pharmacologique nicotinique qui est à la base
du mécanisme. Lors du sevrage, si la dépen-
dance est trop importante, le patient pourra
s’aider pendant quelques temps d’un patch
nicotinique tout en continuant à fumer, pour
éviter d’avoir à fumer plus de deux paquets.
Parfois certains font le sevrage des deux pro-
duits : dans ce cas, la compensation et la sub-
stitution nicotinique sont encore plus indis-
pensables
Et celle du suivi comportemental
Le versant comportemental est le troisième
axe de travail. Le conditionnement puissant
dans lequel se sont installés les gros consom-
mateurs depuis des années est un élément clé
de leur dépendance : l’environnement, les
rituels et la répétition sont déterminants et
opérants lors de la consommation quotidienne
de cannabis. Le suivi comportemental com-
portera classiquement le travail en amont du
sevrage, le travail motivationnel, l’aide au
changement, la préparation du sevrage, l’ana-
lyse des comportements, des circonstances
des moments, des lieux et des émotions asso-
ciées à la consommation. Le sevrage s’appuie
sur un contrôle des stimuli comportementaux
et environnementaux et sur l’élaboration de
réponses adaptées. Le soutien et l’accompa-
gnement, rapprochés au début, sont néces-
saires. L’accompagnement, qui inclue un tra-
vail sur la prévention des rechutes, durera plu-
sieurs mois.
Les bénéfices du sevrage
Passées les premières semaines du sevrage,
avec la disparition du manque, les patients
disent qu’ils ont l’impression de s’éveiller,
d’avoir les idées plus claires, plus d’entrain et
de facilité à élaborer un projet. Les troubles de
la mémoire s’estompent généralement assez
rapidement, sauf lorsque la dépendance et les
troubles sont trop anciens.
Le contexte est déterminant. Si le sevrage
s’inscrit dans un projet élaboré, dans une
démarche positive, avec une maturation et une
motivation importantes, il est assez aisé. La
dynamique globale est un moteur. C’est par-
fois dans ce contexte qu’on voit des patients
faire un double sevrage tabac-cannabis.
Si, au contraire, le contexte est délétère, que la
demande de sevrage est “assise” uniquement
sur des aspects négatifs liés aux dommages
(mémoire, désocialisation), à la dépendance, à
des problèmes avec l’entourage, la famille,
l’école, la justice… il est plus délicat à mettre
en place. Il demande alors une préparation
plus longue et l’élaboration plus aboutie d’un
projet.
Dans tous les cas, un sevrage est une expé-
rience intéressante. Même s’il n’aboutit pas, il
est une étape positive d’un processus de matu-
ration. C’est l’occasion d’un travail motiva-
tionnel et d’une information qui sera béné-
fique pour un sevrage ultérieur.
Parler d’accompagnement des consomma-
teurs de cannabis n’est pas une chose très
facile actuellement : l’espace entre la diaboli-
sation et la banalisation est étroit et le contex-
te est toujours très polémique. L’objectif des
consultations cannabis est avant tout de
répondre à une demande de soin. De plus, les
usagers de cannabis sont souvent des jeunes,
des adolescents pour qui les espaces d’accueil
et de parole ne sont pas très nombreux. Les
médecins et les centres de soins spécialisés
aux toxicomanes sont souvent confrontés à la
difficulté d’accès au soin des adolescents qui,
dans une société qu’ils estiment gérontocrate,
se sentent mis un peu sur la touche. Tout le
monde est d’accord sur un objectif : faire
coïncider nos idées et notre action pour amé-
liorer et l’action et l’aide apportée aux jeunes,
surtout lorsqu’ils les sollicitent.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
i
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
Les généralistes bien placés pour
repérer les consommations d’alcool
Selon l’OMS, une consommation d’alcool est dangereuse lorsqu’elle
est régulière (au moins 5 jours par semaine) et au-dessus de 3 “verres
standard” par jour pour les hommes et 2 pour les femmes ; ou en
usage ponctuel,quel que soit le sexe,à partir de 40 g d’alcool pur,soit
4 “verres standard”.Dans son numéro de juin,Prescrire attire l’attention
sur l’intérêt de repérer en médecine générale les sujets non dépen-
dants de l’alcool, mais pour lesquels une consommation prolongée
d’alcool risque d’avoir ultérieurement des conséquences néfastes
(“usage à risque”),ou qui présentent déjà des dommages induits par
l’alcool (“usage nocif”).Plusieurs essais cliniques
ont évalué l’utilité d’interventions médicales
auprès de ces personnes par entretiens brefs,
généralement uniques, sans prescriptions de médicaments, avec une
information sur les risques liés à l’alcool et le conseil d’en ramener la
consommation à des valeurs réputées non dangereuses. Même s’il
peut être parfois délicat d’aborder la question de l’alcool avec des
personnes qui ne consultent pas pour ce motif,les médecins généra-
listes sont les mieux placés pour une pratique systématique de cette
stratégie de repérage et,le cas échéant, d’intervention brève.
In: Prescrire n° 262, juin 2005. www.prescrire.org.
F.A.R.
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
1
/
2
100%