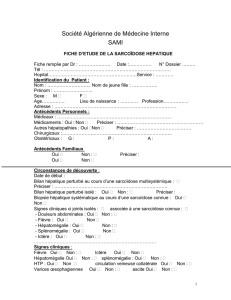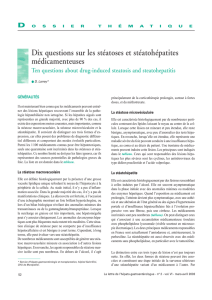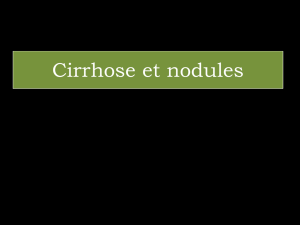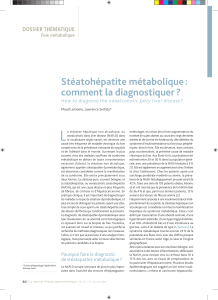Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009
228
dossier thématique
Stéatohépatite métabolique :
comment la diagnostiquer ?
How to diagnose the nonalcoholic fatty liver disease?
Maud Lemoine, Lawrence Serfaty*
* Service d’hépatologie,
hôpital Saint-Antoine, Paris.
© La Lettre de l’hépato-
gastroentérologue 2009;3(XII).
L
a stéatose hépatique non alcoolique, ou non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD) dans le voca-
bulaire anglo-saxon, est devenue une cause très
fréquente de maladie chronique du foie compte tenu
de la prévalence croissante du surpoids et de l’obésité
dans le monde. Survenant le plus souvent chez des
malades sourant de syndrome métabolique en dehors
de toute consommation excessive d’alcool, la stéa-
tose non alcoolique, également appelée stéatopathie
dysmétabolique, est désormais considérée comme la
manifestation de ce syndrome. Elle existe principa-
lement sous deux formes : la stéatose pure, souvent
bénigne, et la stéatohépatite, ou nonalcoholic stea-
tohepatitis (NASH), qui est une cause de plus en plus
fréquente de brose, de cirrhose et d’hépatocarcinome.
En pratique clinique, il est important de diagnostiquer
les malades à risque de stéatose dysmétabolique, et
plus encore de distinguer les patients ayant une stéa-
tose simple de ceux ayant une stéatohépatite avec
des lésions de brose qui conditionnent le pronostic.
Le diagnostic de stéatopathie dysmétabolique ainsi
que l’évaluation de sa sévérité sont histologiques et
reposent donc sur la biopsie du foie. Toutefois, cet exa-
men est invasif et onéreux, ce qui justie la recherche
de méthodes diagnostiques non invasives. Celles-ci
n’ont pas la précision d’une analyse histologique, mais
pourraient aider à mieux sélectionner les patients can-
didats à la biopsie.
Pourquoi faire le diagnostic
de stéatopathie métabolique ?
La NAFLD occupe une place de plus en plus impor-
tante dans l’activité des services d’hépatogastro-
entérologie, en raison de la forte augmentation du
nombre de sujets obèses au cours des vingt dernières
années et de la mise en évidence du rôle délétère du
syndrome d’insulinorésistance sur les tissus périphé-
riques, dont le foie. Elle est devenue, dans certains
pays occidentalisés, la première cause de maladie
chronique du foie. Aux États-Unis, sa prévalence est
estimée entre 20 et 30 % dans la population générale,
avec une prévalence de la NASH évaluée à 5 % (1). Elle
est également en augmentation chez l’enfant et chez
l’adolescent. Chez les patients ayant une surcharge
pondérale modérée ou sévère, la prévalence de la
NASH histologiquement prouvée serait de 42 %. Dans
une série de 195 patients obèses, Abrams et al. ont
montré que la prévalence de la NASH était de 36,4 %
et que, parmi ces derniers patients, 12 % avaient des
lésions de brose sévère (2).
Fréquemment associée à une insulinorésistance indé-
pendamment du surpoids, la stéatose hépatique non
alcoolique est considérée comme la manifestation
hépatique du syndrome métabolique. Celui-ci est
déni par l’association d’une obésité centrale, d’une
hypertension artérielle, d’une hypertriglycéridémie,
d’un HDL-cholestérol bas et d’une intolérance au
»
La stéatose hépatique non alcoolique, ou stéatopathie
dysmétabolique, existe sous deux formes : la stéatose simple,
d’évolution bénigne, et la stéatohépatite (NASH), qui peut se
compliquer d’une fibrose, d’une cirrhose et d’un cancer.
»
Seule la biopsie hépatique permet de distinguer les patients ayant
des lésions de stéatohépatite de ceux ayant une stéatose simple. Il
n’existe pas encore de recommandations quant à ses indications. Elle
paraît justifiée en l’absence d’amélioration des anomalies biologiques
hépatiques malgré les mesures hygiénodiététiques et le contrôle
des perturbations métaboliques.
» La place des tests non invasifs (élastométrie hépatique, NashTest®
et FibroTest®) pour le diagnostic et l’évaluation de la sévérité de la
stéatohépatite reste à définir.
Mots-clés : Stéatopathie dysmétabolique – Biopsie hépatique –
Marqueurs non invasifs de brose.
Keywords: Nonalcoholic fatty liver disease – Liver biopsy – Non invasive
markers .
Points forts
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009
229
Stéatohépatite métabolique : comment la diagnostiquer ?
glucose, voire d’un diabète de type 2 (tableau). Le
syndrome métabolique touche environ 25 % de la
population aux États-Unis, avec des chires presque
similaires en France selon l’âge, le sexe et l’origine
géographique.
Alors que la stéatose pure est une lésion bénigne, son
association à des lésions inammatoires, dénissant la
NASH, peut évoluer vers la cirrhose dans 10 à 15 % des
cas, avec un risque de complications, et en particulier
d’hépatocarcinome. Plusieurs études épidémiologiques
ont suggéré un lien entre insulinorésistance, cirrhose
et carcinome hépatocellulaire. La prévalence du carci-
nome hépatocellulaire est plus élevée chez les patients
obèses et chez les diabétiques de type 2 que dans la
population générale. Plusieurs études ont également
montré que les patients ayant une NASH avaient un
taux de survie plus faible (3). Le travail de Ong et al.
basé sur les données de la NHANES III a montré une
mortalité globale et une mortalité d’origine hépatique
plus élevées chez les patients ayant une stéatopathie
dysmétabolique que chez ceux n’ayant pas de maladie
du foie (4). Aussi, l’indication de transplantation hépa-
tique pour cirrhose d’origine dysmétabolique est en
augmentation en France et aux États-Unis (10 % des
indications de transplantation aux États-Unis).
Au regard des données épidémiologiques et des risques
évolutifs liés à cette hépatopathie, poser le diagnostic
de NAFLD, et en particulier celui de NASH, est impor-
tant en termes de santé publique. Ce diagnostic per-
met la mise en œuvre de règles hygiénodiététiques
et thérapeutiques pour le contrôle non seulement de
la maladie hépatique mais aussi des comorbidités qui
lui sont associées.
Quand doit être évoqué
le diagnostic ?
Le diagnostic est le plus souvent posé à l’occasion de
l’exploration d’anomalies chroniques de la biologie
hépatique, ou lors de la découverte fortuite d’une hépa-
tomégalie hyperéchogène chez des patients ayant un
surpoids ou un authentique syndrome métabolique
sans consommation excessive d’alcool et sans autres
causes de maladie chronique du foie. En dehors de la
cirrhose, aucun symptôme n’est relevé, l’hépatomé-
galie est inconstante et les seules anomalies cliniques
sont en général celles du syndrome métabolique (HTA,
obésité abdominale). Bien plus que le surpoids estimé
par l’indice de masse corporelle, c’est l’épaisseur de la
graisse abdominale, métaboliquement active, qui doit
sensibiliser le clinicien.
D’un point de vue biologique, le diagnostic doit être
évoqué devant des anomalies persistantes des tests
hépatiques, après avoir éliminé toutes les autres causes
d’hépatopathie chronique, en particulier si ces anoma-
lies sont associées à des troubles du métabolisme glu-
cidique et/ou lipidique et/ou à une insulinorésistance. Il
s’agit le plus souvent d’une augmentation modérée des
transaminases et/ou d’une élévation isolée de la γGT.
Dans une étude prospective française incluant
272 patients ayant une élévation chronique des transa-
minases, des lésions de stéatose non alcoolique étaient
retrouvées dans près de 60 % des cas (26,8 % avaient
des lésions de stéatose et 32,7 % une NASH) [5]. Les
transaminases dépassent exceptionnellement cinq
fois la normale. La normalité des transaminases n’éli-
mine pas le diagnostic, en particulier pour les patients
hypertendus et insulino résistants, chez qui une NAFLD
est retrouvée dans un tiers des cas malgré des tran-
saminases normales (6). D’autres études ont montré
que la normalité des transaminases ne garantissait pas
l’absence de lésions hépatiques.
En l’absence de syndrome métabolique, les anomalies
lipidiques et/ou glucidiques favorisent la stéatose. Dans
une étude récente incluant 1 909 patients hyperlipé-
miques et 925 donneurs de sang, il a été montré, à partir
de marqueurs non invasifs, que 30 % des patients hyper-
lipémiques avaient une stéatose, 7 % une NASH et 3 %
des lésions de brose (7). Dans cette même étude, la
prévalence de ces lésions hépatiques était plus élevée
chez les patients ayant au moins deux critères du syn-
drome métabolique et, en particulier, chez les sujets
diabétiques et hyperlipémiques, pour qui la prévalence
de la stéatose était estimée à 66 %, celle de la NASH à
24 % et celle de la brose avancée à 6 %.
Tableau. Dénition du syndrome métabolique selon la Fédération internationale du diabète (2005).
Il existe un syndrome métabolique en cas de présence
d’au moins trois des cinq critères suivants
Obésité abdominale évaluée par le tour de taille
Hommes
Femmes
≥ 94 cm
≥ 80 cm
Pression artérielle
ou HTA traitée
≥ 130 / ≥ 85 mmHg
Glycémie à jeun
ou diabète de type 2 traité
≥ 5,6 mmol/l
Triglycérides ≥ 1,7 mmol/l
HDL-cholestérol
Hommes
Femmes
≤ 1 mmol/l
≤ 1,3 mmol/l

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009
230
dossier thématique
La résistance à l’insuline est considérée comme l’élé-
ment central dans le développement de la stéatose.
Indépendamment du surpoids ou du syndrome méta-
bolique, l’insulinorésistance peut être à l’origine d’une
stéatose. Ainsi, l’insulinorésistance représente un élé-
ment important pour le diagnostic de stéatose dysméta-
bolique. Elle peut se mesurer simplement par l’index de
HOMA (Homeostasis Model Assessment), obtenu à partir
d’un relevé à jeun de l’insulinémie et de la glycémie
(insulinémie x glycémie/22,5). Un index supérieur à 3
signe l’existence d’une insulinorésistance.
La découverte d’un foie hyperéchogène sur des exa-
mens d’imagerie doit également faire évoquer le
diagnostic. La stéatose pouvant être observée dans
beaucoup de maladies chroniques du foie, et en par-
ticulier celles liées à une consommation abusive d’al-
cool. Il est essentiel d’éliminer toutes les autres causes
d’hépatopathie chronique et d’évaluer avec précision la
consommation quotidienne d’alcool. On rappelle que,
selon l’Organisation mondiale de la santé, une consom-
mation d’alcool est à faible risque si elle reste inférieure
à 10 g/j chez les femmes et à 20 g/j chez les hommes.
Le diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique
sera donc évoqué en cas d’anomalies persistantes
des tests hépatiques chez des patients ayant un ou
plusieurs critères du syndrome métabolique ou chez
des patients ayant une insulinorésistance. Une fois le
diagnostic de NAFLD évoqué, il est dicile en pratique
clinique de distinguer les patients ayant une stéatose
isolée de ceux ayant des lésions de stéatobrose.
Seule la biopsie peut formellement diérencier ces
deux sous-groupes pathologiques.
De la stéatose pure
à la stéatohépatite :
un diagnostic histologique
La stéatose hépatique non alcoolique désigne un
spectre d’entités histologiques allant de la stéatose
simple à la stéatohépatite avec ou sans brose. Les
lésions histologiques sont très proches de celles
observées au cours de la maladie alcoolique du foie.
Cependant, au cours de la stéatose métabolique, l’ac-
tivité nécrotico-inammatoire et la brose sont moins
intenses, les corps de Mallory plus rares et les noyaux
glycogéniques plus fréquents. La stéatose hépatique
est habituellement macrovacuolaire, sous forme de
larges gouttelettes lipidiques de triglycérides refoulant
le noyau en périphérie (gure 1). Elle est quantiée
en pourcentage. Une stéatose pure touchant entre
1 et 5 % des hépatocytes est en général considérée
comme physiologique. La NASH se dénit par l’asso-
ciation d’une stéatose et de lésions nécrotico-inam-
matoires associées à une ballonisation hépatocytaire
(8). L’inammation est souvent mixte, faite d’un inltrat
lymphocytaire ou neutrophile. Les corps de Mallory,
agrégats de cytokératine dans le cytoplasme, ne sont
pas constamment observés.
La biopsie est donc le gold-standard pour le diagnostic
de NAFLD. Elle est cependant associée à des risques
de complications et à des erreurs d’échantillonnage.
La valeur prédictive négative de la biopsie pour le
diagnostic de NASH est estimée à 74 % (9).
Quand doit être envisagée
la biopsie ?
L’intérêt de la biopsie hépatique reste débattu, car il
s’agit d’un examen invasif et cher pour le diagnostic
d’une maladie vis-à-vis de laquelle les moyens théra-
peutiques restent encore limités et peu efficaces aux
yeux de beaucoup de praticiens. Bien que rares, les
complications attribuées à la biopsie limitent sa réali-
sation et son acceptation aussi bien par le malade que
par le médecin. La littérature rapporte en effet une
Figure 1. La stéatose est le critère histologique essentiel au diagnostic. La stéatose hépatique non alcoolique, ou
NAFLD, regroupe deux entités : la stéatose pure et la stéato hépatite, dénie par l’association d’une stéatose et de
lésions inammatoires.
La fibrose est une complication
de la stéatose hépatique non alcoolique, mais elle
n’est pas un critère diagnostique.
Stéatose hépatique non alcoolique
ou stéatopathie métabolique
(nonalcoholic fatty liver disease)
Stéatohépatite non alcoolique
(nonalcoholic steatohepatitis)
NASH
Stéatose
+ lésions inflammatoires
+ souffrance hépatocytaire :
– ballonisation hépatocytaire
– infiltrat inflammatoire
– nécrose hépatocytaire
Stéatose pure

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009
231
Stéatohépatite métabolique : comment la diagnostiquer ?
morbidité de 1/1 000 et une mortalité de 1/10 000.
Dans tous les cas, il semble légitime de proposer
une biopsie hépatique aux patients dont les tests
hépatiques révèlent des anomalies inexpliquées. La
biopsie est sujette à discussion lorsque le diagnostic
de stéatopathie dysmétabolique apparaît évident
chez un patient présentant les anomalies métabo-
liques décrites précédemment et une perturbation
des tests hépatiques. Dans ce cas, l’indication de la
biopsie peut être rediscutée en l’absence d’amélio-
ration de la biologie hépatique ou de correction des
anomalies métaboliques après initiation de règles
hygiénodiététiques. Aucune recommandation n’est
définie en matière de diagnostic non invasif au cours
de la stéatose métabolique.
Place des examens non invasifs
pour le diagnostic
et l’évaluation de la sévérité
de la stéatose hépatique
non alcoolique
Imagerie : échographie, scanner
Dans une petite série de malades ayant subi simulta-
nément une biopsie hépatique, une échographie, un
scanner et une imagerie par résonance magnétique
(IRM), Saadeh et al. ont évalué les performances de ces
examens radiologiques pour le diagnostic de stéatose
hépatique, et plus particulièrement leur capacité à dis-
criminer stéatose pure et NASH (10). Dans cette étude,
l’échographie et le scanner avaient une excellente
sensibilité pour le diagnostic de stéatose supérieure à
33 % (respectivement 100 % et 93 %), avec des valeurs
prédictives positives respectivement de 62 % et 72 %.
Cependant, aucun de ces examens n’était capable de
distinguer la NASH de la stéatose pure. Ainsi, on retien-
dra qu’une imagerie hépatique normale n’élimine pas
le diagnostic de stéatose métabolique dans la mesure
où ces examens sont performants pour des lésions
de stéatose de plus de 33 %. À ce jour, l’imagerie per-
met seulement une orientation diagnostique. D’autres
techniques non validées, comme l’IRM de diusion,
pourraient être prometteuses pour l’évaluation radio-
logique de la brose.
Facteurs cliniques et biologiques
prédictifs de NASH et de brose
Plusieurs études ont tenté d’identier des facteurs pré-
dictifs de stéatohépatite et de brose. Ces études ont
montré qu’un âge ≥ 50 ans, un indice de masse corpo-
relle ≥ 30 kg/m
2
, l’existence d’un diabète, un rapport
ASAT/ALAT ≥ 1, une hypertriglycéridémie ≥ 1,7 mmol/l
et une HTA étaient prédictifs de brose. Dans l’étude
de Abrams et al., l’hypertriglycéridémie et l’existence
d’un diabète étaient étroitement associées à la présence
et à la sévérité des lésions de brose. Cependant, la
valeur prédictive médiocre de ces paramètres incite
à rechercher d’autres marqueurs. Certaines cytokines
pro-inammatoires (TNFα, IL-8) ou certaines adipokines,
cytokines produites par le tissu adipeux (adiponectine,
leptine, IL-6), ont été proposées comme marqueurs de
sévérité hépatique, compte tenu de leurs eets sur l’in-
sulinosensibilité, l’inammation et peut-être la brose.
Au cours de l’obésité, du diabète ou de l’insulinorésis-
tance, les taux sanguins d’adiponectine sont diminués,
alors que ceux de leptine et de TNFα sont augmentés.
Une étude australienne a suggéré que la baisse des
taux circulants d’adiponectine était prédictive de NASH
chez les patients ayant une stéatose dysmétabolique.
Selon un travail réalisé par notre équipe, le HOMA > 3
associé à un rapport adiponectine/leptine < 1,4 per-
mettrait de discriminer les patients ayant une NASH
de ceux ayant une stéatose pure (11). Cependant, ces
molécules ne peuvent pas être dosées en routine, ce qui
limite leur utilisation comme marqueur diagnostique
ou pronostique. Le dosage de l’acide hyaluronique et
celui du collagène IV restent des outils biochimiques
intéressants en tant que marqueurs indirects de brose.
Place de l’élastométrie (FibroScan®)
pour le diagnostic de brose
au cours de la NAFLD
Mesure non invasive de la fibrose hépatique, le
FibroScan® (gure 2) a été évalué pour le diagnostic
de brose au cours de la NASH. Peu de travaux sont
disponibles (5, 12), et un seul est actuellement publié
(12). Ce travail a été réalisé par une équipe japonaise
chez 97 patients ayant une stéatose hépatique non
alcoolique histologiquement prouvée. Les valeurs
d’élastométrie étaient associées au stade de brose
selon la classification de Brunt. Pour le diagnostic
de brose signicative, la valeur seuil était de 8 kPa
(gure 3). L’étude prospective espagnole de Marin et al.,
incluant 110 malades avec NAFLD, montre de bonnes
performances du FibroScan® pour le diagnostic de
brose, avec une AUROC à 0,97 pour le diagnostic de
cirrhose. D’autres études non encore publiées retrou-
vent des résultats analogues (de Lédinghen et al., AGA,
2006). L’étude de Mahmoudi et al. menée à l’hôpital
Jean-Verdier (Bondy) sur une série de 92 patients a
retrouvé également de bonnes performances du
FibroScan
®
pour le diagnostic de brose au cours de
la NASH. L’inconvénient principal du FibroScan
®
est son

dossier thématique
taux d’échec plus élevé chez les malades obèses (entre
5 et 30 % selon les séries). Une sonde spéciale pour les
patients obèses est à l’étude.
FibroTest®, ActiTest®, NashTest®
L’étude de Poynard et al. a évalué la valeur diagnos-
tique de marqueurs biochimiques (NashTest®) pour
le diagnostic de NASH au cours de la stéatose non
alcoolique (13). Il s’agit d’une combinaison de dix
marqueurs (α2-macroglobuline, haptoglobine, apo-
lipoprotéine A1, bilirubine totale, γGT, ASAT, ALAT,
glycémie à jeun, triglycérides, cholestérol) ajustés
sur l’âge, le sexe, le poids et la taille du patient (www.
biopredictive.com/services/tests/nashtest). Le dia-
gnostic est exprimé en trois classes : N0, pas de NASH ;
N1, NASH possible ; N2, NASH certaine (gure 5). Ce
test n’est pas réalisable en cas d’hémolyse, d’hépa-
tite aiguë, d’inammation aiguë ou de cholestase,
et il n’est pas validé chez les patients transplantés.
Pour évaluer l’existence et l’intensité des lésions de
stéatose, le SteatoTest
®
(Biopredictive) a également
été validé au cours de la stéatose non alcoolique.
La sévérité de la stéatose est exprimée en quatre
classes (S0-S4), les classes S3 et S4 correspondant à
une stéatose de plus de 33 %, c’est-à-dire un seuil à
partir duquel l’échographie dépiste aussi la stéatose
avec une excellente sensibilité. Le FibroTest® a éga-
lement été validé pour le diagnostic de brose au
cours de la stéatose hépatique non alcoolique avec
de bonnes performances diagnostiques, en particulier
pour le diagnostic de brose en pont ou de cirrhose
(gure 4) [14].
Quand surseoir à la biopsie ?
Beaucoup de raisons conduisent à éviter la biop-
sie. Outre son caractère invasif et ses complications
potentielles, c’est un examen cher, limité par le risque
d’erreurs d’échantillonnage (9). Au cours de l’hépa-
tite C, Poynard et al. ont suggéré que les marqueurs
biochimiques seraient moins souvent source d’er-
reurs qu’une biopsie de petite taille ou fragmentée
pour l’évaluation de la fibrose. Pour ces différentes
raisons, beaucoup de marqueurs indirects ont été
proposés pour le diagnostic de NASH afin de discri-
miner les patients ayant une stéatose pure des autres
ayant une NASH, candidats à la biopsie. Les tests non
invasifs, précédemment cités, sont intéressants mais
ne suffisent pas à remplacer l’analyse histologique.
À ce jour, la biopsie hépatique reste le gold-standard
pour le diagnostic de stéatopathie dysmétabolique.
Figure 2. Mesure non invasive de la brose hépatique par élastométrie : FibroScan® (Echosens, Paris).
Figure 3. Valeurs d’élastométrie en fonction de la sévérité de la brose chez 97 patients ayant une NAFLD histolo-
giquement prouvée (d’après Yoneda et al. Gut 2007).
Élasticité (kPa) IC95
F0 4,850 ± 0,893 4,406-5,294
F1 7,382 ± 2,432 6,439-8,325
F2 9,283 ± 3,492 7,809-10,758
F3 13,333 ± 4,712 10,990-15,677
F4 25,344 ± 6,058 20,687-30,001
F0 F1 F2 F3 F4
Stade de fibrose
Élasticité (kPa)
0
30
20
10
40
Figure 4. Performances diagnostiques du FibroTest® pour le diagnostic de brose avancée (AUROC : 0,81) [A] ou de
brose en pont ou cirrhose (AUROC : 0,88) [B] (d’après Ratziu et al.).
0,00 0,500,25
A
Spécificité
Sensibilité
0,75 1,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
0,00 0,500,25
B
Spécificité
Sensibilité
0,75 1,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
 6
6
1
/
6
100%