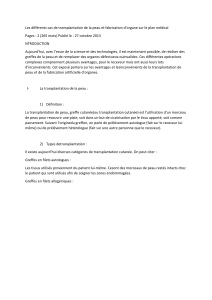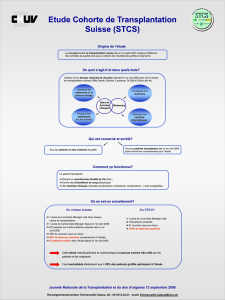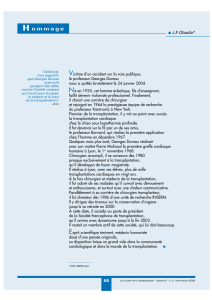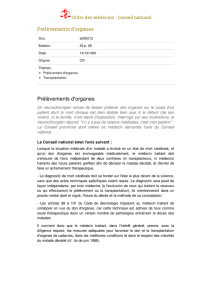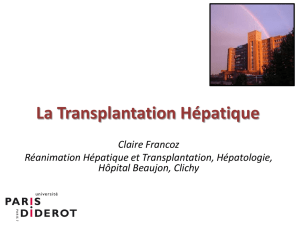Prise en charge des transplantés hépatiques D

DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 4 - vol. IV - septembre 2001 195
Prise en charge des transplantés hépatiques
au cours de la première année post-greffe
!G.P. Pageaux*
a transplantation hépatique est maintenant le trai-
tement de référence des hépatopathies chroniques
graves et des hépatites fulminantes. Selon le registre européen
de la transplantation hépatique, la survie des patients à un an
et à trois ans est respectivement de 78 % et 72 % ; de même,
la survie du greffon hépatique est respectivement de 71 % et
64 % (1). Cela signifie que la mortalité et la morbidité sont
maximales pendant la première année qui suit la greffe, et
notamment pendant les trois premiers mois. De plus, certaines
complications survenant au cours de la première année peu-
vent avoir des conséquences sur le fonctionnement à long
terme du greffon, mais également sur la morbidité extrahépa-
tique et notamment sur le risque cardiovasculaire.
Dans ce chapitre, nous aborderons les complications qui sur-
L
*Service d’hépato-gastroentérologie, hôpital Saint-Éloi, CHU Montpellier.
POINTS FORTS
Durant la période postopératoire précoce, les trois compli-
cations pouvant conduire à une retransplantation hépatique
en super urgence sont : la non fonction-primaire du gref-
fon, la thrombose de l’artère hépatique et le rejet hyper-
aigu.
"À la fin de la première semaine, le rejet aigu, les infections
et les complications biliaires constituent les complications les
plus fréquentes. La surveillance du patient jusqu’à la sortie de
l’hôpital doit être clinique, biologique (1 à 3 bilans quotidiens)
et morphologique avec un écho-doppler abdominal au mini-
mum bi-hebdomadaire afin de surveiller la perméabilité de l’ar-
tère hépatique.
"Durant la première année, la majorité des patients reçoi-
vent une immunosuppression associant un inhibiteur de la
calcineurine (ciclosporine A ou tacrolimus), poursuivi indé-
finiment et un corticostéroïde dont l’interruption peut être
proposée entre 6 mois et un an après la transplantation hépa-
tique en raison de ses effets secondaires.
"Le médecin généraliste et le patient doivent être informés
des interactions médicamenteuses fréquemment constatées
avec les immunosuppresseurs.
Les conseils hygiéno-diététiques remis au patient par les méde-
cins à la sortie de l’hôpital sont fondamentaux pour le main-
tien d’une survie à court terme, mais aussi à long terme, du
patient : l’arrêt du tabac doit être obtenu en raison du risque
accru de cancer ORL, la consommation d’alcool est décon-
seillée, le patient doit être informé des risques d’excès pondé-
ral après transplantation hépatique.
"Le suivi d’un transplanté hépatique nécessite, dès la pre-
mière année, une collaboration étroite entre le médecin trai-
tant du patient, l’hépato-gastroentérologue ayant adressé le
patient au centre de transplantation hépatique et les médecins
de ce centre, afin de pouvoir proposer, dès le deuxième tri-
mestre post-transplantation hépatique, un suivi en alternance.
Le développement des séminaires de formation continue sur
le suivi des transplantés hépatiques devrait permettre d’amé-
liorer la qualité de la prise en charge des patients.
POINTS FORTS

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 4 - vol. IV - septembre 2001
196
DOSSIER THÉMATIQUE
viennent dans la période postopératoire précoce, puis nous déve-
lopperons le suivi et la prise en charge du patient transplanté hépa-
tique depuis sa sortie de l’hôpital jusqu’à la fin de la première année.
PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE PRÉCOCE
Elle couvre la période qui s’étend de la fin du geste chirurgical jus-
qu’à la sortie du patient de l’hôpital. Une fois l’intervention termi-
née, le patient est transféré en réanimation puis, dès qu’il est extubé,
et en l’absence de défaillance viscérale telle qu’une insuffisance
rénale nécessitant une prise en charge en dialyse, il va en unité de
soins continus et/ou en chambre dans le service de chirurgie ou d’hé-
patologie.
Le traitement immunosuppresseur est instauré pendant et au décours
de l’intervention chirurgicale. Plusieurs types de médicaments peu-
vent être utilisés : un inhibiteur de la calcineurine (ciclosporine ou
tacrolimus), un médicament bloquant la prolifération cellulaire (aza-
thioprine ou mycophénolate mofétil), un corticoïde, un anticorps
monoclonal anti-CD25, c’est-à-dire bloquant le récepteur de l’in-
terleukine 2 (basiliximab ou daclizumab), des globulines antilym-
phocytaires polyclonales (2). Actuellement, tout protocole immu-
nosuppresseur en transplantation hépatique comporte un inhibiteur
de la calcineurine, ciclosporine ou tacrolimus, et le plus souvent des
corticoïdes.
Durant cette période, plusieurs types de complications peuvent sur-
venir. Trois complications très précoces nécessitent le plus souvent
une retransplantation hépatique en super urgence : la non-fonction
primaire du greffon, la thrombose de l’artère hépatique, le rejet
hyperaigu.
La non-fonction primaire
Elle survient dans environ 3 % des cas et le seul facteur de risque
unanimement reconnu est la stéatose macrovésiculaire du greffon
supérieure à 50 % (3). Elle se traduit par une insuffisance hépatique
grave avec cytolyse majeure, souvent supérieure à 100 fois la nor-
male, et facteurs de coagulation effondrés. Une acidose métabo-
lique, une hypoglycémie et une insuffisance rénale aiguë sont sou-
vent associées. Il existe des formes mineures de dysfonctionnement
précoce du greffon, se traduisant par une activité sérique des trans-
aminases très élevée et une remontée lente des facteurs de coagu-
lation ainsi qu’une correction lente de l’acidose métabolique. Ce
type de dysfonctionnement récupère habituellement, mais expose
le patient à des complications infectieuses générales.
La thrombose de l’artère hépatique
C’est la complication vasculaire la plus fréquente, survenant dans
5 à 10 % des cas (4). Lorsqu’elle survient dans les 8 premiers jours
de la transplantation, elle se traduit par une insuffisance hépatique
aiguë. Si elle est diagnostiquée précocement, une désobstruction
artérielle peut être tentée, mais cette thrombose nécessite le plus
souvent une retransplantation en urgence.
Le rejet hyperaigu
Il s’agit d’un rejet à médiation humorale entraînant une nécrose
hémorragique du greffon et une thrombose vasculaire, aussi bien
artérielle que veineuse. Il survient essentiellement dans les situa-
tions de transplantation hépatique anisogroupe (groupe sanguin
ABO incompatible) rendue nécessaire en cas d’hépatite fulmi-
nante grave (5). Biologiquement, il existe des stigmates d’insuf-
fisance hépatique aiguë sévère, et là encore, la retransplantation
est souvent nécessaire en urgence.
D’autres complications peuvent survenir au cours de la première
semaine. Il s’agit essentiellement de complications hémorra-
giques qui se présentent dans environ 10 à 15 % des cas. Elle sont
souvent secondaires à un problème technique vasculaire et sont
favorisées par des troubles de l’hémostase, qu’il s’agisse d’un
dysfonctionnement du greffon, ou d’une normalisation tardive
des facteurs de coagulation. Une laparotomie exploratrice est sou-
vent nécessaire. Des complications générales peuvent également
survenir (6),la plus fréquente étant l’insuffisance rénale qui, pen-
dant cette période, est multifactorielle : troubles hémodynamiques
peropératoires, transfusion massive peropératoire, hypovolémie
circulante efficace, utilisation de médicaments immunosuppres-
seurs néphrotoxiques et notamment les anticalcineurines.
À LA FIN DE LA PREMIÈRE SEMAINE
À la fin de la première semaine, les complications observées peu-
vent être : le rejet aigu, les infections, et les complications biliaires.
Le rejet aigu
Il s’agit d’un rejet à médiation cellulaire. Il est le plus souvent
décrit entre le 7eet le 21ejour après la greffe (7-9). La définition
du rejet est à la fois biologique – augmentation de l’activité
sérique des aminotransférases et/ou cholestase –, histologique
avec mise en évidence d’une triade spécifique (infiltrat portal
polymorphe, endothélite, infiltrat lymphocytaire de l’épithélium
des canaux biliaires), et parfois clinique avec une fièvre et une
sensation de tension du greffon. Il est usuel de ne traiter que les
rejets histologiques avec anomalies des tests biologiques hépa-
tiques et cela se produit dans environ 30 à 50 % des cas. Le pro-
tocole habituel comporte des bolus de 1 g de méthylprednisolone
administrés 1 à 3 fois. En cas d’absence de réponse après admi-
nistration de ces bolus, on parle de rejet aigu corticorésistant. Si
le patient est sous ciclosporine, le traitement du rejet aigu corti-
corésistant consiste à substituer le tacrolimus à la ciclosporine.
Si le patient est déjà sous tacrolimus, et que l’augmentation des
posologies de tacrolimus est insuffisante, on utilise des anticorps
monoclonaux dirigés contre le récepteur des lymphocytes T
(OKT3). Avec l’utilisation de ces protocoles, il est actuellement
exceptionnel de rencontrer des rejets corticorésistants évoluant
vers une chronicité et nécessitant une retransplantation.

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 4 - vol. IV - septembre 2001 197
DOSSIER THÉMATIQUE
Les infections
Elles représentent la première cause de mortalité après la trans-
plantation. Le risque infectieux dépend de l’état du patient avant la
transplantation et notamment de son état nutritionnel, de l’intensité
du traitement immunosuppresseur, et de l’éventuelle transmission
de l’agent infectieux par le greffon.
!Les infections bactériennes
Elles sont décrites chez près de 40 % des malades et les germes les
plus souvent rencontrés sont d’abord le staphylocoque doré, puis
les bacilles Gram négatifs (10). Il ne faut pas attendre la survenue
des signes cliniques, et notamment de la fièvre, pour diagnostiquer
ces infections bactériennes et des prélèvements multiples sont effec-
tués systématiquement 1 à 2 fois par semaine.
!Les infections virales
Elles sont surtout dues à des virus du groupe Herpès et notamment
au cytomégalovirus (CMV). Il peut s’agir soit d’une primo-infec-
tion transmise par le donneur ou les transfusions, soit d’une réacti-
vation d’une infection latente sous l’influence du traitement immu-
nosuppresseur. On distingue habituellement l’infection à CMV qui
se traduit par la mise en évidence d’une virémie ou d’une antigé-
némie CMV pp65, de la maladie à CMV avec atteinte viscérale
(greffon hépatique, tube digestif) associée à une fièvre et à une leu-
copénie. Chez les malades à haut risque (donneur+/receveur-, forte
immunosuppression), un traitement préventif par ganciclovir p.o.,
3 g/j, peut être proposé (11). Le traitement curatif repose sur le gan-
ciclovir i.v., 10 mg/kg/j adapté à la fonction rénale, pendant une
durée de 2 à 3 semaines.
!Les infections parasitaires
Du fait de l’immunodépression, l’infection parasitaire la plus fré-
quemment retrouvée est due au Pneumocystis carinii même si en
termes de fréquence, elle ne dépasse pas 5 % (12). L’intensité du
traitement immunosuppresseur et notamment la majoration de celui-
ci en cas de rejet aigu corticorésistant, est le principal facteur de
risque. Elle se manifeste habituellement par une fièvre et une
hypoxie. Le diagnostic est fait par le lavage broncho-alvéolaire et
le traitement repose sur le cotrimoxazole.
Les complications biliaires
Ce sont les complications techniques les plus fréquentes ; elles sur-
viennent avec une fréquence comprise entre 10 et 30 % (13). On
distingue les fistules et les sténoses biliaires. Les fistules biliaires,
essentiellement décrites au niveau du site de l’anastomose cholé-
docho-cholédocienne, se révèlent par un cholépéritoine. Les sté-
noses peuvent être anastomotiques ou non anastomotiques, se mani-
festant soit par une cholestase biologique isolée, soit par une
angiocholite avec fièvre et cytolyse biologique. Le diagnostic repose
habituellement sur l’opacification directe des voies biliaires, qu’elle
soit faite par voie endoscopique rétrograde ou par voie transparié-
tale, mais la cholangiographie IRM est en cours d’évaluation. Il faut
s’assurer de la perméabilité de l’artère hépatique en cas de compli-
cations biliaires car, à côté des manifestations cliniques bruyantes
décrites précédemment, la thrombose de l’artère hépatique peut se
constituer à bas bruit, sans conséquence sur la fonction hépatique,
et du fait de son rôle dans la vascularisation de l’arbre biliaire, se
révéler plus tardivement par des sténoses non anastomotiques de
type ischémique. Le traitement des complications biliaires peut être
soit chirurgical, soit médical, notamment par la mise en place de
drains et de prothèses biliaires.
Pendant toute cette période postopératoire précoce, la surveillance
est bien sûr clinique, mais essentiellement biologique avec, pen-
dant la première semaine, trois bilans quotidiens, puis, à partir de
la deuxième semaine, un bilan biologique quotidien, des
recherches systématiques d’infections bactérienne et virale, un
écho-doppler bi-hebdomadaire au début, avec artériographie au
moindre doute sur la perméabilité de l’artère hépatique et, enfin,
une biopsie hépatique en cas d’anomalie des tests biologiques
hépatiques et de l’écho-doppler.
LE SUIVI DU PATIENT TRANSPLANTÉ HÉPATIQUE
APRÈS LA PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE
La sortie de l’hôpital se fait habituellement entre le 20eet
le 30ejour. La situation est alors la suivante : le patient est déper-
fusé, porteur dans certains cas d’un drain biliaire de Kehr tutéri-
sant l’anastomose cholédocho-cholédocienne, clampé, et qui sera
définitivement enlevé au troisième mois. Cliniquement, il peut
persister une ascite et un épanchement pleural droit et biologi-
quement des stigmates de l’hypersplénisme préopératoire et,
notamment, une thrombopénie.
Le rythme de surveillance va être hebdomadaire jusqu’à la fin du
deuxième mois, puis bi-mensuel jusqu’à la fin du quatrième mois,
puis mensuel jusqu’à la fin de la première année. Lors de toute
consultation, sont réalisés un examen clinique avec systématique-
ment prise de la tension artérielle en position assise ou allongée avec
un repos de 15 mn, détermination du poids et de la taille, recherche
d’adénopathies périphériques et d’organomégalie, et des examens
biologiques : tests biologiques hépatiques, ionogramme sanguin,
détermination de la glycémie et de la créatininémie, dosage sanguin
de la concentration de l’inhibiteur de la calcineurine (ciclosporiné-
mie ou tacrolémie). Pendant cette première année, il est usuel de
faire une électrophorèse et une immunoélectrophorèse des protéines,
ainsi qu’une sérologie de l’Epstein-Barr virus tous les 3 mois, et un
bilan biologique lipidique, un dosage de l’uricémie et une détermi-
nation de la clairance de la créatinine tous les 6 mois.
Les objectifs de ce suivi vont être d’adapter le traitement immu-
nosuppresseur, de mettre en place des règles hygiéno-diététiques,
de diagnostiquer les rares cas de rejets et les complications
biliaires éventuelles, de diagnostiquer le plus précocement pos-
sible la récidive éventuelle de la maladie initiale sur le greffon,
d’apprécier enfin le retentissement psychologique et la réhabili-
tation personnelle et socioprofessionnelle du patient transplanté.

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 4 - vol. IV - septembre 2001
198
DOSSIER THÉMATIQUE
Le traitement immunosuppresseur
Jusqu’à présent, les protocoles d’immunosuppression étaient stan-
dardisés pour tous les patients, mais il semble que l’on s’achemine
maintenant vers des traitements “à la carte” adaptés à chaque patient.
Le but est d’employer les médicaments immunosuppresseurs à la
dose minimum efficace, suffisante pour éviter les phénomènes de
rejet, sans en payer le prix par des effets secondaires trop impor-
tants. Ainsi, une altération de la fonction rénale à la fin du 6emois
est souvent prédictive du développement d’une insuffisance rénale
chronique à long terme. Pendant cette période, la majorité des centres
utilisent une bithérapie immunosuppressive associant un inhibiteur
de la calcineurine et un cortico-stéroïde (14,15). Les concentrations
sanguines habituellement requises pour les inhibiteurs de la calci-
neurine sont comprises entre 100 et 200 ng/ml pour la ciclosporine
et entre 5 et 10 ng/ml pour le tacrolimus par méthode de dosage
RIA monoclonal. La tendance actuelle est de baisser rapidement les
corticoïdes en essayant de les arrêter au bout de 6 mois à un an dans
le but de diminuer leurs effets secondaires à long terme.
Il faut être très attentif aux interactions médicamenteuses qui peuvent
survenir avec les médicaments immunosuppresseurs (tableau I). Cela
doit se faire en lien étroit avec le médecin généraliste et l’hépato-gas-
troentérologue, qui peuvent être amenés à suivre le patient. Les anti-
calcineurines étant métabolisés par le système enzymatique du cyto-
chrome P450 3A4, la coadministration de médicaments qui inhibent
ou stimulent cette isoenzyme influence le métabolisme des antical-
cineurines. Ainsi, l’utilisation des antibiotiques et des antifungiques
doit être encadrée (tableau I). D’autre part, les anti-inflammatoires
non stéroïdiens sont absolument proscrits du fait du risque de majo-
ration de néphrotoxicité des anticalcineurines. Lorsque des médica-
ments inhibiteurs de la synthèse cellulaire comme le mycophénolate
mofétil sont utilisés, la prescription d’allopurinol, qui peut être indi-
quée en cas d’hyperuricémie, fréquente chez ces patients, peut être
responsable d’une augmentation des risques de myélotoxicité (16).
Règles hygiéno-diététiques
Il faut encourager l’arrêt de toute consommation de tabac, notam-
ment en raison du risque accru de cancer de la sphère ORL, notam-
ment chez les patients qui ont été transplantés pour cirrhose alcoo-
lique (17).
La consommation d’alcool doit être nulle chez les patients trans-
plantés pour cirrhose alcoolique, et encadrée chez les autres patients,
en proposant les règles usuelles de consommation, à savoir de ne
pas dépasser 20 g d’alcool par jour chez la femme et 30 g chez
l’homme.
Des règles alimentaires doivent être proposées. En effet, la prise
de poids est quasi constante chez les patients transplantés hépa-
tiques et elle apparaît essentiellement au cours de la première
année. On admet que 20 % des patients auront un index de masse
corporelle supérieur à 30. De même, l’hypertriglycéridémie et
l’hyperglycémie sont fréquemment décrites au cours de la pre-
mière année, allant de pair avec le surpoids. Il faut donc propo-
ser des régimes pauvres en sucres rapides et en graisses animales
afin de limiter ce type d’effets secondaires. Une prise en charge
commune avec une diététicienne peut s’avérer extrêmement utile
(18). Enfin, une activité sportive doit être recommandée (19).
Il n’existe aucune contre-indication à la pratique du sport chez
un patient transplanté hépatique. Cela va de pair avec les règles
diététiques citées.
Le rejet
Après le premier mois postopératoire, les épisodes de rejet aigu sont
rares et il faut rappeler que le rejet chronique, qu’il fasse suite à des
rejets aigus incomplètement résolutifs ou qu’il apparaisse d’emblée
sous cette forme, est rare après transplantation hépatique, survenant
chez moins de 5 % des patients adultes. Les épisodes de rejet aigu
surviennent souvent dans un contexte d’immunosuppression trop
faible (et il faut alors augmenter la posologie) ou de mauvaise obser-
vance thérapeutique. L’hépatopathie initiale est un élément impor-
Augmentation Diminution Majoration toxicité
de la concentration sanguine de la concentration sanguine
Antibiotiques Macrolides Rifampicine Aminosides (rein)
Antifongiques Kétoconazole Amphotéricine B
Fluconazole (i.v.)
Itraconazole
Anti hypertenseurs Nicardipine
AINS Tous (rein)
Divers Naringénine Phénobarbital Diurétiques hyperkaliémiants
(jus de pamplemousse) Phénytoïne
Carbamazépine
Tableau I. Principales interactions médicamenteuses avec les anticalcineurines.

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 4 - vol. IV - septembre 2001 199
DOSSIER THÉMATIQUE
tant à prendre en compte : en effet, il a été démontré que les rejets
sont plus souvent observés chez les patients transplantés pour mala-
die auto-immune telle que la cirrhose auto-immune elle-même ou
la cirrhose biliaire primitive, lorsqu’on les compare notamment aux
patients transplantés alcooliques (20).
Les complications biliaires
Qu’il s’agisse de la pérennisation de complications biliaires appa-
rues dans la période postopératoire précoce ou de complications
de novo, elles représentent la principale complication mécanique
à distance de la transplantation. À ce stade, ce sont surtout les
sténoses non anastomotiques qui posent problème, pouvant aller
jusqu’à réaliser un tableau de cholangite sclérosante secondaire.
L’indication d’opacification biliaire doit être posée avec soin en
raison du risque infectieux et la prise en charge doit être absolu-
ment multidisciplinaire, faisant intervenir chirurgiens, radio-
logues et endoscopistes afin d’éviter une évolution toujours pos-
sible vers une cirrhose biliaire secondaire nécessitant une
retransplantation hépatique (21).
La récidive de la maladie initiale
!Cirrhose virale C. Chez les malades transplantés pour une cir-
rhose virale C, la récidive virologique est quasi constante, et
l’ARN viral est retrouvé dans le sérum dans 90 à 100 % des cas
au cours de la première année qui suit la greffe. Quant à la réci-
dive histologique, une hépatite chronique est décrite chez 80 %
et une cirrhose chez 10 % des patients à 5 ans (22). Au cours de
la première année, cette récidive peut être soit asymptomatique
sur le plan biologique, soit se manifester par une cytolyse pré-
dominant sur les ALAT comme chez le patient immunocompé-
tent. Dans ce cas-là une biopsie du greffon permettra de mettre
en évidence, au stade aigu de la récidive, le plus souvent une hépa-
tite lobulaire. Quoi qu’il en soit, chez ces patients, une biopsie
sera nécessaire au minimum à un an après la transplantation hépa-
tique. L’intérêt de biopsies plus précoces est à discuter, notam-
ment en fonction du choix thérapeutique qui va être fait, à savoir,
traitement préventif ou traitement curatif de la récidive virale C.
Dans les deux cas, il s’agira d’une association interféron et riba-
virine, en prenant en compte le risque de rejet lié à l’utilisation
de l’interféron chez des patients transplantés (23).
!Cirrhose post-virale B. Les patients transplantés pour cirrhose
post-virale B auront un traitement prophylactique de cette réci-
dive adapté à leur statut réplicatif pré-greffe (24, 25). S’il s’agit
de patients qui étaient non réplicants avant la transplantation avec
un ADN négatif en hybridation in situ, ils vont recevoir après la
greffe des immunoglobulines anti-HBs afin de maintenir un taux
d’anticorps au minimum supérieur à 100. S’ils étaient réplicants
avant la transplantation, et négativés sous lamivudine, toujours
avant la transplantation, la lamivudine sera continuée après la
transplantation en plus des immunoglobulines anti-HBs, mais en
essayant alors d’avoir un taux d’anticorps plus élevé habituelle-
ment supérieur à 500. Il est usuel actuellement de poursuivre l’im-
munoprophylaxie passive plus ou moins associée à la lamivudine
indéfiniment. En effet, lorsqu’elle survient, la récidive virale B
est toujours grave, avec possibilité d’hépatite fulminante ou d’évo-
lution rapide vers la cirrhose.
!Cirrhose alcoolique. La récidive d’une consommation d’alcool
après transplantation hépatique, si elle ne semble pas responsable
à court terme de complications sur le fonctionnement du greffon,
pose des problèmes éthiques évidents. Elle est estimée au cours
de la première année entre 8 et 25 %, mais il faut noter que les
critères utilisés pour diagnostiquer cette récidive sont très divers
en fonction des études (26). Quoi qu’il en soit, un suivi alcoolo-
gique est nécessaire, à notre sens, chez tous les patients trans-
plantés pour cirrhose alcoolique. Le risque de récidive doit être
assumé au même titre que celui de la récidive virale. Il y a encore
un débat pour savoir si cette récidive est plus facilement dia-
gnostiquée par les membres de l’équipe de transplantation qui
suivent le patient ou par des membres extérieurs de type psy-
chologues ou psychiatres (27).
!Cirrhose biliaire primitive. Il est acquis maintenant que la cir-
rhose biliaire primitive peut récidiver, mais cette récidive survient
habituellement au-delà de la cinquième année (28).
!Cholangite sclérosante primitive. La cholangite sclérosante pri-
mitive peut récidiver. Le tableau est alors strictement identique à
celui de la cholangite sclérosante secondaire et ischémique pré-
cédemment décrite. Ce diagnostic différentiel peut être difficile
(29). Un point particulier concernant la cholangite sclérosante
primitive est celui de la plus grande fréquence de cancers coliques
décrits après transplantation hépatique dans cette indication et ce,
notamment du fait de l’association avec la rectocolite hémorra-
gique. Une coloscopie est donc indiquée de façon annuelle chez
ces patients.
!La cirrhose auto-immune. Elle peut récidiver sur le greffon et,
comme nous l’avons dit plus haut, il y a un risque de rejet aigu
tardif ou de rejet chronique augmenté chez les patients trans-
plantés pour cirrhose auto-immune. Chez ces patients, il faudra
donc être très prudent quant à la décroissance du traitement immu-
nosuppresseur et, notamment, des corticoïdes (30).
!Le carcinome hépatocellulaire. Chez les patients transplantés
pour carcinome hépatocellulaire, le diagnostic de la récidive doit
être le plus précoce possible. Ainsi, le dosage sérique de l’alpha-
fœtoprotéine est mensuel et des examens morphologiques sont
faits tous les 4 à 6 mois avec, notamment, scanner thoraco-abdo-
minal. Le problème reste entier concernant le traitement de ces
récidives qui peut être chirurgical en cas de récidive localisée, et
pour lesquelles les chimiothérapies par voie générale sont peu
efficaces (31).
La qualité de vie et le retentissement psychologique
Globalement, toutes les études portant sur la qualité de vie et la réha-
bilitation après transplantation hépatique concluent que celles-ci
 6
6
 7
7
1
/
7
100%