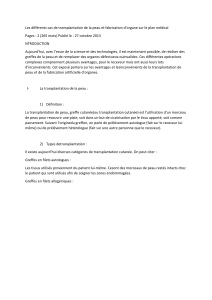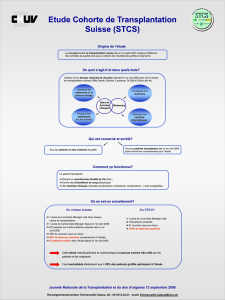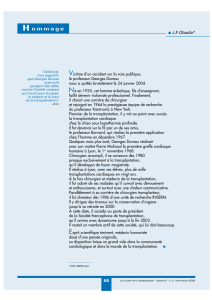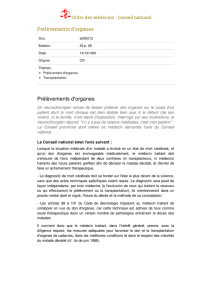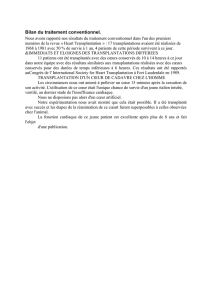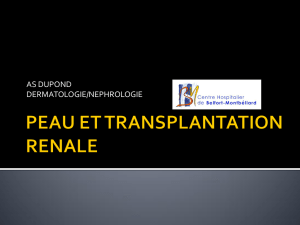L La qualité de vie chez le transplanté »

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 91
La vie du transplanté
»Les études de la qualité de vie (QDV) montrent une amélioration
progressive de la santé physique et de sa perception générale chez
la plupart des transplantés. L’état psychologique peut avoir un effet
direct ou indirect sur les résultats de la transplantation, en augmentant
l’incidence des complications et/ou en réduisant l’observance des
recommandations médicales. L’évaluation de la QDV est donc devenue
primordiale avant et après la greffe, tant à court terme qu’à long
terme, et devrait être intégrée à la pratique dans les centres de
transplantation. Quand bien même le concept de “QDV liée à l’état
de santé” n’est ni complètement développé ni unanimement reconnu,
les mesures génériques ou spécifiques de l’état de santé apportent
une dimension nouvelle et intéressante à l’évaluation de l’état sanitaire
de la population des transplantés. Toutefois, le concept de QDV liée
à l’état de santé doit être amélioré. D’autres instruments de mesure
de la QDV des transplantés doivent être développés et évalués. Il
conviendrait à terme de disposer de questionnaires génériques
complétés de questionnaires spécifiques aux transplantés, ce qui
permettrait des comparaisons avec d’autres groupes d’individus, et
ce en regard des normes de la population générale.
Mots-clés : Transplantation – Qualité de vie.
Studies of the quality of life (QOL) of transplant patients show a progressive
improvement of the physical health and the general health perception
for most transplant recipients. The psychological status can have a direct
or indirect impact on the results of transplantation while increasing the
incidence of complications and/or lowering the compliance to the medical
recommendations. The assessment of QOL became therefore primordial
before and after the transplantation, at short-term as well as at long-
term, and should be integrated in the practice of transplantation centers.
Although the concept of QOL is not fully developed and not unanimously
acknowledged, generic and specific measurements of QOL can contribute
to providing additional, and useful, outcome measures in the transplant
recipients’ population. Finally, the concept of QOL must be improved.
Instruments to measure the QOL of transplant recipients must also be
developed and validated. A combination of a short portable generic
instrument with questions more specific to the transplant population
is probably the best choice, allowing comparisons with other groups of
individuals and population norms.
Keywords: Transplantation – Quality of life.
La qualité de vie chez le transplanté
Quality of life of organ transplant patients
Vincent Karam (Centre hépatobiliaire, hôpital Paul-Brousse ; unité Inserm U785, université Paris Sud, Villejuif)
L
a transplantation d’organe a connu un essor
considérable ces 10 dernières années, ce qui
s’explique par une meilleure prise en charge
médico-clinique précoce des patients, se traduisant
par une diminution des risques opératoires et par un
meilleur contrôle des phénomènes de rejet aigu, des
risques d’infection, et de certaines récidives. Un rapport
du registre américain United Network for Organ Sharing
(UNOS) [www.unos.org] a montré que, outre le coût de
la greffe, plus de 5 milliards de dollars sont dépensés
annuellement pour financer le suivi des transplantés.
L’attention des professionnels de la transplantation
se porte désormais vers l’amélioration du suivi à long
terme des transplantés. Parce que la sévérité de l’état tel
que perçue par le clinicien ne correspond pas toujours
au vécu du patient, l’évaluation de la QDV ne saurait être
le seul fait des cliniciens : elle doit également prendre
en compte le ressenti des patients. Il faut donner la
parole aux transplantés et les faire participer à la mise
au point des instruments de mesure. La transplantation
est vécue comme un “rituel de mort et renaissance pour
une nouvelle vie”. Le retour à une activité physique,
aux rapports sociaux et au travail après la transplan-
tation peut aussi être associé à un stress psychopatho-
logique. D’après le registre européen European Liver
Transplant Registry (ELTR) [www.eltr.org], entre 1989
et 2009, le nombre de transplantés hépatiques (TH) en
Europe a presque quadruplé, passant de 1 698 à 6 143
par an. La survie à 1 an est passée de 64 % en 1986 à
85 % après 2004 (1). Il n’y a donc pas de doute que la
transplantation augmente la durée de vie, mais, face à
la pénurie de greffons, la communauté des transplan-
teurs doit également tenter d’identifier les patients qui
pourraient le mieux bénéficier de ces organes. La mise
au point et l’utilisation régulière des outils de mesure
de la QDV sont donc fondamentales dans la pratique
de la transplantation.
Définition
Intuitivement, la QDV est une notion individuelle à
laquelle chacun peut donner sa propre définition.
Celle-ci varie en fonction de l’importance que l’individu
donne aux différents aspects de sa vie (santé, famille,
RésuméSummary

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
92
La vie du transplanté
finances, environnement, etc.), à ses attentes, sa culture et son expérience. Il n’y a
donc pas de consensus quant à une définition universellement acceptée, même
si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la QDV comme étant “non
seulement l’absence de maladie, mais aussi la présence d’un bien-être physique,
mental et social”. Le concept de QDV est donc difficile non seulement à définir, du
fait de son aspect multidimensionnel, mais aussi à quantifier.
Méthodologie de l’évaluation
L’instrument
Parce que beaucoup de composantes de la QDV ne peuvent pas être observées
directement, elles sont habituellement évaluées d’après les principes classiques
de la théorie de mesure d’items (groupe de questions) [2]. Le choix de l’instrument
(questionnaire) est primordial. Une revue systématique récente des instruments
mis en œuvre pour l’évaluation de la QDV des TH a identifié 128 études per-
tinentes ayant utilisé plus de 50 instruments différents (3). Les instruments
génériques sont les plus communément utilisés et, parmi eux, le Medical
Outcomes Study Short Form-36 (SF-36), la Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) et le Beck Depression Inventory (BDI) arrivent en tête de la liste.
Ils ont le mérite d’exister en plusieurs langues, ce qui permet de réaliser des
études comparatives au niveau international. Peu d’études (16 %) ont utilisé
des instruments spécifiques à une pathologie. Le questionnaire du National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), le
Liver Disease Quality of Life questionnaire, et le Chronic Liver Disease
questionnaire sont les instruments spécifiques les plus fréquem-
ment utilisés. Cependant, ils ont été conçus pour évaluer la
QDV dans le cas d’une maladie hépatique chronique plutôt
que spécifiquement chez les TH. L’absence d’un instrument
standard pour les transplantations hépatiques représente
un obstacle pour réaliser des études comparatives dans
cette population en constante évolution.
Le schéma d’étude
Il faut faire primer l’étude longitudinale prospective,
où le sujet est son propre témoin (évaluation avant et,
périodiquement, après la transplantation), sur l’enquête
transversale rétrospective. L’étude longitudinale se carac-
térise par son aspect dynamique, analysant les résultats en
termes de détérioration ou d’amélioration de chaque score.
Dans la littérature, les études longitudinales sont plus rares que
les études transversales, et la majorité d’entre elles s’arrêtent à la
première année suivant la transplantation hépatique. Quel que soit le
schéma de l’étude, longitudinale ou transversale, la comparaison des scores à
ceux d’une population témoin appariée à la cohorte étudiée suivant des critères
comme l’âge et le sexe permet de mesurer l’évolution vers une “normalité” de la QDV.
Résultats des études
Études longitudinales
Une revue récente de la littérature sur la QDV après transplantation hépatique a
identifié 44 études longitudinales valides, représentant 7 % de la globalité des articles
étudiés. L’analyse des données regroupées de ces 44 études, portant sur 4 381 malades

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 93
adultes âgés en moyenne de 45 ans et sur un délai de suivi
moyen de 25 mois, a montré une amélioration considé-
rable, après transplantation hépatique, de la QDV géné-
rale, dans le domaine social ainsi que dans les domaines
de la santé physique et de la santé psychologique, mais
pas dans celui de la sexualité (figure 1) [4]. Nous avons
utilisé le questionnaire NIDDK, considéré comme l’ins-
trument spécifique le plus adapté aux transplantés, pour
réaliser une étude longitudinale de la QDV des TH (5). La
validation de la version française, testée au préalable
dans une cohorte de 315 TH, a montré sa sensibilité et
sa fiabilité. Le taux d’observance obtenu était de 93 %, et
l’analyse des données a montré une amélioration consi-
dérable dans les 5 domaines de la QDV mesurés (figure 2).
Comparativement à l’état précédant la transplantation, les
malades ont rapporté peu de symptômes liés à la maladie
1 an après l’intervention. Cependant, nous avons noté
une incidence statistiquement significative de l’excès
d’appétit, des tremblements et des maux de tête. Ces
symptômes peuvent être considérés comme des effets
indésirables des traitements immunosuppresseurs. La
perception générale de la santé s’est 7 fois plus améliorée
qu’elle ne s’est dégradée, et le retour au travail est devenu
possible pour 28 % des patients. Il a été rapporté qu’un
patient âgé de moins de 50 ans et qui avait un emploi
dans l’année précédant la transplantation hépatique
était plus susceptible de reprendre le travail. Ces données
doivent cependant être interprétées avec prudence, car
la plupart de ces enquêtes ne distinguaient pas le travail
à temps partiel ou à domicile du travail à temps plein ou
sur un site dévoué. Dans d’autres études, il est relevé que
la plupart des malades qui n’ont pas repris une activité
professionnelle après la transplantation hépatique décri-
vaient leurs problèmes de santé comme un obstacle
majeur à l’emploi. L’âge du patient, la durée d’invalidité
et le type de travail avant la transplantation affectaient
l’état du patient après l’intervention. Suivant l’argument
selon lequel l’exercice physique a des effets bénéfiques en
cardiologie gériatrique et en cas de maladie pulmonaire,
la mise en place d’exercices physiques surveillés après la
période de la récupération postopératoire améliorerait
considérablement la perception générale que les TH ont
de leur propre santé (6, 7). L’indication de la transplanta-
tion hépatique peut avoir un effet, quelquefois à long
terme, sur le statut psychologique, en particulier s’il y a
un risque de récidive de la maladie initiale, comme en
cas d’hépatite C ou de carcinome hépatocellulaire (8).
D’autres caractéristiques telles que l’abus d’alcool, la consommation de tabac ou la
situation socioprofessionnelle peuvent influencer la QDV. Globalement, 1 an après
la tranplantation hépatique, les scores des transplantés n’étaient pas très éloignés
de ceux de la population témoin. Même s’il ne s’agissait pas d’un véritable retour à
la normale, ils s’en approchaient nettement.
Figure 1. Études longitudinales comparant les domaines de la qualité de vie avant et après
transplantation hépatique en utilisant différents outils (n = 44) [reproduction autorisée par le
Dr Santiago Tome et al.
(4)
].
Détérioration
–10 0 10 20 30 40
Amélioration The sign test
Santé psychologique
p = 0,014
Fonctionnement sexuel
p = 0,58
Adaptation psychosociale
p = 0,0001
Qualité de vie générale
p < 0,0001
Fonctionnement physique
p < 0,0001
Figure 2. Évaluation longitudinale de la qualité de vie des patients transplantés à l’hôpital
Paul-Brousse
(5)
.
Rôle social
1
0,75
0,50
0,25
0
Statut psychologique
Évaluation de la maladie
Activité physique
Perception générale de la santé
1 an après la transplantation hépatique Avant la transplantation hépatique
Population générale

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
94
La vie du transplanté
Études transversales
Comme les études longitudinales, la quasi-totalité des études transversales publiées
ont rapporté une assez bonne QDV, quel que soit l’organe transplanté (cœur, foie
ou rein). Toutefois, elles suivent des méthodologies variables, utilisant souvent
des instruments non validés ou portant sur un nombre de sujets insuffisant. Une
analyse récente de 16 études transversales jugées méthodologiquement cor-
rectes a comparé les 8 dimensions du SF-36 chez des
patients TH et dans la population générale (1 615 TH,
âge moyen : 49 ans, durée moyenne de suivi : 43 mois).
Ce travail a montré de considérables améliorations
des scores par rapport à la population générale dans
6 domaines : activité physique ; limitations liées à la
santé physique ; limitations liées à la santé mentale ;
fonctionnement ou bien-être social ; vitalité (énergie/
fatigue) ; santé générale. Les 2 domaines de la douleur
physique et de la santé mentale étaient semblables
dans les 2 groupes. Dans seulement 8 % des études, le
délai entre la transplantation et l’évaluation était supé-
rieur à 3 ans (9). Pour évaluer la QDV à long terme, nous
avons réalisé une étude multicentrique portant sur des
patients ayant bénéficié depuis plus de 10 ans d’une
transplantation hépatique, rénale ou cardiaque (10).
Pour les 3 organes, les scores étaient proches de ceux de
la population générale (figure 3, A et B). Les symptômes
les plus généralement trouvés (excès d’appétit, change-
ment d’aspect du visage, fragilité de la peau, maux de
tête, tremblements, etc.) étaient plus fréquents chez les
transplantés rénaux. Ces symptômes sont liés aux effets
indésirables des immunosuppresseurs, dont les doses
ne sont pas équivalentes dans les 3 types de transplan-
tation. Ces doses sont généralement plus élevées en
cas de transplantation rénale. Les corticoïdes peuvent
également entraîner des modifications psychiques,
comme l’irritabilité, des sautes d’humeur et des défauts
de concentration. L’importance de l’incidence d’un
diabète souvent lié à la prise d’immunosuppresseurs
a déjà été rapportée dans la littérature. La survenue
de complications ostéo-articulaires, souvent handica-
pantes, résulterait de la conjonction de la maladie ini-
tiale et de la prise de corticoïdes (11, 12). Les infections
opportunes, les lymphomes ou les rejets chroniques
associés aux immunosuppresseurs représentaient 40 %
de la mortalité tardive après la transplantation (13). C.W.
Pinson et al. ont même proposé que l’évaluation de la
QDV fasse partie, au même titre que la recherche des
rejets, des critères permettant d’ajuster le traitement
immunosuppresseur (14). Pour les 3 organes, l’index
de bien-être et celui du bonheur étaient meilleurs
que ceux de la population générale (figure 3B), ce qui
prouve l’importance de la transplantation aux yeux des
patients, même longtemps après l’intervention. L’étude
de C.W. Pinson et al. a montré que la QDV, quel que soit
Figure 3. Évaluation transversale de la qualité de vie, 10 ans après la transplantation, des patients
de l’hôpital Paul-Brousse (foie), de l’hôpital Bicêtre (rein) et de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
(cœur)
[10]
. A) Items où un faible score indique une bonne qualité de vie. B) Items où un score
élevé indique une bonne qualité de vie.
Rôle social
Fréquence des symptômes
physiques
A
Plus le score est faible,
meilleure est
la qualité de vie
Score des
symptômes
physiques
Fréquence des symptômes
psychologiques
Score des symptômes
psychologiques
120 %
105 %
150 %
135 %
90 %
75 %
Foie
Cœur
Population
générale
(100 %)
Rein
Perception
générale
de la santé
Travail
Bonheur
Plus le score est élevé,
meilleure est
la qualité de vie
95 %
80 %
125 %
110 %
65 %
50 %
Foie
Cœur
Population
générale (100 %)
Rein
B

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 95
l’organe transplanté, atteint un plateau entre 1 et 2 ans après la transplantation :
la transplantation rénale a alors la meilleure QDV, la transplantation hépatique
est en position intermédiaire et la transplantation cardiaque arrive en dernier. Ces
auteurs ont ensuite émis l’hypothèse que la QDV des transplantés rénaux allait
baisser à long terme, ce que notre étude a confirmé. Nous avons également mis en
évidence le fait que la QDV des TH devenait la plus proche de celle de la population
générale. Toutefois, il faut rester prudent lorsqu’on compare des résultats de QDV
provenant d’études ayant utilisé des instruments différents (15). Il a été prouvé que
la transplantation d’organe est un traitement efficace permettant de sauver la vie
des patients au stade terminal de leur maladie. Il a été démontré également que les
bons résultats de survie étaient accompagnés d’une QDV des patients acceptable.
Le défi consistant à améliorer et à maintenir ces résultats à long terme semble être
plus fréquemment relevé dans le cas de la transplantation hépatique que pour les
autres transplantations.
Conclusion
En transplantation, comme dans les autres domaines médicaux, le traditionnel
“modèle biomédical” de santé fondé sur la biologie moléculaire, la génétique,
la physiologie et la biochimie est en train d’intégrer le “modèle des sciences sociales”
de la santé, fondé, lui, sur des arguments psychosociaux et économiques. Malgré
le coût élevé de la transplantation, d’autant plus dans un contexte de restrictions
des dépenses liées à la santé, ses partisans la défendent, en vertu non seulement
du nombre de “vies sauvées” mais aussi de l’amélioration de la QDV. Toutefois,
l’évaluation correcte de cette dernière demande le respect d’une méthodologie
bien établie. ■
1. Registre européen des greffes hépatiques (ELTR). www.
eltr.org.
2. Testa MA, Simonson DC. Assessment of quality-of-life out-
comes. N Engl J Med 1996;334(13):835-40.
3. Jay CL, Butt Z, Ladner DP, Skaro AI, Abecassis MM. A review
of quality of life instruments used in liver transplantation. J
Hepatol 2009;51(5):949-59.
4. Tome S, Wells JT, Said A, Lucey MR. Quality of life after
liver transplantation. A systematic review. J Hepatol
2008;48(4):567-77.
5.
Karam V, Castaing D, Danet C et al. Longitudinal prospective
evaluation of quality of life in adult patients before and one
year after liver transplantation. Liver Transpl 2003;9(7):703-11.
6. Hunt CM, Tart JS, Dowdy E, Bute BP, Williams DM, Clavien
PA. Effect of orthotopic liver transplantation on employment
and health status. Liver Transpl Surg 1996;2:148-53.
7. Beyer N, Aadahl M, Strange B et al. Improved physical per-
formance after orthotopic liver transplantation. Liver Transpl
Surg 1999;5:301-9.
8.
De Bona M, Ponton P, Ermani M et al. The impact of liver
disease and medical complications on quality of life and psy-
chological distress before and after liver transplantation. J
Hepatol 2000;33:609-15.
9.
Dew MA, Switzer GE, Goycoolea JM et al. Does transplanta-
tion produce quality of life benefits? A quantitative analysis of
the literature. Transplantation 1997;64:1261-73.
10. Karam VH, Gasquet I, Delvart V et al. Quality of life in
adult survivors beyond 10 years after liver, kidney, and heart
transplantation. Transplantation 2003;76(12):1699-704.
11. Taillandier J, Alemanni M, Samuel D, Bismuth H. Rheumatic
complications following liver transplantation. Transplant Proc
1999;31:1717-8.
12. Forsberg A, Lorenzon U, Nilsson F, Bäckmana L. Pain and
health related quality of life after heart, kidney, and liver trans-
plantation. Clin Transplant 1999;13(6):453-60.
13. Asfar S, Metrakos P, Fryer J et al. An analysis of late deaths
after liver transplantation. Transplantation 1996;61(9):1377-81.
14. Pinson CW, Feurer ID, Payne JL, Wise PE, Shockley S, Speroff
T. Health-related quality of life after different types of solid
organ transplantation. Ann Surg 2000;232(4):597-607.
15. Bombardier C, Tugwell P, Sinclair A, Dok C, Anderson G,
Buchanan WW. Preference for endpoint measures in clinical trials:
results of structured workshops. J Rheumatol 1982;9:798-801.
Références bibliographiques
1
/
5
100%