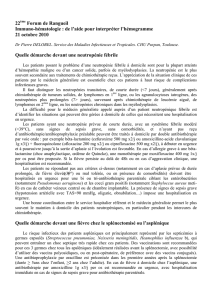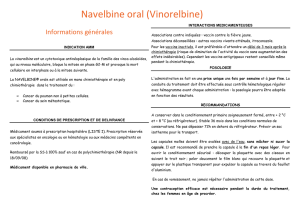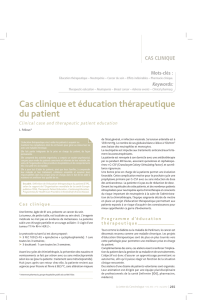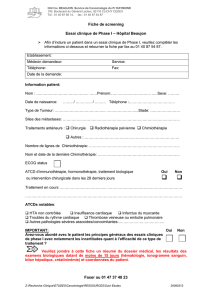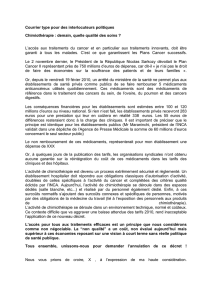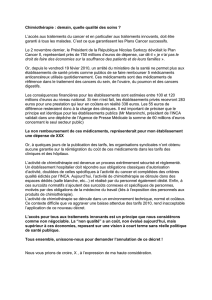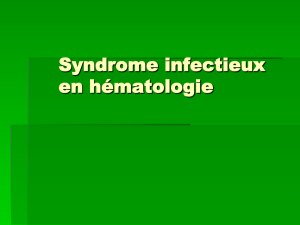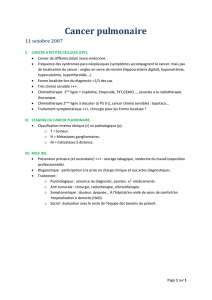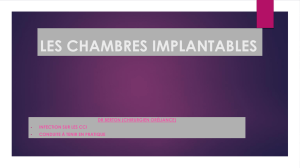L é c h o s d e s ...

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
40
40
échos des congrès
LE VÉCU DE LA PRISE EN CHARGE
DE LA NEUTROPÉNIE FÉBRILE
D’après Noël Milpied (Pessac, Bordeaux)
La première édition des États généraux de
la neutropénie fébrile (NF) organisée par le
laboratoire Amgen s’est déroulée le 26 sep-
tembre 2008 dans le site très prestigieux de
la Bibliothèque nationale de France, à Paris.
Ces États généraux avaient pour objectif de
faire un état des lieux sur la prise en charge de
la NF en France, dans la pratique quotidienne
des cliniciens hématologues et des cancéro-
logues et non pas dans le cadre de protocoles
ou d’essais thérapeutiques. En effet, étant
tous confrontés à la survenue d’une NF et à
ses complications, ils prescrivent des facteurs
de croissance hématopoïétiques, sans que les
modalités optimales de cette prise en charge
soient précisément établies. L’objectif de cette
manifestation était donc de faire progresser
et d’harmoniser les bonnes pratiques de la
prise en charge de la neutropénie fébrile à
partir de l’expérience d’experts et de l’analyse
des résultats recueillis lors de douze ateliers
régionaux. Ont ainsi été recueillies des don-
nées précises sur les pratiques quotidiennes
de plus de 150 praticiens confrontés à des cas
cliniques de patients atteints de lymphomes
ou de tumeurs solides. Les échanges ont mis
en évidence une diversité des attitudes par
rapport à la prévention de la neutropénie
fébrile, et notamment à l’utilisation des fac-
teurs de croissance hématopoïétiques : indi-
cations, modalités, durées de traitement.
Dégager un consensus de prise en charge
de la NF se révélait donc nécessaire. Cette
harmonisation pourra ainsi permettre d’ap-
porter des réponses à certaines questions
et une véritable plus-value dans la prise en
charge de nos patients.
Par ailleurs, cette session spéciale a apporté
des réponses quant :
à la prise en charge aux urgences de la
✓
NF, à partir d’une enquête réalisée auprès
d’urgentistes dans ce cadre spécifi que ;
au coût de cette prise en charge ; ✓
aux recommandations d’utilisation des
✓
facteurs de croissance hématopoïétiques
en pratique quotidienne et à la façon dont
pourraient évoluer ces recommandations.
La synthèse des pratiques de prise en charge
de la NF chimio-induite et des recommanda-
tions qui a été apportée par le conseil scien-
tifi que de ces États généraux fait l’objet de
cet article.
NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET HÉMOPATHIES
LYMPHOÏDES
D’après Philippe Solal-Céligny (centre Jean-
Bernard, Le Mans)
Les modalités de prévention de la NF
✔
sont très variables
À partir d’un cas clinique d’un patient âgé de
73 ans, avec un état général conservé et une
fonction rénale normale, pris en charge pour
un lymphome diffus à grandes cellules de
stade III et traité par un protocole classique
R-CHOP-21, un premier constat s’impose :
l’estimation de l’incidence des épisodes
attendus de NF est très disparate, entre 10 %
et 40 %, d’après les hématologues interro-
gés. De nombreuses causes concourent à
expliquer cette diversité d’appréciation. Tout
d’abord, la défi nition consensuelle de la NF
est récente : il s’agit d’une fi èvre à 38,5 °C en
une prise ou supérieure à 38 °C lors de trois
prises en moins de 24 heures, associées à
un taux de PNN à 500 ou à une leucopénie
inférieure à 1 000, ou encore à un taux de
PNN inférieur à 1 000 sachant qu’il y a un
risque que ce taux diminue encore. Un autre
problème est celui de l’hétérogénéité des
patients traités : les données sont différentes
selon que l’on se place dans le cadre d’essais
cliniques, d’observatoires ou d’études
rétrospectives. Généralement, les données
des essais cliniques sont minorées, compte
tenu de la sélection des patients inclus dans
Les États généraux
de la neutropénie fébrile
A. Ponzio-Prion*
* Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

41
41
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
Les États généraux de la neutropénie fébrile
les essais. D’autres facteurs entrent en jeu :
le nombre de lignes de traitements préa-
lables jouant un rôle important dans cette
incidence ; l’association à une radiothérapie
concomitante ou préalable ; l’utilisation de
G-CSF ou non, et avec quelle intention (en
prévention primaire ou secondaire) ; enfi n, la
politique du centre d’exercice vis-à-vis d’une
NF (report de cure, réduction de dose, etc.)
est une variable non négligeable.
Quant à la prévention de la NF, les recom-
mandations de l’ASCO en matière de pro-
phylaxie primaire par G-CSF sont rappelées :
indication d’un facteur de croissance héma-
topoïétique si l’incidence attendue de sur-
venue d’une NF est supérieure à 20 %, ou
lorsque le risque est moindre, mais que des
facteurs de risque tels que les traitements
antérieurs multiples, les irradiations éten-
dues, les protocoles de chimio-radiothéra-
pie, l’infi ltration médullaire, la dénutrition, la
présence d’une infection, le stade avancé de
la maladie et la présence d’une comorbidité
grave sont associés. Enfi n, et toujours selon
ces recommandations, le traitement d’un
patient âgé atteint d’un lymphome malin
non hodgkinien (LMNH) par un protocole
CHOP ou similaire constitue une indication
à la prophylaxie primaire.
En effet, l’incidence de la neutropénie de
grade 3-4 est de 65 % et celle des infec-
tions, de 27 %, selon une étude récente de
D.O. Persky et al. (1). Le risque est majoré
par l’instauration du rituximab, et lors du
premier cycle du fait de la lyse tumorale
importante à ce stade, comme l’avait déjà
indiqué Bertrand Coiffi er. Un site Internet,
www.toxcalculator.com, permet de prévoir le
risque de NF et d’orienter ainsi les modalités
de cette prévention. Cet outil utilisé par les
hématologues allemands pourrait s’avérer
très utile en pratique.
Une méta-analyse de la Cochrane Library,
portant sur 12 essais randomisés et
1 823 patients a permis de mettre en évi-
dence le bénéfi ce de l’utilisation des fac-
teurs de croissance hématopoïétiques dans
le traitement des lymphomes avec un impact
majeur sur la réduction des neutropénies de
grade 3-4 (RR : 0,67 [0,60-0,73]), des NF (RR :
0,74 [0,62-0.89]) et des infections sévères
(RR : 0,74 [0,64-0,85]) ; en revanche, sans
infl uence sur la survie globale, la survie sans
progression et la mortalité infectieuse (2).
Quant au type de G-CSF prescrit en prati-
que quotidienne, les réponses des médecins
interrogés à propos du cas clinique proposé
révèlent que les praticiens (55 % d’entre eux)
utilisent en majorité des G-CSF classiques.
Or, une étude a souligné l’avantage, certes
non signifi catif, de l’utilisation du pegfi lgras-
tim par rapport au fi lgrastim lors d’un traite-
ment par R-CHOP-14 sur le nombre de cycles
administrés et la fréquence des réductions
de doses, permettant respect de la dose-
intensité (3), celui-ci ayant une infl uence
bénéfi que sur la survie.
Il ressort également de l’enquête que les
modalités d’utilisation des G-CSF classiques
sont très variables : instauration du traite-
ment entre le 4e et le 8e jour (majoritairement
au 6
e
jour), durée d’administration de 6 à
10 jours (majoritairement pendant 6 jours).
Les données de la littérature démontrent
que l’apparition du nadir est retardée avec le
délai d’administration du G-CSF et qu’il serait
préférable de commencer le traitement à J4.
Quant à la durée optimale de traitement, elle
est encore méconnue.
L’utilisation du pegfi lgrastim permettrait
d’optimiser la prévention en évitant des
pratiques peu effi caces, du fait des moda-
lités de prescriptions de G-CSF classiques
encore mal précisées.
NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET CANCERS
BRONCHO-PULMONAIRES
D’après Christos Chouaid (CHU Saint-
Antoine, Paris)
Dans le cadre des cancers broncho-pulmo-
naires, les facteurs de risque de survenue
d’une NF sont comparables à ceux rencon-
trés lors du traitement des patients atteints
d’hémopathies lymphoïdes. À ces facteurs de
risque s’ajoutent le terrain souvent fragilisé
de ces patients et d’autres facteurs de risque
hématologique associés tels que le nadir au
premier cycle, le taux d’hémoglobine, une
lymphopénie initiale inférieure à 700 ou une
lymphopénie inférieure à 500 à J5, lors du
cycle précédent (4). Chez ces patients, il sem-
ble que la NF survienne plus volontiers lors
des premiers cycles et représente 65 % des
hospitalisations durant les 2 premiers cycles.
Pourtant, d’après l’étude de J. Crawford et
al. (5), la prévention est simple et très effi -
cace, avec une réduction signifi cative du taux
de NF (70 % versus 40 % [p < 0,001]), de sa
durée (6 jours versus 1 jour), et une réduc-
tion de moitié des épisodes d’infections,
d’utilisation des antibiotiques et des jour-
nées d’hospitalisations. L’effi cacité du peg-
fi lgrastim paraît ainsi au moins équivalente
à celle des G-CSF classiques selon plusieurs
études et une méta-analyse (6-8).
L’incidence des NF chez ces patients est fré-
quente avec les protocoles de chimiothérapie
classiquement utilisés, notamment dans le
traitement des cancers bronchiques à petites
cellules mais aussi non à petites cellules,
d’autant plus que s’ajoutent progressive-
ment de nouveaux agents thérapeutiques qui
accentuent le risque (bévacizumab, erlotinib,
cétuximab, etc.). Il est donc très important
d’appréhender ce risque et d’en assurer la
prophylaxie de façon homogène, simple et
effi cace.
NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET CANCERS
DU SEIN
D’après Étienne Brain (centre René-
Huguenin, Saint-Cloud) et Joseph Gligorov
(AP-HP-Tenon, Paris)
En ce qui concerne les cancers du sein, l’in-
cidence des NF chimio-induites est là encore
très élevée et celle des complications infec-
tieuses est liée à l’âge élevé, un état général
altéré, la survenue d’un épisode lors d’une
hospitalisation, la progression tumorale, une
immunodépression associée, une comorbi-
dité sévère, des mauvaises conditions de
suivi ou de réactivité, des signes de gravité
au premier examen, etc. (9, 10).
Les protocoles de chimiothérapie utilisés dans
le cancer du sein sont nombreux et induisent
très fréquemment des NF avec leur lot de
complications, y compris en phase précoce
de la maladie ; l’utilisation de médicaments
hémato-toxiques tels que les anthracycli-
nes et les taxanes y participe fortement, et
plus souvent lorsque ces médicaments sont
associés (incidence de 3 % à 41 %). L’analyse
des essais majeurs testant les protocoles
actuellement en vigueur en phase adjuvante,
démontre une disparité importante dans la
prévention des complications hématologi-
ques et infectieuses. Il en est de même en
pratique quotidienne comme l’illustrent les
réponses aux cas cliniques proposés lors des
réunions régionales des États généraux.

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
42
42
échos des congrès
La prophylaxie primaire réduit, quant à
elle, considérablement le risque de NF et
ses complications, que la chimiothérapie
soit administrée en situation métastatique
ou en phase précoce (adjuvant/néoadju-
vant), ou qu’elle soit très ou modérément
hématotoxique : l’utilisation du pegfi lgrastim
administré en prévention primaire lors d’une
chimiothérapie par docétaxel en monothé-
rapie, réputée modérément hématotoxique,
s’est avérée effi cace dans la prévention des
NF, des hospitalisations et du recours aux
antibiotiques par voie intraveineuse (11)
[fi gure 1].
C’est pourquoi, l’ensemble des sociétés
savantes recommande et encadre l’utilisa-
tion des facteurs de croissance hématopoïé-
tiques chez les patientes traitées pour un
cancer du sein.
La synthèse de ces recommandations selon
le profi l des patientes et l’incidence attendue
de NF est illustrée dans la fi gure 2.
QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS DE
SAINT-PAUL EN TERMES DE PROPHYLAXIE
PRIMAIRE ?
Selon les experts de Saint-Paul, il y a indica-
tion à la prophylaxie primaire dès lors que
l’utilisation des G-CSF est bénéfi que pour
réduire le risque de NF :
quelle que soit la situation, adjuvante ou
✓
métastatique, pour toute patiente traitée
par chimiothérapie dont le risque de NF est
supérieur à 20 % (niveau I, grade A) ;
en situation adjuvante pour un risque de ✓
NF entre 10 % et 20 % (niveau I, grade A).
Elle sera discutée au cas par cas en situation
métastatique pour un risque de NF entre 10 %
et 20 % (accord d’experts). En revanche, elle
n’est pas indiquée quelle que soit la situation
adjuvante ou métastatique pour un risque de
NF inférieur à 10 % (niveau I, grade A).
Les modalités de prescription varient selon
le produit utilisé (accord d’experts).
G-CSF à injection quotidienne : l’adminis-
✓
tration est préconisée 24 à 72 heures après
la fi n de la chimiothérapie selon une dose
recommandée de 5 μg/kg/j et doit être pour-
suivie jusqu’à ce que le taux de polynucléai-
res neutrophiles atteigne 2 à 3 x 109/l.
G-CSF pégylé (pegfi lgrastim) : une injection
✓
unique 24 heures après la fi n de la chimio-
thérapie est préconisée.
1BUJFOUFT
/FVUSPQnOJF
GnCSJMF
)PTQJUBMJTBUJPO "OUJCJPUJRVFJW
/PNCSFEFQBUJFOUFT
1MBDFCP
%BQSoT7PHFMFUBM+$MJO0ODPM
1FHGJMHSBTUJN
Figure 1. Intérêt du pegfi lgrastim en prévention primaire lors d’une chimiothérapie par docétaxel
en monothérapie.
Figure 2. Recommandations de l’ASCO et de l’EORTC pour l’évaluation de la NF.
Cet arbre décisionnel est constitué par la synthèse des recommandations 2006 de l’EORTC et de l’ASCO.
* Les facteurs de risque soulignés correspondent à
un niveau de preuve I/II d’après l’EORTC.
(1) Aapro MS et al. Eur J Cancer 2006;42:2433-53.
(2) Smith TJ et al. J Clin Oncol 2006;24:3187-205.
Étape 2 : évaluer les facteurs augmentant le risque de NF
PRÉVENTION
PAR G-CSF
RECOMMANDÉE
G-CSF NON
RECOMMANDÉ
Risque global de NF ≥ 20 % Risque global de NF < 20 %
Risque de NF ≥ 20% Risque de NF entre 10 et 20% Risque de NF < 10%
Âge ≥ 65 ans • (1, 2)
Mauvais indice fonctionnel •(1, 2)
Maladie avancée • (1, 2)
Comorbidités graves •(2)
Cytopénies dues à l’envahissement •
médullaire par la tumeur (2)
Sexe féminin •(1)
Hémoglobine •< 12 g/dl (1)
Carence nutritionnelle •(1, 2)
Chimio-radiothérapie •
combinée (2)
Antécédent de NF • (1, 2)
Plaies ouvertes ou infections •
évolutives (2)
Pas d’antibioprophylaxie •
Étape 1 : évaluer le risque de NF associé au protocole prévu de chimiothérapie
Pour chaque patient, le risque de NF doit être évalué en routine avant chaque cycle de chimiothérapie •
Les protocoles de chimiothérapie dose-denses doivent toujours être considérés comme à risque élevé de NF •
(risque de NF ≥ 20 %) [1]
Les patients âgés de plus de 65 ans atteints de LNH et traités par une chimiothérapie curative doivent être consi- •
dérés comme à risque élevé de NF (2)

43
43
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
Les États généraux de la neutropénie fébrile
Les experts indiquent que le choix du G-CSF
doit prendre en compte les aspects pratiques
d’administration liés à chacun des produits
disponibles.
Éric-Charles Antoine conclut : “Enfi n, la pres-
cription d’un G-CSF est toujours recomman-
dée pour remplir le contrat moral vis-à-vis
des patients, à savoir maintenir le traitement
le plus effi cace et garant du bénéfi ce maxi-
mal, ce qui sous-entend le maintien de la
dose-intensité. Nous sommes tous confron-
tés au risque de NF et à ses complications
qui peuvent être graves dans nos protocoles
de traitement et nous devons nous poser la
question sur notre droit à imposer un risque
toxique chez nos patients lorsque l’on peut
l’éviter”.
COÛT DE LA PRISE EN CHARGE DE CETTE
PRÉVENTION
D’après Isabelle Durand-Zaleski et Isabelle
Borget
Sur le plan économique, deux présentations
complémentaires ont évoqué l’impact du
coût de la NF dans le contexte hospitalier.
La première présentation visait à estimer le
coût, pour l’Assurance Maladie, lié à la NF
chimio-induite, prise en charge en hospitali-
sation publique ou privée. Dans cette étude,
seuls les séjours pour lesquels la NF était le
motif de l’hospitalisation et du report de la
chimiothérapie étaient pris en compte. Cette
évaluation économique a montré que, malgré
l’existence de traitements préventifs, la NF
représente encore environ 38 000 séjours
par an, pour un coût de 54 millions d’euros
par an pour l’Assurance Maladie. Ce coût est
probablement sous-estimé, car il n’englobe
pas le coût de prise en charge en ambulatoire
ni l’allongement des durées de séjours à l’hô-
pital lorsque se produit une NF au décours
d’une hospitalisation.
La seconde présentation était une étude
médico-économique monocentrique conduite
à l’IGR dont l’objectif était de comparer le
coût réel pour l’établissement au rembour-
sement de l’Assurance Maladie (coûts-tarifs)
pour des patients arrivant aux urgences en
présentant une NF. Cette étude, menée chez
88 patients, a démontré que globalement
les coûts étaient supérieurs aux tarifs avec
un coût moyen pour l’établissement de
6 096 euros (médiane de 3 796 €) contre un
tarif moyen de 5 125 euros (médiane 4 319 €).
Ce défi cit s’explique par une durée de séjour
réelle souvent supérieure à celle défi nie dans
le GHS et par le profi l des patients de cette
étude (la moitié d’entre eux présentait un
stade métastatique).
Les auteurs de ces études ont souligné
qu’une bonne utilisation des traitements
préventifs disponibles permettrait de réduire
à la fois les remboursements de l’Assurance
Maladie et le coût pour l’hôpital, tout en amé-
liorant la prise en charge des patients.
■
RÉFÉRENCES
1. Persky DO, Unger JM, Spier CM et al. Phase II study
of rituximab plus three cycles of CHOP and involved-
fi eld radiotherapy for patients with limited-stage
aggressive B-cell lymphoma: Southwest Oncology
Group study 0014. J Clin Oncol 2008;26(14):2258-63.
2. Bohlius J, Reiser M, Schwarzer G, Engert A.
Granulopoiesis-stimulating factors to prevent adverse
effects in the treatment of malignant lymphoma.
Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD003189.
3.
Lopez A, Fernandez de Sevilla A, Castaigne S. et
al. Pegfi lgrastim supports delivery of CHOP-R chemo-
therapy administered every 14 days: a randomised
phase II study. Blood 2004;104:3311.
4.
Ray-Coquard I, Borg C, Bachelot T et al. Prognostic
factors for febrile neutropenia. Bull Cancer
2006;93(5):501-6.
5.
Crawford J, Ozer H, Stoller R et al. Reduction in
the incidence of chemotherapy-induced febrile neu-
tropenia in patients with small cell lung cancer by
granulocyte colony-stimulating factor (R-metG-CSF).
N Engl J Med 1991;325:164-71.
6. Green MD, Koelbl H, Baselga J et al. A randomized
double-blind multicenter phase III study of fi xed-dose
single-administration pegfi lgrastim versus daily
fi lgrastim in patients receiving myelosuppressive
chemotherapy. Ann Oncol 2003;14(1):29-35.
7.
Vose JM, Crump M, Lazarus H et al. Randomized,
multicenter, open-label study of pegfi lgrastim com-
pared with daily fi lgrastim after chemotherapy for
lymphoma. J Clin Oncol 2003;21(3):514-9.
8.
Pinto L, Liu Z, Doan Q et al. Comparison of peg-
fi lgrastim with fi lgrastim on febrile neutropenia,
grade IV neutropenia and bone pain: a meta-analysis
of randomized controlled trials. Curr Med Res Opin
2007;23(9):2283-95.
9. Talcott JA, Siegel RD, Finberg R, Goldman L. Risk
assessment in cancer patients with fever and neu-
tropenia: a prospective, two-center validation of a
prediction rule. J Clin Oncol 1992;10(2):316-22.
10. Talcott JA, Finberg R, Mayer RJ, Goldman L.
The medical course of cancer patients with fever
and neutropenia. Clinical identifi cation of a low-
risk subgroup at presentation. Arch Intern Med
1988;148(12):2561-8.
11. Vogel CL, Wojtukiewicz MZ, Carroll RR et al. First
and subsequent cycle use of pegfi lgrastim prevents
febrile neutropenia in patients with breast cancer: a
multicenter, double-blind, placebo-controlled phase
III study. J Clin Oncol 2005;23(6):1178-84.
1
/
4
100%