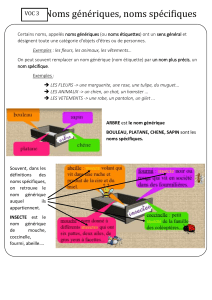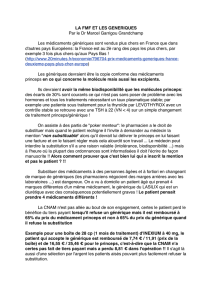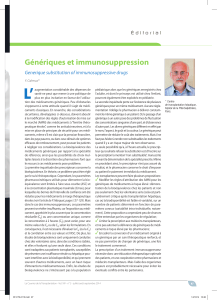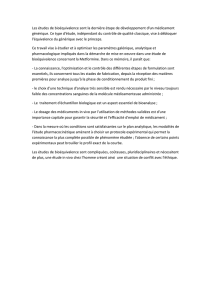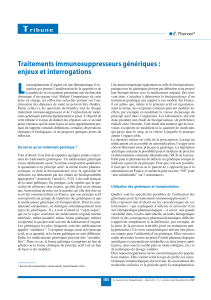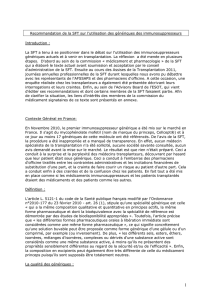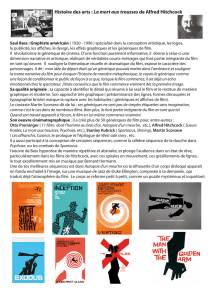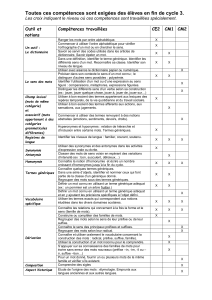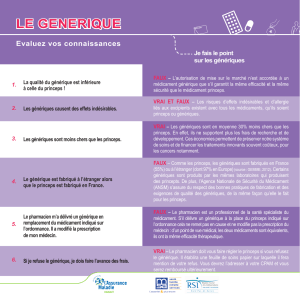VOCABULAIRE L TIONS A

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
102
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
102 Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
Les pages de la SFT
RECOMMANDATIONS
L
a Société francophone de transplan-
tation (SFT) a tenu à se positionner
dans le débat sur l’utilisation des
immunosuppresseurs génériques actuels
et à venir en transplantation. La réflexion
a été menée en plusieurs étapes. D’abord,
au sein de la commission “Médicament et
pharmacologie” de la SFT, qui a élaboré le
texte actuel avant soumission et accep-
tation par le conseil d’administration de
la SFT. Ensuite, au cours des Assises de la
transplantation 2011, journées annuelles
professionnelles de la SFT durant les-
quelles nous avons pu débattre avec les
représentants de l’Afssaps et des phar-
maciens d’officine. À cette occasion, une
enquête réalisée chez les transplanteurs a
également été présentée, décrivant leurs
interrogations et leurs craintes. Enfin, au
sein de l’Advisory Board de l’ESOT, qui
vient d’éditer ses recommandations, et
dont certains membres de la SFT faisaient
partie.
Afin de clarifier la situation, les liens d’in-
térêts des membres de la commission du
médicament signataires de ce texte sont
présentés en annexe.
Contexte général en France
En novembre 2010, le premier immuno-
suppresseur générique a été mis sur le
marché en France. Il s’agit du mycophé-
nolate mofétil (nom de marque du prin-
ceps, Cellcept®), et, à ce jour, au moins
17génériques de cette molécule ont été
référencés. De l’avis de la SFT, la procé-
dure a été inappropriée et a manqué de
transparence. Eneffet, aucun médecin
spécialiste de la transplantation n’a
été sollicité, aucune société savante
consultée, aucun avis demandé avant
la mise sur le marché. Le résultat est
que rien n’était préparé. Certains méde-
cins transplanteurs ont découvert par
hasard, avec perplexité, que leur patient
était sous générique. Cela a mis dans
l’embarras des pharmaciens d’officine,
tiraillés entre les contraintes adminis-
tratives et les incitations financières de
substitution, d’une part, et la crainte de
faire courir un risque au patient, d’autre
part. Cela a enfin généré des craintes et
une certaine confusion chez les patients.
En fait, tout a été mis en place comme si
les médicaments immunosuppresseurs
et les patients transplantés étaient des
médicaments et des patients comme les
autres.
Définition
L’article L. 5121-1 du code de la santé
publique français, modifié par l’ordon-
nance n°2010-177 du 23 février 2010
- art. 26(1), stipule qu’une spécialité
générique est celle “qui a la même com-
position qualitative et quantitative en
principes actifs, la même forme pharma-
ceutique et dont la bioéquivalence avec
la spécialité de référence est démontrée
par des études de biodisponibilité appro-
priées”. Toutefois, l’article précise que “les
différentes formes pharmaceutiques
orales à libération immédiate sont
considérées comme une même forme
pharmaceutique”, ce qui signifie concrè-
tement qu’une solution buvable peut
être proposée comme forme générique
d’une gélule ou d’un comprimé, par
exemple (ou inversement). De plus, “les
différents sels, esters, éthers, isomères,
mélanges d’isomères, complexes ou
dérivés d’une substance active sont
considérés comme une même substance
active, à moins qu’ils ne présentent des
propriétés sensiblement différentes au
regard de la sécurité et/ou de l’efficacité.”
Enfin, la composition en excipients peut
également être très différente de celle
du médicament princeps, puisqu’ils sont
supposés être totalement neutres.
La qualité des génériques
Il existe une crainte sur la qualité de
fabrication des génériques. Plusieurs
dysfonctionnements ont été révélés
dans la presse, et, plus récemment, l’Aca-
démie nationale de médecine a mis en
garde contre les déviations possibles par
rapport aux bonnes pratiques de fabrica-
tion pour les médicaments génériques,
cette dernière étant, plus fréquemment
encore que pour les princeps, sous-
traitée dans les pays émergents(2). Il
existe clairement un risque d’insuffisance
des contrôles de fabrication dans ces
pays émergents (contrôles qui seraient
en partie sous-traités et confiés par les
agences occidentales à des officines
locales).
La bioéquivalence
Les essais de bioéquivalence sont menés
chez un petit nombre de volontaires
sains (souvent sur 12 à 36personnes),
jeunes, en dose unique et en conditions
très standardisées. Les paramètres de
biodisponibilité considérés sont l’ASC0-∞
(à défaut, l’ASC0-t, jusqu’à la dernière
concentration mesurable) estimée par la
méthode des trapèzes, la Cmax mesurée
(non interpolée) et, plus accessoirement,
le Tmax (temps maximal pour obtenir la
concentration). Les règles de bioéquiva-
Recommandation de la Société francophone
de transplantation sur l’utilisation des génériques
des immunosuppresseurs
Yannick Le Meur (Brest), Laurent Sebbag (Lyon), Dany Anglicheau (Paris), Nassim Kamar (Toulouse), Eliane Billaud (Paris),
Anne Hulin (Créteil), Pierre Marquet (Limoges)

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 103
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
103
Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
lence imposent que l’ASC0-∞ ou, à défaut
l’ASC0-t ainsi que la Cmax obtenues avec
le générique se situent dans un intervalle
de 80 à 125 % des valeurs obtenues avec
le princeps, et ce chez au moins 90 % des
volontaires sains (en fait, l’IC
90
des valeurs
individuelles doit être compris entre 80 et
125 %) [3]. De plus, pour les médicaments
qu’elles considèrent comme présentant
une marge thérapeutique étroite, l’Afssaps
et l’EMA demandent que la marge de
tolérance soit comprise entre 90 et 111 %
(tolérance de 10 % et non de 20 %), et cela
depuis janvier 2010(1, 4). En pratique,
cela signifie que, pour les médicaments
standard, on admet une variation de 5 %
autour de la valeur moyenne, et pour les
médicaments à marge thérapeutique
étroite, une variation de 3 %.
De nombreuses discussions ont eu lieu
sur ces critères de bioéquivalence, et en
particulier sur les points suivants :
Il ne s’agit pas d’une bioéquivalence en
situation réelle chez des patients greffés,
sous traitement au long cours et dans un
contexte d’interactions médicamenteuses
multiples. Les avantages et inconvénients
respectifs des essais en doses répétées
chez des volontaires sains et chez des
patients dont l’état est stable doivent être
discutés, probablement au cas par cas. En
effet, le concept d’essai très standardisé
chez des patients avec un minimum de
facteurs de variation a été établi pour per-
mettre de détecter de “faibles” différences
de biodisponibilité. Il fait abstraction, en
revanche, des interactions médicamen-
teuses ou des particularités pharmaco-
cinétiques des patients, qui peuvent être
polypathologiques, avec des défaillances
d’organe, et qui reçoivent très souvent des
polythérapies. Dans ces situations de plus
forte variabilité intra-individuelle, des
essais de bioéquivalence ont d’ailleurs
été proposés par des experts de la FDA,
nécessitant 2alternances princeps-géné-
riques successives, à l’état stable(5).
La bioéquivalence ne prend pas en
compte les indices d’exposition utilisés
pour le suivi thérapeutique (concen-
tration résiduelle [C0], concentration
2heures après l’administration [C2], ou
ASC interdose à l’état stable des concen-
trations). De toute façon, ces derniers ne
peuvent pas être mesurés dans les essais
de bioéquivalence usuels, en dose unique.
Par conséquent, rien ne garantit que des
valeurs d’ASC0-∞ (ou d’ASC0-t) et de Cmax
“bioéquivalentes” correspondent à des
valeurs équivalentes d’indice d’exposition
à l’équilibre, et donc que la même dose de
princeps et de génériques aboutira à la
même exposition, ou que l’ajustement de
posologie sur la concentration sanguine
résiduelle C0 aboutira à la même exposi-
tion globale (ASC) pour le générique et
le princeps.
Que cachent les règles de bioéqui-
valence dans la vraie vie ? Peu d’études
se sont intéressées à des comparaisons
d’exposition après substitution par un
générique. On peut noter que, pour la
ciclosporine, certaines ont fait état de
différences significatives, telles qu’une
baisse significative (p<0,05) de la Cmax
et de l’ASC motivant des adaptations
de posologie(6). Il existe bien sûr une
variabilité individuelle à ces variations
d’exposition. Ainsi, il est clair que la subs-
titution justifie au minimum des contrôles
supplémentaires et souvent des visites
supplémentaires pour adapter les doses…
à condition de disposer de cibles théra-
peutiques adaptées aux (ou compatibles
avec les) différentes formes génériques.
Marge thérapeutique étroite
Pour la FDA (Code of Federal Regulation,
Title 21) [7], les médicaments à marge
thérapeutique étroite sont définis comme
des médicaments dont la concentration
minimale toxique est inférieure à 2fois
la concentration minimale efficace chez
l’homme, ou nécessitant un ajustement
de posologie et une surveillance précau-
tionneuse (careful) du patient. De plus, les
immunosuppresseurs sont des médica-
ments nécessitant un suivi thérapeutique
pharmacologique, c’est-à-dire l’ajustement
individuel de la dose sur la base d’un mar-
queur d’exposition systémique (C0 ou C2,
ASC des concentrations en fonction du
temps ou ASC…). La valeur cible de ce(s)
marqueur(s) d’exposition est alors définie
comme la concentration pour laquelle
le meilleur rapport bénéfice/risque est
obtenu dans la population (ou dans un
groupe défini de patients). L’agence euro-
péenne n’a pas donné de définition précise
ni de liste de médicaments ou de classe
thérapeutique “à marge thérapeutique
étroite” et préfère statuer au cas par cas(4).
Elle a retenu pour l’instant la ciclosporine
et le tacrolimus. Pour le mycophénolate
mofétil, la situation est plus compliquée.
De l’avis de la commission “médicament
et pharmacologie” de la SFT, en accord
avec les recommandations de l’ESOT, le
mycophénolate mofétil devrait être classé
dans cette catégorie. En effet, son efficacité
est corrélée à son exposition, il existe une
large variabilité interindividuelle de l’expo-
sition, de nombreux centres contrôlent et
adaptent cette exposition, enfin son acti-
vité immunosuppressive est au premier
plan dans le cadre des stratégies de mini-
misation des inhibiteurs de la calcineurine,
situation dans laquelle la nécessité d’une
exposition optimale à l’acide mycophéno-
lique, métabolite actif du mycophénolate
mofétil, est fondamentale.
La sécurité clinique
À ce jour, Il y a eu peu d’études de substi-
tution bien menées. Pour les génériques
de la ciclosporine, une étude rétrospective
a fait état de plus de rejets dans le groupe
générique(8). Deux études prospectives
plus récentes, dont une seule randomisée,
concluent à l’interchangeabilité du prin-
ceps (même efficacité et effets indési-
rables) et des génériques testés, mais
elles ont été menées sur de petits effec-
tifs de patients stables sélectionnés(9,
10). Des résultats équivalents en termes
de sécurité clinique ont été rapportés
pour les génériques du tacrolimus, avec
2 études non randomisées sur un petit
nombre de patients stables(11, 12). La
majorité des études mettent en évidence
des modifications des taux résiduels après
substitution, nécessitant un monitoring
rapproché et des modifications de doses. Il

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
104
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
104 Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
Les pages de la SFT
RECOMMANDATIONS (SUITE)
y a eu, par exemple, 3fois plus de modi-
fications thérapeutiques dans le groupe
tacrolimus générique que dans le groupe
princeps(11). Il n’y a pas d’études équi-
valentes à ce jour pour les génériques
du mycophénolate mofétil.
La substitution
D’une manière générale, il paraît
dangereux que la substitution soit faite
par le pharmacien sans en informer le
médecin transplanteur. Aujourd’hui, le
médecin prescripteur conserve la pos-
sibilité d’inscrire la mention “non subs-
tituable” sur l’ordonnance. Néanmoins,
l’absence de cette mention ne garantit
pas que le médecin recommande la
substitution, et la vérification par un
simple contact téléphonique paraît
recommandable. En effet, le pharma-
cien n’a pas la connaissance précise, à
un instant donné, de l’état clinique du
patient et des stratégies thérapeutiques
en place. Le patient peut sortir d’un rejet
aigu, bénéficier de traitements associés
responsables d’interactions médica-
menteuses majeures, avoir un équilibre
thérapeutique précaire – en particulier
avec des difficultés d’équilibration des
taux sanguins d’immunosuppresseurs
–, être en phase de minimisation des
anticalcineurines ou de remplacement
par une autre classe thérapeutique
comme les inhibiteurs de mTor, etc. Dans
toutes ces situations, la substitution peut
rompre l’équilibre difficilement obtenu et
impose des contrôles biologiques ainsi
que, éventuellement, des adaptations
de posologie et un renforcement de la
surveillance clinique. Il faut noter que,
pour le mycophénolate mofétil, certains
centres pratiquent un monitorage sur la
base de la mini-ASC, soit régulièrement
soit lors d’événements intercurrents ou
de modifications de la stratégie immuno-
suppressive. La substitution par un
générique modifie alors complètement
la prise en charge des patients puisque,
dans ce cas, le monitorage est impossible,
faute d’outils appropriés pour les géné-
riques. En conséquence, il ne saurait y
avoir de “substitution sauvage”, qui serait
découverte plusieurs semaines plus tard
et dont les conséquences potentielle-
ment graves, s’il en existait, devraient
être assumées par le pharmacien.
Le deuxième risque principal est celui
de la substitution entre génériques, dont
la bioéquivalence entre eux n’a pas été
vérifiée. En effet, si chaque générique
doit prouver sa bioéquivalence avec
le princeps, il n’est pas tenu de le faire
avec les autres génériques référencés.
Ce risque est bien réel puisque, en sep-
tembre 2011, en France, 17laboratoires
avaient obtenu l’AMM pour 36formes
différentes de mycophénolate mofétil, et
17formes provenant de 10laboratoires
étaient effectivement disponibles sur
le marché. Pour éviter des variations
répétées d’exposition au médicament,
et des surcoûts liés au suivi thérapeu-
tique pharmacologique, il serait sou-
haitable qu’un seul et même générique
soit délivré à un patient donné. Pour
cette raison, la SFT recommande que
les génériques soient prescrits sous leur
nom commercial afin que le patient, le
médecin transplanteur et le pharmacien
parlent tous de la même formulation.
L’éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique est l’une
des priorités nationales de la prise en
charge des patients, mise en place ces
dernières années et relayée par les
agences régionales de santé. Les services
de transplantation en France ont pour la
plupart développé des activités d’édu-
cation thérapeutique, parfois de façon
très structurée. Des nombreux échanges
menés au cours des Assises de la trans-
plantation, il ressort que l’avènement des
génériques complique singulièrement
cette démarche. Les patients sont perdus
entre les princeps et les génériques de
leurs traitements associés (antihyper-
tenseur, statine, protecteur gastrique,
etc.), avec de multiples erreurs de prise
et parfois même la prise concomitante
du princeps et du générique. La diversité
des appellations, des boîtes, des couleurs,
des formes des comprimés ajoute à la
confusion. Dans ce contexte, l’arrivée des
génériques des immunosuppresseurs
est vécue avec beaucoup d’appréhen-
sion par les responsables de l’éducation
thérapeutique.
Le rapport bénéfice/risque :
pharmaco-économie
La mise en place des génériques n’a
qu’un intérêt économique. Encore faut-il
prouver que leur utilisation conduit réel-
lement à des économies de santé. Cette
question est compliquée, et nous n’en
aurons probablement jamais la réponse.
À grande échelle, sur des médicaments
n’appartenant pas à la classe “marge
thérapeutique étroite”, sur des patholo-
gies aiguës (infections), ou des classes de
médicaments moins sensibles (hypocho-
lestérolémiants, protecteurs gastriques,
hypnotiques, etc.), la conservation du
rapport bénéfice/risque paraît probable.
Sur nos patients fragiles pour lesquels
chaque complication, chaque hospita-
lisation, voire chaque renforcement du
monitorage et de la surveillance coûte
cher, la question reste posée. Une seule
étude pharmaco-économique a été
publiée sur le sujet, concernant la ciclos-
porine. Elle montrait, avec une métho-
dologie probablement critiquable, que
le coût de la substitution (ciclosporine)
était supérieur à celui du princeps : la
mise en place du générique nécessi-
tait des augmentations de dose pour
obtenir des taux résiduels équivalents
et un monitorage plus rapproché(13).
L’avis des praticiens
et des patients
La majorité des médecins transplan-
teurs réclame plus d’informations
concernant les règles d’AMM, de pres-
cription et de substitution des médi-
caments génériques en général et des
immunosuppresseurs en particulier. À
défaut d’espérer que les fournisseurs de
médicaments génériques jouent ce rôle
d’information de manière objective, les
Assises de la transplantation 2011 ont

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 105
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
105
Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
essayé d’appor ter l’information la plus
complète et la plus contradictoire pos-
sible sur le sujet.
Pour sa part, le groupe de travail “médica-
ment et pharmacologie” de la SFT, à l’aide
d’un questionnaire proposé aux membres
de l’association, a pu mettre en évidence
que seule une minorité d’entre eux étaient
prêts à prescrire des génériques d’immuno-
suppresseurs, en l’état actuel de leur infor-
mation. Certaines craintes exprimées
sont clairement infondées, mais d’autres
semblent tout à fait légitimes, concernant
en particulier la bioéquivalence entre
génériques, l’impact de la substitution
sur les indices d’exposition utilisés pour
le suivi thérapeutique pharmacologique,
et surtout l’éducation thérapeutique et la
compréhension de leur traitement par les
patients.
La position des sociétés
savantes
De nombreuses sociétés savantes en
Europe ont pris position sur les géné-
riques des médicaments immunosuppres-
seurs (Allemagne, Hollande, Espagne,
Angleterre, etc.). Certaines sont plus
concernées, puisque des génériques de
ciclosporine sont autorisés dans leur pays
depuis quelques années, ainsi que plus
récemment des génériques du tacrolimus.
Toutes les sociétés savantes semblent
inquiètes du développement systématique
et incontrôlé des génériques et se posent
des questions identiques aux nôtres. Plus
récemment, un advisory board a été mis
en place au sein de l’ESOT, qui a publié
ses propres recommandations. La SFT se
reconnaît dans ces recommandations mais
a tenu à publier les siennes, adaptées à la
spécificité de la situation française.
Recommandations de la SFT
La SFT ne s’oppose pas à l’utilisation des
génériques en général, mais s’interroge
sur la politique mise en place et à venir
concernant les médicaments immuno-
suppresseurs dans la population trans-
plantée. Dans ce groupe spécifique de
patients fragiles pour lesquels l’équilibre
thérapeutique est difficile à obtenir, la plus
grande prudence doit être de mise.
Tous les immunosuppresseurs actuels
doivent être considérés comme des médi-
caments à marge thérapeutique étroite
(anticalcineurines, inhibiteurs de l’IMPDH,
inhibiteur de mTor).
Des règles de bioéquivalence renforcées
sont nécessaires pour des médicaments
faisant l’objet d’un suivi thérapeutique
pharmacologique, comme les immuno-
suppresseurs. En particulier, un critère
de bioéquivalence supplémentaire doit
être pris en compte : celui utilisé pour
l’adaptation de posologie (C0, C2, ou ASC
interdose à l’état stable).
La substitution par un générique ne
peut se faire que par le médecin trans-
planteur ou, à défaut, en plein accord avec
lui et le patient.
Le médecin transplanteur doit pouvoir
continuer à prescrire le princeps s’il le juge
opportun, dans l’intérêt du patient.
Les génériques doivent être prescrits
sous leur nom commercial, et la mention
“non substituable” doit être notée sur
l’ordonnance pour éviter les substitutions
successives d’un générique à un autre.
La substitution par un générique néces-
site des contrôles biologiques et un suivi
clinique rapproché pour s’assurer de la
bonne exposition au produit et effectuer
les adaptations de posologie si nécessaire.
Les patients doivent être informés et
éduqués à l’utilisation des génériques.
Une surveillance doit être mise en
place chez les patients sous générique
d’immunosuppresseur, permettant de
colliger des informations sur l’efficacité
et la tolérance.
Références bibliographiques
1. Code de la santé publique, Article L5121-1
modifié par l’ordonnance n°2010-177 du 23
février 2010 - art. 26.
2. Rapport Académie de médecine du 14 février
2012.
3. Bioavailability and Bioequivalence Studies
for Orally Administered Drug Products - General
Considerations. Revision 1. Guidance for Industry.
U.S. Department of Health and Human Services,
Food and Drug Administration Center for
Drug Evaluation and Research (CDER). March
2003. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
GuidanceComplianceRegulatory Information/
Guidances/ucm070124.pdf.
4. European Medicines Agency, Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP).
Guideline on the investigation of bioequiva-
lence, January 2010. Doc. Ref.: CPMP/EWP/
QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr. http://www.emea.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Scientific_guideline/2010/01/WC500070039.pdf.
5. Chen ML, Lesko LJ. Individual bioequivalence
revisited. Clin Pharmacokinet 2001;40(10):701-6.
6. Pollard S, Nashan B, Johnston A, Hoyer P,
Belitsky P, Keown P, Helderman H; CONSENT:
Consensus on Substitution in European
Transplantation. A pharmacokinetic and clinical
review of the potential clinical impact of using
different formulations of cyclosporin A. Clin Ther
2003;25(6):1654-69.
7. U.S. Food and Drug Administration. CFR -
Code of Federal Regulations. Title 21-Food and
drugs. Chapter I-Food And Drug Administration
Department Of Health And Human Services.
Subchapter D-Drugs for human use. Part
320-Bioavailability and bioequivalence require-
ments. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/
cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?cfrpart=320
(site consulté le 28 novembre 2011).
8. Taber DJ, Baillie GM, Ashcraft EE et al. Does
bioequivalence between modified cyclosporine
formulations translate into equal outcomes?
Transplantation 2005;80(11):1633-5.
9. Diarra DA, Riegersperger M, Säemann MD,
Sunder-Plassmann G. Maintenance immuno-
suppressive therapy and generic cyclosporine A
use in adult renal transplantation: a single center
analysis. Kidney Int 2010;115(Suppl.):S8-11.
10. Vítko S, Ferkl M. Interchangeability of
ciclosporin formulations in stable adult renal
transplant recipients: comparison of Equoral
and Neoral capsules in an international, multi-
center, randomized, open-label trial. Kidney Int
2010;115(Suppl.):S12-6.
11. McDevitt-Potter LM, Sadaka B, Tichy EM,
Rogers CC, Gabardi S. A multicenter expe-
rience with generic tacrolimus conversion.
Transplantation 2011;92(6):653-7.
12. Momper JD, Ridenour TA, Schonder KS,
Shapiro R, Humar A, Venkataramanan R. The
impact of conversion from prograf to generic
tacrolimus in liver and kidney transplant reci-
pients with stable graft function. Am J Transplant
2011;11(9):1861-7.
13. Helderman JH, Kang N, Legorreta AP, Chen
JY. Healthcare costs in renal transplant recipients
using branded versus generic ciclosporin. Appl
Health Econ Health Policy 2010;8(1):61-8.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
106
VOCABULAIREVOCABULAIRE
106 Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
Les pages de la SFT
RECOMMANDATIONS (SUITE)
que consultant, ou orateur à des symposiums, ou formateur, ou a été invité à
des congrès ou des séminaires, ou a reçu des subventions pour la recherche
par les laboratoires suivants : Astellas, BMS, Genzyme (Sanofi), Novartis,
Wyeth (Pfizer), Roche.
L. Sebbag : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur à des
symposiums, ou formateur, ou a été invité à des congrès ou des séminaires,
ou a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires suivants :
Astellas, Novartis, Roche, Biopharma.
D. Anglicheau : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur à
des symposiums, ou formateur, ou a été invité à des congrès ou des séminaires,
ou a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires suivants :
Amgen, Astellas, Novartis, Roche, Wyeth (Pfizer).
N. Kamar : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur à des
symposiums, ou formateur, ou a été invité à des congrès ou des séminaires, ou
a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires suivants : Amgen,
Astellas, BMS, Fresenius, Genzyme (Sanofi), Novartis, Wyeth (Pfizer), Roche.
E. Belaud : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur à des
symposiums, ou formateur, ou a été invité à des congrès ou des séminaires,
ou a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires suivants :
Astellas, Genzyme (Sanofi), Novartis.
A. Hulin : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur à des
symposiums, ou formateur, ou a été invitée à des congrès ou des séminaires,
ou a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires suivants :
Astellas, Novartis, Roche, Wyeth (Pfizer).
P. Marquet : a reçu des honoraires en tant que consultant, ou orateur
à des symposiums, ou formateur, ou a été invité à des congrès ou des
séminaires, ou a reçu des subventions pour la recherche par les laboratoires
suivants : Astellas, Novartis, Roche.
Liens d’intérêts
Y. Le Meur : a reçu des honoraires en tant
Dose recommandée : 1 g deux fois par jour (2 g/j) par voie orale ou IV ou 5 ml de suspension buvable 2 fois par jour. Enfants et adolescents (âgés de 2 à 18 ans) : Dose recommandée :
600 mg/m2 administrés par voie orale deux fois par jour (maximum de 2 g/j ou 2 g/10 ml de suspension buvable par jour). CellCept comprimés doit être prescrit uniquement aux patients dont la
surface corporelle est supérieure à 1,5 m2 et CellCept gélules uniquement aux patients dont la surface corporelle est d’au moins 1,25 m 2. Surface corporelle comprise entre 1,25 et 1,5 m2 :
la posologie de CellCept gélules est de 750 mg deux fois par jour (1,5 g/j). Surface corporelle supérieure à 1,5 m2 : la posologie de CellCept gélules est de 1 g deux fois par jour (2 g/j). Enfants
(< 2ans) : l’utilisation de Cellcept n’est pas recommandée. Utilisation en transplantation cardiaque (sauf CellCept poudre pour perfusion) : par voie orale, initiation dans
les 5 jours suivant la greffe cardiaque. Dose recommandée : 1,5 g deux fois par jour (3 g/j). Utilisation en transplantation hépatique : CellCept pour perfusion doit être administré
pendant les 4 premiers jours suivant la transplantation hépatique avec un relais du CellCept par voie orale dès qu’il peut être toléré. Doses recommandées : 1 g deux fois par jour (2 g/j) par voie IV
puis 1,5 g deux fois par jour per os (3 g/j). Utilisation chez l’enfant : CellCept formes orales : Aucune donnée disponible chez les transplantés cardiaques ou hépatiques en pédiatrie. CellCept
pour perfusion : aucune donnée pharmacocinétique disponible chez les transplantés rénaux et hépatiques en pédiatrie. Utilisation chez les personnes âgées (≥ 65 ans) : Doses
recommandées : CellCept formes orales : 1 g deux fois par jour chez les transplantés rénaux et 1,5 g deux fois par jour chez les transplantés cardiaques ou hépatiques. CellCept pour perfusion :
1 g deux fois par jour chez les transplantés rénaux ou hépatiques. Utilisation en cas d’insuffi sance rénale sévère (débit de fi ltration glomérulaire < 25 ml.min-1.1,73m-2) : chez les
transplantés rénaux éviter d’administrer des doses supérieures à 1 g de CellCept deux fois par jour, en dehors de la période immédiatement postérieure à la greffe. Aucune donnée n’est disponible
concernant les transplantés cardiaques ou hépatiques. Utilisation en cas d’insuffi sance hépatique sévère : aucune adaptation de dose n’est nécessaire chez les transplantés rénaux
atteints de maladie hépatique parenchymateuse sévère. Aucune donnée n’est disponible concernant les transplantés cardiaques. Traitement pendant les épisodes de rejet : pas de
diminution de dose ou d’interruption du traitement requise en cas de rejet de greffe rénal. Aucun argument ne justifi e l’ajustement de la dose de CellCept en
cas de rejet de greffe cardiaque. Aucune donnée pharmacocinétique disponible en cas de rejet de greffe hépatique. CONTRE-INDICATIONS : Des réactions d’hypersensibilité à CellCept ont
été observées (voir Effets indésirables). CellCept est donc contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité au mycophénolate mofétil ou à l’acide mycophénolique.
CellCept 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion est contre-indiqué chez les patients qui sont allergiques au polysorbate 80. CellCept est contre-indiqué chez la femme allaitante
(cf Grossesse et allaitement). Pour les informations concernant l’usage pendant la grossesse et les mesures contraceptives requises, voir Grossesse et allaitement. MISES EN GARDE
SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI*. INTERACTIONS*. GROSSESSE ET ALLAITEMENT*. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES
ET A UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDESIRABLES* : effets indésirables inattendus observés lors des essais cliniques : Diarrhée, leucopénie, infections
généralisées et vomissements. Certaines infections surviennent avec une fréquence accrue. Tumeurs malignes. Infections opportunistes. Enfants et adolescents (âgés de 2 à 18 ans). Patients âgés
(≥ 65 ans). Autres réactions indésirables. Effets indésirables inattendus observés depuis la commercialisation : Appareil digestif. Troubles liés à l’immunosuppression.
Affections hématologiques et du système lymphatique. Hypersensibilité. Affections congénitales. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales. SURDOSAGE*. PROPRIETES
PHARMACODYNAMIQUES* : Immunosuppresseurs sélectifs : code ATC : L04AA06. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES*. DONNEES DE SECURITE
PRECLINIQUES*. INCOMPATIBILITES*. CONSERVATION* : Gélules et Comprimés : 3 ans. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. A conserver dans
l’emballage d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité. Poudre pour suspension buvable : 2 ans. Suspension reconstituée : 2 mois. Poudre pour suspension buvable et suspension
reconstituée : à conserver à une température ne dépassant pas 30°C. CellCept poudre pour solution à diluer pour perfusion : 3 ans. A conserver à une température ne dépassant
pas 30°C. Solution reconstituée et solution à diluer pour perfusion : La perfusion ne doit pas débuter plus de 3 heures après la reconstitution et la dilution du médicament. A conserver entre 15°C
et 30°C. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET MANIPULATION*. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste I. Agréé aux collectivités (toutes formes).
CellCept formes orales : Prescription initiale hospitalière de 6 mois. Remboursé SS à 100%. CellCept pour perfusion : Réservé à l’usage hospitalier. NUMEROS
D’IDENTIFICATION : CELLCEPT® 500 mg, comprimés : EU/1/96/005/002, CIP 3400935952707, boîte de 50 comprimés (en plaquette thermoformée de 10) : Prix 109,91 €. CTJ :
en transplantation rénale 8,79 € - en transplantation cardiaque et hépatique 13,19 € - CELLCEPT® 250 mg, gélules : EU/1/96/005/001, CIP 3400935952585, boîte de 100 gélules (en plaquette
thermoformée de 10) : Prix 109,91 €. CTJ : en transplantation rénale 8,79 € - en transplantation cardiaque et hépatique 13,19 € - CELLCEPT® 1g/5 ml, poudre pour suspension buvable :
EU/1/96/005/006, CIP 3400935952936, boîte de un fl acon de 110 g de poudre. Prix 197,27 €. CTJ : en transplantation rénale : 11,27 € - en transplantation cardiaque et hépatique : 16,91 €.
CELLCEPT® 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion : EU/1/96/005/005, boîte de 4 fl acons. CIP 340095619394 3.TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHE : Roche Registration Limited - 6, Falcon Way- Shire Park - Welwyn Garden City - AL7 1TW– Royaume Uni. Représentant local : ROCHE SAS – 30, cours de l’Ile Seguin
92650 Boulogne-Billancourt cedex Tél. : 01 47 61 40 00. DATE D’APPROBATION/REVISION : Mars 2012. V0312.
*Pour une information complète, consulter le dictionnaire RCP disponible sur le site de l’AFSSAPS (www.afssaps.fr) ou à défaut sur le site
de ROCHE (www.roche.fr)
Le fi chier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. Roche est responsable de ce fi chier qui a pour fi nalité le suivi de nos relations avec les professionnels
de santé. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition aux données recueillies à votre sujet auprès du Service Juridique de Roche, tél. du standard 01 47 61 40 00.
01979/CELL/0312 Etabli le 13/03/2012 H.RibonCom
ROVALCYTE® 450 mg, comprimés pelliculés - ROVALCYTE® 50 mg/ml, poudre pour solution buvable. COMPOSITION* : Comprimé : Valganciclovir 450,00 mg sous forme de chlorhydrate de valganciclovir. Poudre
pour solution buvable : Valganciclovir 50 mg sous forme de chlorhydrate de valganciclovir pour 1 ml de solution reconstituée. Un flacon de 12 g de poudre pour solution buvable contient 5,5 g de chlorhydrate de
valganciclovir. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Rovalcyte est indiqué dans le traitement d’attaque et le traitement d’entretien de la rétinite à cytomégalovirus (CMV) chez les patients atteints de
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Rovalcyte est indiqué en traitement prophylactique des infections à CMV chez les patients CMV négatif ayant bénéficié d’une transplantation d’organe
solide à partir d’un donneur CMV positif. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Observer strictement les recommandations posologiques afin d’éviter un surdosage. Sur le plan thérapeutique, un
traitement par le valganciclovir per os à la posologie de 900 mg deux fois par jour équivaut à un traitement par le ganciclovir administré par voie IV à la posologie de 5 mg/kg deux fois par jour. L’exposition systémique
au gancicolvir après administration de 900 mg de solution buvable de valganciclovir est équivalente à celle après administration de 900 mg de valganciclovir sous forme de comprimés. Posologie standard chez
l’adulte : Traitement d’attaque de la rétinite à CMV : 900 mg 2 fois par jour pendant 21 jours dans la mesure du possible avec des aliments. Traitement d’entretien de la rétinite à CMV : En poursuite d’un traitement
d’attaque ou chez les patients présentant une rétinite à CMV non évolutive 900 mg 1 fois par jour dans la mesure du possible avec des aliments. Traitement prophylactique de la maladie à CMV en transplantation
d’organes solides : 900 mg une fois par jour, dans la mesure du possible avec des aliments à débuter dans les 10 jours suivant la transplantation et poursuivre jusqu’à 100 jours après celle-ci. Instructions
posologiques particulières : Insuffisants rénaux : surveillance étroite de la clairance de la créatinine et ajustement de la posologie en fonction de la clairance de la créatinine. Patients hémodialysés : Comprimés :
Rovalcyte ne devra pas être utilisé chez ces patients. Poudre pour solution buvable : adaptation posologique nécessaire. Insuffisants hépatiques : La sécurité et l’efficacité de Rovalcyte comprimés n’ont pas été
étudiées. Enfants et adolescents : ne doit pas être utilisé chez l’enfant en dessous de 18 ans suite à un manque de données concernant la sécurité et l’efficacité. Patients âgés : La sécurité et l’efficacité n’ont pas
été établies. Patients présentant une leucopénie, une neutropénie, une anémie, une thrombopénie ou une pancytopénie de caractère sévère : En cas de dégradation significative de la numération formule sanguine,
l’administration de facteurs de croissance hématopoïétiques et/ou l’interruption du traitement doivent être envisagées. CONTRE-INDICATIONS : Rovalcyte est contre-indiqué chez les patients présentant une
hypersensibilité au valganciclovir, au ganciclovir ou à l’un des excipients. Du fait de la similarité de structure chimique de Rovalcyte avec celle de l’aciclovir et du valaciclovir, une réaction d’hypersensibilité croisée
entre ces médicaments est possible. De ce fait, Rovalcyte est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité à l’aciclovir ou au valaciclovir. Rovalcyte est contre-indiqué durant l’allaitement ;
cf. Grossesse et allaitement. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Poudre pour solution buvable : en raison du caractère tératogène, la poudre Rovalcyte et la solution reconstituée doivent
être manipulées avec précaution. L’inhalation doit être évitée. En cas de contact avec la peau, la surface doit être soigneusement lavée avec de l’eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, ceux-ci doivent être
immédiatement et soigneusement rincés avec de l’eau. Comprimés : Respecter scrupuleusement les posologies recommandées lors de l’instauration du traitement, lors du passage du traitement d’attaque au
traitement d’entretien, ainsi que chez les patients qui passent du ganciclovir oral au valganciclovir, car Rovalcyte ne peut être substitué au ganciclovir en gélules sur la base d’un comprimé pour une gélule.
Aqualuna Communication • Etabli le 29/06/10 • 00379/ROVA/0610 • Photo droits gérés : getty images
2 comprimés,
1 prise par jour1**
Rovalcyte® 450 mg
comprimés pelliculés
Seul traitement prophylactique
oral des infections
à CMV en
Toutes formes : Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité d’utiliser une méthode de contraception efficace durant le traitement. Les hommes doivent être informés de la nécessité
d’avoir recours à une méthode de contraception mécanique durant le traitement par Rovalcyte et pendant au moins 90 jours après ce traitement, sauf s’il est certain que la partenaire n’est pas à risque de procréer.
Aucun traitement ne devra être entrepris si le nombre absolu des polynucléaires neutrophiles est < à 500 cellules/µl, ou le nombre des plaquettes < à 25.000/µl ou la valeur de l’hémoglobine < à 8 g/dl. Surveillance
de la numération formule sanguine et du nombre des plaquettes durant le traitement. Chez les insuffisants rénaux, la posologie doit être ajustée en fonction de la clairance de la créatinine. INTERACTIONS* :
Interactions médicamenteuses avec valganciclovir : voir celles observées avec le ganciclovir. Effets des autres médicaments sur le ganciclovir : Imipénème-cilastatine. Probénécide. Effets du ganciclovir
sur les autres médicaments : Zidovudine. Didanosine. Mycophénolate mofétil. Zalcitabine. Stavudine. Triméthoprime. Autres antirétroviraux. Autres interactions médicamenteuses potentielles. GROSSESSE ET
ALLAITEMENT*. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDESIRABLES* : Effets indésirables rapportés au cours des essais cliniques : Infections et
infestations- Affections hématologiques et du système lymphatique - Affections du système immunitaire - Troubles du métabolisme et de la nutrition - Affections psychiatriques - Affections du système nerveux -
Affections oculaires - Affections de l’oreille et du labyrinthe - Affections cardiaques - Affections vasculaires - Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales - Affections gastro-intestinales - Affections hépato-
biliaires - Affections de la peau et du tissu sous-cutané - Affections musculo-squelettiques, systémiques et osseuses - Affections du rein et des voies urinaires - Affections des organes de reproduction et du sein -
Troubles généraux et anomalies au site d’administration - Investigations. SURDOSAGE*. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES* : nucléosides et nucléotides excl. inhibiteurs de la transcriptase inverse, code ATC :
J05A B14. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES*. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES*. CONSERVATION* : Comprimés : 3 ans, Poudre pour solution buvable : 2 ans, Solution reconstituée : 49 jours.
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION*. NATURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE*. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET DE MANIPULATION* : Comprimés : Tout produit non utilisé
ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences réglementaires locales. Poudre pour solution buvable : Il est recommandé que le pharmacien reconstitue Rovalcyte pourdre pour solution buvable avant
de la délivrer au patient. NUMERO AU REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES MEDICAMENTS : Comprimés : 3400936013612 : Prix 1584,16€, CTJ : 105,61€ (Traitement d’attaque de la rétinite à CMV),
CTJ : 52,81€ (Traitement d’entretien de la rétinite à CMV), CTJ : 52,81€ (Traitement prophylactique de la maladie à CMV en transplantation), boîte 60 comprimés en flacon (PEHD). Poudre pour solution buvable :
3400938673371 : Prix 276,24€, CTJ : 99,45€ (Traitement d’attaque de la rétinite à CMV), CTJ : 49,72€ (Traitement d’entretien de la rétinite à CMV), CTJ : 49,72€ (Traitement prophylactique de la maladie à CMV en
transplantation), boite de 1 flacon de 12 g de poudre pour solution buvable en flacon + 2 seringues. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste I. Agréé aux coll. Remboursé Sécurité Sociale à 65 %. TITULAIRE DE
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : ROCHE - 52, boulevard du Parc - 92521 Neuilly sur Seine cedex. DATE D’APPROBATION/REVISION : Février 2009. V03/10.
* Pour une information complète, consulter le RCP disponible sur le site de l’AFSSAPS (www.afssaps.fr) ou à défaut sur le site de ROCHE (www.roche.fr).
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. Roche est responsable de ce fichier qui a pour finalité le suivi de nos relations clients. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données recueillies à votre sujet auprès du Service Juridique de Roche, tél. du standard 0146405000.
Rovalcyte® 50 mg poudre
pour solution buvable
La solution
pour des
posologies
adaptées1
13217_ap_cellcept_210x297.indd 2 13/03/12 18:04
1
/
5
100%