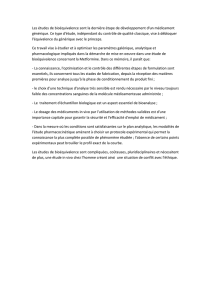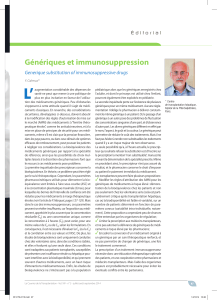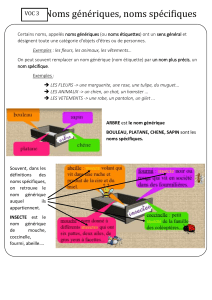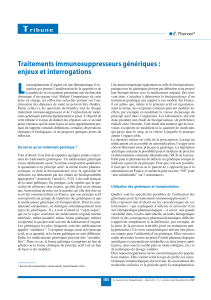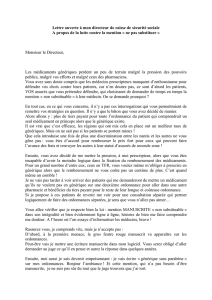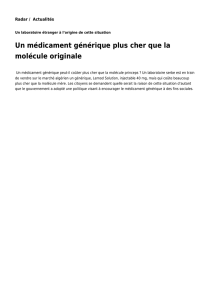Lire l'article complet

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 99
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
99
Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
VOCABULAIREVOCABULAIRE
L’
objectif de ces Assises, organi-
sées en 2demi-journées, était
de débattre de la probléma-
tique des génériques afin d’adapter les
recommandations proposées par l’Euro-
pean Society for Organ Transplantation
(ESOT), puis de faire le point sur les
immunosuppresseurs (IS) de demain.
Immunosuppression
et génériques
Le recours aux médicaments génériques
soulève de nombreuses interrogations,
notamment en ce qui concerne leur
bioéquivalence par rapport à la spé-
cialité de référence et les problèmes
d’observance qui peuvent en découler.
La réglementation actuelle pour
l’obtention de l’autorisation de mise
sur le marché (AMM) des médica-
ments génériques (Dr Anne Dunant,
Unité génériques, Agence française
de sécurité sanitaire des produits
de santé - Afssaps) rejoint celle de la
Food and Drug Administration (FDA)
et de l’European Medicines Agency
(EMA). Avant d’obtenir l’AMM, le médi-
cament générique doit avoir démontré
sa bioéquivalence. Mais bioéquivalent
ne signifie pas identique en termes
d’aspect, de goût ni de couleur. Ainsi,
2 médicaments contenant la même
substance active sont considérés comme
bioéquivalents si leurs biodisponibilités
après administration à la même dose
se situent dans des limites acceptables
prédéfinies. Les paramètres pharmaco-
cinétiques étudiés sont l’aire sous la
courbe (ASC) et la Cmax (concentration
plasmatique maximale), qui doivent se
situer dans un intervalle de confiance
de 80 à 125 %. Pour les médicaments
à marge thérapeutique étroite, l’inter-
valle de confiance et d’acceptation a été
réduit à 90-111 %. Cependant, dans le
cas des immunosuppresseurs, qui sont
effectivement des médicaments à marge
thérapeutique étroite, il est nécessaire
d’évaluer d’autres paramètres pharmaco-
cinétiques comme, notamment, la C0
(concentration résiduelle) et la C2, qui
sont ceux pris en compte pour l’adap-
tation de posologie.
Les études de bioéquivalence sont uni-
quement conduites chez des volontaires
sains, dans des conditions stables et en
ne testant qu’une seule dose. Ces condi-
tions d’étude posent un problème, car
les patients suivis pour transplantation
rénale ou hépatique peuvent égale-
ment présenter une insuffisance rénale
ou hépatique susceptible d’interférer
avec la biodisponibilité. La prescription
de génériques chez les patients trans-
plantés peut être contestée. Administrer
un seul médicament une seule fois à un
volontaire sain ne peut être comparé à
l’administration chronique d’une dizaine
de médicaments à un patient trans-
planté, qui s’expose à un haut risque d’in-
teractions médicamenteuses. De plus,
les études de bioéquivalence ne s’inté-
ASSISES
.
Les génériques et les immunosuppresseurs de demain
Compte-rendu des Assises de la SFT

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
100
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
100 Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
Les pages de la SFT
ressent pas à la population pédiatrique ;
or, tout générique qui aura démontré sa
bioéquivalence chez l’adulte, et dont le
princeps est utilisé chez l’enfant, pourra
également être utilisé en pédiatrie. Sur
le plan de la sécurité et de l’efficacité,
l’administration d’un générique dans ce
cas ne semble pas satisfaisante.
L’Afssaps met à la disposition des phar-
maciens le “Répertoire” où figurent des
recommandations de prudence pour les
médicaments à doses critiques ; ilfaut
prendre en considération à la fois la
pathologie et le patient.
On peut également s’inquiéter du grand
nombre de génériques qui existent sur
le marché, pour une même spécialité
princeps. En effet, le patient peut se
voir délivrer un générique différent
du précédent selon la pharmacie, car
il n’existe aucune réglementation obli-
geant le pharmacien à délivrer le même
générique que son confrère. Le passage
d’un générique à l’autre pose des pro-
blèmes d’appropriation du traitement
et d’observance. La meilleure alternative
qui existe à l’heure actuelle reste la pos-
sibilité pour le prescripteur de refuser la
substitution en précisant que le produit
est “non substituable”. Cette mention
doit être manuscrite et doit figurer sur
l’ordonnance avant la dénomination de
la spécialité prescrite.
Si l’on évalue l’impact médico-écono-
mique réel du recours aux traitements
génériques (Pr Isabelle Durand-Zaleski,
Recherche clinique et santé publique,
hôpital Henri-Mondor, Créteil), il faut
savoir que les IS ont une marge théra-
peutique étroite, si bien que les études
seront plus focalisées sur l’efficacité que
sur le coût, surtout dans les pathologies
où la prise en charge à 100 % améliore
l’observance au traitement. Les patients
transplantés faisant l’objet de nombreuses
hospitalisations, il serait intéressant de
mettre en regard la prescription et l’hospi-
talisation, qui peut être due à un problème
de rejet, d’inefficacité du traitement ou de
mauvaise observance (en raison de chan-
gements fréquents de générique). Afin de
pouvoir réellement débattre de l’efficacité
du générique et évaluer le gain écono-
mique par rapport au princeps, il faudrait
mettre en place une étude prospective sur
une durée suffisamment longue permet-
tant d’estimer la probabilité de voir sur-
venir un événement tout en laissant aux
médecins le libre choix de la prescription.
À côté du problème de sécurité et
d’efficacité que soulève la prescription
de génériques, le Pr Michèle Kessler
(service de néphrologie et de transplan-
tation rénale, CHU de Nancy) a égale-
ment souhaité évoquer leur impact sur
l’éducation thérapeutique. Le traitement
IS est complexe du fait des risques de
rejet et d’infections, et nécessite donc
une bonne “adhésion” du patient au
traitement. Les IS ont une marge théra-
peutique étroite, des effets indésirables
et des interactions médicamenteuses
non négligeables, et ils demandent
une grande rigueur dans la fréquence
et les horaires des prises. Ces contraintes
impliquent un risque de non-observance.
Les génériques diffèrent des médica-
ments princeps par le nom, l’aspect, la
taille, la forme, la couleur, le marquage et
le goût. Tout cela peut être source d’in-
compréhension, d’erreurs et de confu-
sions de la part du patient. De plus, le
risque est de créer une discordance entre
la prescription du médecin transplanteur,
celle éventuellement faite par d’autres
médecins, l’information donnée par le
personnel soignant animant les séances
ASSISES (SUITE)
Glossaire
Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue, depuis
le 29 avril 2012, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM).
AUC0-∞ (à défaut, AUC0-t, jusqu’à la dernière concentration mesurable) : aire sous la
courbe (ASC ou AUC, pour Area Under the Curve), mesure de la surface située sous le
tracé de la courbe de concentration d’un médicament, et qui évalue l’exposition globale
du sujet au médicament.
Biodisponibilité : fraction de la dose d’une substance administrée par voie autre
qu’intraveineuse qui atteint la circulation systémique. Elle est généralement mesurée
en comparant les ASC obtenues après administration du même médicament par voie
intraveineuse et par la voie étudiée (qui est le plus souvent la voie orale).
Bioéquivalence : 2principes actifs sont dits bioéquivalents lorsqu’ils remplissent les
critères réglementaires de bioéquivalence, c’est-à-dire des valeurs non statistiquement
différentes d’ASC, de Cmax (± de Tmax) lorsqu’ils sont administrés à la même dose.
C0 ou Cmin : concentration minimale du produit dans le sang juste avant la prise
suivante en cas d’administration répétée.
Cmax : concentration maximale du produit dans le sang après administration.
EMA : Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency), créée en
1995 et située à Londres.
FDA : Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food
and Drug Administration).
Marge thérapeutique étroite : médicaments dont la concentration minimale toxique
est inférieure à 2fois la concentration minimale efficace chez l’homme, ou nécessitant un
ajustement de posologie et une surveillance précautionneuse du patient.
Substitution d’un produit générique à un produit princeps (ou substitution d’un
générique à un autre) : possibilité, pour le pharmacien d’officine, de remplacer un médi-
cament prescrit par un médecin par un médicament “bioéquivalent”.
Tmax : durée au bout de laquelle la Cmax est atteinte.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 101
VOCABULAIREVOCABULAIRE
VOCABULAIREVOCABULAIRE
101
Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
d’éducation thérapeutique et la délivrance
faite par le pharmacien.
Le générique permettrait, certes, un gain
financier. Cependant, il ne faut pas hésiter
à rendre non substituables les traitements
quand il y a un risque majeur de non-obser-
vance ou de perte de l’autonomie dans
leur gestion. Idéalement, il faudrait pouvoir
identifier clairement ce que l’on prescrit et
le produit de remplacement éventuel pour
surveiller de façon rigoureuse l’apparition
d’événements indésirables.
On peut imaginer qu’une diminution
imposée des coûts du princeps aurait
permis d’éviter de recourir aux génériques.
Une enquête conduite par la Société fran-
cophone de transplantation sur l’utilisa-
tion des IS génériques (Pr Pierre Marquet,
pour la commission médicament de la
SFT, chef de service de pharmacologie,
toxicologie et pharmacovigilance, CHU
de Limoges) a mis en avant les point sui-
vants : il serait souhaitable de renforcer
les règles de bioéquivalence en prenant
en compte les C0 et C2, de ne pas faire
des essais exclusivement en dose unique
et d’élargir ces études aux patients trans-
plantés. Le doute repose sur la qualité des
génériques (insuffisante ou inconstante) et
sur les possibles substitutions d’un géné-
rique à l’autre au fil des mois, sachant par
exemple qu’il existe à l’heure actuelle
17formes différentes du mycophénolate
mofétil. Globalement, 42 % des prescrip-
teurs sont défavorables aux génériques et
seraient favorables à une baisse de prix du
médicament princeps.
Le Pr Yann Le Meur (service de néphro-
logie et de transplantation rénale, CHU
de Brest) a fait le point sur les recomman-
dations de l’ESOT, qui propose de conti-
nuer les recherches et enquêtes sur les
réels bénéfices de l’usage des génériques
dans le domaine de la transplantation.
Tant que la bioéquivalence “stricte” de 90
à 111 % par rapport au princeps n’est pas
démontrée, un générique ne devrait pas
obtenir d’autorisation de commercialisa-
tion. De plus, il faudrait veiller à ce que
chaque changement d’un médicament
vers son générique, ou entre plusieurs
formulations génériques entre elles, fasse
l’objet d’un ajustement et d’une réévalua-
tion de la fenêtre thérapeutique au cas
par cas. Le recours au générique risque
également d’entraîner une variation de la
concentration sanguine lors de la conver-
sion. Une coopération maximale entre
pharmacien et médecin transplanteur doit
être instaurée afin d’informer les patients.
Les immunosuppresseurs
de demain
Le Dr Nathalie Dumarcet (chef du dépar-
tement information et bon usage des
médicaments, Direction de l’évaluation
des médicaments et des produits bio-
logiques [ DEMEB], Afssaps) est revenue
sur les alternatives qui existent à l’heure
actuelle pour les traitements coûteux
prescrits hors AMM. Les 2réponses ins-
titutionnelles permettant aujourd’hui
de pouvoir prescrire hors AMM sont les
autorisations temporaires d’utilisation
(ATU) et les protocoles thérapeutiques
temporaires (PTT). Par exemple, depuis
le mois de novembre 2010, l’Afssaps a
accordé la mise en place d’un PTT pour les
immunoglobulines intraveineuses dans la
prise en charge des greffes rénales, avec
un projet dans la greffe cardiaque, mais
sous réserve de l’inclusion dans un suivi
de cohorte nationale.
À côté de ces outils de prescription hors
AMM s’est développé, depuis 2004, le plan
de gestion de risques (PGR), dont l’objectif
est de surveiller et de minimiser les risques
de façon proactive tout au long de la vie
du produit. En effet, d’une façon générale,
on s’aperçoit que, même si le risque est
connu, on observe des différences entre
la pratique médicale courante et la théorie
(les recommandations et RCP du produit).
Le PGR peut être divisé en 2parties (Dr
Christel Saussier, évaluateur, pharmaco-
épidémiologiste, Afssaps). Il consiste à
établir, dans un premier temps, la liste
des risques potentiels, puis un plan de
pharmacovigilance, avec notification des
effets indésirables, rapports périodiques
de sécurité et éventuellement mise en
route d’activités additionnelles, comme
des études d’utilisation. Un plan de mini-
malisation du risque est établi, après avoir
vérifié que le plan européen de gestion des
risques est suffisant et approprié aux régle-
mentations françaises. Le Tysabri® (nata-
lizumab), par exemple, a fait l’objet d’un
PGR européen pour obtenir des données
sur l’incidence des réactions d’hypersen-
sibilité et des infections, et, sur le plan
national, l’objectif était de colliger tous
les cas d’événements indésirables graves
et inattendus pour minimiser ce risque.
Le Pr Gilles Blancho (service de néphro-
logie et de greffe rénale et pancréatique,
CHU de Nantes) a abordé les médicaments
de demain, leurs modalités d’action, leurs
effets indésirables, ainsi que le moment et
la manière de les utiliser. Il s’agit des bio-
thérapies innovantes, des “antigénériques”.
Si l’on regarde l’exemple du bélatacept,
qui sera commercialisé sous le nom de
Nulojix®, il a fait l’objet de nombreuses
études en phases II et III, présentées
et publiées (American Transplant
Congress 2011 ; ESOT 2011). Un autre
exemple est l’éculizumab (ou Soliris®),
dans le traitement de l’hémoglobinurie
paroxystique nocturne, qui est égale-
ment utilisé en transplantation, hors
AMM. Étant donné le risque d’infections
à méningocoques, une vaccination est
obligatoire. En transplantation, cette
vaccination se fait au moment de l’uti-
lisation de la molécule. Une antibiopro-
phylaxie est une mesure additionnelle
efficace au moment de l’utilisation.
Conclusion
(Pr Jean-Paul Squifflet,
président de laSFT)
L’accès aux médicaments génériques
pour les patients transplantés doit faire,
de la part du transplanteur, l’objet d’une
évaluation au cas par cas. La coopération
médecin/pharmacien et l’inclusion du
pharmacien dans le processus de l’édu-
cation thérapeutique semblent un atout
majeur pour le patient. La baisse de prix
des médicaments princeps, plus que l’ar-
rivée des génériques, permettrait de mieux
développer les médicaments de demain.
1
/
3
100%