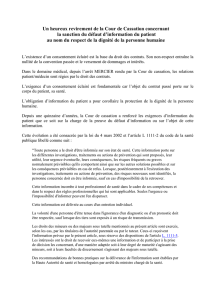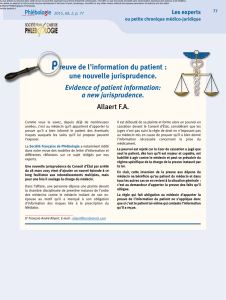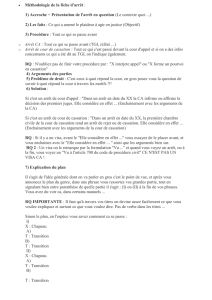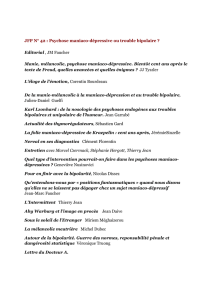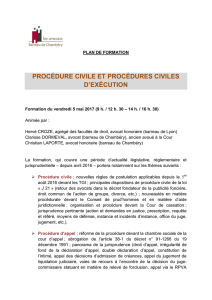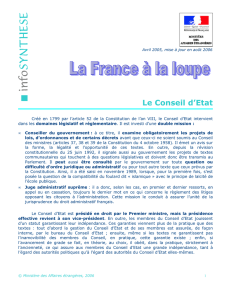Tout dire jusqu’à l’exceptionnel sur l’acte médical envisagé et différer l’annonce

Tout dire jusqu’à l’exceptionnel sur l’acte
médical envisagé et différer l’annonce
d’un diagnostic ou d’un pronostic grave :
ces deux règles qui peuvent, en première lec-
ture, paraître contradictoires sont, en fait,
en continuité. Elles illustrent ce qu’est
le devoir médical et comment ce devoir doit
être concilié avec le droit.
L’information préalable à l’acte médical doit
porter sur tout risque grave, même s’il est
exceptionnel : le principe nouveau, fixé par la
jurisprudence, est désormais bien connu. C’est,
à proprement parler, une véritable onde de choc
qu’a générée la règle définie par les deux juri-
dictions suprêmes, la Cour de cassation et le
Conseil d’État, pour une fois unis. Principe
connu et principe redouté car, sur le terrain,
l’illusion et l’approximation l’ont souvent
emporté sur la rigueur de l’analyse. En effet,
une condamnation pour manquement à l’obli-
gation d’information n’est envisageable que
sous des conditions très restrictives : le dom-
mage ne doit pas être lié à une faute médicale
mais doit résulter d’un aléa, et doit être précédé
d’un véritable choix dans l’acceptation de l’acte
médical, choix qui aurait été modifié par l’insuf-
fisance du consentement... Certes, l’hypothèse
existe, mais elle se rapproche du cas d’école.
É
QUILIBRER LA RELATION MÉDICALE
Par l’adoption de cette jurisprudence, le juge a
voulu rééquilibrer la relation médicale. Le dan-
ger résulte moins de la règle que d’une lecture
simpliste qui générerait des pratiques insen-
sées : multiplication de déclarations écrites de
consentement, exacerbation des risques, oubli
du devoir de convaincre. La relation médicale
ne doit pas dériver vers le formalisme.
Ce formalisme serait mortifère. Quand la régle-
mentation et le souci de la preuve semblent
l’emporter, il devient urgent de revenir à la
source du droit. Le grand principe est le consen-
sualisme : le contrat – et la relation médicale
est de nature contractuelle – se forme par la
rencontre des volontés. Il n’est pas nécessaire
d’en pré-constituer la preuve. Peut-on trouver
une meilleure illustration à cette règle que la
formation du contrat médical ? S’il est un
domaine pour lequel il semble a priori illégitime
de formaliser la preuve, c’est bien le domaine
médical. Au-delà de la réglementation, c’est le
principe fondamental de l’article 1 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 qui définit ce cadre : Tous les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droit.
La relation soignante est égalitaire, une égalité
qu’il ne s’agit pas de constater mais de
construire. Dans cette relation duale, l’un dis-
pose de l’acquis scientifique et de la maîtrise
professionnelle, l’autre est atteint par la mala-
die ou la souffrance, fragilisé par la perte de ses
repères communs. Comment cette rencontre,
qui ne peut trouver son sens qu’empreinte
d’humanisme, pourrait-elle être ramenée à la
futilité de formalités ?
L’égalité de la relation humaine est le principe
clé. Elle crée pour le soignant une obligation
positive et constructive : convaincre de l’utilité
des soins une personne affaiblie par la maladie.
C’est au regard de ce devoir de conviction que
doit être appréciée la notion de consentement
éclairé. Le risque véritable est que le médecin
démissionne de son devoir de conviction,
devoir mesuré et attentif mais devoir certain,
pour s’en tenir à un formalisme vidé de sens,
qui serait orienté non plus vers la recherche de
l’acceptation des soins, mais vers des réflexes
frileux destinés à éviter les recours en respon-
sabilité. Or, autant il est difficile d’obtenir la
condamnation d’un médecin pour un manque-
ment à l’obligation d’information, dès lors que
les soins ont été salutaires, autant les condam-
nations seraient sévères pour sanctionner les
médecins qui, hypertrophiant le risque,
auraient détourné les patients de soins qui
pourtant auraient pu être salutaires.
Les conséquences négatives de cette approche
nouvelle du consentement éclairé sont illustra-
tives des effets dévastateurs que peut avoir une
jurisprudence, équilibrée en elle-même, mais qui
n’est pas ou qui est mal expliquée. L’intention
52
Correspondances en médecine - n° 2, vol. II - avril/mai/juin 2001
Chronique du droit
Quand mentir
devient un devoir
!
!
G. Devers*
* Avocat au barreau de Lyon.
Chargé d’enseignement à l’université
de Lyon-III.

53
Correspondances en médecine - n° 2, vol. II - avril/mai/juin 2001
des juges n’était pas de créer la tempête, mais
de susciter une inflexion et une réflexion sur la
relation médicale. Loin des apparences, la
constance l’emporte sur le bouleversement :
les fondements de la relation médicale résis-
tent au temps.
L
EPIEUX MENSONGE
La jurisprudence vient, dans un domaine
proche, de confirmer ce constat. Il ne s’agit plus
de l’information préalable à l’acte médical, la
fameuse recherche du consentement éclairé,
mais de l’attitude du médecin confronté à l’an-
nonce d’un diagnostic ou d’un pronostic grave.
Comme souvent, la solution puise dans le bon
sens. Bien sûr, le médecin doit dire la vérité sur
la maladie, mais il doit par dessus tout respec-
ter le malade. L’annonce d’un diagnostic grave,
qui correspondrait à une recherche de la vérité,
peut devenir antinomique du respect du
malade : l’affirmation de la vérité ne peut
répondre à aucun automatisme. Cette vérité est
parfois salutaire, parfois destructrice ; parfois
souhaitée, parfois redoutée ; souvent affirmée,
souhaitée, alors qu’elle est en fait redoutée.
Tout est très simple quand une personne en
bonne santé se prononce sur des principes qui
lui sont étrangers. La situation est bien diffé-
rente quand la même personne, confrontée à la
maladie, placée devant la perspective de la
souffrance ou de la mort, cherche à maintenir
les fils de la cohérence et de l’espoir.
C’est la règle du “pieux mensonge” : l’intérêt
réel du patient n’est pas d’être confronté bruta-
lement à une vérité, mais d’être armé le mieux
possible pour lutter contre la maladie. Le Code
de déontologie médicale a toujours retenu
cette option. Le texte actuel, qui résulte du
décret du 6 septembre 1995, rappelle que le
médecin est tenu de donner à son patient une
information loyale, claire et appropriée sur son
état, à propos des investigations et soins qu’il
lui propose, avant d’ajouter en son article 35 :
Pour des raisons légitimes que le praticien
apprécie en conscience, un malade peut être
laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
pronostic grave.
L’
ARRÊT DU
23
MAI
2000
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai
2000, confirme la règle et en souligne toute la
portée. L’affaire jugée concerne la psychiatrie,
mais les règles posées sont transposables à
toute l’activité médicale.
En février 1986, un homme vient consulter un
médecin psychiatre pour un accès dépressif
consécutif au dépôt de bilan de l’entreprise
qu’il dirigeait. Le médecin psychiatre entre-
prend une prise en charge et, dès le mois d’avril
1987, analyse qu’il ne s’agit pas d’un phéno-
mène dépressif banal, mais d’une psychose
maniaco-dépressive. ll n’en informe pas le
patient dans la mesure où l’état semble se sta-
biliser. De fait, à partir de septembre 1987, le
patient va mieux et vivra normalement pendant
deux ans, ne rencontrant qu’épisodiquement le
médecin psychiatre. En septembre 1989 appa-
raît un état d’excitation maniaque suivi très
rapidement d’une phase d’effondrement de
type mélancolique.
Le praticien annonce alors au patient le dia-
gnostic de psychose maniaco-dépressive et éta-
blit, au mois d’octobre 1990, un certificat médi-
cal d’invalidité à 90 %, permettant au patient de
faire valoir ses droits auprès des organismes
sociaux dont il relève et de bénéficier, dans le
cadre des contrats d’assurance qu’il avait sous-
crits, de la prise en charge de crédits bancaires.
Le médecin psychiatre explique que, dès avril
1987, il avait établi le diagnostic de psychose
maniaco-dépressive mais que, compte tenu de
l’évolution favorable, il avait préféré différer
l’annonce de ce diagnostic. Ce faisant, le prati-
cien reconnaît qu’il a bien menti par omission
pendant près de trois ans ; mais il estime ce
mensonge légitime, au regard de l’intérêt supé-
rieur qu’est la prise en charge thérapeutique et,
en définitive, le respect du patient.
Le patient ne se satisfait pas de cette explica-
tion et engage une procédure contre le méde-
cin psychiatre. Il s’agit non d’une plainte
pénale, aucune infraction ne pouvant être invo-
quée, mais d’un recours en responsabilité,
géré par l’assureur du médecin. Les demandes
formées sont doubles : l’une, relativement
marginale, est l’indemnisation d’un dommage
moral ; l’autre, qui constitue le cœur du pro-
cès, est une demande indemnitaire consé-
quente, le patient estimant que, du fait de ce
retard de près de trois ans, il n’a pu faire valoir
ses droits à une pension d’invalidité, à un com-
plément de pension de retraite et à la prise en
charge par sa compagnie d’assurances des
prêts qu’il avait souscrits. Le montant des dom-
mages réclamés dépasse les deux millions
de francs.
Comme dans toute affaire médicale, une exper-
tise est ordonnée. Les experts confirment le

54
Correspondances en médecine - n° 2, vol. II - avril/mai/juin 2001
Chronique du droit
diagnostic mais, à propos de ce retard de trois
ans qui est la question principale, estiment :
Révéler la gravité en phase mélancolique sou-
vent accompagnée d’idée d’incurabilité, d’indi-
gnité, de culpabilité, risquerait d’entraîner un
suicide, malheureusement fréquent dans cette
maladie. Révéler en phase d’excitation
maniaque, où le malade se sent guéri, grand,
fort, entreprenant : il ne le croira jamais.
Révéler à la famille pose un problème à peu
près identique quand on connaît l’importance
de l’espoir des proches dans le soutien à appor-
ter au malade.
Le tribunal de grande instance, puis la cour
d’appel et, enfin, la Cour de cassation, par cet
arrêt du 23 mai 2000, ont tous statué dans le
même sens : l’absence de faute du médecin.
L’
INTÉRÊT DU MALADE COMME CRITÈRE
Sur le plan technique, cet arrêt de la Cour de
cassation confirme une règle qui s’est imposée
ces dernières années : la référence au Code de
déontologie médicale n’est pas limitée à l’ins-
tance disciplinaire. C’est un décret qui peut être
évoqué devant toutes les juridictions, civile,
administrative ou pénale. Dans la présente
affaire, la Cour de cassation vise directement
les dispositions du code de déontologie.
Elle pousse ensuite l’analyse pour définir les
critères qui valident ce mensonge, qualifié
pudiquement de “limitation de l’information”.
Une telle limitation doit être fondée sur des rai-
sons légitimes et dans l’intérêt du patient ; cet
intérêt doit être apprécié en fonction de
la nature de la pathologie et de la personnalité
du malade.
Cet arrêt de la Cour de cassation ne répond pas
qu’à des considérations techniques. C’est une
véritable philosophie de la relation soignante
qui est développée. De manière tout à fait
remarquable, la Cour de cassation utilise le mot
“malade”. C’est bien parce que la personne est
malade que les règles courantes doivent être
intelligemment comprises. Le respect dû au
malade place au second plan la vérité sur la
maladie. L’égalité dans les soins repose sur une
construction attentive.
Par cette démonstration, la Cour de cassation
confirme, s’il en était besoin, qu’elle n’a pas
entendu, par la modification de sa jurispru-
dence sur le consentement éclairé, bouleverser
les fondements de la relation médicale. Elle
semble même affirmer une conviction dans un
contexte qui est marqué par l’annonce répétée
d’une loi prochaine, toujours prochaine, sur les
droits du patient et qui conférerait à celui-ci un
droit direct au dossier médical.
En l’état actuel, le patient n’a accès au dossier
que par l’intermédiaire d’un médecin, qu’il
choisit librement, ce médecin pouvant obtenir
des photocopies et transmettre ensuite l’infor-
mation au patient.
Ainsi, si la loi annoncée se trouvait un jour
adoptée, un tel patient aurait pu, dès avril
1987, avoir accès direct à son dossier et décou-
vrir, alors qu’il allait mieux et que trois ans de
vie tranquille l’attendaient, qu’il était atteint
d’une psychose maniaco-dépressive, obtenir le
certificat d’invalidité et faire jouer les contrats
d’assurance qu’il avait souscrits. Mais qu’en
aurait-il été de son état de santé ? Cette
annonce aurait-elle pu sérieusement être
entendue ? À supposer que cette information
ait pu être entendue, n’aurait-elle pas été des-
tructrice ? N’est-on pas là dans l’illusion la plus
parfaite ?
Vu de loin, tout est simple : le malade a droit à
la vérité sur sa maladie. Vu de près, tout
se complique, car la dimension humaine s’op-
pose à l’automaticité : la vérité sur la maladie
s’efface devant le respect du malade.
1
/
3
100%