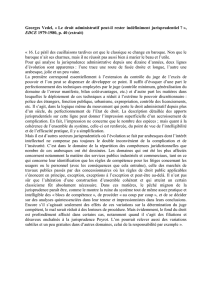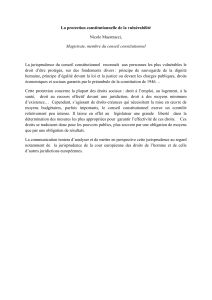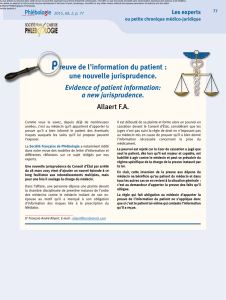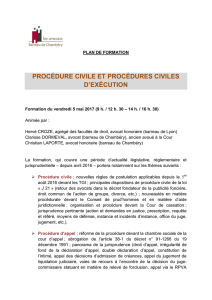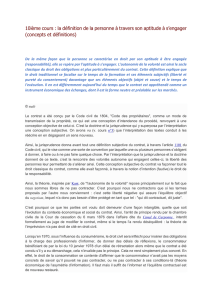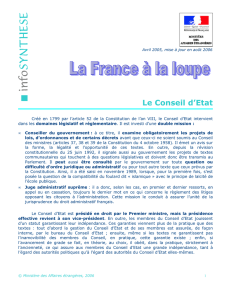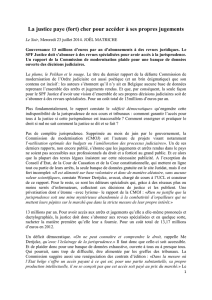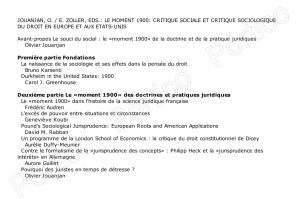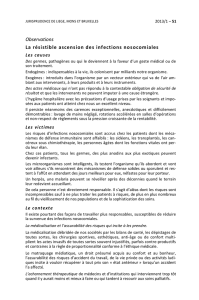Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 10 janvier 2000

Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 10 janvier 2000
Mis à jour le 13/08/2010 par
SFR
Communiqué de presse
Section du Contentieux, sur le rapport de la 5ème sous
-
section
Séance du 10 décembre 1999, lecture du 5 janvier 2000
Arrêt ASSISTANCE PUBLIQUE
-
HOPITAUX DE PARIS et Arrêt CONSORTS TELLE du 1à décembre 1999 :
Le Conseil d'État modifie sa jurisprudence en matière de devoir d'information des patients par les
médecins et fixe des règles semblables à celles retenues récemment par la Cour de cassation.
Selon une jurisprudence fort ancienne, aujourd'hui rappelée par le code de déontologie des médecins, le
droit de la personne au respect de son intégrité physique oblige les médecins à recueillir le
consentement du patient préalablement à l'accomplissement de tout acte médical. Ce consentement n'a
de sens que si le médecin a donné au patient toutes les informations utiles pour éclairer sa décision. De
nombreux litiges dans le domaine de la responsabilité médicale se nouent autour de ce devoir
d'information, certains patients, victimes d'un accident sanitaire, faisant valoir qu'ils n'auraient pas
accepté l'acte s'ils avaient été mieux informés des risques encourus.
Jusqu'à une époque récente, tant le juge administratif, compétent lorsqu'est recherchée la
responsabilité d'un hôpital public, que le juge judiciaire, qui est saisi lorsque le dommage trouve sa
source dans l'exercice de la médecine libérale, estimaient que les médecins n'étaient pas tenus
d'informer le patient des risques inhérents à l'intervention ou aux soins qui lui étaient proposés lorsque
ces risques étaient exceptionnels. Cette jurisprudence était principalement justifiée par le souci de ne
pas nuire à l'efficacité des traitements par l'accroissement de l'anxiété des malades et de ne pas
dissuader ceux
-
ci de se soumettre à des soins ou à des examens par ailleurs hautement souhaitables.
Elle présentait toutefois plusieurs inconvénients : outre le fait qu'elle reposait sans doute sur une sous
-
estimation des capacités psychologiques des patients à affronter la réalité de leur situation, son
maintien était difficilement justifiable s'agissant de risques, certes exceptionnels, mais d'une certaine
gravité. Par ailleurs, l'appréciation du caractère exceptionnel d'un risque posait de nombreuses
difficultés pratiques. Enfin, lorsque le risque par malheur se réalisait, le patient ou sa famille avaient
d'autant plus de mal à l'assumer qu'ils n'y étaient pas préparés. Pour cet ensemble de raisons, le
Conseil d'État a choisi, à l'occasion de deux affaires dans lesquels des patients n'avaient pas été
informés des risques de paralysie que présentent les interventions endovasculaires, d'infirmer sa
jurisprudence antérieure. Il juge désormais que
“
lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans
les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé
dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas
requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que
les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
”
La
Haute Assemblée confirme ainsi l'arrêt Guilbot du 9 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris
qui avait anticipé ce revirement de jurisprudence et qui avait été très remarqué.
Ce faisant, le Conseil d'État fixe, pour les médecins relevant du secteur public hospitalier, des règles
semblables à celles que la Cour de cassation, par des arrêts des 14 octobre 1997 et 7 octobre 1998, a
décidé de retenir pour les médecins exerçant en secteur libéral. Cette unité de la jurisprudence est tout
à fait opportune : s'agissant d'obligations déontologiques qui s'appliquent à une même profession, et
dès lors qu'aucun impératif propre au secteur public hospitalier n'imposait au Conseil d'État de retenir
une solution différente, une divergence des deux Hautes Cours sur les règles applicables aurait été très
préjudiciable et difficilement compréhensible.
A l'occasion de ces deux affaires, le Conseil d'État fait également évoluer sa jurisprudence en conférant
clairement à l'hôpital la charge de prouver que le devoir d'information du malade par le médecin n'a pas
été méconnu. La solution inverse, qui d'ailleurs n'avait jamais été nettement retenue par le Conseil
d'État dans sa jurisprudence antérieure, serait tout à fait inique pour les patients car elle ferait peser
sur eux, alors qu'ils sont de fait dans une situation inégale par rapport à l'administration, la charge
d'apporter la preuve que l'information n'a pas été correctement donnée, ce qui est beaucoup plus
difficile que de prouver qu'elle l'a bien été. Sur ce point, le Conseil d'État retient également une solution
comparable à celle que la Cour de cassation a adoptée par un arrêt du 25 février 1997. Les deux
décisions du Conseil d'État ne précisent pas, car la question ne se posait pas véritablement, dans
quelles conditions la preuve de la correcte information du patient pourra être apportée par l'hôpital.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles d'administration de la preuve sont souples et
pragmatiques en droit administratif. Par ailleurs, le Conseil d'État, en statuant comme il l'a fait, a voulu
promouvoir les conditions d'un dialogue plus confiant et plus transparent entre les médecins et les
malades, mais n'a pas entendu transformer l'obligation de recueillir le consentement éclairé des
patients en une exigence d'information exhaustive dont les médecins pourraient s'acquitter en
distribuant et en faisant signer des feuilles stéréotypées de description des risques.
Parallèlement à l'accroissement des contraintes qui pèsent sur les médecins en matière d'information

des patients, le Conseil d'État a souhaité fixer des règles d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un
défaut d'information plus conformes à la réalité. Sur ce point, sa jurisprudence est désormais plus
sévère, mais là aussi semblable à celle de la Cour de cassation. Le Conseil d'État juge en effet que
lorsque le patient a été victime d'un accident sanitaire et soutient que l'hôpital l'a insuffisamment
informé des risques qu'il encourait, le préjudice subi par le requérant est celui qui résulte de la perte de
chance de se soustraire au risque que ce manquement au devoir d'information a pour lui entraînée. Dans
ces conditions, il incombe au juge d'évaluer d'abord le montant total du dommage subi, puis de fixer le
montant de l'indemnité due au patient par l'hôpital à une fraction de ce dommage déterminée en
fonction de la probabilité que le patient aurait eu de refuser l'intervention s'il avait été informé du
risque.
Lire le texte intégral de la décision : ASSITANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
Lire le texte intégral de la décision : CONSORTS T.
1
/
2
100%