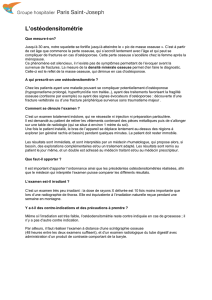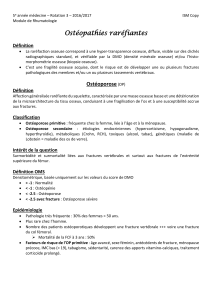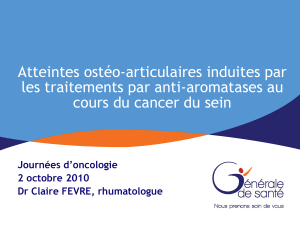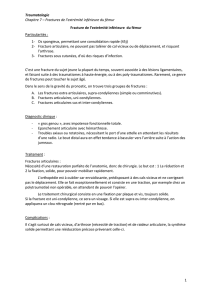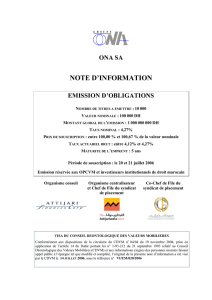Lire l'article complet

11
La Lettre du Rhumatologue - n° 273 - juin 2001
La glucosamine est un constituant naturel des protéo-
glycanes du cartilage, au même titre que la chondroïtine sul-
fate, largement utilisée en France dans le traitement de l’arthrose.
Ces médicaments ont un effet symptomatique retardé et réma-
nent bien documenté, mais leur effet structural sur le cartilage,
autrefois appelé chondroprotecteur, reste discuté. L’étude réali-
sée a testé la glucosamine 1 500 mg/j versus placebo. Il s’agis-
sait d’une étude randomisée, ayant inclus 212 patients, suivis
3 ans, atteints d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne. Les cli-
chés radiologiques ont été effectués dans des conditions standar-
disées pour assurer la meilleure reproductibilité possible (obte-
nue à 1,82 %) : debout, genou en extension, rayon centré et
parallèle à l’interligne, vérifié en scopie, position des pieds repé-
rée par calque utilisé successivement pour éviter les variations de
mesure liées à la rotation du squelette jambier, lecture par obser-
vateur “aveugle”... pour le traitement ! Deux types de mesure ont
été utilisés : d’une part mesure par analyseur automatique
d’images de clichés numérisés, calcul de l’épaisseur moyenne de
l’interligne articulaire, d’autre part mesure de l’interligne articu-
laire au point le plus pincé avec une loupe.
Les résultats sont en faveur de la glucosamine, puisque l’épais-
seur moyenne a augmenté de + 0,07 mm et l’épaisseur du pince-
ment interligne maximal de + 0,11 mm, alors que ces deux
mesures ont diminué dans le groupe placebo, respectivement de
– 0,31 et de – 0,40 mm. La différence est statistiquement signi-
ficative, tant chez les personnes qui ont complété l’essai pendant
trois ans qu’en analyse en intention de traiter. En définissant la
progression radiologique par une accentuation du pincement de
0,5 mm, on observe 15 % d’aggravation dans le groupe glucosa-
mine contre 30 % dans le groupe placebo.
Un certain nombre de remarques peuvent être faites : on est sur-
pris que les obèses (IBM > 30) aient été éliminés de l’étude ; un
tiers des patients n’ont pas terminé l’essai, mais la fréquence est
comparable dans les deux groupes et les causes d’arrêt, y com-
pris les effets secondaires, sont identiques. On est également sur-
pris par l’augmentation de l’interligne dans le groupe traité, mais
cela est à mettre en rapport avec la variabilité des techniques de
mesure.
Reste enfin à préciser la signification clinique de cette variation
radiologique. L’indice Womac, pour la douleur et pour la fonc-
tion, est amélioré de façon significative dans le groupe glucosa-
mine par rapport au placebo, sans toutefois être spectaculaire
(20 à 25 % d’amélioration). On note également l’absence de cor-
rélation évidente entre les symptômes cliniques et l’évolution
radiologique au niveau individuel. Il reste aussi à préciser si, à
long terme, l’amélioration ou la stabilisation de l’état algofonc-
tionnel est suffisante pour éviter, par exemple, le recours à la mise
en place d’une prothèse de genou.
J.L. Kuntz, Strasbourg
La glucosamine : une vitamine pour le cartilage ?
Long-term effects of glucosamine sulphate osteoarthri-
tis progression : a randomised, placebo-controlled clini-
cal trial.
Reginster JY, Deroisy R, Rovati L et al.
●
Lancet 2001 ;
357 : 251-6.
REVUE DE PRESSE
Analyses de la littérature
L’arrivée des nouvelles thérapies par anti-TNF augmente
l’intérêt d’une analyse économique de la PR : le coût élevé
de ces traitements freine leur utilisation, qui pourrait cependant
être élargie si l’on arrivait à montrer aux autorités de tutelle qu’ils
font malgré tout faire des économies. On sait maintenant que, dans
la PR, les coûts indirects représentent entre 50 et 85 % du coût
total, l’essentiel étant dû à l’invalidité puis aux indemnités journa-
lières (IJ) pour arrêt de travail. La présente étude prospective,
multicentrique, réalisée en Allemagne, étudie les coûts indirects
de la PR dans ses trois premières années d’évolution.
Les auteurs ont retenu les patients exerçant une activité profes-
sionnelle à l’inclusion, soit 133 parmi un total de 317 : 63 % de
femmes, âge moyen 47 ± 0,8 ans, 7 ± 3 mois de durée de la PR à
l’inclusion, 66 % exerçant une activité d’employé de bureau. Pour
apprécier les coûts, les auteurs ont calculé un revenu national
moyen en Allemagne de 93 dollars/j pour la période 1994-1996.
À l’issue des 2,5 ± 0,2 années du suivi, divisé en deux périodes
d’un an chacune, 59 % des patients sont encore au travail, 17 %
sont en invalidité, 9 % ont perdu leur poste en raison de la PR,
mais sans pension d’invalidité, et 15 % ont abandonné leur tra-
Si la polyarthrite rhumatoïde m’était comptée...

La Lettre du Rhumatologue - n° 273 - juin 2001
12
vail pour des raisons autres que la PR. Au total, les IJ auront repré-
senté la somme de 7 640 ± 740 dollars par patient-année, les pen-
sions d’invalidité 2 520 ± 550 dollars, et les pertes de travail autres
liées à la PR 1 590 ± 480 dollars, soit un coût indirect total de
11 750 ± 1 120 dollars par patient-année. Durant la première
période de suivi, les arrêts de travail représentaient 84 % du coût
indirect total, contre 25 % durant la deuxième période. Cette baisse
d’un facteur 4,2 du coût lié aux IJ dépassait nettement l’aug-
mentation d’un facteur 3,6 du coût lié aux pertes d’emploi (inva-
lidité et autres causes), ce qui expliquait une baisse de 21 % des
coûts indirects de la PR entre la première et la deuxième période
de suivi. L’analyse en régression logistique ne retenait comme
seuls facteurs prédictifs de cette réduction que l’absence de dif-
ficultés à la réalisation de travaux rapides, à l’extérieur ou debout
(odds-ratio de 4,1, 3,1 et 7,1 respectivement). Aucun critère cli-
nique ou thérapeutique (traitement de fond ou pas, type du trai-
tement de fond, corticothérapie ou pas...) n’était significatif.
Cette étude suggère donc que :
– la PR coûte cher dès les trois premières années d’évolution ;
– ces coûts indirects diminuent cependant, car les dépenses d’IJ
diminuent plus que les dépenses de pension d’invalidité n’aug-
mentent ;
– plus étonnante est la constatation, par comparaison à la littéra-
ture, d’un coût indirect quasi équivalent entre les PR débutantes
et celles plus anciennes et évoluées ;
– finalement, l’évolution de ces coûts est uniquement influencée,
du moins dans cette étude, par la capacité du patient à effectuer
des travaux rapides et/ou debout et/ou à l’extérieur ; les auteurs
en concluent qu’il est nécessaire de développer des méthodes de
réadaptation professionnelle intensive, méthodes qui, de leur
propre aveu, devraient être elles-mêmes évaluées sous l’angle de
leur rentabilité économique!
C. Bologna, Mende
REVUE DE PRESSE
Indirect medical costs in early rheumatoid arthritis.
Merkesdal S, Ruof J, Schöffski O, Bernitt K, Zeidler H,
Mau W.
●
Arthritis Rheum 2001 ; 44 : 528-34.
Le diabète n’est généralement pas considéré comme un fac-
teur de risque d’ostéoporose. Malgré tout, les données de
la littérature restent contradictoires. Dans cette étude, les auteurs
ont utilisé les données de la cohorte de SOF (Study of Osteopo-
rotic Fracture), comportant des femmes âgées de plus de 65 ans,
recrutées entre 1986 et 1988 en Amérique du Nord. Cette cohorte
comportait 9 704 femmes de race blanche, suivies tous les deux
ans. À la visite initiale, les femmes étaient questionnées sur l’exis-
tence d’un diabète et l’utilisation d’insuline. Pour limiter l’ana-
lyse au diabète de type 2, celles dont la maladie avait débuté avant
40 ans étaient exclues de l’analyse. Ainsi, 9 654 femmes ont été
étudiées. Tous les quatre mois, un questionnaire s’enquérant de la
survenue d’éventuelles fractures était envoyé ; dès qu’un événe-
ment était repéré, les femmes étaient interrogées plus en détail.
La durée moyenne du suivi a été de 9,4 ± 2,4 ans. Un diabète révélé
à plus de 40 ans a été mis en évidence chez 657 femmes (6,8 %).
Le diabète évoluait depuis 9,2 ± 7,9 ans ; 106 de ces femmes
(16,1 %) étaient traitées par insuline.
Par rapport aux femmes non diabétiques, elles avaient de plus
mauvais scores évaluant la force, l’équilibre, la vision ou l’état
général, et plus de neuropathies sensitives détectées clinique-
ment. La densité minérale osseuse (DMO) était significative-
ment plus élevée chez les femmes diabétiques, y compris après
correction par l’âge et l’index de masse corporelle : + 5,2 % au
radius distal, + 5,1 % au calcanéum, + 2,9 % au col fémoral ; par
contre, elles présentaient davantage de fractures : 30,1 % vs
27 %, et ce malgré leur DMO plus élevée ! Le risque relatif de
fracture non vertébrale chez les femmes diabétiques était un peu
plus élevé par rapport aux autres femmes : 1,22 (1,06-1,41) ;
celles n’utilisant pas d’insuline avaient un risque accru de frac-
ture humérale et de la hanche, alors que celles qui en prenaient
avaient un risque accru de fracture humérale, de cheville et du
pied par rapport aux femmes non diabétiques. En revanche, il
n’y avait pas de différence concernant les fractures vertébrales
et de l’avant-bras. Hormis pour les fractures humérales, un long
délai diagnostique du diabète constituait un facteur péjoratif pour
la survenue de fractures.
Alors que d’autres études ont retrouvé une diminution du risque
de fractures non vertébrales au cours du diabète, dans cette cohorte
au contraire, malgré une DMO plus élevée, chez les femmes dia-
bétiques, ce risque était accru (hors rachis et avant-bras). Ces dif-
férences peuvent s’expliquer en partie par des différences dans les
populations étudiées, concernant notamment l’âge, et donc le type
de fracture susceptible de survenir. Une autre explication possible
pourrait être l’augmentation de cofacteurs de risque fracturaire
chez les patientes diabétiques ; cependant, l’étude du nombre de
chutes, de la vision, de la pratique d’exercice physique, de l’uti-
lisation de benzodiazépine ou de l’existence d’une neuropathie
périphérique ne permet pas d’expliquer le surcroît de fractures.
Ce manque de corrélation aux facteurs de risque classiques de
fracture est peut-être dû au fait que beaucoup de ces données n’ont
été recueillies qu’à l’inclusion dans l’étude, alors que la durée
moyenne de suivi des fractures non vertébrales a été de neuf ans ;
certains facteurs potentiellement importants, comme l’existence
Diabète et fractures ostéoporotiques : une facture salée !

La Lettre du Rhumatologue - n° 273 - juin 2001
13
d’une rétinopathie, n’étaient pas disponibles dans cette étude. On
peut en outre émettre l’hypothèse que la microarchitecture osseuse
puisse jouer un rôle dans cette discordance entre une DMO plus
élevée et un nombre de fractures plus important.
Conclusion. Cette étude suggère que le diabète pourrait être un
facteur de risque de fracture ostéoporotique chez les femmes
blanches de plus de 65 ans, en dépit d’une DMO plus élevée que
chez les femmes du même âge non diabétiques. Même si ces résul-
tats ne peuvent être étendus à d’autres populations, il semble
important de mener d’autres études, afin de préciser les facteurs
de risque conduisant à ces fractures et de pouvoir détecter et
conseiller les femmes à risque. P. Guggenbuhl, Rennes
REVUE DE PRESSE
Older women with diabetes have an increased risk of
fracture : a prospective study.
Schwartz AV, Sellmeyer DE, Ensrud KE, Cauley JA, Tabor
HK, Schreiner PJ et al.
●
J Clin Endocrinol Metab 2001 ;
86 : 32-8.
Les ostéonécroses sont des complications bien établies du
lupus systémique, mais les facteurs responsables de cette
association morbide sont encore très discutés dans la littérature.
La corticothérapie est néanmoins le facteur prédisposant le plus
régulièrement retenu dans les différentes études disponibles, alors
que d’autres éléments n’ont été signalés que dans certaines études,
comme la coexistence d’un syndrome de Raynaud, d’un livedo,
ou d’anticorps anticardiolipine (aCL)... Ces incertitudes persis-
tent, d’après nos auteurs, essentiellement du fait des limites
méthodologiques des études préalables, en particulier en termes
de taille des effectifs, et de l’absence ou de la non-pertinence d’un
groupe contrôle.
L’objectif de cette étude a donc été d’identifier, par une analyse
multivariée, les facteurs prédictifs d’ostéonécrose aseptique
(ONA), au sein de la large cohorte de patients lupiques de l’hô-
pital de Toronto.
Parmi les 744 patients lupiques suivis entre 1970 et 1995, 95 ONA
symptomatiques ont été identifiées (prévalence : 12,8 %). Vingt-
cinq de ces patients, pour lesquels l’ONA était présente dès l’en-
trée dans la cohorte, ont été écartés de l’étude, puisqu’il n’était
pas possible de recueillir chez eux des facteurs réellement pré-
dictifs. Un groupe contrôle a été constitué au sein de la cohorte
par appariement pour chaque cas en fonction de l’âge, du sexe et
de l’année d’entrée dans la cohorte. Les deux groupes de
70 patients se sont avérés comparables en termes de durée de la
maladie, d’origine ethnique, et d’activité de la maladie à l’entrée
dans la cohorte et au moment de l’étude. Parmi les facteurs cli-
niques potentiellement prédictifs testés, l’analyse statistique a
écarté l’existence d’un livedo, de manifestations lupiques neuro-
psychiatriques, d’un Raynaud, d’une atteinte rénale, de throm-
bose veineuse, de vascularite. Les facteurs biologiques testés ont
tous été écartés, à savoir l’existence d’aCL, d’une élévation du
temps de thromboplastine, des taux de cholestérol ou de trigly-
cérides, de la positivité du test de Coombs. Finalement, les fac-
teurs retenus par l’analyse multivariée sont au nombre de quatre
(tableau I) ; en ce qui concerne la corticothérapie, dont le poids
semble particulièrement important, seuls 2 patients avec ONA
n’avaient pas eu de corticoïdes, contre 20 chez les contrôles ;
les doses maximales et cumulatives de corticoïdes étaient
significativement plus élevées chez les ONA, ainsi que la durée
de la corticothérapie.
Ainsi, on retiendra de cette importante étude que l’ostéoné-
crose symptomatique est bien une complication fréquente du
lupus et que la corticothérapie et l’existence d’arthrites sont les
deux facteurs qui augmentent le plus ce risque, avec, à un moindre
degré, l’utilisation d’agents cytotoxiques ou d’antimalariques.
P. Claudepierre, Créteil
Quels lupiques font des ostéonécroses ?
Predictive factors for symptomatic osteonecrosis in
patients with systemic lupus erythematosus.
Gladman D, Urowitz MB, Chaudry-Ahluwalia V, Hallet DC
,
Cook RJ.
●
J Rheumatol 2001 ; 28 : 761-5.
Tableau I. Facteurs prédictifs d’ONA (analyse multivariée).
Variable OR (IC95)p
Corticothérapie 18,5 (3,2-359,6) 0,0002
Arthrites 4,2 (1,6-13,7) 0,002
Agents cytotoxiques 2,7 (1,02-8,8) 0,046
Antimalariques 2,2 (0,988-8,1) 0,051

La Lettre du Rhumatologue - n° 273 - juin 2001
14
REVUE DE PRESSE
Faut-il faire opérer les malades porteurs d’une hyperpara-
thyroïdie primitive (HPTP) asymptomatique ? La confé-
rence de consensus de 1991 précise qu’un âge inférieur à 50 ans
et une densité minérale osseuse basse (DMO) sont des arguments
importants en faveur de cette décision. Qu’en est-il des patients
plus âgés porteurs de multiples pathologies ou récusés par la
chirurgie ?
Une équipe italienne a étudié l’effet de l’alendronate (Aln) dans
une population de femmes âgées de 68 à 71 ans présentant à la
fois une ostéoporose (T < – 2,5 DS au rachis lombaire ou au col
fémoral) et une HPTP modérée. Vingt-six femmes ayant des
contre-indications ou ayant refusé la chirurgie ont été incluses
dans cette étude. Étaient exclues les patientes ayant d’autres mala-
dies systémiques, une pathologie thyroïdienne, une insuffisance
rénale ou hépatique ou d’autres affections susceptibles d’in-
fluencer la masse osseuse. Aucune patiente n’avait préalablement
reçu de traitement par estrogènes, bisphosphonates ou d’autres
drogues influençant la masse osseuse dans les 18 mois précé-
dents. Les malades ont été randomisées en deux groupes :
13 femmes ont reçu de l’Aln à 10 mg un jour sur 2 et 13 autres
n’ont pas reçu de traitement. Les apports alimentaires de calcium
étaient maintenus entre 800 et 1 200 mg/j. Les patientes ont été
suivies pendant 2 ans et évaluées à 3, 6, 12 et 24 mois. Un troi-
sième groupe de 13 patientes opérées d’une HPTP pendant la
même période a pu être analysé.
Les deux groupes traités médicalement étaient comparables à l’in-
clusion. Les taux de calcium, de phosphore et la calciurie sont
restés stables dans le temps dans le groupe contrôle ; dans le
groupe Aln, on constatait une décroissance de la calcémie, avec
parallèlement une augmentation de la PTH pendant la première
année de traitement, puis un retour aux valeurs de base. Cette
augmentation de la PTH ne semble pas avoir eu de traduction cli-
nique ; elle indique en revanche que, malgré l’HPTP, il persistait
un rétrocontrôle des taux de PTH par la calcémie. Les marqueurs
de résorption osseuse (déoxypyridinolines urinaires) étaient dimi-
nués dès le premier mois alors que les marqueurs de formation
(phosphatase alcaline osseuse et ostéocalcine) ne l’étaient qu’à
partir du troisième mois dans le groupe Aln ; ces valeurs n’ont
pas varié dans le groupe non traité. Une augmentation significa-
tive de la DMO a été observée à tous les sites, à deux ans, dans
le groupe Aln par rapport aux valeurs initiales et par rapport au
groupe non traité. Il y avait une corrélation positive entre les gains
de masse osseuse mesurés au corps entier et les taux initiaux d’os-
téocalcine et de phosphatases alcalines osseuses dans le groupe
Aln ; à l’inverse, on notait une corrélation négative avec les seuls
taux initiaux de phosphatases alcalines osseuses dans le groupe
non traité. Il est intéressant de noter que les gains de masse osseuse
à un an, au niveau lombaire, étaient de 7 % dans le groupe Aln,
comparables à ceux observés chez les patientes opérées (6,7 %).
Aucune fracture n’est survenue durant cette période.
Cette étude montre donc que l’alendronate en prise alternée à
10 mg tous les deux jours permet d’augmenter la masse osseuse
à tous les sites et de freiner le remodelage osseux chez des
patientes âgées atteintes d’HPTP modérée. Les gains observés
sont comparables à ceux procurés par la chirurgie parathyroï-
dienne ou par les traitements par estrogènes dans cette indica-
tion. L’étude des marqueurs de remodelage osseux indique qu’il
existe une diminution rapide de la résorption osseuse dès le pre-
mier mois, mais pas sur les marqueurs de formation osseuse avant
le troisième mois, favorisant un bilan positif du calcium durant
les trois premiers mois ; ces résultats viennent confirmer ceux
retrouvés avec le clodronate dans la même situation.
Conclusion. Cette étude pilote semble indiquer que l’alendro-
nate pourrait avoir un intérêt dans le traitement de l’HPTP non
compliquée chez des patients inopérables ou refusant l’interven-
tion chirurgicale. Reste à confirmer l’intérêt de ce traitement,
d’une part, sur le plan antifracturaire et, d’autre part, sur l’évo-
lution globale de la maladie.
P. Guggenbuhl, Rennes
L’alendronate dans l’ostéoporose de l’hyperparathyroïdie
primitive : une alternative à la chirurgie ?
Effects of oral alendronate in elderly patients with
osteoporosis and mild primary hyperparathyroidism.
Rossini M, Gatti D, Isaia G, Sartori L, Braga V, Adami S.
●
J Bone Miner Res 2001 ; 16 : 113-9.
Les articles publiés dans “La Lettre du Rhumatologue”
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d'adaptation
et de traduction par tous procédés
réservés pour tous pays.
© mai1983 - EDIMARK S.A·
Imprimé en France - Differdange S.A. - 95110 Sannois
Dépôt légal 2
e
trimestre 2001

Les autres articles
à ne pas manquer
REVUE DE PRESSE
The role of hyaluronic acid in protecting surface-active phospholipids from lysis by
exogenous phospholipase A2.
Nitzan DW, Nitzan U, Dan P et al. Rheumatology 2001 ; 40 : 336-40.
Nouvel argument pour le rôle de l’acide hyaluronique dans le processus de “lubrification” articulaire.
The role of osteoprotegerin and receptor activator of nuclear factor κB ligand
in the pathogenesis and treatment of rheumatoid arthritis.
Hofbauer LC, Heufelder AE. Arthritis Rheum 2001 ; 44 : 253-9.
Le système RANK, RANK Ligand, ostéoprotégérine, système de régulation majeur de l’ostéolyse, en particulier
dans la PR.
Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthritis.
Choy E, Panayi G. N Engl J Med 2001 ; 344 : 907-16.
Mise au point claire et synthétique sur le rôle des cytokines dans l’inflammation de la PR.
Tolerance and autoimmunity.
Kamradt T, Mitchison NA. N Engl J Med 2001 ; 344 : 655-64.
Mise au point sur le rôle de la tolérance dans les mécanismes de l’auto-immunité.
The cost effectiveness of vaccination against Lyme disease.
Shadick NA, Liankm H, Phillips CB et al. Arch Intern Med 2001 ; 161 : 554-61.
La vaccination est économiquement attractive pour les personnes ayant une probabilité saisonnière d’infection
par Borrelia burgdorferi.
La Lettre du Rhumatologue - n° 273 - juin 2001
15
Arthrose
Polyarthrite rhumatoïde
Divers
1
/
5
100%