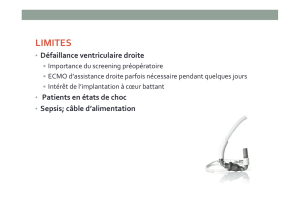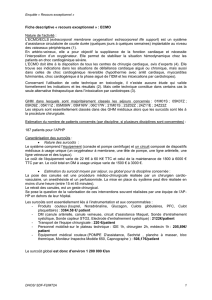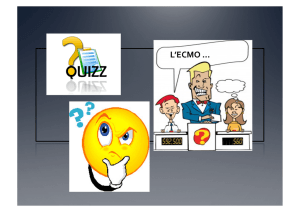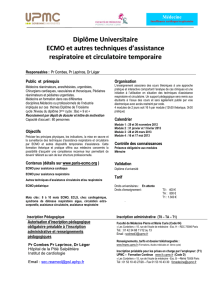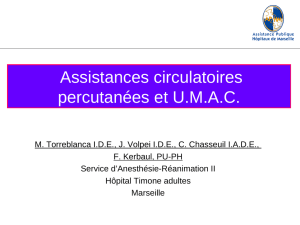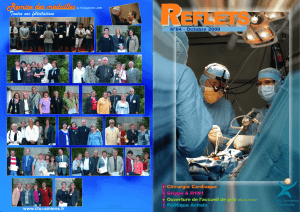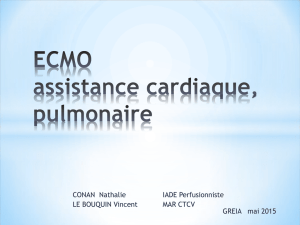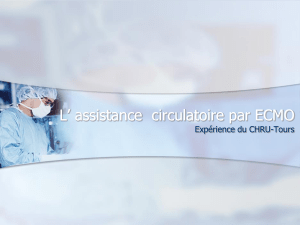Assistance circulatoire mécanique 22 Journées de la Pitié-Salpêtrière

coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
8 | La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009
CONGRÈS
RÉUNION
Assistance circulatoire mécanique
T. Petroni*
22es Journées de la Pitié-Salpêtrière
Paris, du 7 au 9 octobre 2009
sevrage. L’analyse multivariée identifie l’âge avancé
et la nécessité d’un massage cardiaque externe
comme facteurs prédictifs de mauvais pronostic.
Inversement, l’existence d’une cardiopathie aiguë
semble plus favorable. Ces résultats permettent
de refuser d’emblée à certains patients l’assistance
circulatoire d’urgence.
Assistance de longue durée
Le Dr F. Collart (Marseille) a rappelé le bilan néces-
saire à effectuer avant la prise de décision en faveur
d’une assistance de longue durée. L’assistance de
courte durée a été posée en “sauvetage”, ou bien sur
le pari d’une durée d’assistance “courte”. L’évaluation
neurologique préalable est indispensable, avec si
possible l’extubation du patient accompagnée d’une
imagerie cérébrale et des troncs supra-aortiques.
L’évaluation respiratoire est rendue complexe par
la fonction de l’assistance, et doit tirer parti de la
radiographie thoracique, de l’étude des sécrétions
bronchiques et des pressions d’insufflation sur le
respirateur. L’évaluation infectieuse est nécessaire,
tant sur les scarpas que générale (il pourrait être
utile de proposer une cartographie bactérienne du
patient). Enfin, l’évaluation hépatique ne saurait être
oubliée (cytolyse, cholestase, imagerie), ainsi que
l’évaluation globale du patient (projet thérapeutique :
greffe ou implantation ; aptitude à gérer un dispositif
d’assistance) et de sa fonction ventriculaire droite
(rendue délicate par la mise en décharge). On peut
également rechercher une thrombopénie immuno-
allergique à l’héparine, ainsi qu’un syndrome d’acti-
vation macrophagique. Ce bilan permet de réfléchir
à l’indication d’une éventuelle assistance de longue
durée et à son type (mono- ou biventriculaire), avec
une séquence temporelle idéale aux alentours d’une
semaine d’ECMO en l’absence de sevrage ou de trans-
plantation, ou dès la récupération des défaillances
d’organes.
* Institut de cardiologie, hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris.
ECMO
L’unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC),
mise en place par l’institut de cardiologie de la
Pitié-Salpêtrière, permet la pose d’une ECMO
(extracorporeal membrane oxygenation) artério-
veineuse périphérique rapide en dehors du groupe
hospitalier par une équipe de l’institut composée
d’un interne, d’un chirurgien cardiaque sénior et
d’un perfusionniste. Le Dr S. Beurtheret (Paris) a
rapporté les cas de 69 patients implantés entre
2005 et 2009 en Île-de-France et dans les alen-
tours, jusqu’à Orléans, pour 48 % d’infarctus du
myocarde, 20 % de cardiopathies dilatées et 32 %
de cardiopathies aiguës (myocardite, post-partum,
toxique, tako-tsubo, choc anaphylactique, etc.).
Dans 38 % des cas, le patient est en ACR et reçoit
en moyenne 10 mg/h d’adrénaline. Le patient
assisté est laissé dans la structure initiale dans
15 % des cas, transféré à la Pitié-Salpêtrière dans
70 % des cas et à Lariboisière dans 15 % des cas. Le
sevrage est effectif en moyenne après 8 jours, ou
bien le décès survient en moyenne dans le même
délai. Les décès sous ECMO, au nombre de 39,
sont secondaires à des défaillances multiple d’or-
ganes (33 patients) et à une mort encéphalique
ou à un accident vasculaire cérébral (6 patients).
Trente sujets sont sevrés de l’ECMO, 3 d’entre
eux en pont vers la TC, 4 autres en pont vers une
assistance de longue durée, et 23 ont récupéré. Au
total, 41 patients sont décédés sous ECMO ou après
Nous évoquions dans le numéro précédent les grandes actualités des 22
es
Journées
de la transplantation cardiaque qui se sont tenues à la Pitié-Salpêtrière en octobre
dernier. Parmi les thèmes abordés, l’assistance circulatoire mécanique et les avancées
dans ce domaine ont fait l’objet de plusieurs communications.

La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009 | 9
CONGRÈS
RÉUNION
Assistance biventriculaire
L’assistance biventriculaire a été détaillée par le
Dr J.P. Mazzucotelli (Strasbourg). Dans les registres,
la survie est plus importante dans le groupe des
patients implantés d’une assistance monoventricu-
laire gauche que dans le groupe des biventriculaires
avec le biais connu de la gravité de l’état des patients.
Cette donnée semble être infirmée par l’étude des
chiffres récoltés entre 2000 et 2008, qui montrent
une survie similaire dans les deux cas (58 % à 1 an).
Depuis 2005, la tendance est à l’implantation plus
importante d’une assistance monoventriculaire
gauche, y compris dans des cas particulièrement
sévères. Dans cette optique, il convient de déter-
miner le risque de dysfonction postopératoire du
ventricule droit, dont on sait qu’il se situe entre 10 et
35 %. L’évaluation doit d’abord rechercher la cause
de la cardiopathie sous-jacente, puis les caractéris-
tiques échocardiographiques du VD. Enfin, le score
de Matthews permet de définir le score de risque de
défaillance du VD sur la base de paramètres simples
(administration de vasopresseur, créatininémie,
bilirubinémie, ASAT). L’indication d’une assistance
biventriculaire sera généralement retenue en cas
de choc cardiogénique “grave”, de dysfonction du
VD, et dans certaines situations spécifiques (cardio-
pathie congénitale, réinterventions chirurgicales
multiples, etc.).
Décharge ventriculaire gauche
Le Dr M. Massetti (Caen) a rapporté son expérience
originale de décharge ventriculaire gauche chez des
patients implantés d’une ECMO en œdème pulmo-
naire massif. Il propose la réalisation d’atriosepto-
stomies percutanées, consistant à créer un shunt
à l’étage auriculaire. Cette technique, présentée
comme simple, rapide et peu invasive, a été réalisée
chez 8 patients. Il existe, en revanche, un risque de
thrombose intraventriculaire gauche, car la valve
aortique reste fermée du fait de la postcharge élevée
conférée par la canule de réinjection intra-aortique.
Cette technique a permis l’augmentation moyenne
de 1 l/mn du débit d’ECMO, pour une durée moyenne
de 20 minutes de la procédure en cardiologie inter-
ventionnelle. Une tamponnade est survenue au cours
des procédures. D’autres alternatives “mini-invasives”
proposées sont le drainage percutané du ventricule
gauche, l’emploi de l’Impella®, d’un ballonnet de
contre-pulsion intra-aortique, ou la canulation de
décharge percutanée de l’artère pulmonaire.
Assistance biventriculaire
implantable
L’assistance biventriculaire implantable connaît un
essor significatif, comme en témoigne l’expérience
du Dr L. Camilleri (Clermont-Ferrand). Ce dispositif
a été implanté chez 40 patients âgés de 45 ans en
moyenne (extrêmes : 15-59), avec une FE à 17 % en
moyenne : 37 % des patients étaient ventilés, 18 %
étaient en ACR et 23 % bénéficiaient d’une ECMO.
Sous assistance, la durée moyenne de survie était
de 105 jours, avec la survenue de 20 décès. Dix-neuf
patients ont été greffés et 1 a été sevré de l’assistance.
Les causes de mortalité sont classiques, rattachées à
la défaillance multiviscérale, l’infection et l’ischémie
digestive. La morbidité n’est pas négligeable, avec
43 % de reprise chirurgicale pour complications
hémorragiques, 20 % d’infections de matériel, et 8 %
d’accidents neurologiques. L’avantage est le nombre
de canules transcutanées, réduit à 2. La survie est de
75 % à 1 mois, de 45 % à 6 mois et de 41 % à 1 an.
Celle des patients transplantés rejoint les chiffres
connus, avec 78 % à 1 an. Le retour à domicile a été
possible pour 9 patients, bénéficiant de permissions
répétées de 48 à 72 heures avec rééducation inten-
sive, autonomisation et sécurisation du domicile.
D’autres matériels d’assistance circulatoire sont
particulièrement intéressants et prometteurs. C’est
le cas du système CorCap
®
, présenté par le Dr P. Dos
Santos (Bordeaux). Dans le cadre du remaniement
ventriculaire tant anatomique que fonctionnel, cette
chirurgie du remodelage offre un soutien télédiasto-
lique en diminuant la tension pariétale, et contribue
à interrompre la progression de l’IC et de la dilata-
tion cavitaire. L’étude des boucles pression-volume
retrouve une augmentation de surface et un déca-
lage vers la gauche de la boucle, soit une évolution
vers un volume moindre pour un régime de pression
moins élevé. Ce dispositif (figure 1, p. 10) favorise la
récupération de la fonction contractile cardiomyocy-
taire et corrige l’allongement myocytaire. Il offre une
solution intéressante lorsque le traitement médical
est maximal, ainsi qu’aux limites des thérapies de
resynchronisation. Il s’agit d’un filet nécessitant, pour
sa mise en place, la sternotomie pour une chirurgie
à cœur battant, suivie de l’extériorisation du massif
ventriculaire que l’on entoure de la prothèse, tout en
respectant le massif auriculaire. Un surjet à la face
antérieure du VG permet sa fixation et le réglage
de tension, ainsi qu’une ligne de suture suivant le
sillon auriculo-ventriculaire. L’essai ACORN a inclus
300 patients porteurs d’une cardiopathie dilatée
(ischémique et non ischémique) symptomatique

coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
Figure 1. Prothèse CorCap®.
10 | La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009
CONGRÈS
RÉUNION
mini-thoracotomie. Cette intervention doit être
précédée d’une scannographie cardiaque pour le
choix des dimensions de la prothèse en fonction
d’abaques simplifiés établis par le constructeur,
et d’un repérage de l’apex par échocardiographie.
L’incision mesure 5 cm, et permet l’injection du
produit de contraste intrapéricardique pour le
repérage du sillon auriculo-ventriculaire. Bien sûr,
la sonde de resynchronisation latéroventriculaire
gauche peut aider à la visualisation du sinus coro-
naire. Les baleines, faites de bandes de glissement
en polytétrafluoroéthylène (PTFE), préviennent
tout traumatisme épicardique. L’automaintien est
assuré par un stent en silicone avec marqueurs
radio-opaques permettant de matérialiser le sillon
auriculo-ventriculaire sur lequel il est placé. Vingt-
cinq implantations ont été réalisées, 2 ont nécessité
une conversion chirurgicale en raison d’adhérences.
Le temps opératoire requis a été de 2 heures, avec
une mise en place effective entre 5 et 35 minutes.
Il n’a pas été observé de mortalité ni de morbidité
spécifique. Au cours du suivi, 3 décès sont survenus,
à 14, 28 et 29 mois.
Dispositifs d’assistance
circulatoire
Au registre de ces dispositifs d’assistance circulatoire,
le Dr B. Berthier (Paris) a présenté l’ECMO pulsée de
CorHem. En effet, l’ECMO présente quelques limites,
parmi lesquelles un débit parfois limité, non pulsa-
tile, et une mauvaise décharge. Eu égard à la physio-
pathologie de l’état de choc, le débit pulsé pourrait
constituer un avantage fort dans cette situation, du
fait de l’occlusion des capillaires avec dysfonction
endothéliale aggravant la situation globale et limi-
tant la perfusion des organes. D’une durée de vie
pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines, ce généra-
teur de débit pulsé (figure 2, p. 12) se décline sous la
forme d’un actionneur spécifique et d’un composant
régulant le débit. Mobile et nomade, sa mise en place
est facile et son maniement aisé, avec une interchan-
geabilité rapide des éléments consommables. Il peut
fonctionner tant en suppléance qu’en assistance et
présente une fonction d’autorégulation. La fin du
développement du prototype V0 est prévue pour les
mois à venir, et l’étude de deux autres prototypes,
V1 et V2, pour 2010 et 2011.
Aux Pays-Bas, le Dr M. Mariani emploie le Pulse-
Cath® (figure 3, p. 12), facile à placer et à retirer,
de coût modéré et de conception simple, capable
de générer un flux pulsatile. Il mesure 21 Fr, et est
en classe III de la NYHA sous traitement médical
optimal. La FEVG était altérée (< 35 %) et le VG
dilaté (DTD > 60 mm). Deux groupes ont été consti-
tués, selon qu’il y avait ou non une indication de
plastie mitrale chirurgicale. Dans chacun de ces deux
groupes, une randomisation a réparti les patients en
deux sous-groupes, bénéficiant ou non de ce dispo-
sitif. Le suivi a été conduit sur 12 mois, avec des résul-
tats positifs pour le critère primaire (score clinique
composite associant la classe de dyspnée NYHA, les
décès et les procédures cardiaques majeures) et le
critère secondaire (qualité de vie). Une amélioration
de la FE ainsi qu’une diminution du diamètre VG ont
été observées. Les patients éligibles seraient donc
ceux restant symptomatiques aux limites des théra-
peutiques actuelles validées, médicales et interven-
tionnelles (stimulation multisite), éventuellement en
chirurgie combinée en cas de dyspnée en classe II de
la NYHA, avec une fonction du VD préservée, et dont
la pathologie n’est pas trop évoluée (DTDVG entre
30 et 40 mm/m²). Il faut remarquer qu’en termes
de mortalité, il n’a été noté qu’une tendance non
significative à un bénéfice chez les patients avec un
DTDVG entre 30 et 40 mm/ m². De même, aucune
constriction péricardique secondaire au cours du
suivi n’a été rapportée.
Chirurgie mini-invasive
Cette thérapeutique trouve son corollaire dans
une version mini-invasive développée par le
Pr L. Labrousse (Bordeaux), dénommée Gen2
CorCap®. Après une étude préalable du dispositif
CorCap
®
chez 117 patients, aucune différence à 5 ans
sur la mortalité, l’assistance, la TC et la chirurgie
cardiaque majeure n’a été retrouvée. Le dispo-
sitif Gen2 CorCap
®
est, quant à lui, inséré après

coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
Figure 2. Prototype V0 de l’ECMO pulsée de CorHem.
Figure 3. Pulse-Cath® : observation de l’hémodynamique liée au cœur natif et de la
pression générée par le dispositif.
100 8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
PA
Débit
Pression aortique (mmHg)
Débit (l/mn)
80
60
40
20
0
Figure 4. Impella®.
12 | La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009
CONGRÈS
RÉUNION
débit jusqu’à 3 l/mn, et fait l’objet d’une étude
multicentrique pour une utilisation prolongée de
24 heures à 14 jours.
L’Impella® (figure 4) constitue un autre moyen plus
connu d’assistance ventriculaire gauche temporaire,
comme l’a rappelé le Dr J. Eliet (Montpellier). Deux
modèles peuvent être employés : le LP2.5, délivrant
un débit de 2 l/mn, implantable par voie fémo-
rale rétrograde et limité par le positionnement,
et le LP5, délivrant un débit de 4,4 l/mn, qui se
place par un abord sous-clavier droit et qui peut
être limité par la fonction du VD. Une hémolyse
modérée peut être observée, et l’apparition d’une
défaillance du VD peut conduire à l’implantation
d’une ECMO périphérique. Il a pu être observé un
saignement lors de l’abord vasculaire ainsi qu’une
perte de signal de positionnement et de débit après
quelques jours, mais sans événement thrombo-
embolique. Son maniement associé à l’ECMO peut
rendre difficile le passage transvalvulaire aortique
lorsque l’assistance tourne (ce passage est facilité
par un massage cardiaque externe simultané), et
peut nécessiter un repositionnement itératif écho-
guidé en raison de problèmes de succion. Ce trai-
tement trouve sa place dans le choc cardiogénique
par défaillance du VG, et peut être employé 1 à 2
semaines (modèle LP5) en attendant la récupéra-
tion (favorisée par la diminution des contraintes
pariétales), constituant ainsi potentiellement un
pont vers d’autres thérapeutiques éventuellement
nécessaires. C’est également l’occasion d’un test
fonctionnel du cœur droit. Il est possible de le
combiner avec une ECMO pour diminuer l’œdème
pulmonaire, favoriser le sevrage des inotropes et
limiter le risque thrombo-embolique en rétablissant
un flux transaortique.
relié à une pompe externe. Ce dispositif trouve sa
place en cas d’altération importante de la fonction
systolique du VG, chez des patients nécessitant
une assistance circulatoire mécanique tempo-
raire (infarctus du myocarde, choc cardiogénique,
chirurgie à cœur battant, postopératoire de
chirurgie cardiaque, etc.). En revanche, il est contre-
indiqué en cas d’anévrisme de l’aorte ascendante,
de calcifications aortiques pariétales extensives, de
pathologie ou de prothèse valvulaire aortique, de
thrombus intraventriculaire gauche, de dysfonc-
tion du VD ou du VG terminale. Il peut délivrer un

Figure 5. Jarvik 2000®.
La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009 | 13
CONGRÈS
RÉUNION
Sevrage de l’ECMO
Les réflexions sur les indications de l’ECMO sont
indissociables de celles se rapportant au sevrage.
Voilà tout l’objet du travail du Dr N. Aissaoui
(Paris), rapporté par le Pr A. Combes, concernant les
marqueurs cliniques et échocardiographiques prédic-
tifs du succès de sevrage de l’ECMO. Sur cette étude
prospective ayant inclus 51 patients, des mesures
échocardiographiques étaient réalisées lors de la
diminution, par paliers de 15 minutes, du débit d’as-
sistance, à 66 % puis 33 % puis 1 l/mn, avec clam-
page des lignes pendant 1 à 2 minutes. Cette épreuve
était interrompue en cas de chute de la pression arté-
rielle moyenne en dessous de 60 mmHg. Parmi ces
patients, 20 ont été sevrés, dont 19 ont survécu ;
31 n’ont pas été sevrés, dont 6 ont été greffés et
6 implantés d’une assistance ventriculaire de longue
durée. Sur l’ensemble de ces patients, 38 ont toléré
le test de sevrage, dont les 20 qui ont été sevrés. Les
paramètres identifiés comme étant les plus prédictifs
du succès du sevrage de l’ECMO sont l’ITV aortique
(> 12 cm) et l’onde S télédiastolique à l’anneau mitral
(> 6 cm/s). Ces critères sont simples à acquérir et
sont surtout applicables dans les cardiopathies au
moins partiellement réversibles.
Le Jarvik 2000
®
(figure 5) a été présenté par le
Dr É. Lemoine (Tours). Dispositif d’assistance mono-
ventriculaire gauche couramment implanté, il s’agit
d’une turbine axiale à l’apex du VG et fixée dans
l’aorte thoracique descendante, reliée à un connec-
teur mastoïdien. Il représente une alternative à la
TC pour les sujets âgés de 70 à 75 ans ayant une IC
terminale avec une bonne fonction du VD.
Cardiomyopathies spécifiques
Certaines cardiomyopathies spécifiques peuvent
amener à envisager une transplantation. C’est le
cas de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH),
comme l’a souligné le Pr R. Isnard (Paris). De trans-
mission autosomique dominante, la CMH est une
hypertrophie septale souvent asymétrique dont
l’histoire naturelle est variable, et dont la consé-
quence clinique est hétérogène. Les risques majeurs
inhérents à cette pathologie sont la mort subite
et l’insuffisance cardiaque (IC), pour laquelle il est
rappelé la gravité de la fibrillation atriale (FA) lorsque
celle-ci survient. Le tournant évolutif de la patho-
logie est l’apparition d’une dysfonction systolique.
L’étude rétrospective de 825 greffés entre 1985
et 2008 a permis d’identifier 27 patients porteurs
de CMH, avec un âge moyen au diagnostic de 25 ans,
pour un âge moyen à la transplantation de 39 ans.
Quarante-six pour cent d’entre eux avaient des
antécédents familiaux de cardiopathie, et 27 % de
mort subite. Cinquante-huit pour cent présentaient
une FA, et 73 % avaient une fraction d’éjection (FE)
inférieure à 50 %. Il faut noter qu’aucun ne présentait
un gradient moyen intraventriculaire gauche supé-
rieur à 30 mmHg, du fait des traitements et du bas
débit. Cinquante pour cent ont été greffés dans les
30 premiers jours, avec un délai d’attente moyen de
3 mois ; 2 patients ont été assistés de prime abord.
Le suivi rapporte 5 décès un mois après la trans-
plantation, sans facteur prédictif en analyse multi-
variée, et une retransplantation à 11 ans. Bien que la
mortalité précoce de ces patients soit comparable
aux chiffres des patients greffés pour CMD, la survie
paraît toutefois meilleure à long terme. Il s’agit donc
d’une cause rare de transplantation cardiaque (TC),
concernant des sujets plus jeunes, dont la particula-
rité est la nécessité de délais courts du fait des limites
du traitement médical au stade de l’IC.
Enfin, deux autres thématiques ont fait l’objet de communications lors de
ces Journées : les cardiomyopathies spécifiques et les effets indésirables des
thérapeutiques.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%

![poster SFE [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002606653_1-328843f59c0d371798636ef08e132fb9-300x300.png)
![ECMO / ECLS - divine [id]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000567898_1-07d1d25fd9a5455038f85260be2c51cb-300x300.png)