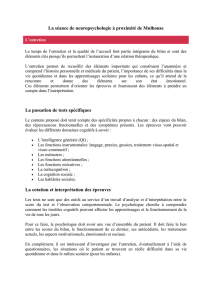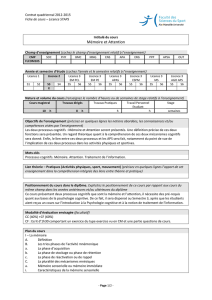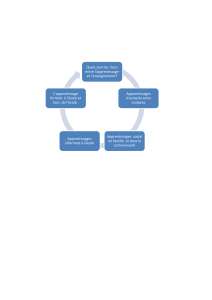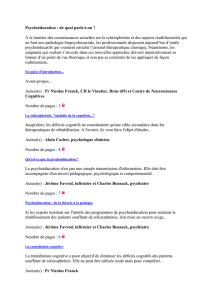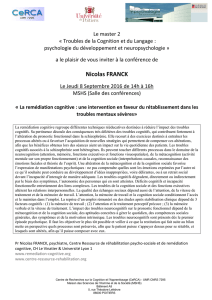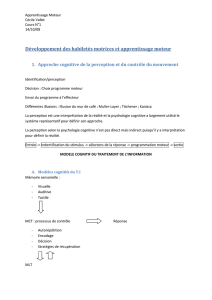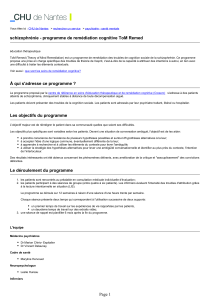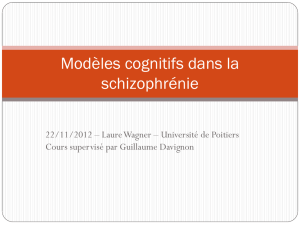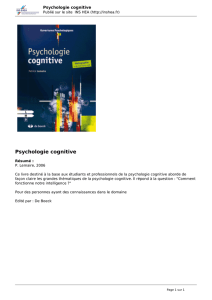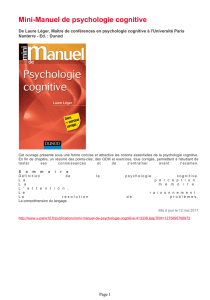Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ?

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2007) Supplément 1, S18-S21
journal homepage : www.elsevier.com/locate/encep
Quelle prise en charge cognitive
pour les schizophrénies défi citaires ?
A. Gut-Fayand
Hôpital Sainte-Anne, SHU de Santé Mentale, 75674 Paris cedex 14
Rappel historique
Il est intéressant de rappeler l’évolution de la prise en
charge des schizophrénies dans son approche comporte-
mentale et cognitive.
En 1968, l’ouvrage de Ayllon et Azorin [2] a fait connaî-
tre l’économie de jetons. Ces techniques étaient fondées
sur la technique du renforcement, et ciblaient les compor-
tements utiles à développer et non les symptômes à réduire.
Une évaluation continue du malade prenait en compte la
quantité de comportements utiles et l’engagement du
malade dans ces comportements. À l’époque, l’idée était
de diminuer progressivement la valeur en jetons des com-
portements fonctionnels adaptés, ou de transformer les
gratifi cations en possibilité de sortir de l’hôpital, mais
cette étape fut rarement possible.
L’abord comportemental des symptômes par la thérapie
comportementale a permis de construire un programme de
modifi cation des comportements, grâce à l’économie de
jetons associée à la technique du coût de la réponse inadé-
quate. Ces programmes étaient appliqués par l’équipe soi-
gnante surtout en extrahospitalier, en utilisant le milieu de
vie comme facteur de renforcement. Des stratégies d’en-
traînement aux habiletés sociales ont aussi été dévelop-
pées, mais elles ont été jugées d’effi cacité réduite chez les
patients défi citaires. Mais malgré un succès indéniable, les
thérapies comportementales ont buté sur les diffi cultés
cognitives des patients, qui étaient mal comprises à l’épo-
que [14].
Dans les années 80, une réfl exion basée sur le concept
de réadaptation psychiatrique s’est développée. L’approche
de la schizophrénie se veut dorénavant pluridisciplinaire et
non stigmatisée, la plus proche du monde normal mais en
aucun cas démédicalisée. Le patient bénéfi cie d’une éva-
luation initiale et continue, qui considère les problèmes
d’adaptation à la vie quotidienne, le retentissement socio-
professionnel et les actions psychosociales nécessaires pour
parvenir à la réinsertion. Ainsi, l’approche de réadaptation
psychiatrique la plus connue est celle développée par
Anthony [1] dans les années 1990, qui utilise la technique
du « case management » ou plan de soin, et qui permet de
réunir le patient, ses proches et les professionnels médi-
caux, paramédicaux et sociaux dans un même moment
autour d’un même projet.
Défi nitions des techniques
de réadaptation psycho-sociale
Les techniques de réadaptation psychosociale sont nom-
breuses et comprennent la psychoéducation, la thérapie
cognitivo-comportementale, la remédiation cognitive
(Rehacom et Recos), l’IPT, l’entraînement aux habiletés
sociales, l’entretien motivationnel, les techniques de réso-
lution de problèmes, les stratégies de coping, le travail sur
les fonctions exécutives. Seules les techniques de rémédia-
tion cognitive (Rehacom er Recos), l’IPT et l’entretien
motivationnel seront ici abordés.
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
L’auteur n’a pas signalé de confl its d’intérêts.
4487_10_Gut . i ndd 184487_10_Gut.indd 18 12/ 12/ 07 9: 17: 5412/12/07 9:17:54
> XPress 6 Noir

Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ? S19
Il convient de rappeler quelques défi nitions. La réadap-
tation cognitive vise à améliorer les habiletés de la personne
dans différents contextes de vie ; elle repose sur le fait que
l’addition des symptômes, des défi cits cognitifs et des biais
cognitifs conduisent à des diffi cultés de résolution de problè-
mes, qui engendrent des diffi cultés d’adaptation au quoti-
dien. Elle comprend l’ensemble des techniques sus-citées.
La remédiation cognitive vise à restaurer les défi cits
cognitifs de la personne par des exercices de mémoire,
d’attention, de fl exibilité conceptuelle ; elle repose sur le
constat que les diffi cultés de fonctionnement de la per-
sonne sont liées à des défi cits cognitifs. En remédiant aux
défi cits cognitifs, on permet un meilleur fonctionnement ;
mais ceci n’est toutefois pas vrai dans tous les domaines.
La thérapie cognitive vise la modifi cation des schémas
cognitifs dysfonctionnels de la personne ; elle repose sur le
fait que la fragilité psychologique est liée à la présence de
schémas inadéquats et à des biais cognitifs plus fréquents
que chez les sujets normaux. Ce sont des thérapies axées
sur le contenu de la pensée ; il s’agit de la thérapie person-
nalisée [7], de la réponse rationnelle de Kingdon et
Turkington [5], de la modifi cation des croyances [4], des
techniques de thérapies cognitives des psychoses chroni-
ques de Chambon, Marie-Cardine et al. [5].
Les techniques de remédiation et de réadaptation
cognitives visent à restaurer les défi cits cognitifs et à per-
mettre un meilleur fonctionnement cognitif au quotidien.
Le développement de ces techniques a vu le jour grâce à de
nombreux travaux ayant permis une meilleure identifi ca-
tion des défi cits cognitifs en jeu dans la schizophrénie :
ceux-ci touchent l’attention, la mémoire, les fonctions
exécutives, les performances motrices, les habiletés spa-
tiales, le langage, la concentration et les capacités d’abs-
traction.
Des modèles cognitifs mis en évidence par les recher-
ches en neurosciences cognitives, le trouble de la planifi ca-
tion de l’action, les diffi cultés de la prise en compte du
contexte, les troubles du monitoring ou de l’initiation de
l’action, le défi cit de motivation ou le trouble des interac-
tions sociales, rendent compte de la multitude des défi cits
cognitifs rencontrés au cours de l’évolution de la schizo-
phrénie. Les différentes techniques de réadaptation psy-
chosociale sont la mise en pratique de ces modèles cognitifs
précédemment identifi és.
Le programme IPT est un programme de réadaptation
élaboré par l’équipe de Brenner [10] ; il s’effectue en
groupe. Le programme Rehacom, validé par l’équipe de
Cochet et al. [6] à Lyon, et le programme Recos, de l’équipe
de Pascal Vianin [15, 16] à Lausanne, ont pour objectif
d’effectuer de la remédiation cognitive. Ce sont des tech-
niques individuelles.
L’Integrating Psychological Treatment
(IPT) [3, 10, 12]
L’IPT intègre toutes les approches de la réadaptation psy-
chosociale. Élaboré de façon empirique par l’équipe de
Brenner en 1995 [10], ce programme comporte 6 modules :
1. différenciation cognitive, 2. perception sociale, 3. com-
munication verbale, 4. compétence sociale, 5. gestion des
émotions et 6. résolutions de problèmes.
Les trois premiers modules sont axés sur la thérapie
cognitive et s’adressent aux patients présentant des trou-
bles cognitifs prononcés, une anxiété sociale importante,
une symptomatologie négative marquée, une faible moti-
vation, de longues hospitalisations. La forte structuration
et la charge émotionnelle minime de ses sous-programmes
donnent aux patients une première possibilité de s’engager
dans les interactions sociales, à l’intérieur d’un cadre thé-
rapeutique qui ne soit pas trop stimulant.
Les trois derniers modules sont plus axés sur l’améliora-
tion des compétences sociales ; ils concernent des patients
jeunes, ayant une bonne motivation pour la thérapie, des
diffi cultés de gestion des situations sociales et ayant ter-
miné avec succès la partie cognitive de l’IPT. Dans ces der-
niers modules, la charge émotionnelle et les interactions
de groupe sont beaucoup plus importantes.
En pratique, les groupes sont constitués de 4 à 8 patients
pouvant présenter une symptomatologie clinique hétéro-
gène. Les séances ont lieu trois fois par semaine et durent
de 60 à 90 minutes chacune ; deux soignants animent le
groupe. En général la transition d’un module à l’autre se
fait quand tous les patients ont acquis le module en cours ;
les patients sont élèves, puis modèles pour le groupe quand
ils ont acquis la compétence demandée dans le module.
Les récentes études montrent des résultats encoura-
geants pour cette technique. Briand et collaborateurs ont
suivis 90 patients ayant effectué le groupe IPT et ont réa-
lisé une évaluation clinique avant le groupe, après le groupe
et 3 mois plus tard. Ils ont rapporté une amélioration signi-
fi cative des patients sur leur symptomatologie clinique,
leurs compétences sociales, leur qualité de vie, ainsi que
sur les défi cits cognitifs, en particulier la mémoire visuo-
spatiale et la mémoire de travail. Roder et al. [12], sur une
méta-analyse portant sur 7 études IPT versus placebo, ont
montré des résultats positifs sur la symptomatologie clini-
que et cognitive chez des patients aigus et chroniques.
Le programme RECOS
Mis en place par P. Vianin au département universitaire de
Lausanne, en Suisse, c’est une technique de remédiation
cognitive individuelle. Le principe repose sur le fait que les
symptômes cliniques sont la conséquence des troubles
cognitifs observés.
Après la passation d’une importante batterie de tests
neuropsychologiques et cliniques, trois styles cognitifs sont
défi nis. Le style « appauvri », où les symptômes cliniques
comme l’alogie, l’avolition, l’apathie, l’anhédonie sont
corrélés à des défi cits cognitifs mis en évidence par le WCST
(Wisconsin card sorting test) et le test de la fl uence ver-
bale ; le style « désorganisé », où les symptômes comme
les troubles du cours de la pensée, des comportements
bizarres, des affects inappropriés sont corrélés à des ano-
malies au test de stroop ou au Degraded stimulus conti-
nuous perform test ; enfi n le style « rigide », où les
4487_10_Gut . i ndd 194487_10_Gut.indd 19 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58
> XPress 6 Noir

A. Gut-FayandS20
symptômes cliniques sont dominés par les hallucinations,
les idées délirantes et les défi cits cognitifs mis en évidence
par la fi gure de Rey, le MEM III et la liste de mots.
Le programme se répartit en 5 modules exclusivement
cognitifs : mémoire verbale, mémoire et attention visuo-
spatiale, mémoire de travail, attention sélective et raison-
nement.
La séance dure une heure et le module est constitué de
20 séances. Pour passer d’un module à l’autre, il faut en
général environ 6 mois. Ce programme s’étend donc sur
2 ans et demi environ.
L’étude de P. Vianin portant sur 10 patients réévalués
8 mois après avoir effectué le programme RECOS montre
que plus de 70 % des résultats défi citaires aux tests de l’at-
tention mémoire ou aux fonctions exécutives sont amélio-
rés par la phase de remédiation cognitive.
Les mécanismes d’amélioration cognitive sont à ce jour
encore mal élucidés, mais une étude récente de Wykes
et al. [17] a montré, lors d’une étude couplée à l’IRMf,
qu’il existait des modifi cations d’activité cérébrale à la
suite du programme de remédiation cognitive. Il serait bien
sûr intéressant de poursuivre ces études.
D’autre part, il est à noter que plus le patient bénéfi cie
de séances de remédiation cognitive, plus l’amélioration
sur l’estime de soi, l’adaptation sociale, la symptomatolo-
gie positive, les défi cits cognitifs sont importants.
Le programme proposé par l’équipe de Vianin n’est pas
encore validé ; il s’agit d’un travail individuel effectué sur
ordinateur, pour une prise en charge très ciblée des défi cits
cognitifs mis en évidence après la passation d’une lourde
batterie de tests neuropsychologiques. Les patients comme
les familles reçoivent des informations très spécialisées sur
les défi cits cognitifs rencontrés dans la schizophrénie, mais
il n’y a pas de travail sur les habiletés sociales ou sur la vie
quotidienne, et il n’existe pas de dynamique de groupe.
Le programme REHACOM
Il s’appuie sur un logiciel constitué de 17 modules, dont
4 modules cognitifs touchant l’attention et la concentra-
tion, la mémoire topologique, le raisonnement logique, les
fonctions exécutives. Il s’effectue sur 14 séances indivi-
duelles à raison de 2 séances par semaine, après une éva-
luation neuropsychologique spécifi que. L’équipe de Cochet,
à l’hôpital du Vinatier à Lyon, a mis en place le programme
et a montré des résultats positifs dès la troisième semaine,
c’est-à-dire après sept séances environ.
Les techniques de remédiation cognitive sont intéressan-
tes mais très variées dans leur contenu et dans leurs procé-
dures d’exécution. Il faudrait multiplier les études contrôlées,
aujourd’hui insuffi santes pour étayer la validité des pro-
grammes à court moyen et long terme. Les évaluations neu-
ropsychologiques de références sont peu transposables d’une
étude à l’autre, et l’on peut se poser la question du passage
de la théorie à la pratique, une fois le défi cit « rééduqué ».
De plus, la motivation personnelle du sujet est peu mention-
née dans ces programmes, alors qu’elle est primordiale dans
la réadaptation psycho-sociale.
L’entretien motivationnel
C’est une approche qui a démontré son intérêt pour aider
les personnes à s’engager dans le changement. Développée
dans les années 80 par Miller et Rollnick [9], cette « méthode
de communication centrée sur le client » cherche à favori-
ser le développement de la motivation au changement, par
l’exploration et la résolution de l’ambivalence du sujet.
Il articule, de manière nouvelle, différents concepts
comme la notion d’empathie défi nie par Carl Rogers [13],
les stades du changement de Proschaska et DiClemente
[11] (Fig. 1) (stades de précontemplation (indifférence),
contemplation (ambivalence), décision, action, maintien
et rechute), la balance décisionnelle de Janis et Mann [8]
(Tableau 1), ou encore le sentiment d’effi cacité person-
nelle de Bandura.
Plusieurs principes animent la conduite des entretiens.
Il s’agit d’exprimer de l’empathie en utilisant l’écoute
réfl ective ; de développer la divergence entre les objectifs
du patient et le comportement problématique actuel, avec
une écoute réfl ective et un feed-back objectif ; d’éviter
l’argumentation en assumant le fait que le patient est res-
ponsable de la décision de changer ; de « rouler avec la
résistance » plutôt que de s’y confronter ou de s’y oppo-
ser ; de renforcer le sentiment d’effi cacité personnelle et
l’optimisme dans le changement.
Ces principes accompagnent l’intervenant pour faire
ressortir le discours-changement, puis renforcer l’engage-
ment au changement, deux phases importantes de l’appro-
Figure 1 Les stades de changements (D’après 11).
Tableau 1 L’ambivalence au changement (9)
4487_10_Gut . i ndd 204487_10_Gut.indd 20 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58
> XPress 6 Noir

Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ? S21
che motivationnelle. L’exploration de l’ambivalence doit
permettre au sujet d’avancer dans la direction du change-
ment.
Le thérapeute s’appuie sur des « techniques » comme
le refl et (simple, amplifi é, double), le résumé, le reca-
drage, la valorisation, etc. Tout au long de son interven-
tion, le soignant utilise la résistance du patient comme un
baromètre de la relation thérapeutique. Elle guide son
action pour l’aider à développer son écoute empathique.
C’est en ajustant son intervention que le soignant favorise
une diminution de la résistance, et en corollaire permet le
développement du discours-changement.
L’entretien motivationnel est un défi à mettre en place
dans la pathologie schizophrénique, où la diffi culté princi-
pale pour le patient est de soutenir et renforcer sa motiva-
tion à s’engager dans le changement quel qu’il soit. La
symptomatologie négative, les défi cits cognitifs, la
conscience partielle du trouble sont de réels obstacles au
changement. Cependant les études ont montré que cette
approche permettait d’obtenir des améliorations durables
sur au moins 6 mois, et que leurs bénéfi ces étaient plus
importants qu’un simple conseil non spécifi que.
Conclusion
Ainsi, dans la pratique courante les techniques de remédia-
tion cognitive sont une approche intéressante pour agir sur
les défi cits rencontrés dans la schizophrénie. Mais elles ne
se suffi sent pas à elles seules, et doivent être englobées
dans un plan de soins spécifi que pour le patient.
Ces approches ont pour but principal de prévenir les
rechutes et de favoriser la réintégration sociale des
patients. L’approche de groupe est séduisante surtout
quand les patients présentent une symptomatologie défi ci-
taire marquée.
La réalisation de ces programmes de remédiation asso-
ciée à la mise en place des thérapies motivationnelles
pourraient permettre de conjuguer plus facilement la théo-
rie à la pratique, en l’intégrant dans la vie quotidienne du
patient.
Références
[1] Anthony WA. Psychiatric rehabilitation technology : opera-
tionalizing the « black box » of the psychiatric rehabilitation
process. New Dir Mental Health Serv 1998 ; 79 : 79-87.
[2] Ayllon T, Azrin NH. Traitement comportemental en institution
psychiatrique, Bruxelles : Dessart, 1973.
[3] Briand C, Vasiliadis H-M, Lesage A et al. Including Integrated
Psychological Treatment as part as standard medical therapy
for patients with schizophrenia. The journal of Nervous and
mental disease 2006 ; 194 (7) : 463-70.
[4] Chadwick P, Birchwood M. The omnipotence of voices : a cog-
nitive approach to hallucinations. Br J Psychiatry 1994 ; 2 :
190-201.
[5] Chambon O, Perris C, Marie-Cardine M. Techniques de psycho-
thérapie cognitive des psychoses chroniques. Paris : Masson,
1997 : 158.
[6] Cochet A, Saoud M, Gabriele S et al. Impact de la remediation
cognitive dans la schizophrénie sur les strategies de resolu-
tion de problèmes et l’autonomie sociale : utilisation du
logiciel REHACOM. Encéphale, 2006 ; 32 (2) : 189-97.
[7] Hogarty GE, Flescher S. Cognitive remediation in schizophre-
nia : Proceed with caution. Schizophrenia bulletin 1992 ; 18 :
51-8.
[8] Janis IL, Mann L. Decision-making : a psychological analysis of
conflict, choice and commitment. New York : Free Press ;
1977.
[9] Miller W, Rollnick S. Motivationnal interviewing : preparing
people for change, 2e édition, États-Unis : The Guilford Press,
2002 : 428.
[10] Pomini V, Neis L, Brenner HD et al. Thérapie psychologique des
schizophrénies. Lille : ed. Mardaga (Belgique) 1988 ; 180.
[11] Prochaska JO, Diclemente CC. Stages and processes of self-
change of smoking : toward an integrative model of change, J
Consult Clin Psychology 1983 ; 51 (3) : 390-5.
[12] Roder V, Mueller DR, Mueser T et al. Integrated Psychological
Therapy for Schizophrenia : Is it effective ? Schizophrenia
Bulletin 2006 ; 32 (S1), S81-S93.
[13] Rogers CR. A theory of therapy, personalities, and interpersonal
relationships as developed in client-centered framework. In :
Koch S, ed. 1959 ; 3 : 184-256. New York : McGraw-Hill.
[14] Simonet M, Brazo P. Modèle cognitivo-comportemental de la
schizophrénie. Encyclopédie Médico-chirurgicale 2005 ; 37-
290-A-10.
[15] Vianin P. La remédiation cognitive : une nouvelle approche
pour le traitement de la schizophrénie. Revue médicale de la
Suisse Romande 2004 ; 124 : 217-9.
[16] Vianin P, Marquet P, Magistretti et al. Pertinence d’un pro-
gramme de remédiation cognitive pour patients schizophrènes :
l’hypothèse de la plasticité cérébrale. Médecine et hygiène
2003 ; 2450 : 1737-42.
[17] Wykes T, Brammer M, Mellers J et al. Effects on the brain of a
psychological treatment : cognitive remediation therapy :
functionnal magnetic resonance imaging in schizophrenia.
British journal of psychiatry 2002 ; 181 : 144-52.
4487_10_Gut . i ndd 214487_10_Gut.indd 21 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58
> XPress 6 Noir
1
/
4
100%