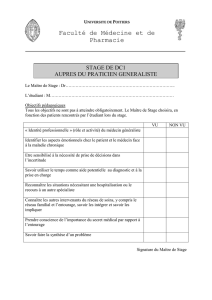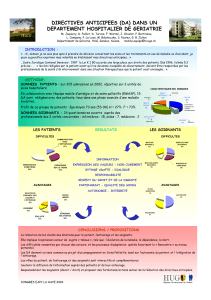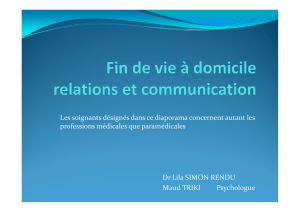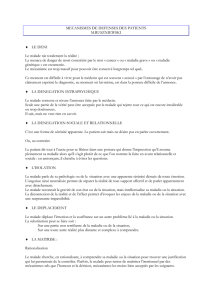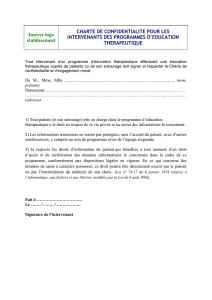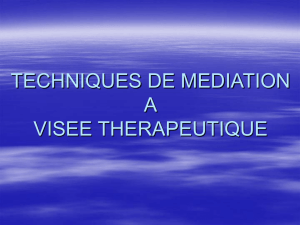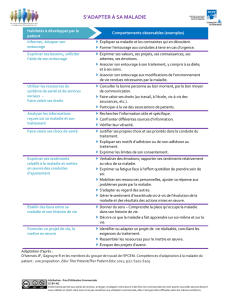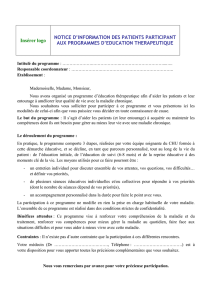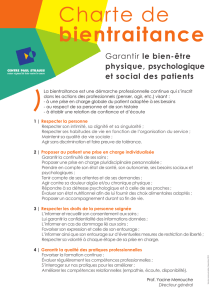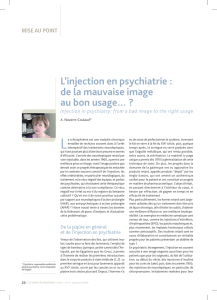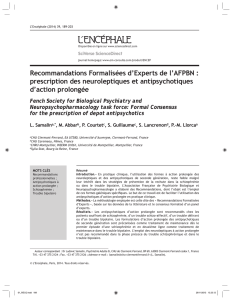Comment prescrire un APAP ? D. Dassa, M. Lacambre, M.N Vacheron

© L’Encéphale, Paris, 2009. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2009) Supplément 3, S109–S113
journal homepage: www.em-consulte.com/produit/encep
Cependant quel type d’information lui délivre-t-il ?
Comment le fait-il afi n que cette information ait un sens,
que le patient puisse évoluer dans un rapport de confi ance
et soit encouragé à adhérer à son traitement ?
L’information sur la maladie
C’est au psychiatre qu’incombe la responsabilité de l’infor-
mation ; elle sera ensuite relayée par les infi rmiers, le méde-
cin généraliste, le psychologue (lorsque le patient bénéfi cie
d’une psychothérapie), et le travailleur social. Le psychiatre
présente au patient sa maladie de façon simple et ce le plus
tôt possible [17], sans pour autant formuler un diagnostic
précis, notamment au début de la prise en charge. Avec l’ac-
cord du patient, il informe également l’entourage qui a été
souvent le premier à déceler les troubles, et à diriger le
patient vers les soins. L’entourage, sollicité pour l’accompa-
gnement au long cours du patient, est généralement très
curieux du diagnostic et du pronostic ; cependant il convient
de temporiser, même vis-à-vis des proches.
Le psychiatre aide le patient à décrypter ses symptô-
mes ; cela lui permet de justifi er l’instauration du traite-
ment et de lui apprendre à repérer par la suite les signes
d’une éventuelle rechute. Il informe sur la maladie, son
histoire naturelle, son pronostic et l’ensemble des soins
nécessaires (traitements médicamenteux, stratégies psy-
chothérapeutiques et mesures psychosociales), en prenant
en compte les principaux facteurs psychologiques, sociaux
et éducatifs de chaque patient. L’information porte donc
sur l’ensemble des stratégies ; l’abord médicamenteux
Comment prescrire un APAP ?
D. Dassa, M. Lacambre, M.N Vacheron
La prise en charge des schizophrénies, nécessite une approche
pragmatique et rigoureuse que l’utilisation des traitements
antipsychotiques atypiques à action prolongée, facilite [1, 2,
10]. Nous proposons une mise au point pratique sur l’utilisa-
tion des APAP considérant en particulier : l’information du
patient et de son entourage (modalité, type, étendue et inté-
rêts de cette information) ; le suivi du traitement et la réponse
clinique au traitement.
L’information du patient
et de son entourage
Avec l’évolution des sciences et la vulgarisation du savoir, le
patient qui était auparavant ignorant, dans une « relation
paternaliste » avec les soignants, est devenu souvent surin-
formé ou mal informé. L’information donnée par le médecin
n’en est plus qu’une parmi toutes celles glanées sur internet,
dans les médias, le cinéma, les associations… Parallèlement,
la loi du 4 mars 2002 [14], relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé rappelle le droit à l’accès
direct du patient à son dossier et rend obligatoire l’informa-
tion délivrée par le médecin. Indépendamment du cadre juri-
dique, le patient et son entourage demandent à être rassurés
par le médecin sans oser toujours le questionner. Le médecin
doit donc s’efforcer d’informer le patient à tout moment, y
compris lors des situations de crise, afi n de lui permettre
d’avoir des repères une fois celle-ci surmontée. L’information
qui est délivrée doit être adaptée en fonction du degré de
compréhension du patient et de son état clinique.
Aucun auteur n’a déclaré de confl its d’intérêts.

D. Dassa, M. Lacambre, M.N VacheronS110
n’étant qu’un des piliers de la prise en charge. Ainsi, le
patient et ses proches pourront percevoir la cohérence des
options thérapeutiques. L’information est renouvelée et
enrichie tout au long de la prise en charge. En effet la
pathologie psychotique évolue au long cours, ce qui
demande souvent plusieurs années pour la compréhension
des troubles et leur acceptation par le patient et à son
entourage. Plus le déni est important, plus il faut persévé-
rer, répéter les mêmes arguments, insister sur les change-
ments bénéfi ques induits par le traitement et les autres
éléments de la prise en charge [16]. L’objectif est aussi de
développer chez le patient une attitude critique face à sa
maladie, et le prémunir de suggestions malencontreuses
inopportunes de l’entourage, telles que la prise de drogues,
l’arrêt de la thérapeutique souvent assimilée à une drogue
par les proches, le déni ou la banalisation des troubles.
L’information délivrée permet d’humaniser les soins. Elle
devient un enjeu contribuant à améliorer « l’insight », elle
aide le patient à prendre de la distance vis-à-vis de ses
troubles [5].
L’information sur le traitement
Les explications données par le psychiatre sur les thérapeu-
tiques sont essentielles et très attendues. L’information
portera sur : l’évolution du trouble en l’absence de traite-
ment, les alternatives éventuelles aux traitements médica-
menteux (psychothérapies, électroconvulsivothérapie…),
les effets recherchés sur les symptômes les plus gênants
(hallucinations, angoisse…) en s’appuyant sur la souffrance
perçue avant le traitement, et le délai d’action des théra-
peutiques. Les mécanismes d’action des médicaments sont
abordés de manière simplifi ée. Les effets indésirables
éventuels sont évoqués de façon adaptée, qu’ils soient fré-
quents ou exceptionnels, en insistant sur les effets secon-
daires qui pourraient limiter l’observance tels que la prise
de poids ou la sédation. Un patient ne pourra accepter le
traitement que s’il connaît les effets bénéfi ques de la
molécule proposée et les effets secondaires qu’il est en
mesure d’accepter. Dans tous les cas, le médecin aménage
l’information en ayant une préoccupation essentielle : l’in-
térêt de la personne soignée. Les risques liés au traitement
doivent toujours être inférieurs au bénéfi ce retiré quant à
l’évolution spontanée de la maladie. L’information sera
d’autant plus importante que le rapport bénéfi ce/risque
sera plus faible [11]. Les objectifs de la thérapeutique
seront clairement expliqués, répétés et adaptés à diffé-
rents moments du suivi du patient : reprise de l’autonomie,
maintien ou réinvestissement d’un projet social, familial
ou professionnel. Le malade bien informé comprend mieux
ses troubles et accepte plus volontiers le fait que les trai-
tements, loin de le déposséder de sa liberté et de sa per-
sonnalité, puissent au contraire lui permettre une
réappropriation de sa vie par le contrôle de sa maladie. Il
devient capable d’expliquer son état et les effets indésira-
bles éventuels de son traitement [7]. L’important est qu’il
se sente écouté par le médecin et les soignants dans son
vécu du traitement et qu’il perçoive que celui-ci est régu-
lièrement adapté et réévalué.
L’observance médicamenteuse des patients souffrant
de troubles psychotiques est problématique. Alors que les
soins psychiatriques sont devenus essentiellement extra-
hospitaliers, on ne peut plus contraindre le patient à un
traitement régulier, mais on doit l’en convaincre et recher-
cher avec lui la forme galénique la plus appropriée. Dans ce
cadre, le traitement à action prolongée est négocié avec le
patient et avec son entourage, au même titre que le traite-
ment par voie orale, dès le premier épisode [12]. L’entourage
est souvent réticent aux injections du fait d’une représen-
tation de la piqûre associée à un état grave. L’information
portant sur cette forme d’administration insiste sur les
avantages : arrêt du traitement quotidien qui rappelle la
maladie, administration facilitée du médicament au patient
qui présente des troubles cognitifs ou un déni partiel des
troubles, réduction des risques d’oubli, diminution des
effets secondaires du fait d’une diminution de la dose
totale administrée, simplifi cation du schéma thérapeuti-
que, diversifi cation des contacts avec les soignants plus
nombreux à être investis dans la prise en charge et amélio-
ration du contrôle des symptômes [10, 18]. Les effets
secondaires liés à la forme injectable sont également abor-
dés avec les patients en leur indiquant les moyens de les
éviter : douleurs, induration, abcès au site de l’injection
évités par des doses plus faibles, utilisation de crèmes
anesthésiques au site de l’injection et rappel des règles
d’hygiène inhérentes à toute pratique d’injection intra-
musculaire [8].
Les informations délivrées par le médecin de façon
spontanée, régulière, informelle et relayées par l’équipe
soignante, sont essentielles pour construire l’alliance thé-
rapeutique avec le patient. Cependant elles ne semblent
pas suffi santes pour garantir l’observance à long terme.
Quelle pédagogie mettre en œuvre alors pour faciliter la
compréhension de l’information délivrée afi n que le patient
soit plus autonome dans la gestion de son traitement et de
sa maladie ?
Place des programmes psycho-éducatifs
Dès le début des années 80, les psychiatres nord-améri-
cains se sont penchés sur la question de l’information à
délivrer au patient, du fait de l’augmentation du nombre
de procès à leur encontre et de l’obligation d’obtenir un
consentement éclairé de leur part avant toute prescrip-
tion. Un certain nombre d’études ont été alors développées
concernant l’évaluation de l’information des patients.
L’ensemble des données, bien qu’il n’existe pas de vérita-
ble méta-analyse de ces travaux parfois hétérogènes, indi-
que qu’une procédure d’information structurée des patients
peut améliorer leur observance médicamenteuse, voire
infl uencer leur symptomatologie et diminuer la fréquence
de leurs rechutes [15]. L’éducation thérapeutique peut
ainsi s’effectuer autour de programmes éducatifs stratégi-
ques intégrant des notions pharmacologiques, socio-psy-
chologiques et pédagogiques, en complément de
l’information délivrée par le médecin et l’équipe soignante
et des supports que représentent internet, les notices de
produits, les brochures éditées sur la maladie par les labo-

Comment prescrire un APAP ? S111
ratoires pharmaceutiques ou les associations d’usagers. Il
est important que cette éducation soit organisée, dispen-
sée par des professionnels compétents (médecins, infi r-
miers, pharmaciens), formés à cet effet ; elle ne devra pas
être limitée à des présentations d’exposés et des discus-
sions de groupe ; et elle devra s’inscrire dans la dynamique
de travail de l’équipe de soins. Il faut également assurer la
continuité de ce processus éducatif par des sessions de rap-
pel du groupe d’éducation pharmacothérapeutique. En
milieu ambulatoire, c’est au sein des réseaux de soins,
appelés aujourd’hui à se développer, que l’éducation thé-
rapeutique peut s’exercer dans les meilleures conditions.
De plus, le caractère organisé et formalisé du dispositif
d’éducation constitue au plan juridique une preuve solide
que le patient a bénéfi cié d’une information de qualité,
délivrée dans de bonnes conditions [4].
Ce qu’il faut retenir :
L’information à délivrer au patient et à l’entourage est
essentielle.
Le type d’information à donner, les moyens de la délivrer
sont fonction de la relation médecin-malade, adaptés à
chaque cas et non standardisés.
Souvent les patients se sentant trop vulnérables, n’osent pas
rechercher cette information auprès de leur médecin. Il
nous apparaît donc important de pouvoir rester accessible
au patient quelle que soit la situation dans laquelle il se
trouve, et de l’aider à formuler sa demande d’information.
C’est au prix d’une information de qualité, évolutive, que
se construira l’alliance thérapeutique.
L’utilisation d’un APAP peut être évoquée et proposée
dès le premier épisode psychotique.
•
•
•
•
•
Suivi et surveillance du traitement
L’antipsychotique atypique à action prolongée (APAP) n’est
pas un médicament de la phase aiguë. Il peut être proposé
aux patients atteints de schizophrénie dès le premier épi-
sode et réservé aux patients stabilisés aussi bien en ambu-
latoire qu’en hospitalisation.
Le suivi du traitement s’aborde de manière globale en
mobilisant le prescripteur, le patient et le personnel infi r-
mier.
Du côté du prescripteur, le rythme des injections impose
un contact soignant toutes les deux semaines : c’est l’op-
portunité d’associer la consultation à la date de l’injec-
tion, surtout au sortir d’une hospitalisation ou en cas de
réactivation symptomatique. L’information délivrée au
patient est capitale, mais elle a aussi son importance pour
l’ensemble des soignants au contact du patient ainsi qu’à
l’égard de son entourage. Les effets indésirables doivent
être recherchés systématiquement pour être correctement
traités, notamment, prise de poids (calcul de l’index de
masse corporelle et mesure du périmètre abdominal),
baisse de libido, symptômes extrapyramidaux, dyskinésies
tardives. Lors de tout traitement antipsychotique, une sur-
veillance biologique est recommandée (glycémie à jeun,
bilan lipidique) à l’introduction du traitement, un mois,
trois et six mois, puis une fois par an, afi n d’éliminer
d’éventuels troubles métaboliques [6]. Toute anomalie bio-
logique sera confi rmée par un second prélèvement et, si
nécessaire, un traitement adapté sera proposé (modifi ca-
tion du régime, éducation diététique, accompagnement à
la pratique d’un exercice physique régulier, médicament
hypolipémiant…).
Avant tout changement de dose, il faut se laisser du
temps pour évaluer la réponse clinique (au moins un mois).
La question de l’injection sera réévoquée régulièrement
afi n de proposer d’éventuelles mesures d’aménagement
(antalgique local au site d’injection, explications sur la
libération du produit, anxiolytique avant l’injection…).
Du côté du patient, pour renforcer l’observance, des
relances pour les injections : courriers, e-mails, appels télé-
phoniques, visites à domicile, doivent être programmées.
Par ailleurs, la remise d’un carnet de suivi permet de respon-
sabiliser le patient et de faire le lien avec le médecin trai-
tant référent. Au-delà de l’évaluation clinique objective,
l’expression du vécu subjectif du patient sur son traitement
permet de répondre à de nouvelles questions qui peuvent
émerger au cours de la prise en charge et renforcer ainsi
l’alliance thérapeutique. Des rencontres régulières avec
l’entourage contribuent à renforcer cette alliance.
Enfi n, du côté des soignants, la formation et l’informa-
tion sur les APAP doivent être les plus complètes possibles.
La mise en place d’un cahier de suivi des traitements injec-
tables (date de l’injection mais aussi impression globale du
soignant au moment de la rencontre, données cliniques
comme le poids, le périmètre abdominal, la pression arté-
rielle), voire d’alarmes (téléphonique, internet…) avec
l’aménagement d’une souplesse relative du cadre des
injections (horaires d’ouverture, disponibilité des soi-
gnants, relais avec des cabinets libéraux…) renforcent
encore la qualité du suivi.
Ce qu’il faut retenir :
L’APAP ne doit être proposé qu’après la stabilisation
clinique obtenue par un traitement oral.
Compte-tenu de la pharmacocinétique de l’APAP, toute
modifi cation de posologie se fera de manière très pro-
gressive.
Le suivi est simple, l’adhésion de l’ensemble des par-
tenaires impliqués est nécessaire (patient, soignants,
entourage).
•
•
•
Évaluation de la réponse clinique
Le praticien poursuit quatre buts lorsqu’il traite les symp-
tômes psychotiques [9] :
1) apporter une réponse clinique,
2) atteindre une rémission symptomatique,
3) obtenir, si possible, une récupération fonctionnelle,
encore appelée dans la littérature « rémission fonction-
nelle »
4) prévenir une rechute.

D. Dassa, M. Lacambre, M.N VacheronS112
Obtenir une rémission permet d’accéder à ce qui pour-
rait être considéré comme une « guérison ». Il existe des
critères scientifi ques de la rémission symptomatique et de
la rémission fonctionnelle [3]. Il nous semble cependant
que c’est une évaluation clinique fi ne, rigoureuse et systé-
matique qui peut permettre d’évaluer au mieux la qualité
de la réponse clinique aux APAP.
De façon générale [13], la réponse clinique à un traite-
ment antipsychotique est une réduction des symptômes.
Cette amélioration est souvent incomplète. Les patients
restent, dans un nombre de cas non négligeable, sympto-
matiques et en danger de rechute. La réponse clinique
n’évolue pas toujours vers une régression des symptômes.
Un patient peut, par ailleurs, avoir une bonne réponse cli-
nique symptomatique en restant cependant porteur de
symptômes résiduels.
L’évaluation de la réponse clinique s’effectue, dans la
plupart des études, à l’aide d’échelles d’évaluation symp-
tomatiques telles que la Brief Psychiatric Rating Scale
(BPRS) et la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).
Pour les formes productives de schizophrénie, une diminu-
tion de 50 % du score établi à partir de ces échelles peut
être un critère de réponse clinique [13]. Cependant, les
cliniciens utilisent très peu ces instruments en pratique
courante. L’évaluation clinique des symptômes à l’origine
de la prescription doit être fi ne et systématique.
Un certain nombre de symptômes doivent être évalués,
en particulier :
les symptômes positifs (hallucinations et délire),
les symptômes négatifs (émoussement affectif, pauvreté
du discours et avolition),
la désorganisation de la pensée,
les symptômes affectifs tels que l’anxiété et la dépression
ainsi que leur relation avec les symptômes psychotiques,
les idées et le comportement suicidaires ainsi que l’im-
pulsivité qui doivent être évalués à chaque consultation
et traités,
la consommation de drogues doit être recherchée dès le
début de la prescription d’antipsychotiques ; il est néces-
saire (d’être capable) d’évaluer leurs conséquences, à la
fois sur l’apparition des symptômes psychotiques et sur
leur persistance.
Avec l’accord du patient, des informations particulière-
ment importantes pourront être obtenues en consultant
son entourage. Ces informations pourront être collectées
auprès de la famille du patient, des travailleurs sociaux,
des équipes de soins (infi rmiers de secteurs ou libéraux) et
du médecin généraliste. Ces informations sont essentielles
pour une meilleure et plus complète compréhension des
signes, des symptômes et du fonctionnement du patient.
Il n’y a pas de consensus pour défi nir, de façon rigou-
reuse, une rechute.
Néanmoins, les auteurs s’accordent sur un certain nom-
bre d’éléments devant être pris en compte pour évaluer et
prévenir l’apparition d’une rechute :
une amélioration clinique plus lente et moins complète,
la recrudescence des symptômes,
•
•
•
•
•
•
•
•
l’augmentation de la fréquentation des services d’ur-
gence et de l’utilisation des lieux de soins (CMP, consulta-
tions…),
l’apparition d’une résistance au traitement,
le risque de passage à l’acte plus important,
un niveau de fonctionnement devenant mauvais,
une baisse de l’estime de soi,
l’accroissement de la charge pour la famille et l’entou-
rage,
la reprise ou l’accroissement de la consommation de dro-
gues,
la rupture, même transitoirement, du suivi ou du traite-
ment.
Ce qu’il faut retenir :
L’évaluation de la qualité de la réponse à un traite-
ment antipsychotique relève d’éléments cliniques
directs et indirects qu’il convient de rechercher de
manière systématique.
Cette évaluation clinique devra être effectuée de
façon rigoureuse au moins une fois par mois et des
informations apportées par l’entourage devront être
fournies régulièrement au thérapeute.
•
•
Pour conclure, nous souhaitons insister sur l’importance
de quelques règles simples accompagnant un traitement
par APAP : qualité de l’information délivrée au patient sur
son traitement, mais aussi délivrée à son entourage et aux
soignants ; modalités d’ajustement des posologies et d’ad-
ministration du médicament ; organisation du suivi et éva-
luation de la réponse clinique.
Références
[1] Academic Highlights. Guidelines for the use of Long-Acting
Injectable Atypical Antipsychotics. J Clin Psychiatry 2004 ;
65 : 1.
[2] Adams CE, Fenton MKP, Quraishis et al. Systematic meta-
review of depot antipsychotic drugs for people with schizo-
phrenia. British Journal of Psychiatry 2001 ; 179, 290-299.
[3] Andreasen NC, Carpenter WT Jr, Kane JM et al. Remission in
schizophrenia : proposed criteria and rationale for consensus.
Am J Psychiatry 2005 ; 162 ; 441-449.
[4] Bordenave-Gabriel C, De Beauchamp I, Gury C. Rôle du phar-
macien in « Informer le patient en psychiatrie » sous la direc-
tion de J. Palazzolo, Paris : Elsevier Masson eds Paris 2003 :
145-166.
[5] Brousse G, Llorca PM. Information du patient schizophrène in
« Informer le patient en psychiatrie » sous la direction de J.
Palazzolo, Elsevier Masson eds Paris 2003, 33-45.
[6] De Hert MA, Van Winkel R, Van Eyck D et al. Prevalence of the
metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with
antipsychotic medication. Schizophr Res 2006 ; 83 : 87-93.
[7] D’Ivernois JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient :
une approche pédagogique. Vigot, Paris : Vigot, 1999.
[8] Jarboe KS, Littrell K, Tugrul K. Long-acting injectable rispéri-
done : an emerging tool in schizophrenia treatment. J Psy-
chosoc Nurs Ment Health Serv 2005 ; 43 : 25-33.
[9] Kane JM. Treatment strategies to prevent relapse and encou-
rage remission. J Clin Psychiatry 2007 ; 68 (Suppl 14) 27-30.
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment prescrire un APAP ? S113
[10] Kane JM, Aguglia E, Altamura A et al. Guidelines for depot
antipsychotic treatment in schizophrenia–Eur. Neuropsycho-
pharmacol. 1998 ; 8 : 55-66.
[11] Lachaux B. L’information entre dire pour se protéger et informer
pour permettre. L’Encéphale 2001 ; 27 ; Suppl 1 : 26-39.
[12] Leucht S, Barnes RR, Kissling W et al. Relapse prevention in
schizophrenia with new-generation antipsychotics : a syste-
matic review and exploratory meta analysis of randomized,
controlled trials. Am J Psychiatry 2003 ; 160 : 1209-1222.
[13] Leucht S, Kane J. Measurement-based psychiatry : definitions
of response, remission, stability and relapse in schizophrenia.
J Clin Psychiatry 2006 ; 67 : 1818-1814.
[14] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé. Journal Officiel
de la République Française, 5 mars 2002 : 4120-4143.
[15] Merinder LB, Viuff AG, Laugesen HD et col. Patient and rela-
tive education in community psychiatry : a randomized con-
trolled trial regarding its effectiveness. Soc Psychiatr
Epidemiol 1999 ; 34 : 287-294.
[16] Palazzolo J. APAP et relation médecin-malade : quelques élé-
ments de réflexion. Ann Méd Psychol. 2007 ; 165 : 536-544.
[17] Petitjean F, Beaufils B. Information du patient atteint de trou-
bles schizophréniques et information de l’entourage. Ann Méd
Psychol 1999 ; 157 (4) : 256-261.
1
/
5
100%