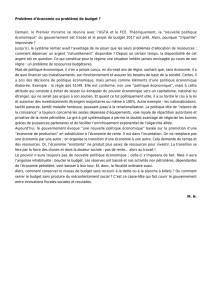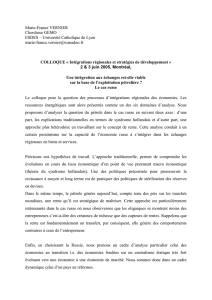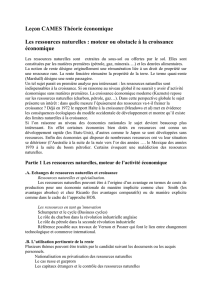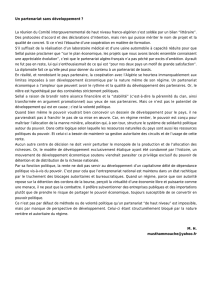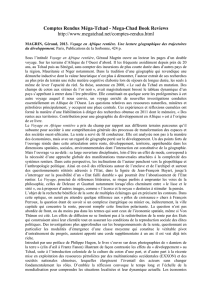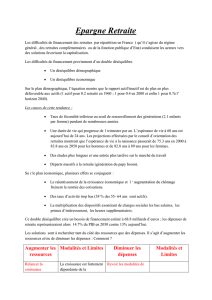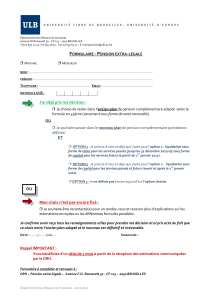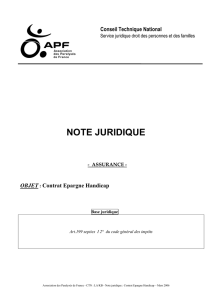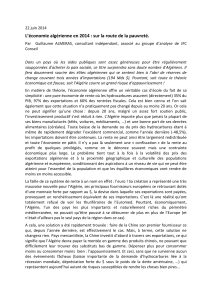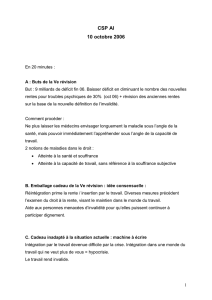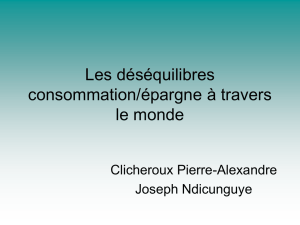Le travail vivant contre l'esprit de rente

Vous êtes ici : Accueil> Société> Le travail vivant contre l'esprit de rente
Le travail vivant contre l'esprit de rente
INTERVIEW DE PIERRE-YVES GOMEZ
© Cédric Audinot
Economiste
<< Nous avons basculé dans une nouvelle ère à partir
du moment où le versement des retraites a été
directement adossé aux revenus du capital >>.
L’onde de choc de la « crise des » a plongé la
subprimes
plupart des pays occidentaux dans une crise financière,
économique et politique profonde, dont l’issue reste
incertaine.
Comme le suggère dans son dernier Pierre-Yves Gomez
ouvrage, comment nos sociétés ont-elles pu succomber
aux mirages de la finance au point de lui donner un tel
pouvoir sur l’économie et, in fine, sur la vie politique et
l’existence individuelle ? La crise durable dans laquelle nous
sommes entrés ne traduit-elle pas l’épuisement du ressort
sur lequel était fondée la promesse de profit affichée par la
finance ? En se plaçant à l’échelle des acteurs individuels –
l’épargnant, le financier, le dirigeant d’entreprise –
Pierre-Yves Gomez montre en effet que la financiarisation
de l’économie a été mue par grande une espérance plus ou
moins avouée ou explicitée : l’entrée dans une nouvelle ère
économique permettant de distribuer des revenus sans
travailler, non pas à quelques-uns, mais au plus grand
nombre possible. Cet « esprit de rente » apparait ainsi
comme un moteur essentiel, presque anthropologique, de la
financiarisation de l’économie. Or, cette dernière va
impliquer des changements majeurs dans la gouvernance et
le management des entreprises, changements qui vont se
révéler particulièrement nocifs pour ce qui reste la source de
la création de richesse : le travail vivant. Ce qui amène
Pierre-Yves Gomez à faire de la valorisation du travail un
enjeu philosophique et politique de première importance.
Economiste, est professeur dePierre-Yves Gomez
stratégie et gouvernance d’entreprise à l'Ecole de
management de Lyon (EM Lyon). Professeur invité et
chercheur associé à la London Business School, et membre
du conseil d’administration de l’Association Internationale de
Management Stratégique (AIMS) et de l’Association
Internationale de gouvernement d’entreprise, Pierre-Yves
Gomez a été élu en 2011 président de la Société française
de Management. Il est par ailleurs conseiller en stratégie et
en changement stratégique auprès de nombreuses

Votre dernier ouvrage, « Le travail invisible », autour duquel se déroule cet échange, s’ouvre sur une image
saisissante : vous imaginez l’un des pires cauchemars de Karl Marx, un cauchemar qui serait devenu réalité...
Dans une nuit prémonitoire, Marx voit l’épargne de millions de travailleurs placée dans le capital des entreprises. La
rente versée aux masses, notamment pour leur retraite, est alors garantie par les profits réalisés par ces entreprises.
Conséquence : c’est la majeure partie de la population qui fait pression pour maximiser les profits et donc exploiter le
travail. Finalement, l’esclavage du prolétaire est assuré par la domination de l’épargnant-prolétaire rentier ou futur rentier
: une gigantesque auto-exploitation du prolétariat. C’est ce cauchemar que la financiarisation de l’économie a réalisé
méthodiquement à partir des années 1970, d’abord aux États-Unis, puis dans le monde entier.
Ce cauchemar prend sa source dans la diffusion de « l’esprit de rente ». Qu’est-ce que vous entendez par là ?
Il y a quelques années, avant la crise, je discutais à la sortie d’un cours avec l’un de mes étudiants sur la manière dont il
entrevoyait son avenir. Tiraillé, comme beaucoup, entre son désir de réussite professionnelle et sa générosité naturelle, il
me dit : « Voilà comment je vois les choses. Je vais travailler pendant une quinzaine d’années comme trader dans une
banque, pour gagner le maximum d’argent. À 40 ans, j’arrêterai de travailler, je pourrai vivre de mes rentes et faire ce qui
me plaît ». Ce qu’il envisageait pour la suite, c’était d’aider une communauté en Afrique. Comme cet étudiant, nous
espérons tous, avec plus ou moins de ténacité, devenir rentiers. Trouver le secret, la pierre philosophale permettant
d’accumuler suffisamment de ressources pour faire ce qui nous plaît. Si l’intérêt général est que l’économie fonctionne
suffisamment pour que chacun puisse en vivre, le désir de chacun est de devenir rentier pour pouvoir faire ce qu’il veut,
quand bon lui semble. D’un côté, il y a la nécessité de contribuer collectivement, par son travail, à la production de
richesses qui, réparties, permettent à chacun de subsister. Mais de l’autre côté, chaque individu aimerait bien échapper à
ce système pour organiser sa propre vie en toute indépendance. Vivre de ses rentes permet cette évasion.
D’où vient cet « esprit de rente » ?
« L’esprit de rente » peut être le fruit d’un calcul opportuniste : vivre aux dépens du travail des autres, sans participer à
l’ouvrage collectif, et bénéficier ainsi d’une partie de la richesse créée par ceux qui travaillent. Mais « l’esprit de rente »
n’est pas seulement produit par l’intérêt privé. Il est rationnel parce qu’il s’enracine dans un besoin profond de sécurité.
La crainte du lendemain, les risques liés à la perte du travail ou au déclin de nos capacités physiques ou intellectuelles,
aux aléas de la vie, nous poussent à espérer un revenu économique stable, indépendant de notre activité, qui nous soit
garanti, même si nous devenions fragiles. Si on écoute bien ce que dit l’étudiant dont je parlais précédemment, on
entend aussi que la rente permet de réaliser des choses que la société nous interdit de faire, des choses « gratuites ».
Obtenir une rente pour faire « ce qui nous plaît » permet des engagements que l’économie ne veut pas financer. L’esprit
de rente s’enracine enfin et, peut-être surtout, dans un puissant désir de liberté. Être rentier procure l’avantage de ne
travailler que comme on le veut et lorsqu’on le veut, et davantage qu’on ne le ferait dans une organisation, mais à notre
rythme et selon notre temps propres. Plus largement, l’esprit de rente traduit l’idéal d’une société sans travail. Beaucoup
de philosophes, depuis les Grecs, ont vu dans la rente un moyen de fonder et d’exercer leur liberté ultime, la liberté de
penser. L’homme libre est celui qui n’a pas besoin de travailler et qui échappe ainsi à l’activité asservissante. Il peut
consacrer son temps aux loisirs, à la méditation, à la contemplation, aux idées. D’une certaine manière, pour être
pleinement philosophe, il faut être rentier.
Vous dites que la « rente pour tous » est devenue un véritable projet politique
entreprises françaises et internationales appartenant à
divers secteurs d’activité. Il a également rédigé le
Référentiel pour une gouvernance raisonnable des
entreprises et il a étroitement participé à l’élaboration du
Code de gouvernance des entreprises moyennes cotées.
Participant au débat public sur ces questions, il intervient
régulièrement dans les médias et tient une chronique
mensuelle dans journal Le Monde.
Réalisée par : Boris CHABANEL
Tag(s) : Modèle économique, Travail, Valeur, Finance, Revue
M3
Date : 30/04/2013

La civilisation démocratique moderne l’affirme. Une société de progrès, une société qui a du sens est une société de
loisirs où le travail peut être réduit au minimum pour que les citoyens bénéficient de longs temps disponibles. La « vraie
vie » serait donc là, et la mission des politiques, des économistes, des hommes d’entreprises modernes et progressistes,
est d’inventer cette société où le travail est marginal et le temps libre la norme. « L’esprit de rente »» n’est donc pas
seulement le produit de rêves ou de calculs individuels, la société moderne démocratique en a fait son projet. La rente ne
doit plus être un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous. Ceux qui rêvaient, il y a quelques décennies
encore, de renverser le capitalisme et d’abolir les rentes qu’ils jugeaient indûment versées aux aristocrates, aux
bourgeois ou aux capitalistes, ont été débordés par plus progressistes qu’eux : ceux qui proposent, au contraire, que la
rente soit généralisée. C’est toute la société qui doit devenir une société de loisirs, une société du temps libre.
Rappelons-nous les mots de Keynes : « le jour n’est pas éloigné où le problème économique sera refoulé à la place qui
lui revient : l’arrière-plan ; et où le champ de bataille de nos cœurs et de nos têtes sera occupé ou plutôt préoccupé par
de véritables problèmes, ceux de la vie et des relations entre les hommes, ceux des créations de l’esprit, ceux du
comportement… l’homme fera-t-il face à son problème véritable et permanent : comment employer la liberté arrachée
aux contraintes économiques ? ». Telle est l’espérance constante promise par les politiques, notamment après la
Seconde Guerre mondiale : le travail peut-être limité grâce aux machines, pour que soit fondée, pour tous, une société
de loisirs, de culture, de plaisirs et donc de liberté. Cet avenir radieux est une question de temps.Et c’est bien ce qu’a
tendanciellement cherché à réaliser la société occidentale depuis un siècle.
Comment s’est construit cette société de rente ?
Elle s’appuie sur une dynamique essentielle qui a parcouru le XX siècle : dans les pays occidentaux, nous produisons
e
aujourd’hui trois fois plus, tout en travaillant deux fois moins qu’en 1900. La différence a permis de généraliser le
versement de revenus de plus en plus déconnectés du travail. On pense bien évidemment à la mise en place de
l’assurance sociale a permis de garantir des revenus en cas de maladie, de chômage, de vieillesse, de pauvreté. Cette
logique de redistribution répond bien aux attentes naturelles de l’homme en matière de sécurité. C’est l’honneur de nos
sociétés d’être parvenues à un tel degré de solidarité.
Mais la généralisation de la rente n’a pas concerné seulement les revenus sociaux. Les revenus du capital sont devenus
des revenus de rente. En particulier, la société anonyme par actions, qui s’est généralisée à partir des années 1900, a
offert un support puissant pour l’économie de rente. Nous avons justement basculé dans une nouvelle ère à partir du
moment où le versement des retraites a été directement adossé aux revenus du capital. Ce basculement va s’opérer aux
Etats-Unis à l’occasion de deux « décisions obscures », apparemment négligeables et largement ignorées du public,
mais dont les effets vont se relever déterminants pour la suite. La première concerne les fonds de pension mis en place
par la plupart des entreprises pour gérer le financement de la retraite de leurs salariés. Visant la sécurité de l’épargne
collectée, l voté en 1974 va instaurer une séparation de gestion nette entre
’Employee Retirement Income Security Act
l’entreprise et son fonds de pension. Ne pouvant plus servir de levier d’autofinancement, le financement des retraites fut
déconnecté de chaque entreprise particulière pour se placer dans des portefeuilles d’entreprises cotées. Les
gestionnaires des fonds de pension, indépendants de leurs entreprises d’origine, ont désormais pour mission de
chercher des débouchés sûrs et rentables pour les flux d’épargne collectée auprès des salariés. Inexorablement, des
milliards de dollars sortirent des entreprises pour se disperser dans d’autres entreprises. La loi permit ainsi de réorienter
massivement l’épargne constituée en vue de la retraite vers un intermédiaire, le marché financier.
La seconde « décision obscure » est prise dans la foulée. Le 1 mai 1975, les opérations sur le
er
New York Stock
furent libéralisées. Jusqu’alors, ces commissions étaient fixes : quelle que soit la quantité d’actions achetées
Exchange
ou vendues, les courtiers recevaient un pourcentage invariable.Mais les fonds de pension se sont plaints que les
sommes considérables qu’ils plaçaient dorénavant sur le marché financier donnaient lieu à des commissions énormes au
bénéfice des intermédiaires. En permettant une libre fixation des commissions, la dérégulation du marché a eu ainsi pour
objectif d’encourager la concurrence de manière à faire baisser leur prix.Avec la concurrence, les intermédiaires devaient
désormais se battre pour assurer le meilleur prix, la meilleure qualité de l’information auprès de leurs clients, ce qui ne
pouvait qu’être favorable à ces derniers et encourager la créativité des services financiers.
Ces deux décisions obscures vont ouvrir des perspectives illimitées à l’intermédiation financière, donnant ainsi naissance
à une nouvelle industrie. Ce qu’on appelle aujourd’hui couramment « marchés financiers » renvoie en réalité à une
industrie de services financiers dont le fonctionnement, quelles que soient la complexité technique et la sophistication
des produits financiers, est très simple : elle transmute l’épargne en produits financiers (comme les SICAV, les fonds
communs de placement ou les produits d’assurances-vie) qu’elle place en capital ou en obligations des entreprises.
Comment les entreprises vont-elles accueillir cette nouvelle manne financière ?
Pour les entreprises américaines cotées, les nouvelles règles de financement de l’économie de la rente furent une
bénédiction : elles pouvaient, en effet, obtenir des financements sous forme de capital en émettant des actions

souscrites par les fonds de pension sur les marchés boursiers. Or, l’avantage d’un tel financement c’est que le capital
n’est pas remboursable aux épargnants à la différence d’une dette bancaire dont il faut chaque année restituer une part
de l’emprunt levé. La déviation de l’épargne de masse vers le capital des entreprises permettait ainsi d’obtenir des
moyens considérables pour investir, à un moment critique de l’histoire économique. Dès la fin des années 1960 en effet,
l’économie industrielle classique s’essoufflait et le taux de profit avait tendance à décroître. Les années 1970 virent
clairement éclater une grande crise économique. De nouveaux relais de croissance étaient nécessaires pour le
capitalisme occidental. En orientant le flux de l’épargne de masse vers le capital des entreprises, celles-ci obtenaient des
ressources énormes pour assurer leur mutation vers ce qui commençait à être considéré comme une nouvelle étape du
capitalisme : l’économie de services et de l’information. Le circuit était bouclé. Dans l’enthousiasme de la révolution
néolibérale de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, il semblait que l’on avait découvert un nouvel eldorado.
Vous expliquez que cette mutation va également gagner les pays européens. Comment cela a-t-il été possible ?
Au milieu des années 1980, tous les pays européens ont basculé dans la logique de la nouvelle économie de rente
inaugurée une décennie plus tôt aux États-Unis. On peut distinguer au moins deux raisons à cela. La première est
d’ordre démographique. Dans les pays où se pratique la retraite par répartition, les perspectives d’accroissement de la
population sont défavorables. La promesse de rente de masse ne semble pouvoir être supportée par les seuls salariés
qui, inexorablement, seront de moins en moins nombreux. Cette perspective a incité les gouvernants, inquiets à l’idée
d’un système de retraite incapable de tenir à terme ses promesses de rente de masse, à encourager l’épargne
individuelle en vue de la retraite. La deuxième raison qui explique l’adhésion au modèle américain de pays comme la
France, tient à ses effets sur les entreprises. Au moment où l’orientation vers la nouvelle économie des services et de
l’information nécessitait d’énormes investissements, les entreprises françaises auraient été défavorisées si elles
n’avaient pas pu puiser, elles aussi, dans cette nouvelle fontaine de jouvence que semblaient promettre les capitaux
abondants issus de l’épargne américaine. C’est le calcul que firent les capitaines d’industrie, issus pour la plupart de la
vieille tradition colbertiste, et convertis aux espérances du marché financier. L’histoire retiendra peut-être que c’est un
Premier ministre socialiste, Laurent Fabius, qui, quatre ans après l’arrivée au pouvoir d’une gauche dont le slogan était «
changer la vie », prit les mesures pour déréguler le marché financier et boursier en France.
L’économie de la rente de masse a pris ainsi une dimension planétaire. Les trois quarts du capital des entreprises cotées
dans le monde sont devenus la propriété des fonds d’investissement et des fonds de pension. Contrairement à ce que
croit encore l’opinion publique, ce capital n’est plus la propriété de quelques riches familles, comme au début du siècle
dernier : il appartient très largement à des fonds de pension chargés de gérer la retraite des ménages.Qu’ils le veuillent
ou non, qu’ils le sachent ou qu’ils l’ignorent, les ménages, soit par le jeu des fonds de pension dans les pays où ils
existent, soit par celui des produits financiers de complément de retraite pour les autres, sont impliqués dans
l’actionnariat des entreprises.
Comment l’industrie de la finance va-t-elle opérer pour allouer les flux d’épargne dont elle dispose ?
Toute la question est de savoir par quels mécanismes cette industrie de la finance s’est efforcée d’assurer la sécurité et
la rentabilité de ses placements. Sans entrer dans le détail de ces mécanismes – je renvois pour cela le lecteur vers mon
dernier ouvrage – on peut souligner ici que l’industrie financière a tendanciellement intérêt à placer l’épargne dans des
entreprises cotées de très grande taille. celles-ci paraissent, par nature, économiquement plus solides.
Toobig to fail,
Surtout, la taille du capital est si considérable que les titres restent liquides et que chaque fonds n’en possède jamais
qu’une part minime. Ce phénomène d’attraction s’auto-alimente. Plus les entreprises obtiennent du capital, plus elles
investissent et se développent, plus elles deviennent des cibles d’investissement intéressantes pour les fonds. L’argent
attirant l’argent, l’épargne de masse concentrée sur peu d’entreprises a fabriqué les géants de l’économie globalisée –
Apple, Microsoft, etc. – qui sont devenus les donneurs d’ordre dominants pour l’ensemble de la chaîne de valeur dans
laquelle ils s’inscrivent.
Selon vous, l’innovation est devenue l’un des principaux terrains d’affrontement des entreprises pour capter la
manne financière. Que voulez-vous dire par là ?
La liberté laissée aux acteurs de la finance d’attribuer leurs capitaux aux projets économiques qui leur paraissent les plus
prometteurs a contraint les entreprises à s’embarquer dans une guerre économique planétaire dans laquelle l’innovation
est effectivement devenue le mot magique. Car la course à la nouveauté est un merveilleux attracteur de capitaux : ceux
qui innovent en savent toujours plus que ceux qui financent l’innovation, puisque, par définition, celle-ci est une rupture,
une invention, du jamais vu. Ils peuvent donc faire rêver les investisseurs, promettre des gains élevés aux épargnants,
orienter le consensus du marché et avec lui, l’afflux de capitaux. De plus, l’innovation permet de détruire l’avantage de la
concurrence en modifiant rapidement et plus ou moins radicalement la manière de produire ou le spectre de l’offre. Ainsi
s’est mise en place une accélération inédite dans l’histoire de l’humanité. Entre 1950 et 2000, le nombre de brevets de

recherche déposés annuellement dans le monde a été multiplié par 250. Mais dans cette course toujours plus rapide à
l’innovation, tout avantage n’est que temporaire, rapidement imité par les poursuivants. En 1999, les grands acteurs du
marché mondial de la téléphonie mobile étaient Nokia et Motorola, en 2012 ce sont Apple et Samsung.
Vous avancez justement l’idée que cette course haletante à l’innovation produit des effets négatifs et à termes
désastreux pour nos sociétés
On peut en effet le penser dans la mesure où elle produit un immense cimetière de produits dépassés. Plus l’innovation
s’accélère, plus elle rend rapidement obsolète les produits précédents. Sur un plan économique, l’extrême rapidité des
innovations ne permet plus l’accumulation de capitaux nécessaire pour rembourser l’épargne consacrée à l’innovation.
On peut parler de création destructrice : l’innovation va si vite qu’elle détruit plus de valeur qu’elle n’en crée. Nous
sommes encombrés de technologies qui se cannibalisent, d’appareils presque neufs et déjà démodés. L’accumulation
capitaliste classique ne peut pas se produire parce que l’investissement n’a pas eu le temps d’être suffisamment amorti
que déjà il est devenu obsolète. Le cycle d’investissement et de consommation de l’innovation ne peut se poursuivre tant
que l’on puise dans une épargne abondante. Mais que se passerait-il s’il fallait rembourser l’épargne de l’économie de
rente ?
Plus largement, la financiarisation de l’économie ne désigne-t-elle pas la prise de pouvoir des entreprises par
l’industrie de la finance ?
Il est essentiel ici de distinguer finance et financiarisation. La finance met en relation, d’une part, les capitaux et, d’autre
part, la production. Elle est indispensable au développement des processus économiques. Elle permet le paiement des
ressources et des investissements engagés pour produire (salaires, technologies, matières premières, etc.) avant que la
production ne soit réalisée par une vente et une consommation. Autre chose est la financiarisation. Il y a financiarisation
lorsque la finance n’est plus une ressource pour réaliser les objectifs économiques mais devient l’objectif lui-même.
L’atteinte du résultat financier est le but que se donne l’organisation, sa raison d’être. De ce point de vue, nous sommes
en effet entrés dans une ère de financiarisation des entreprises au sens où les gestionnaires de l’épargne collective font
pression sur elles pour qu’elles produisent un profit suffisant pour que les rentes soient garanties.
Dans l’économie de rente de masse, l’interface entre l’épargne et les entreprises est devenu le creuset d’une nouvelle
élite économique. L’industrie de la finance a su aligner les intérêts des dirigeants d’entreprises sur les siens en leur
octroyant des rémunérations variables déterminées par l’évolution du profit. Elle a fait en sorte que les postes de
direction générale et de contrôle des plus grandes sociétés soient confiés à des personnes formées en finance, issues
de la banque ou du monde financier.Réunissant les professionnels de la finance et l’état-major des grandes entreprises,
cette oligarchie financière va opérer une révolution politique dans la gouvernance des entreprises.
Quelle est cette révolution ?
Si on s’en tient à la logique du capitalisme, les actionnaires sont les derniers servis dans le partage de la valeur ajoutée
créée par l’entreprise parce que leur part de capital n’est rémunérée, sous forme de dividendes, que dans la mesure où
l’entreprise réalise des profits. En conséquence, une défaillance massive et durable du profit des entreprises dans
lesquelles est placée l’épargne collectée aurait des conséquences économiques et donc sociales considérables. Dès
lors, au nom de l’intérêt supérieur des épargnants et pour sécuriser leurs placements, les fonds d’investissement vont se
rassurer en définissant a priori des objectifs de dividendes à atteindre, plutôt que de les constater a posteriori. Cette
exigence de rendement en échange des apports en capitaux a constitué une révolution, le plus grand bouleversement
politique qu’ont connu les entreprises depuis les nationalisations de l’après-guerre.Ainsi est née la culture contemporaine
de la création de valeur pour l’actionnaire.
Quel en sera l’impact sur le management des entreprises ?
Pour atteindre les objectifs de profits et assurer la transparence vis-à-vis des marchés financiers, l’oligarchie financière
va mettre en place une nouvelle bureaucratie managériale qui va imposer à l’organisation les outils indispensables pour
repérer comment chaque activité peut participer ou non au résultat final. Utilisant la puissance de calcul gigantesque que
permet l’informatique, les nouveaux systèmes d’information vont traduire en termes financiers l’activité humaine concrète
: temps, nombre d’objets fabriqués, nombre de clients contactés, nombre de dossiers traités, nombre de produits vendus
aux clients… Cette information est organisée pour que le travail soit qualifié, stocké et évalué selon une grammaire
financière composée de ratios comparatifs. La grande mécanique financière en déduit des prescriptions pour le travail
réel des gens réels. Sans doute avons-nous assisté, en trente ans, à un des efforts les plus prodigieux de l’intelligence
humaine pour traduire la réalité physique du travail en abstraction repérable et analysable selon un dénominateur
commun : le profit. J’ajoute que cette traduction du travail humain en langage imaginaire s’est finalement étendue à
toutes les organisations économiques et sociales, y compris publiques.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%