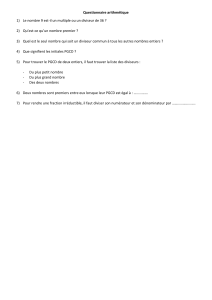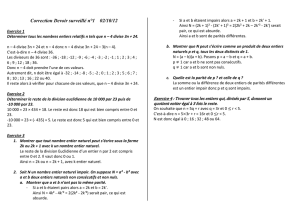polycopié - Espace d`authentification univ

CHAPITRE 1
Les nombres complexes et applications à la
géométrie
1. Les nombres complexes
Lorsqu’on étudie des équations de degré 2à coefficients réels telles
que
x2+ 2x= 0, x2+ 2x+ 1 = 0,et x2+ 2x+ 2 = 0
plusieurs cas de figure se présentent : la première possède deux solutions
réelles, −2et 0, la deuxième possède une solution réelle, −1, et la
troisième ne possède aucune solution réelle car
x2+ 2x+ 2 = (x+ 1)2+ 1
est strictement positif pour tout nombre réel x. Cela ne présage rien
de bon pour l’étude des équations réelles de degré supérieur ; sans une
approche résolument nouvelle, on risque de sombrer dans une zoolo-
gie sans fin. L’introduction des nombres complexes fait disparaître ces
complications et crée un cadre dans lequel le nombre de solutions d’une
equation est égal à son degré, lorsqu’elles sont comptées correctement.
De plus, elle explique le comportement qui semble erratique au premier
abord, du nombre de solutions d’une équation réelle.
Rappelons que Rdésigne l’ensemble des nombres réels 1qu’on se re-
présente géométriquement comme la droite réelle. Le carré cartésien R2
est l’ensemble des couples (x, y)où xet ysont des nombres réels. Géo-
métriquement, on se représente R2comme un plan où chaque point est
donné par abscisse et ordonnée.
Définition 1.1.Un nombre complexe est un élément du carré car-
tésien R2. L’ensemble des nombres complexes est noté C, i.e., C=R2.
On définit les opérations d’addition +et de multiplication ×sur Cpar
les formules suivantes :
(u, v)+(x, y) = (u+x, v +y)et (u, v)×(x, y)=(ux −vy, uy +vx).
1. Avec l’advenu des moyens de mise en page modernes, il convient d’écrire R
ici et non plus Rdu tableau noir.
5

6 1. LES NOMBRES COMPLEXES ET APPLICATIONS À LA GÉOMÉTRIE
Notons qu’on s’est appuyé sur les opérations d’addition et de mult-
plication de nombres réels dans cette définition.
On reconnait l’addition de nombres complexe comme l’addition vec-
torielle dans R2. La multiplication de nombres complexes paraît plus
mystérieuse. Si on la restreint à des nombres complexes de la forme
(x, 0) on obtient les opérations
(u, 0) + (x, 0) = (u+x, 0) et (u, 0) ×(x, 0) = (ux, 0).
Cela veut dire qu’en identifiant la droite réel avec l’axe des abscisses
dans R2, les opérations d’addition et de multiplication sur les deux
coïncident ! C’est dans ce sens-là que les nombres complexes sont une
extension des nombres réels.
On écrira donc désormais uau lieu de (u, 0), lorsque uest un nombre
réel. Avec cette notation le produit de uet d’un nombre complexe
z= (x, y)devient
u×(x, y) = (ux, uy).
On reconnait là l’action des nombres réels sur le plan R2par homothé-
ties.
C’est par souci d’économie qu’on n’introduit pas de suite les opéra-
tions de soustraction et de division sur C; elles vont être déduites des
propriétés de l’addition et de la multiplication.
Proposition 1.2.L’addition et la multiplication sur Cpossèdent
les propriétés suivantes :
(1) L’associativité de l’addition : pour tout t, w, z ∈Cona(t+
w)+z=t+ (w+z).
(2) L’origine 0 = (0,0) est neutre pour l’additition : pour tout
z∈Conaz+ 0 = zet 0+z=z.
(3) Tout élément de Cpossède un opposé : pour tout z∈Cil
existe w∈Ctel que z+w= 0 et w+z= 0.
(4) La commutativité de l’addition : pour tout w, z ∈Con a w+
z=z+w.
(5) La distributivité de la multiplication par rapport à l’addition :
pour tout t, w, z ∈Conat×(w+z) = t×w+t×z,(t+w)×z=
t×z+w×z.
(6) L’associativité de la multiplication : pour tout t, w, z ∈Con a
(t×w)×z=t×(w×z).
(7) Le nombre complexe (1,0) est neutre pour la multiplication :
pour tout z∈Con a z×1 = zet 1×z=z.
(8) Tout élément non nul de Cpossède un inverse : pour tout
z∈C\ {0}il existe w∈Ctel que z×w= 1 et w×z= 1.

1. LES NOMBRES COMPLEXES 7
(9) La commutativité de la multiplication : pour tout w, z ∈Con
aw×z=z×w.
Démonstration. 1. Ecrire t= (r, s),w= (u, v)et z= (x, y)et
simplifier les deux membres :
(t+w)+z= ((r, s)+(u, v))+z= (r+u, s +v) + (x, y) =
(r+u+x, s +v+y)
t+ (w+z) = t+ ((u, v)+(x, y)) = (r, s)+(u+x, v +y) =
(r+u+x, s +v+y)
où on a utilisé l’associativité de l’addition des nombres réels ( !).
2. Ecrire encore z= (x, y)et calculer
z+ 0 = (x, y) + (0,0) = (x+ 0, y + 0) = (x, y) = z.
L’autre équation suivra du 4.
3. Si z= (x, y), on définit w= (−x, −y)et on a bien
z+w= (x, y) + (−x, −y)=(x−x, y −y) = (0,0) = 0.
L’autre équation suivra encore du 4.
4. En écrivant z= (x, y)et w= (u, v)on a bien
w+z= (u, v) + (x, y) = (u+x, v +y) =
(x+u, y +v)=(x, y)+(u, v) = z+w,
où on a utilisé la commutativité de l’addition de nombres réels.
5. Ecrire t= (r, s),w= (u, v)et z= (x, y), calculer les deux
membres de la première équation et constater qu’ils sont égaux :
t×(w+z) = (r, s)×(u+x, v +y) =
(r(u+x)−s(v+y), r(v+y)+s(u+x)) =
(ru +rx −sv −sy, rv +ry +su +sx)
t×w+t×z= (r, s)×(u, v)+(r, s)×(x, y) =
(ru −sv, rv +su) + (rx −sy, ry +sx) =
(ru +rx −sv −sy, rv +ry +su +sx),
où on a utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l’ad-
dition pour les nombres réels. L’autre loi de distributivité suivra du
9.

8 1. LES NOMBRES COMPLEXES ET APPLICATIONS À LA GÉOMÉTRIE
6. Avec les notations ci-dessus, on calcule les deux membres de
l’équation et on constate qu’ils sont égaux :
t×(w×z) = t×((u, v)×(x, y)) = ··· =
(rux −rvy −suy −svx, ruy +rvx +sux −svy)
(t×w)×z) = ((r, s)×(u, v)) ×z=··· =
(rux −rvy −suy −svx, ruy +rvx +sux −svy),
où on a utilisé l’assoctiativité de la multiplication de nombres réels.
7. On calcule
z×1=(x, y)×(1,0) = (x−0,0+y)=(x, y) = z.
La deuxième équation suivra du 9.
8. Soit z= (x, y)où (x, y)= (0,0). En particulier x2+y2= 0, et
on peut définir le nombre complexe wpar
w=x
x2+y2,−y
x2+y2.
On a bien
z×w= (x, y)×x
x2+y2,−y
x2+y2=x2−y(−y)
x2+y2,x(−y)+yx
x2+y2= (1,0) = 1.
L’autre équation suivra du 9.
9. On calcule
w×z= (u, v)×(x, y) = (ux −vy, uy +vx) =
(xu −yv, yu +xv) = (x, y)×(u, v) = z×w,
où on a utilisé la commutativité de la multiplication de nombres réels.
�
Corollaire 1.3.Soient w, z ∈C. Si w×z= 0, alors w= 0 ou
z= 0.
Démonstration. Supposons que z= 0 et montrons qu’alors w=
0. Comme z= 0,zadmet un inverse t. Un multipliant l’équation
wz = 0 par tde deux côtés, on obtient
0 = 0 ×t= (w×z)×t=w×(z×t) = w×1 = w.
�

1. LES NOMBRES COMPLEXES 9
Remarquons que l’opposé d’un nombre complexe zest égal à (−1)×
z. On l’abrègera en écrivant −z. Cela permet d’introduire l’opération
de soustraction de nombres complexe en définissant
w−z=w+ (−z).
L’inverse d’un nombre complexe non nul zsera noté z−1. L’opé-
ration de division d’un nombre complexe par un nombre non nul est
définie par w
z=w×z−1.
Les lois d’associativité nous autorisent de supprimer les parenthèses
dans des expressions itérées comme
(t+w)+zet q×((t×w)×z),
et d’ecrire simplement
t+w+zet q×t×w×z,
respectivement, sans introduire d’ambiguïté. Par contre, les paren-
thèses dans des expressions mixtes comme
(t+w)×z
ne peuvent être supprimées car, comme d’habitude, la multiplication a
précédence sur l’addition.
Proposition 1.4.Les opération unaires d’opposé et d’inverse pos-
sèdent les propriétés suivantes :
(1) −0 = 0.
(2) −(−z) = z.
(3) −(w+z) = (−w)+(−z).
(4) −(w×z) = (−w)×z.
(5) 1−1= 1.
(6) Si zest non nul, z−1est non nul et (z−1)−1=z.
(7) Si wet zsont non nuls, w×zest non nul et (w×z)−1=
w−1×z−1.
La démonstration est laissée au lecteur. Remarquons que la version
additive du 7 n’est pas valable.
Comme pour les nombre réels, on définira les puissances positives
d’un nombre complexe par multiplication répétée :
z0= 1, z1=z, z2=z×z, z3=z×z×zetc.
De manière plus précise,
z0= 1 et zn+1 =z×zn
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
1
/
118
100%