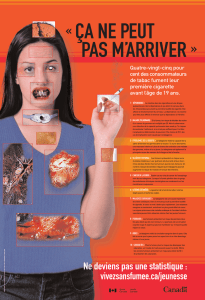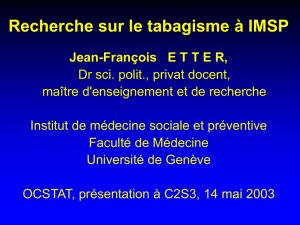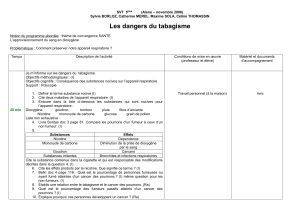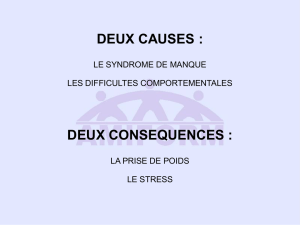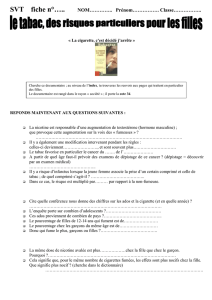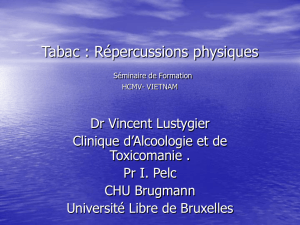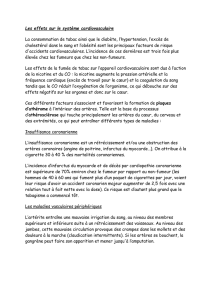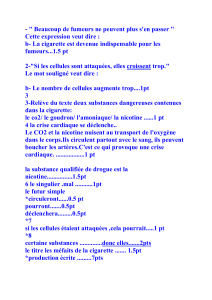r è s

Le Courrier des addictions (12) – n ° 1 – janvier-février-mars 2010 32
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
La 3e édition du congrès de la Société française de tabacologie s'est déroulée avec
succès et a réuni environ 250 participants. Henri-Jean Aubin, son président, a rap-
pelé dans son introduction que beaucoup d'efforts restent à accomplir : "Il est de la
responsabilité de tous les professionnels de santé d’investir une juste part de leurs
efforts pour encourager les fumeurs à s’engager dans une démarche d’arrêt du tabac
et à fournir une aide à sa mise en œuvre. L’ambition de ce congrès est de permettre
des échanges entre professionnels de différents horizons".
Ces efforts vont du conseil minimal à un fumeur, que les médecins généralistes, spécia-
listes, pharmaciens, sages-femmes ou infirmières peuvent donner systématiquement,
jusqu'au remboursement des traitements disponibles et efficaces décidé par l'État.
Brest, 26-27 novembre 2009
Tabac et santés
3e congrès de la Société française
de tabacologie
M. Rakem*
* Médecin journaliste, Vitry-sur-Seine.
En France, chaque année, 66 000 morts
sont imputables au tabagisme, alors
qu’il s’agit de la première cause évitable
de mortalité prématurée.
En 2009, le tabagisme reste au centre des pro-
blèmes de santé publique et de la prévention de
nombreuses maladies. Une séance plénière et
un atelier ont été consacrés à préciser la place
et la démarche de chacun des acteurs dans
la lutte contre le tabagisme. Suite logique de
l’édition 2008 intitulée "la tabacologie au car-
refour des disciplines médicales", l’ambition de
l’édition 2009 était de permettre des échanges
autour des aspects scientifiques, cliniques et
politiques du tabagisme, échanges entre pro-
fessionnels de différents horizons, différentes
spécialités, différentes régions et nationalités.
POINTS D’ACTUALITÉ
Jacques Lehouezec, chargé de La Lettre SFT
consacrée à l’actualité scientifique, a sélec-
tionné et présenté des résultats d’études per-
tinentes pour la pratique. En voici quelques
exemples :
L’étude de Perkins (1) sur la variation de
l’intensité du craving et des symptômes de
manque durant la journée. En effet, selon cette
étude, "le craving du matin n’est pas forcément
le plus élevé, il a tendance à augmenter pen-
dant la journée". D’où l’intérêt d’effectuer des
mesures multiples au lieu de l’unique mesure
habituelle à midi et d’adapter la thérapeutique.
Des nouveautés telles que le nouveau substi-
tut nicotinique, développé en Suède, sous forme
de spray oral dosé à 4 mg de nicotine (Zonnic
®
Pouch) qui soulagerait plus rapidement le cra-
ving (p = 0,002) et serait plus efficace contre l’ir-
ritabilité (p = 0,01) que les gommes ornley (2).
L’étude de Piper (3), menée auprès de 1 504
fumeurs sur la durée de l’arrêt (au moins 10ci-
garettes par jour durant les 6 derniers mois) et
comparant 5 pharmacothérapies différentes à
1 placebo, a confirmé la supériorité du duo ga-
gnant timbre nicotinique + substituts oraux par
rapport au placebo. En effet, le taux de rechute à
6 mois chez les patients traités par le duo patch
+ gommes est significativement le plus bas (p =
0,001).
Les résultats d’un essai mené par Sofuoglu
et al. (4) chez les fumeurs sevrés, effectué dans
le but de préciser les actions de la varénicline
sur les effets dose-dépendants de la nicotine,
concluent que la varénicline, agoniste partiel
α4β2, atténue certains des effets subjectifs et
physiologiques de la nicotine administrée par
voie i.v. chez l’homme. Exemple : "La varénicline
s’oppose à l’effet de la nicotine sur le rythme car-
diaque et diminue l’effet ressenti lors de la prise
de nicotine".
TENIR COMPTE DES TROUBLES
PSYchologiques
La souffrance psychologique du fumeur et sa
prise en charge aont fait l’objet d’une plénière
durant laquelle Gilbert Lagrue et Didier
Touzeau ont présenté leurs travaux sur "Les
troubles psychopathologiques méconnus chez
les fumeurs dépendants", suivie de la commu-
nication de Pierre Bodenez sur la place des
antidépresseurs dans le sevrage tabagique.
Les deux communications recommandent
une plus grande vigilance quant au profil
psychologique et les antécédents psychopa-
thologiques éventuels. Une prise en charge
adaptée à chaque fumeur doit tenir compte
de la co-occurence fréquente entre troubles
psychiatriques et tabagisme : 70 % des troubles
bipolaires I et II, 50 % dans les syndromes dé-
pressifs majeurs et les troubles anxieux. Un
trouble psychiatrique latent associé à un ta-
bagisme important constitue toujours un élé-
ment de gravité supplémentaire, un facteur de
risques majeurs de complications ultérieures
et d’un mal-être psychologique.
LES BONS DOSAGES
Parmi les symposia, celui organisé par les la-
boratoires Pierre Fabre, où l’intérêt et les
règles de prescription des bonnes posologies
de substituts nicotiniques ont été clairement
expliqués. En effet, l’intervention de Jean Per-
riot, pneumologue tabacologue addictologue
(dispensaire Émile-Roux, Clermont-Ferrand)
était particulièrement "libératrice" vis-à-vis
de la prescription de traitements nicotiniques
de substitution (TNS) et pertinente quant aux
posologies initiales : "Il faut systématiquement
utiliser de fortes doses de nicotine, toutes formes
galéniques confondues, pour agir efficacement.
Car, lors d’un sevrage tabagique, un apport in-
suffisant en nicotine entraîne un syndrome de
sevrage et craving, lesquels sont causes de re-
chute", disait-il (voir, dans ce numéro, son ar-
ticle "L’aide à l’arrêt du tabagisme des fumeurs
irréductibles"). Idéalement en pratique, il est
donc conseillé de prendre le temps de bien éva-
luer les besoins du patient grâce à la clinique et
à la biologie (dosage de la cotinine qui est un
métabolite stable de la nicotine ayant une de-
mi-vie plus longue, 24 heures versus 2heures
en moyenne). Et aussi de privilégier l’associa-
tion des formes transdermique et orale, ainsi
que le confirment les études, et de garder à
l’esprit la notion de variabilité interindividuelle
du métabolisme de la nicotine (sa demi-vie va-
rie selon les individus de 1 à 4 heures). Le seul
danger des TNS est le déficit d’apport et l’arrêt
trop précoce du traitement. "Lorsqu’il n’est pas
possible d’effectuer un dosage de cotinine car
coûteux (et par conséquent non disponible dans
toutes les structures de soins) et non remboursé,
la règle est pour un fumeur de moins de 25 ciga-
rettes par jour, on substitue chaque cigarette par
au moins 1 mg de nicotine en patch. Au-delà de
25 cigarettes par jour, le dosage de cotinine est
indispensable pour prescrire une posologie suf-
fisante de TNS".
Durant ce même symposium, Laurence Galanti,
de Belgique, a consacré sa présentation au dosage
de la cotinine. Métabolite primaire de la nicotine,

Le Courrier des addictions (12) – n ° 1 – janvier-février-mars 2010
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
33
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
C
o
n
g
r
è
s
la cotinine est actuellement considérée, avec une
demi-vie plus longue que la nicotine (24 heures
versus 2 heures), comme le marqueur biologique
de choix pour objectiver le degré d’imprégnation
à la nicotine du fumeur actif, confirmer l’exposi-
tion à la fumée environnementale ou valider un
arrêt du tabac depuis plusieurs jours. La concen-
tration en cotinine dans le sang, les urines ou la
salive permet de quantifier les besoins spécifiques
en substitution nicotinique de chaque fumeur, et
d’ajuster la posologie. Cette adaptation est, on le
sait, l’une des solutions pour améliorer l’efficacité
du traitement chez les fumeurs dépendants. En
particulier, ce dosage est important lors du suivi
du sevrage tabagique de groupes spécifiques,
tels les femmes enceintes, les adolescents et les
patients souffrant d’une pathologie cardio-vascu-
laire. Par ailleurs, le dosage d’autres biomarqueurs
issus de la nicotine permet d’évaluer son métabo-
lisme qui semblerait être un facteur déterminant
de la consommation tabagique.
Enfin, Daniel omas, de l’institut de Car-
diologie (groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière),
répond à la question "Faut-il encore craindre
la substitution nicotinique chez le patient co-
ronarien ?" "Beaucoup de confrères cardiolo-
gues n’ont toujours pas intégré les substituts
nicotiniques dans leur pratique. Alors que le
tabagisme est un facteur de risque à prendre
en charge par le cardiologue tout comme les
autres facteurs de risque", disait-il.
De fait, une enquête menée auprès des cardio-
logues français a permis d’identifier les 5 prin-
cipales raisons qu’ils invoquent pour ne pas
prescrire les TNS. Réponse la plus fréquente
(29 % des cas) : "Pas mon rôle" ou "Doit être fait
par quelqu’un d’autre".
Selon D. omas : "De la part d’un cardiologue,
cette attitude est aussi grave que s’il ne prenait
pas en charge une hypercholestérolémie !"
La substitution nicotinique (SN) est un outil
essentiel et d’efficacité parfaitement démon-
trée dans le sevrage tabagique. Elle est à pré-
sent accessible à tous puisqu’elle peut être ven-
due en OTC (Over e Counter). Il est donc
licite de s’assurer de son innocuité.
De rares cas cliniques d’accidents cardio-vas-
culaires, survenus chez des patients traités par
TNS et diffusés dans les médias, ont longtemps
inquiété la population et incité les médecins à
être prudents et à éviter de les prescrire à des
patients coronariens. En fait, les études expé-
rimentales ont montré que les TNS n’ont pas
d’incidence sur la thrombose et probablement
pas sur la fonction endothéliale. Leurs effets
sympathomimétiques éventuels sont très atté-
nués du fait de leur pharmacocinétique (libé-
ration lente de la nicotine) et de la tolérance
acquise par le fumeur vis-à-vis de la nicotine.
Par ailleurs, les études cliniques ne montrent
pas d’excès d’accidents cardio-vasculaires avec
la SN, tant dans la population générale des
fumeurs que chez des coronariens stables.
Même si nous manquons d’études randomi-
sées concernant son utilisation dans les suites
immédiates d’un syndrome coronaire aigu, le
risque absolu de les utiliser dans cette situa-
tion est certainement très inférieur à celui de
la poursuite du tabagisme. L’ensemble de ces
données ont conduit l’AFSSAPS, dès 2003, à en
recommander l’utilisation chez les patients co-
ronariens fumeurs, y compris immédiatement
après un accident coronaire aigu, tel un infarc-
tus du myocarde. Malgré cette recommanda-
tion, peut-être insuffisamment diffusée, une
enquête récente montre qu’ils sont encore trop
peu prescrits par les cardiologues français pour
aider leurs patients coronariens fumeurs.
v
Références bibliographiques
1. Perkins KA, Briski J, Fonte C, Scott J, Lerman C. Se-
verity of tobacco abstinence symptoms varies by time
of day. Nicotine Tob Res 2009;11(1):84-91.
2. ornley S, McRobbie H, Lin RB et al. A single-
blind, randomized, crossover trial of the effects of a
nicotine pouch on the relief of tobacco withdrawal
symptoms and user satisfaction. Nicotine Tob Res
2009;11(6):715-21.
3. Piper ME, Smith SS, Schlam TR et al. A rando-
mized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking
cessation pharmacotherapies. Arch Gen Psychiatry
2009;66(11):1253-62.
4. Sofuoglu M, Herman AI, Mooney M, Waters AJ.
Varenicline attenuates some of the subjective and
physiological effects of intravenous nicotine in hu-
mans. Psychopharmacology 2009;207(1):153-62.
5. Aboyans V, Pinet P, Lacroix P, Laskar M. Knowle-
dge and management of smoking-cessation strategies
among cardiologists in France: a nationwide survey.
Arch Cardiovasc Dis 2009;102:193-9.
BPCO : les femmes aussi !
vDe janvier à septembre 2010, six femmes pneumologues
(Drs Anne Prud’homme du centre hospitalier de Bigorre
[Tarbes], Élisabeth Biron de l’hôpital privé Jean-Mermoz
[Lyon], Cécilia Nocent-Ejnaini du centre hospitalier de la Côte Basque
[Bayonne], Camille Taillé de l’hôpital Bichat [Paris] et les Prs Chantal
Raherison de l’hôpital Haut-Lévêque [Pessac] et Isabelle Tillie-Leblond
de l’hôpital A. Calmette [Lille]), avec le soutien du laboratoire Astra-
Zeneca, mobilisent les femmes pour lutter contre la BPCO, encore consi-
dérée, à tort, comme une maladie réservée aux hommes. Pourtant, 40 %
des malades en France sont des femmes ! Plus sensibles aux méfaits du
tabac, elles ont une altération de la fonction respiratoire plus rapide que
les hommes. En mai 2009, à l’occasion du congrès de l’American o-
racic Society (ATS), les résultats d’une étude menée auprès de 954 pa-
tients atteints de BPCO ont démontré que les femmes développent une
BPCO plus sévère que les hommes, pour un niveau de tabagisme plus
faible. Les causes en sont encore inconnues, mais la taille des poumons
et un métabolisme différent pourraient en partie l’expliquer. D’ailleurs,
selon l’InVS, le taux de mortalité de la BPCO a augmenté, entre 1979 et
1999, de 78 % chez les femmes contre seulement 21 % chez les hommes.
La BPCO progresse donc plus rapidement chez les femmes que chez les
hommes. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de BPCO a aug-
menté de 36 % dans la population féminine entre 1980 et 2000 contre une
baisse de 21 % chez les hommes. Ce constat peut être mis en parallèle
avec la forte augmentation du tabagisme chez les femmes. En France, en
effet, la proportion de fumeurs réguliers, c’est-à-dire fumant au moins
une cigarette par jour, était, en 1953, de 17 % chez les femmes et de 72 %
chez les hommes. Cette proportion est passée en 2007 à 25 % chez les
femmes (+47 %) et à 34 % (-53 %) chez les hommes. L’objectif principal de
cette mobilisation (affiches dans les salles d’attente des pneumologues et
médecins généralistes ; livret patient sur la BPCO et l’importance de son
dépistage ; brochure destinée aux médecins concernant ses spécificités
chez les femmes) est d’informer et d’alerter les femmes sur cette patho-
logie afin de favoriser un dépistage et une prise en charge plus précoces.
– Housset B, Godard P, Crestani B. État des lieux de la BPCO en France en 2005. Rev
Mal Resp 2006;23:8S9-8S12.
– Gan WQ, Man SF, Postma DS, Camp P, Sin DD. Female smokers beyond the peri-
menopausal period are at increased risk of chronic obstructive pulmonary disease: a
systematic review and meta-analysis. Respir Res 2006;7:52.
– Fuhrman C. Mortalité liée à la BPCO en France métropolitaine, 1979-2003. BEH
thématique 3 juillet 2007:27-8.
– Mannino DM, Homa DM, Akinbami JL, Ford SE. Chronic obstructive pulmonary
disease surveillance. United States, 1971-2000. Disponible à l’adresse : http://www.cdc.
gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5106a1.htm
– "International Tobacco Control", projet d’évaluation des politiques publiques de lutte
antitabac. Rapport national ITC France : février 2009. Disponible à l’adresse: http://
www.inpes.sante.fr/ITC/PDF/ITC_RAPPORT_FR.PDF
– Gold DR, Wang X, Wypij D, Speizer FE, Ware JH, Dockery DW. Effects of cigarette smo-
king on lung function in adolescent boys and girls. N Engl J Med 1996;26,335(13):931-7.
– Soerheim IC et al. Gender differences in COPD – Are women more susceptible to smoking ef-
fets? Abstract présenté lors du congrès de l’American oracic Society en mai 2009.
P. de P.
1
/
2
100%