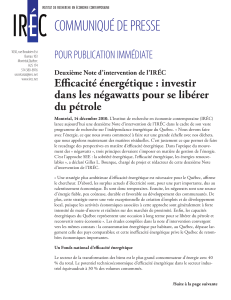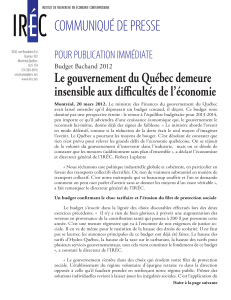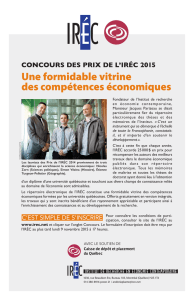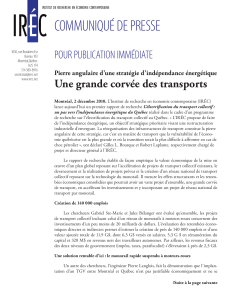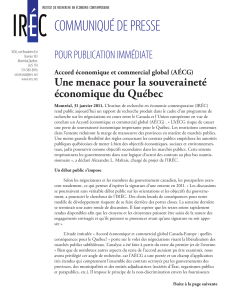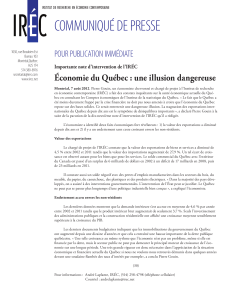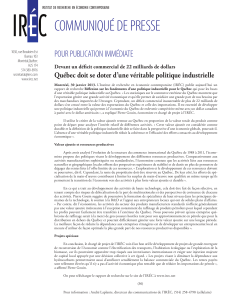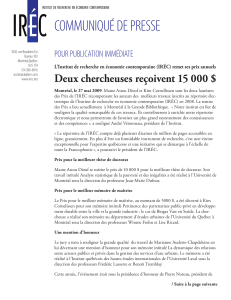BULLETIN DE L’ Le Québec est mûr pour une corvée transport SOMMAIRE

BULLETIN DE L’
Mensuel publié par l’Institut de recherche en économie contemporaine/Janvier-février 2011
SOMMAIRE
À NOTER
❚
Forum « Autres voix,
autres choix »
Budget du Québec
2011 : bâtir des
alternatives
Le regroupement de cinq
réseaux d’économistes tiendra
un forum sur le budget du
Québec. Il sera l’occasion de
faire une synthèse des débats
tenus ces derniers mois lors
de trois conférences publiques
sur le développement
économique (Québec), les
services publics (Montréal) et
les finances publiques (Trois-
Rivières). Des propositions
seront débattues en lien avec
les orientations que devraient
prendre le gouvernement du
Québec lors de la présentation
du budget 2011.
DATE: 24 février 2011
ENDROIT: Auditorium
du Pavillon des sciences
de l’UQAM au 141, rue du
Président-Kennedy à Montréal
HEURE: 9 h à 17 h
Pour informations ou
s’inscrire, voir www.irec.net
2/Analyse du CASIQ
3/ Entrevue avec Yves
Lavoie, président du
RéseauIQ
4/ AÉCG
Répertoire de thèses et de
maîtrise sur le commerce
international
Colloque et conférences
COLLOQUE SUR L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS
Le Québec est mûr pour une corvée transport
Le 20 janvier dernier, la centaine de participants et de participantes au colloque
portant sur l’électrification du transport collectif ont accueilli avec enthousiasme au
projet d’une corvée transport, pierre angulaire d’une stratégie énergétique pour le
Québec. La réception était d’autant plus significative que l’assistance était composée
de représentants et de représentantes des principaux secteurs de la société québé-
coise (industrie, chambre de commerce, syndicats, sociétés de transports, partis poli-
tiques, plusieurs ministères du gouvernement du Québec, firmes d’ingénieurs, etc.)
Robert Laplante a
lancé la réflexion
en situant les enjeux
fondamentaux liés à
l’indépendance énergé-
tique pour le Québec.
Il a notamment insisté
sur la nécessité d’élar-
gir la perspective et de
se placer à l’échelle des
comptes nationaux.
Il a également dit que
l’IRÉC poursuivrait une
recherche sur le finan-
cement de cette grande
corvée transport. Yves Lavoie, a enchaîné en insis-
tant sur l’urgence pour le Québec de se soustraire à
sa dépendance au pétrole. Il a plaidé en faveur d’une
utilisation accrue de l’électricité dans le domaine
du transport en optant pour les véhicules hybrides
branchables, pour les autobus électriques biberon-
nés et pour le monorail rapide suspendu à moteur.
Il a rappelé que le RIQ s’est également penché sur
le financement en proposant la mise sur pied d’un
Fonds national en efficacité énergétique.
Lors de la table ronde sur les choix technologi-
ques et la reconversion industrielle, ii a été question
d’une étude qui montre que le Québec risque de
rater son objectif de -20% d’émission de gaz à effet
de serre à moins d’un coup de barre majeur particu-
lièrement dans le transport (Daniel Breton). Michel
Labrecque a fait ressortir la contradiction entre les
objectifs et la réalité. Il constate qu’il y a une aug-
mentation annuelle de 2-3 % du parc automobile,
une augmentation du nombre d’autoroutes et des
distances à parcourir. Maxime Ouellet a plaidé pour
une meilleure concertation afin de développer le
transport collectif électrique.
Après une descrip-
tion convaincante de
Pierre Langlois sur les
avantages d’un réseau
québécois de monorail
rapide suspendu à
moteur roue l’écono-
miste Gabriel Ste-Marie
a analysé les retombées
économiques d’une
corvée transport. Elle
représenterait un
investissement d’envi-
ron 20 milliards $ et
la création de près de
140 000 emplois. La valeur ajoutée serait de 11,9 G$,
dont 6,3 G$ versés en salaires, 5,3 G$ en rémuné-
NÉGAWATTS/SUITE À LA PAGE 2
Photo : Normand Rajotte
De gauche à droite à l’avant: André Véronneau, président du conseil d’ad-
ministration de l’IRÉC, Pierre Couture, inventeur du moteur roue et concep-
teur du monorail rapide suspendu à moteur roue et Raymond Deshaies,
concepteur d’un autobus hybride dès 1966!
COLLOQUE /SUITE À LA PAGE 2
DEUXIÈME NOTE D’INTERVENTION
Les négawatts
L’Institut de recherche en économie contem-
poraine (IRÉC) a lancé une deuxième Note
d’intervention sur les négawatts dans le cadre de son
vaste programme de recherche sur l’indépendance
énergétique du Québec. Le chercheur Gilles Bourque
suggère de faire avec l’énergie ce qui a commencé
à se faire sur une grande échelle avec les déchets.
« Dans l’optique du mouvement des « négawatts »,
trois principes devraient s’imposer en matière de
gestion de l’énergie, dit-il. C’est l’approche SEE :
la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables.
Une stratégie plus ambitieuse d’efficacité
énergétique est nécessaire pour le Québec.

Au cours du mois de janvier 2011, l’IQ-
30 a subi une hausse de 1,68 % pour se
situer à 1352,40. Seize titres ont augmenté
alors que quatorze titres ont baissé au cours
du mois. Quatre des sept secteurs de l’IQ-30
ont connu une hausse au cours du mois. Le
secteur des Technologies de l’information a
eu la plus forte variation positive soit
11,98 %. Le secteur des Matériaux a subi une
baisse de l’ordre de 6,83 %. Durant le dernier
mois, le titre de la compagnie Bombardier
Tableau comparatif des secteurs de l’IQ-30 avec les secteurs de
l’Indice composé S & P/TSX
Depuis le début de l’année au lundi 31 janvier 2011
IQ-30 (%) TSX composé (%)
10–Énergie - 5,28
15–Matériaux -2,88 -5,43
20–Industrie 4,96 3,58
25–Consommation discrétionnaire -0,81 2,40
30–Biens de consommation de base -0,74 -0,54
35–Santé - 11,95
40–Finance 1,51 0,57
45–Technologies de l’information 11,98 4,82
50–Télécommunications 2,91 4,66
55–Services aux collectivités - 0,72
Variation 1,68 0,81
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
IQ-30: Les plus fortes hausses depuis le début de l'année
Prix ($) Prix ($) Variation Pondération (%) Variation
31 déc. 31 janvier du titre au 31 déc. pondérée
Société 2009 2011 % 2009 %
Corporation minière Osisko 8,46 13,31 57,33 3,35 1,92
BCE 29,00 36,37 25,41 7,39 1,88
Semafo 4,43 10,20 130,25 1,13 1,47
Saputo 30,75 41,80 35,93 4,02 1,44
Banque Nationale du Canada 60,24 69,81 15,89 8,44 1,34
ANALYSE DU CASIQ AU 31 JANVIER 2011
L’IQ-30 connaît une hausse de 1,68 %
BBD.D. a augmenté de +13,77 %. Celui de
la compagnie Corporation Minière Osisko
(OSK) a affiché une diminution de l’ordre de
-8,33 %.
Depuis le début de l’année, les huit
secteurs du TSX composé ont connu une
croissance positive de +0,81 %. La plus forte
variation positive provient du secteur de la
Santé avec 11,95 %.
Pour des informations plus complètes, voir
l’URL : http://www.iq30-iq150.org/
Tableau comparatif des secteurs
Depuis le vendredi 31 décembre 2010 au lundi 31 janvier 2011
IQ-30 (%) TSX Composé (%)
10–Énergie - 5,28
15–Matériaux -2,88 -5,43
20–Industrie 4,96 3,58
25–Consommation discrétionnaire -0,81 2,40
30–Biens de consommation de base -0,74 -0,54
35–Santé - 11,95
40–Finance 1,51 0,57
45–Technologies de l’information 11,98 4,82
50–Télécommunications 2,91 4,66
55–Services aux collectivités - 0,72
Variation 1,68 0,81
N.B. Le secteur de l’énergie, la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
COLLOQUE/SUITE DE LA PAGE1
ration du capital et 320 M$ en revenus nets
des travailleurs autonomes. Par ailleurs, les
revenus fiscaux des deux niveaux de gouverne-
ment (impôts, taxes, parafiscalité) s’élèveraient
à près de 2,3 G$. Pour le monorail, on parle
de 90 000 emplois dont 65 % des retombées
restent au Québec.
Les participants et participantes à la
deuxième table ronde ont essayé de voir en
quoi ce projet pourrait être mobilisateur. Une
stratégie mobilisatrice doit avoir une vision
intégrée du financement et de la gouvernance
avec des cibles qualitatives échelonnées sur un
horizon de dix ans. Il faut définir des objectifs
communs. (Florence Juncas-Adenot). Les deux
autres intervenants ont insisté sur la nécessité
de ne pas mettre de côté d’autres solutions
comme la réduction des infrastructures
routières, revoir nos modèles d’urbanisme, etc.
(Philippe Bourque) et de penser la mobilité
en matière d’occupation du territoire. (Claire
Bolduc)».
Voir le dossier complet sur le colloque sur
le site de l’IRÉC à l’URL : http://www.irec.net/
index.jsp?p=82
NÉGAWATTS/SUITE DE LA PAGE1
D’abord, les surplus actuels d’électricité sont
temporaires. Ensuite, les négawatts sont
une source d’énergie fiable, peu coûteuse,
durable et favorable au développement des
communautés. De plus, cette stratégie ouvre
une voie exceptionnelle de création d’em-
plois et de développement local, puisque
les activités économiques associées à cette
approche sont généralement à forte intensité
de main-d’oeuvre et réalisées sur des marchés
de proximité. Enfin, les capacités énergétiques
du Québec représentent une occasion à long
terme pour se libérer du pétrole et reconvertir
notre économie ».
Le secteur de la transformation des biens
est le plus grand consommateur d’énergie avec
40 % du total. Le potentiel d’efficacité énergéti-
que dans le secteur industriel équivaudrait à
30 % des volumes consommés.
Enfin, le chercheur a retenu une proposi-
tion du Réseau des ingénieurs du Québec. «La
création d’un Fonds de financement de projets
d’efficacité énergétique dédié aux secteurs
industriel, commercial et institutionnel (les
ICI) constitue une proposition à fort potentiel
structurant. Ce fonds devrait constituer une
pièce majeure d’une stratégie globale de recon-
version soutenable puisqu’elle s’adresse au
plus grand consommateur d’énergie, le secteur
manufacturier », a-t-il conclu.
2

3
ENTREVUE AVEC YVES LAVOIE
Le développement énergétique
nécessite l’interdisciplinarité
À l’automne 2010, le Réseau des ingénieurs du Québec publiait une impor-
tante étude sur la mobilité durable1. Nous avons rencontré Yves Lavoie, le nou-
veau président. Nous le remercions. « Sans nous être consultés, dit-il, l’IRÉC et
le RIQ en arrivent aux mêmes constats. Il faut se sortir de notre dépendance
au pétrole et miser sur la mobilité durable grâce en particulier à l’électri-
cité. Nous sommes conscients qu’il faut s’associer avec d’autres voix pour le
développement durable. Le développement énergétique nécessite l’interdisci-
plinarité. Nous maîtrisons les dimensions technologiques. Avec l’IRÉC, nous
pouvons intégrer la dimension économique dans notre réflexion ».
Il a poursuivi en expliquant que cette impli-
cation du RéseauIQ fait partie de l’effort
pour responsabiliser et soutenir les ingénieurs
face aux défis énergétiques, au développement
durable et aux grands enjeux de société.
C’est pourquoi le Réseau insiste tant sur la
nécessité de s’affranchir de la dépendance du
Québec au pétrole. « Cela coûte chaque année
environ 15 milliards de dollars à l’économie
du Québec. Un peu plus de la moitié de cette
somme est absorbée par le transport des
personnes et des marchandises. Le pétrole est
le premier produit d’importation et le premier
responsable de notre déficit commercial »,
explique Yves Lavoie.
Tout milite en faveur de cette reconversion:
les sources d’approvisionnement seront de plus
en plus coûteuses à exploiter, elles le seront
dans des zones géopolitiques instables alors
que les économies émergentes verront leurs
propres demandes augmenter. C’est aussi une
source d’énergie très polluante.
S’appuyer sur l’électricité
« Des choix judicieux doivent être faits si on
veut diminuer notre consommation de pétrole
de 60% d’ici 20 ans dans les transports rou-
tiers, soutient l’ingénieur. Le Québec dispose
d’électricité en abondance pour effectuer le
virage de l’électrification des transports et sans
avoir à construire de nouveaux barrages ».
Le RéseauIQ est en faveur de la mise en
œuvre d’une stratégie québécoise de la mobilité
durable selon deux axes stratégiques.
Réduire l’empreinte de carbone
Le premier axe est centré sur la réduction
de l’empreinte de carbone et de la dépendance
au pétrole du transport. Pour cela, il suggère
de maximiser la pénétration des véhicules
à motorisation électrique (VME) légers et la
diminution de la consommation de carburant.
Selon Yves Lavoie, « un million de voitures
électriques consommerait moins de 2% de
l’électricité utilisée par les Québécois et les
Québécoises ».
Le RIQ suggère également de favoriser les
transports collectifs, alternatifs et actifs. Pour
les transports collectifs urbains, il préconise
les autobus électriques biberonnés, car ils
rendent possible l’électrification complète d’un
parc d’autobus urbains, sans fil au-dessus des
rues et l’utilisation de batteries québécoises au
titanate de lithium nanométrique qui per-
mettent de les charger très rapidement. Pour
les transports collectifs interurbains, comme
l’IRÉC, le RéseauIQ préconise le monorail
rapide suspendu à moteur roue. Enfin, il faut
augmenter l’usage des carburants alterna-
tifs avec, notamment, les biocarburants de
deuxième génération.
Soutenir l’industrie québécoise
Le deuxième axe est centré sur le soutien de
l’industrie québécoise des VME. « Nous suggé-
rons entre autres d’accroître la part de marché
du contenu québécois dans la chaîne d’approvi-
sionnement des VME, d’accroitre la visibilité de
l’industrie québécoise du VME dans le monde »,
souligne le président du RIQ.
Un Fonds national en efficacité
énergétique
Le RIQ s’est aussi penché sur le finance-
ment. « Avec du financement avantageux, la
consommation énergétique des bâtiments, des
procédés de production ou des parcs automobiles
à la grandeur du Québec pourrait être attaquée
de front. C’est pourquoi nous proposons un
Fonds national en efficacité énergétique (FNEE)
bâti sur le modèle d’un fonds qui consentirait
des prêts aux grands consommateurs d’énergie
et s’autofinancerait dans le temps, à même les
économies d’énergies réalisées ».
Le président du RéseauIQ conclut en affir-
mant que l’avenir du Québec réside dans sa
capacité à utiliser l’énergie à bon escient, que
ce soit pour ses procédés industriels ou pour la
mobilité des hommes et des biens. « Le Québec,
dit-il, a tout ce qu’il faut pour relever les défis
de la conjoncture énergétique mondiale. C’est
en matière de transport et de mobilité durable
que se posent les premiers défis ».
Yves Lavoie est président du RéseauIQ depuis
2010. Il est membre du Ccomité spécial pour l’inté-
gration, du comité de gouvernance et du comité de
soutien des intérêts socioéconomiques des ingé-
nieurs. Il a été administrateur de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec et de la Chambre de commerce et
d’industrie de Sorel-Tracy. Depuis 2006, il est admi-
nistrateur du Technocentre en écologie industrielle.
1. Voir sur le site www.reseauiq.qc.ca, le document Pro-
positions du RéseauIQ pour engager le Québec sur
la voie de la mobilité durable. Un autre document
fort intéressant peut aussi être consulté : Propositions
concernant la création d’un Fonds national en
efficacité énergétique.
Le RéseauIQ, c’est
quoi?
Le RéseauIQ est un organisme sans but
lucratif qui représente plus de 59 000
membres répartis dans tout le Québec. Sa
mission est de valoriser, promouvoir et servir
les ingénieurs au Québec.
Pour cela, l’organisme :
- prend des positions publiques afin de
promouvoir les intérêts socio-économiques des
ingénieurs;
- conçoit et négocie des programmes et des
services avec des partenaires commerciaux
reconnus;
- répond aux besoins des différents acteurs
du monde du génie en matière d’emplois et de
formation.

ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AÉCG)
Une menace pour la souveraineté
économique du Québec
Un rapport de recherche produit dans le cadre d’un programme de recher-
che sur les négociations en cours entre le Canada et l’Union européenne en
vue d’un Accord économique et commercial global (AÉCG) conclut que le
Québec court le risque d’une perte de souveraineté économique importante.
« Les restrictions contenues dans l’entente réduiront la marge de manoeuvre
des provinces en matière de marchés publics. Cette entente emprisonnera les
gouvernements dans une logique d’octroi des contrats au plus bas soumis-
sionnaire », a déclaré Alexandre L. Maltais, chargé de projet de l’IRÉC.
Bulletin d’information
de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) à l’intention des Amis
de l’IRÉC/Numéro 12
1030, rue Beaubien Est, bureau 103
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél. 514 380-8916/Télécopieur: 514 380-8918
adm.irec@videotron.net/ www.irec.net
Directeur général de l’IRÉC: Robert Laplante
Responsable du bulletin: André Laplante
514 564-7955/andrelaplante@irec.net
Collaboration: Frédéric Farrugia (CASIQ)
Graphisme(grille): Anne Brissette
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec
BULLETIN DE L’
4
Photo : Michel Giroux
Photo : André Laplante
place par les gouvernements grâce aux mar-
chés publics et aux normes sociales en vigueur
au Québec.
Après avoir passé en revue la littérature
scientifique, le chercheur de l’IRÉC demeure
sceptique quant aux soi-disant bienfaits de
la libéralisation des marchés publics. « Le
grand gagnant de cette négociation sera fort
probablement le secteur privé, dit-il. En effet,
plusieurs observateurs ont fait valoir que
l’accord était calqué sur les besoins des grandes
entreprises. En outre, les retombées économi-
ques seraient distribuées inégalement entre les
régions du Canada ».
En conclusion, le chercheur constate que «
des choix lourds de conséquences pour notre
modèle de développement risquent de se faire
derrière des portes closes, car les discussions se
poursuivent sans véritable débat public ».
➜« Autres voix, autres
choix »
Une conférence sur les services
publics a eu lieu le 24 novembre 2010
à Montréal. (Voir photo ci-contre).
Celle portant sur les finances publi-
ques a eu lieu le 19 janvier 2011 à
Trois-Rivières. Le forum «Budget du
Québec 2011 : Bâtir des alternatives!
aura lieu le 24 février 2011. Voir page
1 de ce bulletin et sur le site de l’IRÉC
http://www.irec.net/index.jsp?p=80.
L’étude intitulée « Accord économique et
commercial global Canada-Europe : quel-
les conséquences pour le Québec? » porte sur
le volet des négociations visant la libéralisation
des marchés publics subfédéraux. L’AÉCG a une
portée et un champ d’application très éten-
dus qui comprennent l’ensemble des contrats
octroyés par les gouvernements des provinces,
des municipalités et des entités adjudicatrices
(sociétés d’État, organismes publics et parapu-
blics, etc.). Il impose le principe de la non-dis-
crimination envers les fournisseurs étrangers
et interdit de favoriser les entreprises locales.
D’autres aspects inquiétants de
l’entente
L’auteur montre également que l’AÉCG
constitue une menace sérieuse aux politiques
de protection de l’environnement mises en
UN COLLOQUE ET DEUX CONFÉRENCES
POUR FAIRE AVANCER LES CHOSES
Social-démocratie
➜
Un colloque international sur le
renouvellement de la social-démo-
cratie a réuni plus de 200 personnes à
Montréal les 26 et 27 novembre 2010.
Un texte publié dans Le Devoir a
servi de point de départ (http://www.
chantiersocialdemocratie.org/spip.
php?rubrique1). Une synthèse a été
rédigée par Benoît Lévesque (http://
www.irec.net/index.jsp?p=78).
RÉPERTOIRE DE L’IRÉC
Commerce
international
En complément à l’article sur l’AÉCG
Canada-Europe, voici des thèses et des
mémoires sur le commerce international se
trouvant sur: www.irec.net. Notre site est
l’un des plus riches répertoires de thèses et de
mémoires produits dans les universités québé-
coises dans le domaine de l’économie.
AVIGNON, Pierre. Les innovations de
l’Accord nord-américain de coopération
dans le domaine du Travail (ANACT).
Université de Montréal, 79 p. 2003, Numéro de
référence: 360
BOURQUE, José. L’impact de la libérali-
sation des échanges commerciaux sur
l’environnement. École des Hautes Études,
1999, 70 p. Numéro de référence: 64
MARCARIAN, Arwin. Méta-analyse de
l’incidence du commerce international sur
l’inégalité salariale. ESG-UQAM, 2010, 88 p.
Numéro de référence: 718
SINCLAIR, Jean-Christophe. Migra-
tions internationales et intégration
régionale dans l’Union européenne et dans
l’Accord de libre-échange nord-américain.
UQAM, 1998, 162 p. Numéro de référence: 220
STRACHINESCU-OLTEANU, Magdalena
Andreea. Les accords commerciaux pré-
férentiels entre les petits et les grands
pays - le cas d’un accord entre le Canada
et l’Association européenne de libre-
échange. HEC Montréal, 2007, 248 p. Numéro
de référence: 709
1
/
4
100%