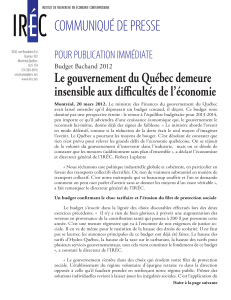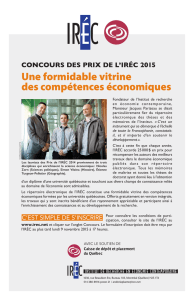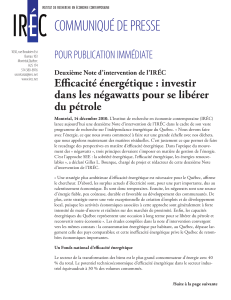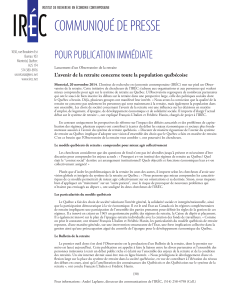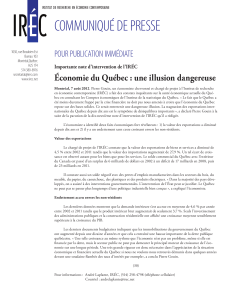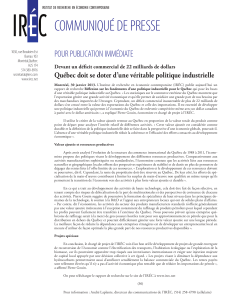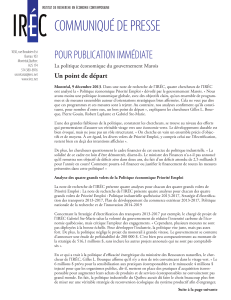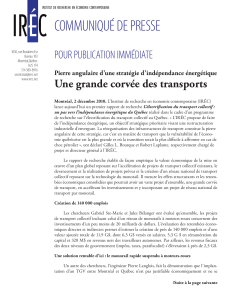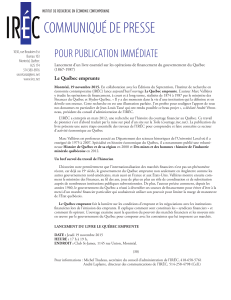BULLETIN DE L’ Un actif pour l’économie l et le développement régiona

BULLETIN DE L’
Publié par l’Institut de recherche en économie contemporaine/www.irec.net/Mars-avril 2015
SOMMAIRE
3/Débat-midi sur le modèle
québécois et le gouvernement
Couillard: Un train peut en
cacher un autre
4/Nouvelles brèves
Crédits
Un impact budgétaire de 8,4G$ en 2013
LES AMIS DE L’IRÉC
Soutenir son
indépendance
En devenant un Ami de
l’IRÉC ou en incitant
vos amis à le devenir, vous
permettez à l’Institut de
préserver son indépen-
dance intellectuelle et
financière. Pour en savoir
plus, voir l’onglet «Amis de
l’IRÉC»
CPDQ INFRA/LA SUITE À LA PAGE2
MODIFICATIONS AU RÉGIME FISCAL QUÉBÉCOIS DES PARTICULIERS1997-2013
L’étude de l’IRÉC sur les changements au régime fiscal québécois des particuliers2 sur-
venus entre 1997 et 2013 montre que les changements introduits depuis 1997 ont eu un
impact négatif sur le budget de 8,4G$ en 2013. Le total auquel arrivent les chercheurs
de l’IRÉC, Jules Bélanger et Oscar Calderon, s’explique par une diminution de 4,5G$ des
revenus fiscaux ainsi qu’une augmentation de 4,1G$ des transferts vers les particuliers.
RÉGIME FISCAL QUÉBÉCOIS/LA SUITE À LA PAGE2
Le régime fiscal des particuliers québécois a subi
des transformations en passant par les modifica-
tions aux taux d’imposition, l’introduction et la boni-
fication de plusieurs crédits d’impôt. Pour connaître
les impacts fiscaux en 2013 sur les ménages qué-
bécois s’ils avaient été imposés avec les paramètres
fiscaux de 1997, les chercheurs se sont inspirés d’une
étude de 2014 du directeur parlementaire du budget
(DPB) du gouvernement fédéral. Ils ont comparé les
CDPQ Infra: la moitié
d’une bonne nouvelle4
Tous les intervenants en conviennent: la situation
du transport en commun au Québec, et en parti-
culier dans la région métropolitaine, pose problème
À
l’occasion des consultations de la Commission
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des
ressources naturelles (CAPERN) sur l’accaparement
ACCAPAREMENT DES TERRES/LA SUITE À LA PAGE2
Le dynamisme qu’insuffle le Cégep à la région
repose principalement sur la présence de jeunes
qui, tout en menant à terme leurs projets d’études,
contribuent directement à la vitalité des collectivités
LE CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Un actif pour l’économie
et le développement régional
L’étude de l’IRÉC sur le Cégep de Gaspé et des Îles (CGÎM)1 permet d’analyser le rôle
des cégeps en région éloignée pour l’économie et le développement territorial. «Le
Cégep accomplit, en plus de sa mission institutionnelle, des fonctions de développe-
ment économique et territorial et contribue à la rétention des jeunes et à l’attraction
des diplômés dans la région»,ont expliqué François L’Italien, chercheur pour l’IRÉC
et Jean-François Spain, enseignant au Cégep.
Photo: Cécilie Joncas
locales et de la région. Il s’agit là d’un impact écono-
mique de longue portée qui est de nature qualita-
tive», ont poursuivi les auteurs de l’étude.
CÉGEP DE LA GASPÉSIE/LA SUITE À LA PAGE4
ACCAPAREMENT DES TERRES
Reprendre l’initiative3

RÉGIME FISCAL QUÉBÉCOIS/ LA SUITE DE LA
PAGE1
2
ACCAPAREMENT DES TERRES/LA SUITE DE LA
PAGE1
régimes d’imposition de 1997 et 2013 et ont
onclu à un impact négatif de 8,4G$.
Impacts des modifications
les plus importantes
Par la suite, ils ont analysé les impacts
fiscaux des modifications les plus importantes:
n La première modification porte sur
les paliers d’imposition. En 1997, le régime
fiscal incluait cinq paliers d’imposition et
deux surtaxes, alors qu’en 2013 les surtaxes
été éliminées et les paliers ont été diminués
à 4. Les modifications ont aussi porté sur les
seuils et les taux d’imposition. Les impacts
budgétaires nets ont été de 6,0G$ en revenus
supplémentaires pour le gouvernement du
Québec. Ces modifications ont surtout profité
aux ménages ayant des revenus supérieurs.
n Le crédit d’impôt pour le soutien
aux enfants a remplacé au milieu des
années2000, diverses mesures dont l’allo-
cation familiale et la réduction des impôts.
Les impacts budgétaires ont fait diminuer
les revenus de 1,2G$ et les transferts vers
les ménages de 1,6G$. L’impact net a été de
457M$ en revenus supplémentaires pour le
gouvernement du Québec. Cette mesure a été
bénéfique pour les ménages sous la médiane.
n Le crédit d’impôt à la solidarité est venu
remplacer à la fin des années2000 le CI à la
TVQ, le remboursement d’impôt foncier et le
CI aux villages nordiques. L’impact net a été
de 1G$ en revenus supplémentaires pour le
gouvernement du Québec. Ce crédit est favo-
rable aux ménages de revenus inférieurs.
n Finalement, la taxe de vente du Québec
est passée de 7,5% à 9,5% entre 1997 et
2013, puis harmonisée à la TPS au taux de
9,975%. L’impact net a été une diminution
de revenus de 3,6G$ pour le gouvernement
du Québec. La diminution des taxes de vente
aux taux en vigueur en 1997 est profitable
aux ménages des revenus inférieurs.
En conclusion
Cette étude a été réalisée en partie avec le
soutien de la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). «Au bout du compte, les impôts sont
plus bas qu’il y a 15 ans et la grande majo-
rité de la population en paie les frais par des
services moins accessibles et des tarifications
accrues», a conclu Louise Chabot, présidente
de la CSQ. z
aggravé par l’incertitude quasi perpétuelle
quant à la participation financière gouverne-
mentale à long terme. Le vaste bassin d’actifs
que constitue l’épargne québécoise pour la
retraite représente l’une des principales pistes
de solutions pour le financement de la recon-
version des infrastructures au Québec vers une
économie plus durable.
Des avantages
La mise sur pied de CDPQ Infra dans
l’écosystème financier québécois représente le
développement d’une expertise québécoise dans
la captation de la plus-value foncière (CPVF),
c’est-à-dire à de nouvelles modalités de déve-
loppement d’infrastructure liant étroitement
les expertises de la finance, de l’immobilier, de
l’urbanisme, de la gestion du territoire et du
transport dans une perspective plus durable.
Un autre avantage serait d’apporter plus de
rigueur et de discipline dans les processus de
priorisation et de réalisation de projets structu-
rants de mobilité durable.
Des écueils à éviter
Il faut d’abord que le gouvernement et la
Caisse tiennent compte de divers enjeux: le
problème de gouvernance déficiente du trans-
port dans la région métropolitaine, le caractère
de service public des projets d’infrastructure,
des schémas d’aménagement édictés par les
autorités municipales et finalement du partage
des risques et de propriété publique des nouvel-
les infrastructures mises en place.
Le gouvernement doit aussi accorder aux
municipalités un nouvel outil de finance-
ment inspiré du modèle de financement par
de nouvelles taxes foncières «Tax Increment
Financing (TIF)» permettant de capter les
revenus futurs de la taxe foncière pour mobi-
liser les ressources locales dans les investisse-
ments d’infrastructure. Ce nouvel outil serait
nécessaire pour donner aux municipalités la
capacité financière de participer au montage
financier des projets.
Cette initiative de CDPQ Infra ne doit pas
servir de prétexte au gouvernement pour ne
pas agir à la hauteur des défis auxquels nous
faisons face dans les domaines du transport
et de la lutte aux changements climatiques.
Le gouvernement doit s’engager à hausser sa
contribution et à exiger du fédéral une action
similaire. Il doit proposer aux Québécois un
plan audacieux de transition vers une mobilité
durable. z
des terres au Québec, l’IRÉC a présenté un
mémoire demandant au gouvernement du Qué-
bec de renforcer la vocation et le contrôle du
domaine agricole. «L’accaparement des terres
ne peut être traité comme un phénomène éco-
nomique parmi d’autres, car il constitue une
remise en cause radicale des grands consensus
qui ont présidé à l’élaboration des politiques
agricoles au Québec. Or, les résultats de l’agri-
culture de propriétaire exploitant au Québec,
s’ils sont évidemment perfectibles, ne laissent
voir aucune faiblesse structurelle. Le gouverne-
ment du Québec doit faire preuve d’initiative en
développant des outils institutionnels nouveaux
qui permettront de limiter l’agriculture de capi-
taux», ont déclaré François L’Italien et Robert
Laplante, respectivement chercheur et directeur
général de l’IRÉC.
L’IRÉC a fait valoir que les dispositions
législatives et réglementaires qui encadrent
le domaine et les pratiques agricoles ont été
élaborées en fonction de choix de société
privilégiant l’agriculture familiale. C’est le cas
de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAQ) et de la Loi sur
l’acquisition des terres agricoles par des non-
résidents (LATANR), qui visait à décourager les
investisseurs étrangers d’acheter de grandes
superficies de terres. Cette dernière ne peut
faire face à cette dynamique lorsqu’elle est pilo-
tée par des investisseurs québécois.
Se donner les moyens d’agir
Les auteurs ont conclu en demandant au
gouvernement de développer des outils institu-
tionnels nouveaux qui permettront de limiter
l’agriculture de capitaux et de soutenir le déve-
loppement des fermes familiales. «La création
d’une Société d’aménagement et de développe-
ment agricole du Québec (SADAQ), disent-ils,
pourrait constituer le cœur de cette stratégie
de soutien. La SADAQ, qui a fait l’objet d’un
rapport de recherche publié par l’IRÉC en 2012,
aurait le mandat d’observer les transactions
foncières sur le territoire et celui d’intervenir
sporadiquement, mais stratégiquement dans
le marché foncier. Elle donnerait aux commu-
nautés agricoles régionales un levier supplé-
mentaire pour maîtriser leur développement et
donner à l’agriculture de métier les moyens de
se redéployer dans la nouvelle donne définie
par les pressions exercées en faveur d’une
agriculture de capitaux». z
CDPQ INFRA/LA SUITE DE LA PAGE1
2. BÉLANGER, Jules et Oscar CALDERON, Analyse des
modifications au régime fiscal québécois des parti-
culiers. Impacts sur les recettes du gouvernement
du Québec et sur la distribution des revenus de
1997 à 2013, rapport de recherche de l’IRÉC, mars 2015,
55 p.
3. L’ITALIEN, François et Robert LAPLANTE, Repren-
dre l’initiative, mémoire présenté à la Commission de
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources
naturelles (CAPERN) à l’occasion d’un mandat d’initiative
sur l’accaparement des terres agricoles, 16 mars 2015, 21 p.
4. BOURQUE, Gilles et Michel BEAULÉ, CDPQ Infra: la
moitié d’une bonne nouvelle? note d’intervention de
l’IRÉC no41, avril 2015, 7 p.

1. L’intervention de Robert Laplante a fait l’objet d’un arti-
cle dans l’édition du 12 mars 2015 du journal Le Devoir
[http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434117/un-
train-peut-en-cacher-un-autre]. Il est également possible
de l’écouter dans son intégralité sur le site de l’IRÉC dans
la section Clip audio [http://www.irec.net/index.jsp?p=58].
DÉBAT-MIDI SUR LE MODÈLE QUÉBÉCOIS ET LE GOUVERNEMENT COUILLARD
Un train peut en cacher un autre
Un débat s’est tenu à l’UQAM le 27 février 2015 afin d’outiller les principaux acteurs de la société civile dans la
conjoncture où le gouvernement Couillard s’en prend de manière systématique au modèle québécois. Une lecture
commune des actions gouvernementales s’est dégagée: les mesures d’austérité ne sont pas un simple exercice bud-
gétaire, mais bien une attaque contre l’État social québécois qui s’est construit depuis 50 ans. C’est ce qui a fait dire
à Robert Laplante de l’IRÉC «qu’un train peut en cacher un autre». La discussion qui a suivi et la synthèse de l’édi-
torialiste Josée Boileau du journal Le Devoir ont montré qu’il faut renouveler le projet social-démocrate et trouver
des relais politiques.
Gérald Larose a com-
mencé son exposé
par un constat. «Il y a 18
ans, dit-il, la société civile
était convoquée à un Som-
met dans le cadre d’une
opération sur le déficit
zéro. Aujourd’hui, nous
assistons à la liquidation
de l’État. Il n’est plus
question des compromis
avec la société civile».
Après avoir fait un
rappel historique sur la
construction du modèle
québécois caractérisé
par ce qu’il appelle la
«codécision» avec les
partenaires du gouver-
nement, le conférencier a
comparé l’atteinte du défi-
cit zéro réalisée par le gouvernement de Lucien
Bouchard et celle qui est visée par le gouver-
nement Coullard. Il a rappelé les sommets et
les consultations qui ont permis à la société
civile d’obtenir des compromis issus de cette
grande négociation sociale comme la création
d’un réseau de garderies, la création des cen-
tres locaux de développement (CLD), l’équité
salariale, un fonds de développement de 250
millions de dollars, le passage de la semaine
de travail normale de 44 à 40 heures et une
orientation favorable à l’économie sociale.
«Avec le gouvernement Charest, ajoute-
t-il, cela a été cinq lois baillons pour sortir la
société civile du jeu et avec le gouvernement
Couillard, ce sont les compressions dans la
plus grande opacité qui vise à diminuer les
capacités de l’État et à retourner ses missions
dans le marché. Notre tâche sera de restaurer
les capacités de l’État à les remplir».
La dénationalisation
RobertLaplante1, directeur général de l’Ins-
titut de recherche en économie contemporaine
(IRÉC), a affirmé que «la crise actuelle est une
crise fabriquée. Nous assistons à une reconfi-
guration majeure des moyens dont dispose le
Québec. Nous avons un problème de revenus.
Nous envoyons 50 milliards $ à Ottawa. Les
Québécois pensent que l’arbitrage ultime est
à Québec. C’est faux: Québec gouverne avec
les moyens que le Canada lui laisse». L’éco-
nomiste a rappelé qu’Ottawa payait 50% de la
facture au début de l’assurance hospitalisation
contre seulement 15% des dépenses en santé
aujourd’hui. Selon des études de l’IRÉC, les
transferts fédéraux ont fondu de 6,6 milliards $
par an de 2009 à 2013.
«Québec s’en prend à sa population au lieu
de lutter contre Ottawa, poursuit-il. Le consen-
tement à la minorisation est présenté comme
un modèle de développement. À Ottawa, c’est la
version dure du néolibéralisme qui prédomine.
L’État fédéral a permuté: il est devenu un
pétroétat».
Robert Laplante estime que le gouverne-
ment Couillard s’inspire de la «stratégie du
choc» qui vise à agir sur tous les fronts avec
brutalité, à rendre opaques les restructurations
en cours, à diffuser un discours alarmiste sur
la dette en raisonnant sur la
dette brute et à faire diversion
en suscitant des débats sur
d’autres sujets tels que le nom
du pont Champlain ou les
problèmes de sécurité natio-
nale. «La dénationalisation,
explique-t-il, prend un carac-
tère radical en jouant sur la
symbolique et la mémoire,
en favorisant l’érosion du fait
français, en affaiblissant la
dimension institutionnelle
du Québec, en réduisant la
représentation du Québec à
l’étranger, en détruisant les
infrastructures — il y a plus
de wagons à Lac-Mégantic
qu’avant la tragédie, en
enlevant les outils du dévelop-
pement régional comme les
centres locaux de développement (CLD)».
Les sources d’inspiration
Le professeur émérite de sociologie de
l’UQAM, BenoîtLévesque2, s’est penché sur la
vision qui inspire la politique d’austérité et
les réformes de structure du gouvernement
Couillard. En centrant l’attention sur les
finances publiques de façon comptable, le
premier ministre Couillard veut éviter le débat.
«Nous faisons l’hypothèse, dit Benoît Lévesque,
qu’il refuse d’expliciter sa vision parce que son
projet de réforme soulèverait plus de résistance
que celui d’une politique dite de rigueur».
Les politiques du gouvernement Couillard
s’alimente de deux livres cultes de la droite:
Réinventer le Québec: douze chantiers
à entreprendre de Marcel Boyer et Nathalie
Elgrably-Lévy et The Fourth Revolution:
The Global Race to Reinvent the State.
Dans ce dernier ouvrage — le livre de chevet
du premier ministre — les auteurs estiment
que les États occidentaux actuels sont non per-
formants et doivent s’inspirer de modèles asia-
Robert Laplante, Gérald Larose, Miriam Fahmy, animatrice et Benoit Lévesque lors du débat
midi le 27 février 2015.
Photo: Michel Giroux
2. L’intervention de Benoit Lévesque a fait l’objet d’un arti-
cle dans l’édition du 12 mars 2015 du journal Le Devoir
[http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434119/l-ins-
piration-de-philippe-couillard].

4
Bulletin d’information
de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) à l’intention des Amis
de l’IRÉC/Numéro43
1030, rue Beaubien Est, bureau103
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél. (514) 380-8916/Télécopieur: (514) 380-
8918
secretariat@irec.net/ www.irec.net
Directeur général de l’IRÉC: Robert
Laplante
Responsable du bulletin: André Laplante
(514) 380-8916 poste21
andrelaplante@irec.net
Collaboration: Oscar Calderon, Jules Bélan-
ger
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du
Québec
BULLETIN DE L’
Nouvelles brèves
n Septième Lettre sur le commerce internatio-
nal de l’IRÉC publiée en mars Les femmes, les
oubliées du commerce international.
n Bulletin de la retraite no4 en mars sur le
rôle de la régulation publique dans la restructu-
ration des régimes de retraite du secteur privé.
tiques comme Singapour ou la Chine. Marcel
Boyer propose une analyse proche des auteurs
britanniques. Avec Nathalie Elgrably-Lévy, ils
visent en premier lieu, à réduire la taille de
l’État et à démanteler la fonction publique pour
mettre en place des mécanismes concurrentiels
et des méthodes d’évaluation. En deuxième
lieu, des politiques sectorielles feraient place
au privé dans l’éducation, la santé et l’envi-
ronnement, sans oublier les infrastructures
publiques. En troisième lieu, c’est l’arrimage de
la protection sociale à la performance écono-
mique entre autres avec une taxe généralisée
sur la consommation plutôt que l’impôt sur le
revenu, l’abolition du salaire minimum et une
réforme du régime de travail.
«Ces réformes, dit le sociologue, laissent
voir une vision étriquée du modèle de dévelop-
pement québécois alors qu’une grande partie
des problèmes sociaux sont des problèmes
économiques non résolus ou mal résolus (ex.
santé et environnement)».
Des pistes d’action
Selon Benoît Lévesque, il faut prendre au
sérieux trois grandes questions: 1) comment
démocratiser la démocratie représentative et le
rapport entre la démocratie représentative et
la participation citoyenne; 2) comment penser
des rapports soutenables à long terme entre les
revenus et les dépenses de l’État; et 3) comment
réagir à la concurrence fiscale que posent à
l’État social les pays en émergence, autrement
qu’en s’enlignant sur les critères et les normes
les moins équitables. Les réponses à ces ques-
tions sont nécessaires pour un renouvellement
de la social-démocratie, sans ignorer la ques-
tion nationale, qui traverse aussi bien la société
civile que les partis politiques.
«Le printemps érable a montré que les res-
sorts sociaux sont encore là», analyse de son
côté Gérald Larose. «Il faut sortir du discours
sur l’austérité. Il faut recadrer les faits. Notre
premier travail, c’est d’articuler un minimum
de propositions. David a gagné contre Goliath
parce qu’il a su déplacer le terrain de la lutte»,
soutient Robert Laplante.
Il n’y a pas de relais politiques
«Ce qui m’inquiète, c’est qu’il n’y a pas
de relais politiques», a affirmé Josée Boileau,
rédactrice en chef au journal Le Devoir, qui
concluait le débat. Elle mise sur les syndicats
qui doivent travailler à rebâtir à côté de ce
que le gouvernement démolit comme ils l’ont
fait sous Duplessis. «Mais il faut, conclut-elle,
refaire l’exercice avec les jeunes, car l’énergie
du printemps érable en 2012 n’a pas été récu-
péré. Ils ne se sentent pas écoutés». z
n Huitième Lettre sur le commerce interna-
tional en avril Doctrine Gérin-Lajoie :
Quel bilan pour l’action internationale
du Québec?
n Entrevue de Frédéric Hanin le 18 février 2015.
Voir la vidéo sur le site observatoireretraite.ca à
partir de 1 minute 32
n Entrevue de Nicolas Zorn à Canal Argent le 5
mars sur le Crédit d’impôt relatif aux fonds
de travailleurs: qui en profite?
UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE/LA
SUITE DE LA PAGE3
n Intervention de Robert Laplante le 18 mars au
salon de l’industrie verte nord-américaine Ame-
ricana sur la gestion des matières résiduelles.
n Entrevue à RDI Économie le 24 février 2015
sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.
n Entrevue de Robert Laplante le 25 mars à
Radio Canada radio à Montréal et le 26 à Qué-
bec avant la présentation du budget Leitao.
n Entrevue de Nicolas Zorn, chargé de projet à
l’IRÉC, à Radio Canada radio à Rimouski le 17
avril au sujet du fardeau fiscal des Québécois.
n Lancement le 4 mai du numéro de la Revue
Vie économique sur la transition énergétique.
n Les 22 et 23 avril 2015, deuxième édition
du colloque Gaspésie 21e. François L’Italien
et Robert Laplante sont conférenciers.
n Le 23 avril, lancement à Gaspé d’une étude
sur le Cégep de la Gaspésie et des Îles.
HISTOIRE DU COURTAGE
Phase3
Le projet sur l’histoire du courtage
financier au Québec passe à la phase3
après une campagne de financement qui a
permis de recueillir 125000$. Le travail de
collecte de données donnera lieu notamment
à la publication de deux livres dont le premier
portera sur l’histoire du syndicat financier et
le second sur l’histoire du courtage financier
au Québec. La première phase a permis de
financer le projet et de recueillir les données
de base. La phase2 a été consacrée à la
construction d’un site: [courtage.irec.net] z.
Quant aux retombées quantitatives, le CGÎM
est un acteur économique de première impor-
tance, aussi bien sur le plan de l’emploi que des
effets économiques qu’il génère chaque jour.
«Peu d’acteurs économiques dans la région
peuvent revendiquer le fait de soutenir, par
ses dépenses en salaires, 131 emplois directs
et indirects dans la région, en plus d’induire
une valeur ajoutée de 11M$ au PIB régional et
de générer des revenus fiscaux et parafiscaux
de 2,5M$ pour le gouvernement du Québec,
sans compter les prélèvements à la source déjà
réalisés par lui», ont indiqué François l’Italien
et Jean François Spain.
Le CGÎM s’est engagé au cours des derniè-
res années à développer, conjointement avec
des organisations de sa région, les Centres
collégiaux de transfert de technologie (CCTT).
Il joue ainsi un rôle de premier plan dans la
formation professionnelle associée aux princi-
paux créneaux de développement économique
de la région, soit l’industrie récréotouristique,
le secteur halieutique et la filière éolienne.
Deux propositions
Les auteurs ont proposé d’intensifier la
poursuite du programme de mobilité interré-
gionale des étudiants et la lutte au décrochage.
La première mesure se ferait à un coût fort
raisonnable. Le coût estimé de cette initiative a
été d’environ 900$ par étudiant en 2014 alors
que celui pour les étudiants internationaux a
été de 3300$ par étudiant en 2014. z
1. L’ITALIEN, François et Jean-François SPAIN, Le Cégep
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine: un actif
de premier plan pour l’économie et le développe-
ment régional, rapport de recherche de l’IRÉC, avril
2015, 43 p.
CÉGEP DE LA GASPÉSIE/LA SUITE DE LA PAGE1
1
/
4
100%