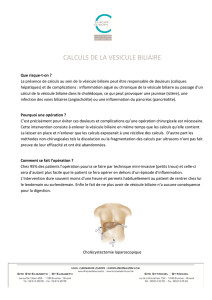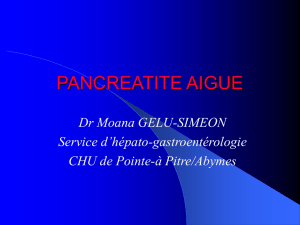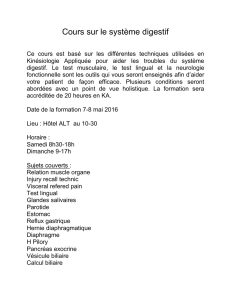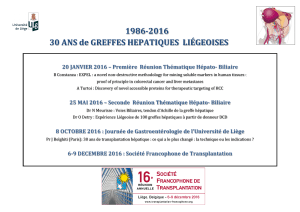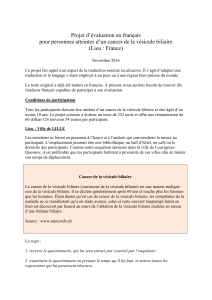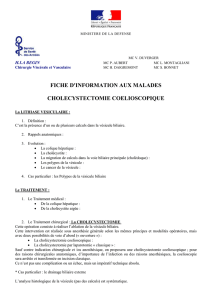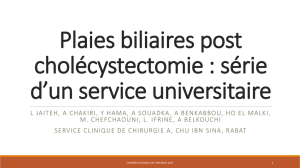PDF - John Libbey Eurotext

Une st
enose
biliaire r
ev
el
ee
par un ict
ere
Observation
Un homme de 70 ans, en excellent
etat g
en
eral (OMS 0),
ayant comme ant
ec
edents une hypertension art
erielle et
un diab
ete de type 2, est venu consulter aux urgences
pour un ict
ere d’apparition r
ecente associ
e
a un prurit.
Le bilan biologique montrait une cholestase (phospha-
tases alcalines
a 6N, GGT
a 4N), une cytolyse (ASAT et
ALAT
a 2N) associ
ee
a une
el
evation de la bilirubine totale
a 312 mmol/L. Le TP
etait
a 96 %. Une
echographie
montrait une dilatation des voies biliaires intrah
epatiques,
la v
esicule biliaire
etait non dilat
ee. Le bilan morpholo-
gique
etait compl
et
e par un scanner thoraco-abdomino-
pelvien inject
e puis une IRM et une bili-IRM qui mettaient
en
evidence une masse de 30 mm de la convergence
biliaire, responsable d’une dilatation biliaire dans les foies
droit et gauche (figure 1).
A noter qu’il n’existait pas
d’envahissement vasculaire ni d’ad
enopathie cœliaque ou
inter-aortico-cave. L’albumin
emie est normale, l’ACE
a3N
et le CA19-9
a 20N.
Commentaires : diagnostic
pr
eop
eratoire, diagnostics diff
erentiels,
preuve histologique
L’ict
ere est le principal mode de r
ev
elation du cholangio-
carcinome hilaire (75 %). La difficult
e majeure de la prise
en charge d’un obstacle de la convergence biliaire est la
quasi-impossibilit
e d’obtenir, dans la majeure partie des
cas, une preuve histologique avant de proposer un
traitement ad
equat. Le diagnostic est souvent pr
esomptif
et repose sur un faisceau d’arguments cliniques et
radiologiques. Il doit ^
etre non invasif et r
ealis
e avant tout
geste de drainage biliaire.
‘‘ La difficult
e majeure de la prise en charge
d’un obstacle de la convergence biliaire
est la quasi-impossibilit
e d’obtenir,
dans la majeure partie des cas, une preuve
histologique avant de proposer un traitement
ad
equat’’
Le scanner montre la dilatation des voies biliaires
intrah
epatiques en amont de l’obstacle, mais il a parfois
quelques difficult
es
a caract
eriser la l
esion. L’atout majeur
du scanner r
eside dans le bilan d’extension local
vasculaire, ganglionnaire, p
eriton
eal et
a distance. Il
permet
egalement le calcul de la volum
etrie h
epatique
avant et apr
es une
eventuelle embolisation portale afin de
v
erifier l’hypertrophie h
epatique souhait
ee. L’IRM montre
de plus en plus fr
equemment la tumeur elle-m^
eme (
ala
diff
erence du scanner). L’int
er^
et majeur des s
equences
bili-IRM va ^
etre de pouvoir faire une analyse s
emiologique
de la st
enose sans opacification. Lorsque celle-ci est
abrupte, circonf
erentielle et irr
eguli
ere, cela plaide en
faveur du diagnostic de cholangiocarcinome. La CPRE
diagnostique n’a plus de place.
‘‘ Il est essentiel d’effectuer le bilan
d’imagerie initial avant la mise en place
de proth
ese biliaire plastique ou m
etallique’’
A stenosis of the biliary convergence
David Fuks
CHU Nord Amiens,
service de chirurgie digestive et m
etabolique ;
Universit
e de Picardie,
Place Victor Pauchet,
80054 Amiens Cedex 01,
France
e-mail : <regimbeau.jean-marc@chu-amiens.fr>
Pour citer cet article : Fuks D. Une st
enose biliaire r
ev
el
ee par un ict
ere. H
epato Gastro 2013 ; 20 : 205-210. doi : 10.1684/hpg.2013.0842
doi: 10.1684/hpg.2013.0842
205
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n83, mars 2013
ossier th
ematiqueD
HEPATO
GASTRO
et Oncologie
digestive
Cholangio-
carcinome
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

M^
eme si, en cas d’obstacle de la convergence biliaire, le
diagnostic de cholangiocarcinome hilaire est
evoqu
een
priorit
e, il faut savoir
evoquer les diagnostics diff
erentiels
et les
eliminer : cancer de la v
esicule biliaire avec extension
hilaire, une compression par ad
enopathies m
etastatiques,
un syndrome de Mirizzi, une cholangite scl
erosante
primitive, une cholangite scl
erosante secondaire, une
pseudo-tumeur inflammatoire et, plus rarement, une
cholangite auto-immune, une biliopathie portale, une
papillomatose biliaire, une cholangite
a
eosinophiles et
une cholangite isch
emique. L’
etude d’Are et al.[1] a
montr
e que sur 171 patients ayant un obstacle de la
convergence consid
er
e comme un cholangiocarcinome,
30
etaient atteints d’une autre maladie, qu’elle ait
et
e
b
enigne (pour 5 % des cas) ou maligne (cholangiocarci-
nome v
esiculaire ou autre cancer). Dans cette s
erie, seules
l’invasion vasculaire et l’atrophie lobaire plaidaient en
faveur du diagnostic de cholangiocarcinome m^
eme si leur
sp
ecificit
e
etait peu
elev
ee.
La preuve du cancer en situation curative est souvent
difficile
a obtenir dans ces cancers caract
eris
es par une
infiltration sous-muqueuse canalaire biliaire car la tumeur
est petite, le plus souvent peu visible, les voies biliaires
sont dilat
ees et la cytologie apr
es brossage peu fiable
(rentabilit
e diagnostique de l’ordre de 30 %). Dans la s
erie
de l’AFC [2], la preuve histologique
etait obtenue avant
r
esection chez 14 % des patients. Les recommandations
des soci
et
es savantes sont claires, l’obtention d’une
preuve histologique ou cytologique doit ^
etre discut
ee au
cas par cas avant chirurgie
a vis
ee curative, et
evit
ee dans
la majorit
e des cas compte tenu du risque d’essaimage
tumoral le long du trajet de ponction percutan
e[3].
‘‘ Le diagnostic histologique de certitude est
accessible en pr
eop
eratoire chez moins
de 20 % des patients’’
Observation
Le dossier du patient
etait discut
eenr
eunion de
concertation pluridisciplinaire avant tout geste invasif.
Malgr
e l’absence de preuve histologique, le premier
diagnostic
evoqu
e
etait un cholangiocarcinome hilaire
Bismuth-Corlette IV (
a gauche le canal biliaire du
segment IV
etait s
epar
e de ceux des segments II et III)
(figure 2). Le scanner thoraco-abdominal inject
e montrait
que le tronc porte et les branches gauches de l’art
ere
h
epatique et de la veine porte n’
etaient pas envahies par
la tumeur. Un PET-Scan ne mettait en
evidence aucune
l
esion secondaire
a distance. Compte tenu du caract
ere
r
es
ecable de la tumeur et de l’absence de contre-
indication (cardiologique et pulmonaire)
a l’intervention,
il
etait envisag
eder
ealiser une r
esection h
epatique droite.
Dans la mesure o
u le futur foie restant (lobe gauche)
repr
esentait 20 % (soit moins de 40 % du volume
h
epatique total), une embolisation portale droite,
pr
ec
ed
ee d’un drainage biliaire par voie endoscopique,
etait d
ecid
ee (figure 3).
‘‘ Le PET-Scan et la cœlioscopie exploratrice
sont recommand
es pour mettre en
evidence une
eventuelle extension
a distance’’
Commentaires : cœlioscopie
exploratrice, drainage biliaire,
embolisation portale
Avant d’envisager le drainage biliaire et/ou l’embolisa-
tion portale, l’exploration cœlioscopique chez les
patients ayant un cancer du hile potentiellement
ABC
Figure 1. TDM en coupes axiales au temps portal (A). IRM en coupe axiale pond
er
ee en T1 avec saturation du signal de la graisse et apr
es injection
de ch
elates de gadolinium au temps tardif (B) et cholangio-IRM 3D (C) en projection MIP. Masse tumorale hilaire hypodense
etendue au segment
IV et au canal h
epatique droit responsable d’une dilatation des voies biliaires intrah
epatiques.
206 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n83, mars 2013
ossier th
ematiqueD
HEPATO
GASTRO
et Oncologie
digestive
Cholangio-
carcinome
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

I II III
A
B
IV
Figure 2. Classification Bismuth-Corlette (dessin Richard Delcenserie). Type I : atteint la convergence sans l’obstruer. Type II : atteint et obstrue la
convergence primaire. Type III : atteint et obstrue les convergences secondaires droite ou gauche. Type IV : atteint les deux convergences
secondaires (
a gauche le canal biliaire du segment IV est s
epar
e de ceux des segments II et III).
AB
Figure 3. A) Clich
es de cholangiographie r
etrograde endoscopique. St
enose tumorale hilaire atteignant la convergence confirm
ee sur le clich
ede
cholangiographie avec pr
esence d’un r
etr
ecissement serr
e et irr
egulier de la voie biliaire principale proximale associ
ee
a une dilatation des voies
biliaires intrah
epatiques gauches. R
ealisation de biopsies de la st
enose et mise en place de proth
eses plastiques
a gauche permettant de drainer
les voies biliaires dilat
ees en amont. La projection du foie droit est sch
ematis
ee par le triangle noir et le ligament rond par le trait jaune.
B) Portographie apr
es la mise en place de proth
ese biliaire en vue d’une embolisation portale droite.
207
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n83, mars 2013
ossier th
ematique Cas cliniqueD
HEPATO
GASTRO
et Oncologie
digestive
Cholangio-
carcinome
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

r
es
ecable permet d’
eviter 20
a 50 % de laparotomies
exploratrices, et permet un acc
es plus rapide
ala
chimioth
erapie dans un contexte palliatif. Elle doit ^
etre
r
eserv
ee en routine aux patients avec cholangiocarci-
nome hilaire de stade T2-T3 [4].
‘‘ L’exploration cœlioscopique
chez les patients ayant un cancer
du hile potentiellement r
es
ecable permet d’
eviter
20
a 50 % de laparotomies exploratrices’’
Le drainage biliaire ne doit plus ^
etre syst
ematique mais
plut^
ot propos
e
a la carte. Il existe un consensus pour
consid
erer qu’un drainage biliaire est n
ecessaire dans trois
circonstances :
1) lorsque le futur foie restant repr
esente moins de 40 %
du volume h
epatique total et qu’une embolisation portale
est envisag
ee ;
2) en pr
esence d’une angiocholite ;
3) s’il existe une d
enutrition, une insuffisance r
enale ou
une hypoalbumin
emie.
Si un drainage est r
ealis
e, il peut, selon l’expertise locale,
^
etre indiff
eremment endoscopique ou percutan
e[2].Le
drainage endoscopique est plus adapt
e aux st
enoses
basses et peut ^
etre r
ealis
e en une seule s
eance, mais il
comporte un risque plus important de sepsis qui, pour
certains, le rend peu adapt
e dans une perspective
curative. Le drainage percutan
en
ecessite plusieurs
s
eances mais est associ
e
a un risque moindre d’angio-
cholite pr
ecoce. N
eanmoins, il existe un risque d’essai-
mage tumoral sur le trajet du drain. M^
eme si elle ne
compromet pas toujours la r
ealisation secondaire d’un
geste d’ex
er
ese, la mise en place de proth
eses m
etalliques
non couvertes doit formellement ^
etre
evit
ee tant que
l’irr
es
ecabilit
e n’a pas
et
e affirm
ee. Un drainage biliaire
unilat
eral, qui doit porter sur le futur foie restant, permet,
chez la majorit
e des patients, de r
eduire la concentration
de bilirubine et est pr
ef
erable,
a la fois dans des mod
eles
exp
erimentaux et cliniques,
a un drainage bilat
eral. Il
semblerait que le b
en
efice du drainage biliaire est r
eel
avant h
epatectomie droite alors qu’il est plus discutable
avant h
epatectomie gauche [2].
L’embolisation portale, qui ne doit pas ^
etre syst
ematique
car elle comporte ses propres risques, est habituellement
r
ealis
ee lorsque le futur foie restant repr
esentait moins de
40 % du volume tumoral total. Certains y ont eu en outre
recours de fac¸on plus syst
ematique avant toute ex
er
ese
droite,
etendue ou non.
‘‘ Le drainage biliaire ne doit plus ^
etre
syst
ematique mais plut^
ot propos
e
a la carte’’
Observation
Apr
es drainage biliaire, on note une diminution de la
bilirubine totale qui passe de 400
a76mmol/L. Apr
es
drainage, le CA 19-9 est
a 13N. L’embolisation portale
chez ce patient chez qui une r
esection de type lobectomie
droite (segments IV, V, VI, VII, VIII et I)
etait pr
evue a
concern
e les branches portales droites et celles du
segment IV (figure 4).
AB
Figure 4. L’embolisation portale chez ce patient chez qui une r
esection de type lobectomie droite (segments IV, V, VI, VII, VIII et I)
etait pr
evue
a concern
e les branches portales droites et celles du segment IV. A) Avant embolisation portale : foie total : 1 470 cc ; lobe gauche : 304 cc
(20 %). B) Apr
es embolisation portale : foie total : 1 500 cc ; lobe gauche : 560 cc (37 %) ; gain : 17 % ; poids : 70 kg ; LG/poids : 0,8.
208 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n83, mars 2013
ossier th
ematiqueD
HEPATO
GASTRO
et Oncologie
digestive
Cholangio-
carcinome
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

L’intervention chirurgicale avait lieu 4 semaines apr
es
l’embolisation portale droite (volume du lobe gauche
37 %) et consistait en une lobectomie droite associ
ee
a
une r
esection du segment I et de la voie biliaire principale
(figure 5). Un curage ganglionnaire du p
edicule h
epatique
etait effectu
e. Les pertes sanguines
etaient de 600 mL et
le patient n’
etait pas transfus
e.
Commentaires : strat
egie chirurgicale,
type de gestes, antibioth
erapie
Il existe actuellement des arguments pour proposer,
lorsqu’elle est possible, une r
esection h
epatique droite
pour des raisons :
–techniques (h
epatectomie droite plus facile que gau-
che, reconstruction de la veine porte gauche plus facile,
r
esection du segment I plus facile apr
es h
epatectomie
droite que gauche, embolisation portale droite facile,
longueur anatomiquement plus grande du canal
h
epatique gauche) ;
–carcinologiques (branche de l’art
ere h
epatique
a
distance de la voie biliaire principale
a l’inverse de la
branche droite, plafond et plancher de la convergence
r
es
equ
es lors d’une h
epatectomie droite
etendue au
segment IV, principe de la r
esection carcinologique des
tumeurs du hile plus facile, longueur anatomiquement
plus grande du canal h
epatique gauche).
Lorsque les deux gestes sont possibles, la r
esection gauche
pr
ef
erentielle peut ^
etre argument
ee par l’absence de
n
ecessit
e d’un drainage biliaire et d’une embolisation
portale pr
eop
eratoire, simplifiant la prise en charge des
patients (sauf pour les cas avec extension au secteur
param
edian droit).
La r
esection du segment I est recommand
ee car ses
canaux biliaires sont envahis dans pr
es de 90 % des cas en
raison de ses rapports avec le hile. Il est n
ecessaire de le
r
es
equer
egalement, le plus souvent pour des raisons de
drainage biliaire. La survie
a 5 ans des patients ayant eu
une r
esection du segment 1
etait de 46 % dans la s
erie
r
etrospective de Sugiura et al.versus 12 % en l’absence
d’une telle r
esection.
Enfin, compte tenu de la dur
ee d’intervention (li
ee
ala
complexit
e du geste chirurgical) et du drainage biliaire
pr
eop
eratoire, il est le plus souvent n
ecessaire de d
ebuter
une antibioth
erapie
a large spectre, apr
es avoir r
ealis
e des
pr
el
evements bact
eriologiques de la bile (voie biliaire
principale, v
esicule biliaire).
‘‘ La r
esection carcinologique d’une tumeur
du hile comprend la voie biliaire principale
et la convergence biliaire, une h
epatectomie
du c^
ot
e atteint par la tumeur et un curage
ganglionnaire locor
egional’’
Observation
Le patient
etait hospitalis
eenr
eanimation pendant dans
les 4 premiers jours postop
eratoires. Les suites
etaient
marqu
ees par une fistule biliaire, survenant au 3
e
jour
postop
eratoire et qui s’est tarie au bout de 23 jours, ainsi
qu’une pneumopathie basale droite. Le patient quittait le
service au 28
e
jour postop
eratoire.
‘‘ Les suites op
eratoires n
ecessitent chez
pr
es de 30 % des patients un geste invasif
radiologique ou endoscopique’’
Commentaires : morbi-mortalit
e
Apr
es h
epatectomie majeure pour cholangiocarcinome
hilaire, la mortalit
e globale est de 10 % et la morbidit
ede
l’ordre de 60 %. Dans une
etude prospective r
ealis
ee en
2008 dans le cadre du rapport de l’AFC, la morbidit
e
etait
de 72 % ; la fistule biliaire et le sepsis repr
esentaient la
moiti
e des complications postop
eratoires [5]. Vingt pour
cent des patients ayant une complication n
ecessitaient un
geste (r
eintervention ou drainage) sous anesth
esie
Figure 5. Photo perop
eratoire apr
es lobectomie droite, curage du
p
edicule h
epatique, r
esection en bloc de la veine porte pour
cholangiocarcinome hilaire « Neuhaus concept ». La continuit
e
biliaire est assur
ee par une anastomose biliodigestive. De la bile coule
par les canaux biliaires des segments II et III.
209
HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive
vol. 20 n83, mars 2013
ossier th
ematique Cas cliniqueD
HEPATO
GASTRO
et Oncologie
digestive
Cholangio-
carcinome
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.
 6
6
1
/
6
100%