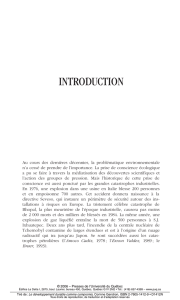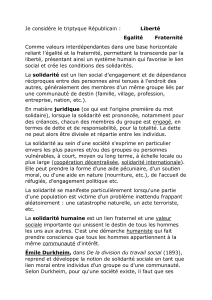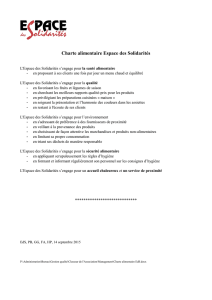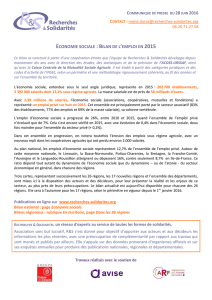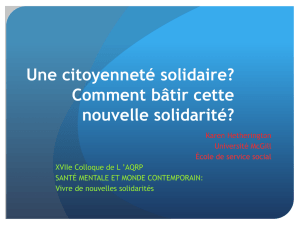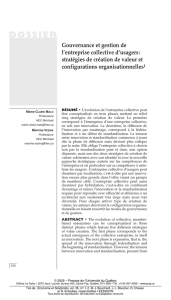L`invention de l`utilité sociale des associations en France

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
DOSSIER
7
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M. J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
RÉSUMÉ • La notion d’utilité sociale est de plus en plus
utilisée en France depuis les années 1990 pour carac-
tériser l’économie sociale et lui attribuer une identité
distinctive. Mais le flou des conceptions invite à revenir
sur l’histoire récente de cette convention sociopolitique
émergente et non stabilisée. En s’appuyant sur une série
de travaux récents, une grille des dimensions et des
critères en présence est proposée, ainsi que des indi-
cations sur les méthodes d’évaluation envisageables.
ABSTRACT • Since the nineties, the notion of social
utility is increasingly used in France to characterize
the social economy sector. But this notion is still fuzzy,
which invites to come back to the contemporary history
of its social and political construction as an emergent
convention. A possible evaluative framework is put
forward, based on a series of recent research works.
RESUMEN • La noción de utilidad social es cada
vez más utilizada en Francia desde la década de 1990
para caracterizar la economía social y atribuirle una
identidad distintiva. Sin embargo la imprecisión de las
concepciones invita a volver sobre la historia reciente de
esta convención socio-política emergente y no estabili-
zada. Apoyándose sobre una serie de trabajos recientes,
el autor propone una grilla de dimensiones y criterios
presentes, así como indicaciones respecto a los métodos
de evaluación considerados.
— • —
L’invention de l’utilité sociale
des associations en France :
à la recherche de conventions,
de régulations, de critères
et de méthodes d’évaluation
Jean Gadrey
Professeur d’économie
Faculté des sciences
économiques et sociales
Université de Lille I (France)

8 Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
INTRODUCTION
Ce texte prend appui sur une synthèse (Gadrey, 2004) d’un très ambitieux
programme qui a permis de financer une trentaine de recherches dans toutes
les régions françaises en 2002 et 2003. L’utilité sociale n’était que l’un des
thèmes couverts par ces travaux. Mon objectif est ici de prendre du recul par
rapport aux justifications des acteurs de l’économie sociale, parfois utilisées
telles quelles comme base d’analyse par les chercheurs. La contextualisation
de l’utilité sociale des associations est un moment indispensable pour mener
une analyse pertinente et peut-être plus efficace pour l’action (associative ou
publique).
Des questions analogues sont à l’ordre du jour au Québec. Elles s’y
expriment souvent en d’autres termes, notamment celui de rentabilité sociale.
Mais il me semble que le débat sur la contextualisation de l’utilité sociale, sur son
caractère de construction sociale et de convention sociopolitique, est pertinent
dans nos deux pays, et sans doute au-delà.
UNE PREMIÈRE CONTEXTUALISATION :
UNE HISTOIRE RÉCENTE DES DÉBATS PUBLICS
SUR LA NOTION D’UTILITÉ SOCIALE EN FRANCE
Une histoire de régulation de la concurrence
L’histoire des débats publics sur cette notion1 remonte, en France, aux
années 1970, où, pour la première fois, dans le cadre du droit fiscal, un arrêt
du Conseil d’État de 1973 a considéré qu’une association ne pouvait pas être
exonérée des impôts commerciaux que paient les entreprises lucratives, à
partir des deux seules conditions qui suffisaient antérieurement, à savoir la
non-lucrativité et la gestion désintéressée. Il fallait qu’elle apporte en plus
la preuve d’une contribution particulière, une contribution que le marché n’était
pas à même de fournir. Dès ce premier épisode, c’est dans le rapport aux solu-
tions marchandes lucratives, et pour pouvoir bénéficier de certains avantages
fiscaux ou financiers, que l’idée d’utilité sociale a émergé. De toute évidence, on
ne parlerait pas autant en France d’utilité sociale des associations s’il ne fallait
pas réguler les rapports entre l’associatif et le secteur privé lucratif et maintenir
un certain « équilibre » entre leurs développements respectifs, avec comme
impératif surplombant, du point de vue de l’État, une notion de « concurrence
loyale » qui tend à l’emporter sur tout autre argument de justice2.
Au cours des années 1980 et au début des années 1990, la question est
revenue à diverses reprises sur le tapis, mais sans avancée institutionnelle. Les
débats les plus intenses ont eu lieu dans la deuxième moitié des années 1990,
avec en particulier, en 1995, un avis du Conseil national de la vie associative

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005 9
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
(CNVA) proposant aux pouvoirs publics une liste de 10 critères d’utilité sociale,
en vue d’une reconnaissance officielle de certaines associations par un label
d’utilité sociale. Les années suivantes ont été marquées par un processus très
impressionnant de consultations régionales et nationales dont rend compte
notamment le rapport d’Alain Lipietz, remis en 20003, et, surtout, sur le plan des
décisions politiques, par la nouvelle instruction fiscale de 1998 visant à mettre
de l’ordre, toujours dans une optique de régulation de la concurrence entre
l’économie sociale et le secteur privé lucratif. Cette instruction précise que, en
cas de concurrence, les exonérations fiscales des associations ne sont justifiées
que si l’association produit de l’utilité sociale, ce que l’administration fiscale est
chargée de juger en tenant compte de quelques critères assez généraux, dont
les trois principaux sont les suivants :
1. L’activité satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché,
ou qui l’est de façon insatisfaisante ;
2. L’activité a pour public des personnes en situation économique ou
sociale difficile, comme par exemple des chômeurs et des personnes
handicapées ;
3. Les prix ou tarifs pratiqués permettent un accès plus large du public
aux services, notamment par le biais de tarifs socialement modulés.
Les conventions et la régulation : brèves précisions
sur le cadre théorique de mon interprétation
Ce qui apparaît à l’examen des débats menés depuis une bonne vingtaine
d’années sur le thème de l’utilité sociale des associations, c’est le caractère
historiquement contingent, ambigu, voire subjectif de la notion d’utilité sociale
telle qu’elle est actuellement sollicitée. La tentation du chercheur rigoureux
pourrait alors être la suivante : efforçons-nous, par l’observation et par l’ana-
lyse de réduire le flou et d’aboutir enfin à une définition « claire », pouvant être
objectivée, et sur laquelle il serait alors facile de s’entendre.
Si telle est la tentation, alors on peut rejoindre le diagnostic des chercheurs
nantais précédemment cités (Clergeau et al., 2003) : c’est une voie sans issue.
Ce qui est recherché n’est pas un accord sur une définition et sur des critères
exempts d’ambiguïté, définis par tel ou tel chercheur « rigoureux ». C’est un
accord politique sur une notion générale, du même ordre par exemple que la
notion d’intérêt général, qui a été et qui reste, en dépit du flou qui la caractérise,
« l’épine dorsale du droit public français » (selon les termes du juriste Georges
Vedel). De même, si la notion d’utilité sociale finit par s’imposer pour réguler
une partie de la vie associative, elle sera, elle aussi, flexible et floue, ce qui ne
l’empêchera pas, si elle se consolide dans les esprits et dans les textes, d’être
un point d’appui robuste et bien « réel » pour de multiples décisions juridiques
ou fiscales, voire un repère général pour la gestion de certaines associations. Et

10 Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
c’est même dans sa flexibilité que résidera une partie de sa force, en l’occurrence
sa capacité d’adaptation à des secteurs associatifs dont l’utilité sociale semble
bien ne pas reposer sur les mêmes critères.
Ce genre de notion est une convention sociopolitique4, au sens de la
socioéconomie des conventions, qui désigne en France un courant de recherches
qui met l’accent sur le rôle des règles, des normes sociales et des systèmes de
valeurs dans les pratiques économiques (Postel, 2003). Une bonne partie de ces
règles et normes sont implicites, elles semblent aller de soi, parce qu’elles ont
intégré antérieurement les « cadres cognitifs » des acteurs. Elles s’appuient le
plus souvent sur des considérations de justice, sur des visions plus ou moins
partagées d’une économie et d’une société souhaitables. Dans mon analyse, la
référence à des conventions sociopolitiques est complétée par certains outils
empruntés à une autre grande école économique hétérodoxe française, qui est
l’école de la régulation, dont l’intérêt est qu’elle nous aide à faire de l’histoire
économique et sociale en inscrivant l’action économique dans ses grands cadres
institutionnels. Ces deux approches sont deux outils précieux de contextuali-
sation des notions et des actions, la première permettant de repérer la diversité
des registres d’action et de justifications, donc d’évaluation, la seconde facilitant
la contextualisation historique.
L’invention de l’utilité sociale
comme convention et comme outil de régulation
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’utilité sociale des associations
est, en France, une convention nationale qui se cherche encore, et dont on
ignore si elle se consolidera durablement, mais qui a déjà pour elle des textes
réglementaires, et qui commence donc à être un outil de régulation, même si
le grand projet des années 1995 à 2000 de création d’un label national d’utilité
sociale n’a pas abouti (Lipietz, 2001). L’enjeu de cette convention consiste, pour
une partie au moins de l’économie sociale, mais aussi pour l’État, à marquer un
territoire concurrentiel, en revendiquant des régulations spécifiques, notam-
ment fiscales (mais aussi, au cours des dernières années, des régulations rela-
tives à la possibilité de recourir à des « emplois aidés »). Or, pour marquer ce
territoire, c’est un fait politique que la non-lucrativité et la gestion désintéressée
ne suffisent plus.
D’où l’invention de l’utilité sociale comme convention émergente pouvant
justifier de nouvelles régulations. La convention est la suivante : si une asso-
ciation est effectivement en concurrence, pour le type de service qu’elle rend,
avec une ou des entreprises privées lucratives, la seule justification que l’on
puisse trouver pour lui attribuer certains avantages sans remettre en cause la
« loyauté de la concurrence » réside dans l’existence constatable de contributions
à l’intérêt général que ne fournissent pas, ou que fournissent moins bien, les
entreprises privées.

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005 11
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Parler d’invention de l’utilité sociale ne signifie pas qu’il n’y avait pas
d’utilité sociale avant cette invention. Ce qui est nouveau, c’est le recours à cette
notion comme argument central de l’identité revendiquée. Cette convention
est du même type que celle qui a marqué, en Europe et en Amérique du Nord,
l’invention de la « convention de service universel » dans un contexte de déré-
gulation et de privatisation de nombreux services publics. Dans les deux cas,
c’est la notion d’intérêt général qui a fourni le cadre de pensée initial, en étant
en quelque sorte « divisée en deux » en fonction de son objet : la convention de
service universel pour les services publics, la convention d’utilité sociale pour
l’économie sociale et solidaire (en France).
UNE DEUXIÈME CONTEXTUALISATION :
LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES CONCERNÉES
La deuxième contextualisation découle assez simplement de ce qui précède :
il est clair en effet que la problématique de l’utilité sociale est principalement
destinée à encadrer et réguler non pas l’ensemble des associations (même si,
par la suite, elle devait être appliquée de façon générale), mais essentiellement
celles d’entre elles qui rendent des services personnels à des utilisateurs non membres,
notamment dans le domaine médicosocial, éducatif, social et familial, et qui font payer
ces services dans des proportions diverses (en fonction de l’existence d’autres
ressources, principalement publiques). C’est une problématique qui concerne
assez peu certaines autres associations, par exemple les associations « entre
membres », ce qui, à nouveau, ne signifie pas que ces dernières ne sont pas
socialement utiles...
Mais, pour cette raison entre autres, un espace de controverses est ouvert,
car certaines associations (dont les points de vue sont repris par certains cher-
cheurs) contestent vivement l’obligation où elles se trouveraient de justifier
l’utilité sociale de leur action, ou de devoir passer par un label, alors que la
question n’a pour elles pas de sens ni d’intérêt, ou parce qu’elles estiment que
cette démarche conduit à une dérive soit vers des contrôles publics réduisant la
richesse de leurs missions, soit vers un utilitarisme social plutôt conservateur.
Pour certains acteurs ou chercheurs, cette convention d’utilité sociale serait
même une convention de consolidation des normes de l’ordre établi, une
« béquille de l’économie libérale », et elle ne peut pas convenir à des associations
qui contestent ces normes dominantes.
Ces points de vue sont compréhensibles et, pour certaines associations,
assez légitimes. Leur existence prouve que la convention d’utilité sociale qui
se cherche pourra au mieux être une convention majoritaire, et non pas un
consensus, ce qui est normal et souhaitable pour la dynamique pluraliste de la
vie associative, qui a toujours été un lieu de tensions, souvent créatrices, entre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%