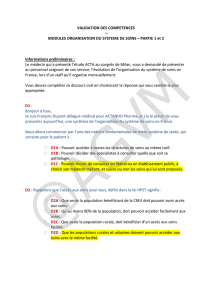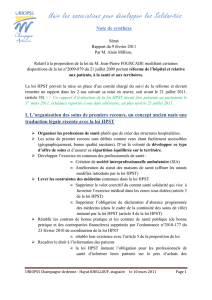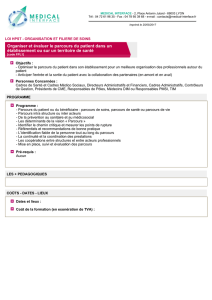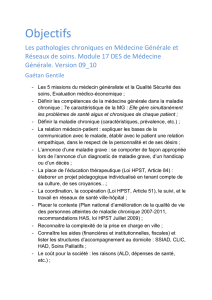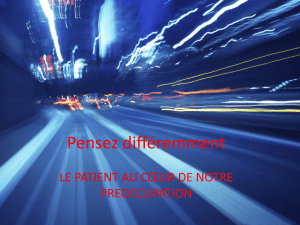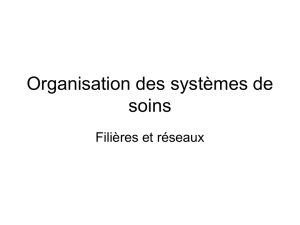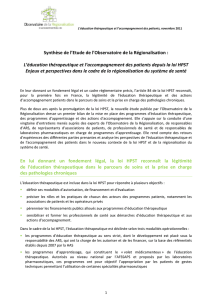La confiance n`est pas qu`un mot

1
La confiance n’est pas qu’un mot
Frédéric Pierru
CERAPS - CNRS
Lorsque j’ai appris que la grande concertation, récemment lancée, sur l’avenir de l’hôpital public
mettait en son cœur la notion de « confiance » et de « contrat de confiance », je dois avouer que j’ai
éprouvé une certaine satisfaction. J’ai alors repensé à la communication que j’avais faite lors du grand
colloque, organisé par le MDHP, qui s’est tenu à la Pitié Salpêtrière alors que les polémiques autour
de la loi HPST n’étaient pas encore retombées, loin s’en faut. Je voudrais en rappeler ici les grandes
lignes avant d’avancer quelques réflexions plus prospectives.
La confiance, pour le sociologue de la santé que je suis, n’est pas un mot-valise ou un slogan. C’est un
concept clé qui reçoit une définition précise et revêt une portée décisive tant sur le plan positif que
normatif. En effet, la confiance est en effet au cœur du professionnalisme en tant que ce dernier est
une modalité d’organisation des activités humaines alternatives au marché et à la bureaucratie (ou la
hiérarchie). Parce que les médecins seuls maîtrisent un corps de savoirs et savoir-faire élaborés et
ésotériques transmis sur le mode du compagnonnage, parce qu’ils travaillent sur des cas singuliers et
des situations, certes à des degrés variables, complexes, en situation d’incertitude, ils bénéficient de
deux « privilèges » professionnels majeurs : le monopole des soins et l’autonomie dans l’exercice de
leur activité quotidienne. L’envers de cette situation est qu’ils doivent bénéficier d’une relative
confiance non seulement de la part de leurs patients – lesquels sont souvent des individus angoissés et
inégalement profanes en matière de connaissances médicales – mais aussi des pouvoirs publics qui
financent les infrastructures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et, plus
fondamentalement encore, l’accès aux services qu’ils dispensent. La confiance consiste en un
mécanisme de réduction du risque et de la complexité qui permet l’action, ici thérapeutique, malgré le
fait que l’information est inévitablement incomplète
1
.
On saisit de suite que la confiance est un phénomène clé pour la relation thérapeutique pour au moins
trois raisons : l’incertitude liée au traitement ; les risques, inégaux, à toute intervention médicale ; la
vulnérabilité de la personne malade ; le déséquilibre d’informations et de connaissances entre le
patient (et celui qui le finance), vulnérable à des degrés divers, et le médecin. D’une façon ou d’une
autre, la personne malade s’en remet à l’expert qu’est le médecin, dont il espère qu’il défendra non ses
intérêts mais celui de son patient. La confiance a, dès lors, une double réalité : cognitive (les
informations tirées de l’expérience des relations thérapeutiques passées) et, indissociablement,
1
Albert Ogien, Louis Quéré (dir.), Les Moments de la confiance. Connaissance, affects et
engagements, Paris, Economica, p. 3. C’est nous qui soulignons.

2
affective. Si elle n’est pas dépourvue de base cognitive ou rationnelle, la confiance implique cependant
un au-delà en forme de pari, autrement dit une disposition à s’engager (ici dans une relation
thérapeutique) sans avoir toutes les informations nécessaires.
J’avais montré, par ailleurs, que la réforme HPST était assez emblématique d’un mouvement
réformateur plus général, en ce sens qu’il ne concerne pas le seul secteur de la santé et la seule France,
à savoir le New Public Management, lequel est un alliage de ces deux formes rivales du
professionnalisme que sont la bureaucratie et le marché. Et c’est la raison pour laquelle les
professionnels avaient vivement réagi à cette réforme. Quels étaient précisément les griefs de ces
derniers ? Rappelons les brièvement, puisqu’ils sont bien connus, surtout en cette enceinte :
- La loi HPST affirmait l’autorité d’un patron - chef d’établissement sur les médecins, dans un
projet de démédicalisation relative de la « gouvernance » hospitalière : ceci était un casus belli
à l’égard des principes d’autorité collégiale et d’autonomie de la profession ;
- La loi HPST renforçait la tutelle sur les établissements avec la transformation des ARH en
ARS, le chef d’établissement n’étant qu’un patron fictif tant que le contrat le liant à l’ARS est
léonin ; l’objectif, plus ou moins avoué, étant d’accélérer le processus de restructuration du
parc hospitalier (fermetures, reconversions, fusions) dans un contexte budgétaire tendu et de
tension sur certaines compétences médicales ;
- La loi HPST banalisait et vaporisait le service public hospitalier, réduisant drastiquement à 14
missions (pouvant être attribuée indistinctement au public et au privé) et sortant, dans le même
mouvement, 80% de l’activité des hôpitaux du champ du service public ; en ce sens elle
mettait la dernière pierre à la dynamique de mise en concurrence qui avait été enclenchée avec
l’adoption de la T2A et le principe de la convergence tarifaire ;
- La loi HPST, avec la transformation de la MEAH et d’autres agences en ANAP, confirmait la
volonté des pouvoirs publics de transférer les techniques de gestion de l’industrie aux
hôpitaux afin de leur faire réaliser des « sauts de performance » et d’exploiter les « gisements
d’efficience » dormant sous l’épaisse couche de bureaucratie professionnelle ; d’ailleurs,
emblématique du moment RGPP, HPST avait ouvert en amont et en aval de nombreux et
juteux marchés aux cabinets de conseil, particulièrement aux plus grands d’entre eux, tant sur
le volet gestion hospitalière que sur le volet ARS ; Finalement, tout se passait comme si
l’activité médicale était une activité comme une autre, banale, pouvant être rationalisée à
l’aide des indicateurs de performance et autre benchmarking…
Je pourrais détailler plus avant, mais le temps m’est compté. L’idée qu’il convient de retenir ici est que
la concurrence et la bureaucratie se renforcent l’une l’autre dans l’optique de « rationaliser » les
pratiques médicales pour obtenir le juste soin au juste coût. La prémisse est évidente : l’on ne peut pas

3
faire confiance aux médecins pour relever ce dernier défi du juste soin au juste coût. Le
professionnalisme serait forcément un corporatisme coûteux et enclin à cacher ses mauvaises
pratiques derrière le paravent de la défense de l’intérêt des malades. La médecine ne peut bénéficier
d’aucun statut d’extra-territorialité. Notons, au passage, que certains représentants des « usagers »
s’étaient à cette occasion rangés du côté des pouvoirs publics au nom de la lutte contre le « pouvoir
mandarinal ». Cette alliance n’était pas anodine : elle témoignait du fait que ce qui était en jeu étaient
bien la confiance et le mandat que la société accordait à la profession médicale. Plus question de
confiance, même pas retenue. L’heure était à la revanche des usagers-consommateurs et des payeurs
sur le corps médical. Il s’agissait bien d’un conflit politique au sens le plus noble du terme qui
brouillait le traditionnel clivage gauche/droite. D’ailleurs, l’on a vu des médecins de gauche et de
droite défiler ensemble dans la rue, aux côtés des syndicats de personnels infirmiers et
administratifs…
La sociologie des professions a montré qu’une bureaucratisation excessive de l’environnement
professionnel – bureaucratisation qui revêt désormais les atours des contrats en cascade, des
indicateurs de performance, etc. – ainsi qu’une déstructuration des collectifs de travail – liée à la
mutualisation des moyens ou encore à la logique des primes individuelles à la performance – ne
suscitaient pas seulement des surcoûts (la confiance peut être un facteur d’économies importantes a dit
l’un des pionniers américains de l’économie de la santé) mais, plus gravement encore, pouvaient
déboucher sur une réduction de la qualité des soins. Le travail important des sociologues Florent
Champy et Nicolas Belorgey ou celui que j’ai dirigé avec le SNPHAR-E ont voulu mettre l’accent sur
les effets pervers potentiels des nouveaux modes de gestion publique en tant que ceux-ci veulent
remettre en cause le statut de nombreuses professions de l’État social, et pas seulement celui de la
médecine (je pense aussi aux chercheurs ou aux enseignants). Il se trouve que des recherches récentes
sur la T2A ou encore des rapports publics sur les fusions hospitalières sont venues confirmer ces
conclusions.
Que déduire de tout cela ?
Certainement pas qu’il convient d’en revenir au « bon vieux temps » temps de la confiance absolue et
inconditionnelle dans les professionnels, ici de la médecine, caractéristique du « paternalisme ». Le
voudrait-on d’ailleurs que l’on ne le pourrait pas. Les mutations économiques, sociales et culturelles
ont irrémédiablement modifié les fondements du professionnalisme. On évoque souvent, à ce titre,
l’avènement de « nouveaux » patients plus informés donc moins dociles et exigeant d’être davantage
associés aux décisions thérapeutiques qui les concernent, et l’avènement, plus incertain, des
« usagers » voulant être eux associés aux choix du système de santé sans son ensemble. La
« démocratie sanitaire » constituerait une des réponses à ses (plus si) « nouvelles » demandes. Ce

4
constat est fondé mais il convient de le nuancer. « Il y a peu de preuves empiriques − conclut une
récente revue de littérature anglo-saxonne sur le sujet − qui valident la thèse selon laquelle la
confiance des patients dans les professionnels de santé s’est érodée ces dernières années, avec un
niveau de confiance dans les cliniciens qui demeure élevé. »
2
La confiance dans les médecins continue
de se situer à des niveaux très élevés, pour 80 à 90% de la population. La diversification ou la pluralité
des sources d’information des patients (Internet, indicateurs de performance, etc.), par ailleurs très
inégale selon les caractéristiques socioculturelles des patients, n’emporte pas une méfiance
grandissante envers les cliniciens. Paradoxalement, l’usage de différentes sources d’informations par
les patients a un impact positif sur la confiance qu’il place dans leur propre praticien.
Davantage convaincant est le constat, tout aussi sociologique que les précédents, que les médecins
peuvent faire un mauvais usage de leur autonomie. C’est ce qu’ont montré notamment les études sur
les très fortes variations de pratique médicale pour une même situation pathologique. Ces variations
peuvent avoir une légitimité en tant qu’adaptation du service à la singularité du patient. Parfois, elles
trouvent leur source dans des mobiles moins légitimes (intérêt financier, défaut de remise à niveau des
connaissances, etc.). Ces variations de pratiques sont dommageable tant sur le plan financier que de la
qualité des soins. La question est dès lors la suivante : les professionnels eux-mêmes peuvent-ils
mettre en place des dispositifs capables de combattre ces mauvais pratiques, préservant ainsi leur
autonomie collective, ou faut-il s’en remettre à un contrôle managérial externe, que ce dernier
s’incarne dans des directeurs d’établissement se rêvant en patrons ou dans des consultants grassement
rémunérés pour implanter des technologies gestionnaires issus du privé ?
Je pense que l’une des réponses a été formulée par un des critiques jadis acerbes des carences de la
régulation professionnelle, à savoir le grand sociologue américain Eliot Freidson. Celui-ci avait fini
par défendre, face aux ravages de la driven-money médicine américaine, ce qu’il avait jadis
pourfendu : l’éthique professionnelle, contrepartie indispensable de la confiance dans les
professionnels. Mais à la seule condition que le professionnalisme se réinvente, qu’il devienne moins
individualiste et plus collectif et institutionnel et qu’il se donne les moyens de répondre aux défis de la
maîtrise des coûts, de la coordination et de la qualité des soins, d’une plus grande attention aux
demandes des patients. Il avait ouvert quelques pistes en ce sens. Je pense que ces réflexions
sociologiques - plaidoyer pro domo - auraient toute leur place dans la salutaire concertation qui s’est
récemment ouverte.
Je vous remercie de votre attention
2
Michael Calnan, Rosemary Rowe, Trust Matters in Healthcare, McGraw Hill, Open University Press,
2008, p. 14.

5
1
/
5
100%