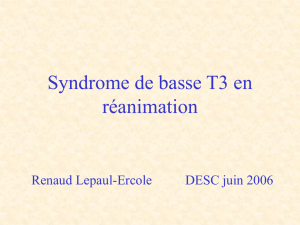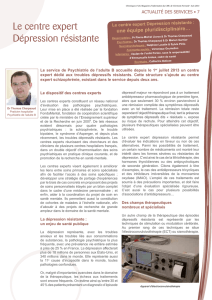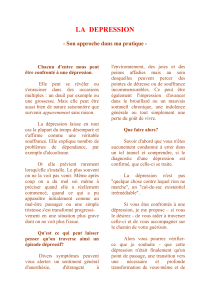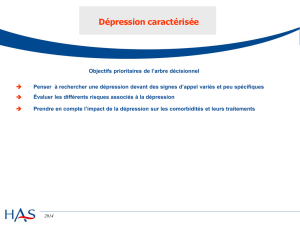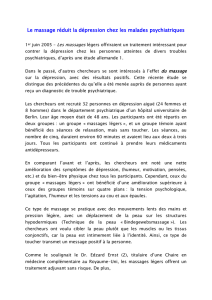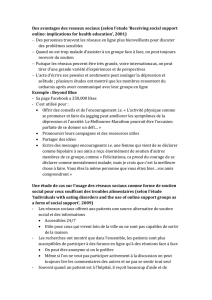Pathologies endocriniennes et troubles

Article de synthèse
RMC-2014 2 1
Pathologies endocriniennes et troubles psychiatriques
Docteur Edith JOTTRAND - Docteur Claude LEMY
Service de médecine Interne
CHU de Charleroi
MOTS CLÉS : endocrinologie, psychiatrie
RÉSUMÉ
I
l existe des interactions complexes entre les hormones et les
neurotransmetteurs. Voilà pourquoi les affections psychiatriques et leur
traitement peuvent parfois avoir d’importantes répercussions endocriniennes et
inversément. Il est donc essentiel d’en tenir compte dans notre pratique clinique
quotidienne.
ARTICLE
I
l existe des interactions complexes entre les hormones et les neurotransmet-
teurs. Voilà pourquoi les affections psychiatriques et leur traitement peuvent
parfois avoir d’importantes répercussions endocriniennes et inversement.
Il est donc essentiel d’en tenir compte dans notre pratique clinique quotidienne.
Pour commencer, nous décrirons les répercussions psychiatriques des affections
endocriniennes. Ensuite, nous aborderons les troubles endocriniens retrouvés
dans les maladies psychiatriques et pour terminer les effets secondaires hormo-
naux des médicaments psychotropes.

Article de synthèse
RMC-2014 2 2
D
e nombreuses affections endocriniennes peuvent se manifester sous la for-
me de syndromes psychiatriques (dépression, anxiété, psychose, …).
Dans l’hyperthyroïdie, 30 à 60% des patients sont déprimés ou anxieux1.
Les épisodes maniaques sont plus rares. Par contre chez les patients âgés, cette
affection peut se manifester sous forme d’une dépression avec léthargie et
apathie ou d’une pseudo-démence. Plusieurs études ont montré que malgré la
normalisation de la fonction thyroïdienne, ces patients continuent à présenter
plus de signes de dépression, d’anxiété, d’hostilité et des troubles du sommeil.
L
es symptômes de l’hypothyroïdie, tels que la fatigue, le sentiment de
dépression, le ralentissement psychomoteur… peuvent parfois mimer ceux
de la dépression1. C’est pourquoi une dysthyroïdie doit être exclue chez tous les
patients déprimés. Dans les formes sévères d’hypothyroïdie, les patients peuvent
parfois présenter un tableau de psychose aigue avec hallucinations, paranoïa, ….
Ce tableau peut être confondu avec celui de l’encéphalite d’Hashimoto qui est un
syndrome neurologique rare (caractérisé par une confusion d’apparition subaigüe
avec une altération du niveau de conscience). Il serait associé à la présence
d’anticorps anti-TPO, bien que cette association reste encore fort controversée.
L
es troubles psychiatriques sont également plus fréquents dans le
syndrome de Cushing2.
Le plus souvent, il s’agit de dépression mais des troubles anxieux, des épisodes
maniaques, de l’irritabilité peuvent également être retrouvés.
B
ien qu’il existe des similitudes avec les symptômes de la dépression
« classique », certaines caractéristiques sont plus spécifiques du syndrome
de Cushing notamment la labilité de l’humeur dépressive au cours du temps et
l’absence de l’anhédonie (l’incapacité à ressentir du plaisir), qui est un critère
diagnostic majeur de la dépression selon la classification DSM IV.
Répercussions psychiatriques des affections
endocriniennes

Article de synthèse
RMC-2014 2 3
U
ne étude récente a montré que des patients opérés d’une maladie de Cus-
hing, il y a plusieurs années, souffrent davantage de troubles psychopatho-
logiques et de troubles de la personnalité que des patients contrôles et que des
patients ayant également été opérés d’un macro-adénome hypophysaire non se-
crétant3.
Ils présentent également plus de troubles cognitifs à long terme que des patients
contrôles4. On pense que ces troubles sont le reflet d’effets irréversibles liés à
l’hypercorticisme.
L
es symptômes du phéochromocytome (palpitations, transpiration,
poussées hypertensives, …) peuvent évoquer de l’anxiété5.
Mais la prévalence de troubles anxieux généralisés est également plus fréquente
dans cette population.
Les patients avec une carence en hormones de croissance auraient une moins
bonne qualité de vie selon plusieurs études6.
L
’hyperprolactinémie peut parfois s’associer à des signes d’anxiété, de
dépression et cette affection peut également se présenter sous la forme d’un
tableau psychotique5. Mais on ne sait pas si ces troubles neuropsychiatriques
sont liés à l’hyperprolactinémie ou à l’hypogonadisme secondaire.
L’insuffisance surrénalienne peut parfois se présenter sous la forme d’une
dépression ou psychose5.
O
n a montré récemment une plus grande prévalence de trouble anxieux chez
les patients avec un hyperaldostéronisme7.
Lors d’un stress aigu, il y a une activation du système nerveux autonome (SNA)
avec libération secondaire de catécholamines et une activation hypothalamo-
hypophysaire augmentant la libération de glucocorticoïdes, prolactine et hormo-
ne de croissance.
L’activation de ces systèmes améliorerait les performances de l’individu face au
danger.
Répercussions endocriniennes d’affections
psychiatriques

Article de synthèse
RMC-2014 2 4
Par son feedback négatif au niveau de l’hypothalamus et de l’hypophyse, le corti-
sol permet un retour à l’homéostasie.
L
e syndrome de stress post traumatique (SSPT) est caractérisé par la
« ré-expérience » de l’évènement traumatisant (sous forme de cauchemars,
de flash back, …), par des « conduites d’évitement » et une activation du SNA
(difficultés d’endormissement, irritabilité, hyper vigilance, trouble de la concentra-
tion, ….).
On pourrait penser que le SSPT est le reflet d’une réponse physiologique
persistante à un évènement traumatique antérieur et serait donc lié à l’échec du
mécanisme d’autorégulation. Dans ce cas, on s’attendrait alors à des taux élevés
de cortisol. Mais ce n’est pas le cas.
P
ar rapport à des patients contrôles et des patients ayant été exposés à la
même situation traumatique, les patients ayant développé un SSPT ont des
taux de cortisol plus bas et des cytokines inflammatoires plus élevées8.
Ces patients ont également une augmentation du nombre de récepteurs aux
glucocorticoïdes et de leur sensibilité. On pense que ces dernières observations
sont des mécanismes compensateurs face à l’hypo-cortisolémie.
Cette carence relative en cortisol pourrait être également le reflet d’une
vulnérabilité à développer un SSPT. En effet, plusieurs études ont montré que les
patients avec un taux faible de cortisol juste après l’évènement traumatique
avaient un plus grand risque de développer un SSPT par rapport aux sujets ayant
un taux normal de cortisol. On pourrait imaginer que chez ces patients, ce taux
de cortisol est insuffisant pour induire un feedback négatif afin d’arrêter la
réponse au stress.
La cortisolémie peut-elle être utilisée comme cible thérapeutique ou préventive ?
P
lusieurs études sont actuellement en cours mais les résultats ne sont pas
encore disponibles.
Les troubles anxieux généralisés augmentent la mortalité cardio-vasculaire.
En effet, l’hypersécrétion secondaire des catécholamines entraine une dysfonc-
tion du SNA avec pour effet une diminution de la variabilité de la fréquence car-
diaque (FC) et une augmentation de la FC et de la tension artérielle.

Article de synthèse
RMC-2014 2 5
L
’anorexie nerveuse se définit par un amaigrissement et des troubles
psychiatriques (caractérisés par une peur irrationnelle de grossir et une
altération de la perception de son corps).
Cette affection va s’accompagner de plusieurs troubles endocriniens9.
E
lle entraine un hypogonadisme hypogonadotrope qui peut causer une
aménorrhée avec de l’ostéoporose secondaire. Mais toutes les femmes de
faible poids n’ont pas une aménorrhée et l’aménorrhée peut persister chez des
femmes malgré le retour à un poids normal. La carence en œstrogène n’est donc
pas le seul facteur causal de l’aménorrhée.
Une des pistes retenue est la leptine, secrétée par l’adipocyte. Parmi ses nom-
breuses fonctions, elle régule la balance énergétique et l’appétit mais également
la fonction reproductive. Chez des souris en jeûne, l’administration de leptine res-
taure un cycle « menstruel » presque normal.
De plus, les patientes anorexiques aménorrhéiques ont des taux de leptine
inférieurs à celle des femmes anorexiques mais sans aménorrhée à poids égal.
C
omme autre trouble hormonal, on observe des taux d’IGF-1 bas lié d’une
part à l’état nutritionnel et d’autre part à une résistance à l’hormone de
croissance.
Une hypercortisolémie est également présente. Elle entraine notamment une
perte osseuse et pourrait jouer un rôle dans le développement de l’anxiété et de
la dépression.
L
es patients déprimés peuvent présenter des perturbations de l’axe
hypothalamo-surrénalien avec une hypercortisolémie secondaire11.
Un « Euthyroid Sick syndrome », caractérisé par une anomalie biologique
thyroïdienne sans traduction clinique, peut également se retrouver chez des
patients avec des troubles psychiatriques12.
La dépression qu’elle soit réactionnelle ou endogène peut entrainer plus
d’incompliance thérapeutique et de sédentarité, et donc, un plus grand risque de
complications micro et macro-vasculaires11.
T
outefois, la dépression elle-même pourrait également avoir un effet délétère
sur le métabolisme glucidique.
En effet, on sait qu’elle entraine de nombreuses modifications biologiques.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%