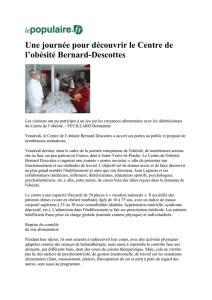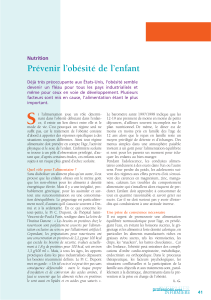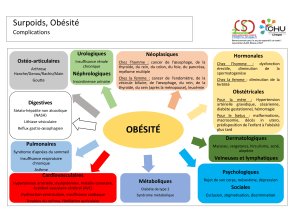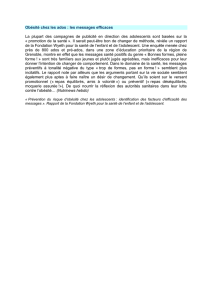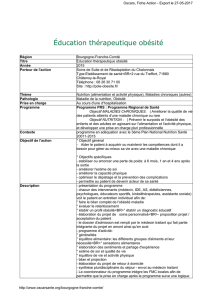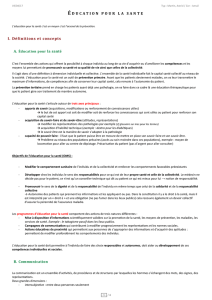Dossier
obésité
Magazine d’information de l’Union Nationale des Mutualités Libres – juin 2007
www.mloz.be

Editeur responsable : Pascal Mertens
Rédacteur en chef : Nicolas de Pape
Pré-press : Luc De Weireld
Ont contribué à ce numéro : Kim Verbruggen, Piet Van Eenooghe, Jan Van Emelen, Olivier Stoop,
Karen Willems.
Traductions : Jenny Vanmaldeghem
Images : Belga
Vos réactions à
ou
Nicolas de Pape
Communication manager
Rue Saint-Hubert 19, 1150 Bruxelles
Sommaire
/EDITORIAL : l’obésité, un problème de poids 3
/« Nous sommes envahis par l’alimentation » 4
/Bientôt des « médecins nutritionnistes » ? 5
/Nutrition et santé : un congrès majeur 6
/Agir dès l’adolescence 8
/Chirurgie : pas pour tous 9
/Médicaments : une offre assez pauvre 10
/Chirurgie : enfin une nomenclature spécifique 11
/Le médecin généraliste est le coordinateur idéal 12
/UE : encore un Livre blanc ? 13
/Obésité et pauvreté 14
/Happy Body : promouvoir un mode de vie sain et dynamique 14
/OMS : les défis de l’obésité 15
/Accompagner plutôt qu’assister : un Guide pratique
signé MLOZ et un Journal à tenir tous les jours 18

3
L’obésité, un problème de poids
n 2007, en Belgique, 7 enfants de moins de 14 ans et
700 adolescents de moins de 18 ans ont subi une inter-
vention de chirurgie bariatrique. Ces chiffres impres-
sionnants, communiqués lors d’une table ronde organisée par
Eetexpert à Louvain, reflètent la triste réalité d’aujourd’hui.
Ces chiffres ont tendance à se maintenir et il est donc impor-
tant d’agir. Que se passe-t-il avec l’obésité en Belgique et dans
les pays voisins ?
Ce numéro de Fax Medica traite de cette problématique et
tente de brosser un tableau de ce qu’il est possible de faire tant
en assurance obligatoire qu’en assurance complémentaire.
Les mutualités ont une responsabilité dans la gestion du bud-
get mais aussi dans la structure sociale des soins de santé. Les
Mutualités Libres l’ont déjà bien compris et ont ainsi entrepris
depuis quelques années des actions en partenariat avec des
prestataires, les autorités publiques ainsi que des structures
de prévention.
L’obésité et l’excès de poids constituent des défis importants
pour la santé publique et le budget de l’assurance maladie.
Les conséquences pour la qualité de vie de nos assurés et pour
les dépenses des soins de santé sont impressionnantes. En
Belgique, on a calculé que l’obésité est responsable de 6 % des
dépenses en soins de santé et ce chiffre ne cesse d’augmen-
ter1.
Il est possible de s’attaquer au problème intelligemment,
comme au Canada. Dans ce pays, grâce à de gros investisse-
ments en prévention et en promotion de la santé, on a pu rédui-
re le coût total de l’obésité à 2,5 % des dépenses totales,
contrairement à son grand frère et voisin, les Etats-Unis, où on
estime l’impact sur les dépenses à plus de 10 %.
Les structures belges des soins de santé accordent donc une
très grande attention à l’obésité et ce, aux différents niveaux de
pouvoir, qui doivent tous prendre leurs responsabilités. Dans
ce cadre, l’Inami a décidé de mettre sur pied un groupe de tra-
vail au sein du Conseil Scientifique pour les maladies chro-
niques. Il a été demandé aux Mutualités Libres d’en prendre les
rennes vu les différentes activités récemment développées par
MLOZ pour ce groupe d’affections.
Le champ d’action du groupe de travail autour du thème de
l’obésité est assez large et sa mission est de développer, sur la
base de ce qui existe au niveau scientifique, des recommanda-
tions aux différentes instances politiques. Ces recommanda-
tions peuvent aller au-delà des limites strictes de l’assurance
maladie obligatoire et peuvent donc couvrir tout le domaine de
la prévention, de la promotion de la santé, de la détection pré-
coce des facteurs de risque et leur approche ainsi que le disea-
se management complet et intégré avec, entre autres, le
développement d’un trajet de soins intégré et la formation des
prestataires. On peut éventuellement en extraire des recom-
mandations sur les interventions financières de l’assurance
maladie obligatoire.
A l’heure actuelle, l’intervention de l’assurance maladie obliga-
toire se limite à deux groupes d’interventions financières uni-
quement pour les patients situés “au sommet de l’iceberg”, à
savoir des interventions forfaitaires pour les centres de troisiè-
me ligne (centres de convention) dans le cadre du traitement
prolongé dans un internat d’enfants, et depuis peu la nouvelle
nomenclature pour la chirurgie bariatrique.
Le nombre de patients visés est toutefois très limité et la ques-
tion suivante se pose : l’assurance maladie obligatoire, soute-
nue par des mesures d’accompagnement au niveau de la Santé
Publique et des Communautés, peut-elle optimiser ses inter-
ventions de manière à être plus efficace et plus efficiente ?
Cet exercice constitue un défi intéressant pour le groupe de
travail spécifique. Ce groupe de travail est en cours de consti-
tution; il préparera un programme concret.
La priorité est de développer une approche professionnelle,
multidisciplinaire ainsi qu’une approche financière et adminis-
trative dans les différents forums du système belge des soins
de santé.
Pascal Mertens
Directeur Général
1Chiffres IBES-BIGE
E

Pr. De Henauw, quelle est l’inci-
dence de l’obésité chez les enfants
et les adolescents ?
Les premiers résultats du projet
HELENA (voir encadré) montrent
que pas moins de 27 % des gar-
çons et 20 % des filles souffrent
d’excès de poids ou d’obésité.
Les enfants obèses deviendront-ils
également des adultes obèses ?
On ne peut pas dire que ce soit
incontournable mais il est évi-
dent que les enfants qui présen-
tent un excès de poids ou qui
souffrent d’obésité ont beaucoup
plus de risques de rencontrer
également ce problème à l’âge
adulte. De nombreuses études,
appelées aussi études ‘tracking’,
confirment effectivement ce
phénomène.
C’est d’ailleurs un motif impor-
tant pour faire de la prévention
primaire.
Mauvaises habitudes alimentaires
Quelle est l’importance de l’héré-
dité dans cette problématique ?
A ce niveau-là, le problème de
l’obésité est assez complexe.
L’hérédité joue un rôle évident
mais, comme dans beaucoup
d’autres maladies chroniques,
il y a une conjonction entre
“ gènes“ et “ environnement“.
En effet, on ne peut pas expli-
quer l’épidémie d’obésité de ces
dernières décennies par une
simple modification génétique.
Il y a néanmoins une interaction
claire entre notre matériel
génétique et l’environnement.
Dans un environnement obèso-
gène, les personnes “prédis -
posées ” vont totalement
som brer, au sens propre comme
au figuré.
Quelle est l’influence des habi-
tudes alimentaires sur ce phéno-
mène ?
S’il y a bien une chose qui soit
très bien documentée en matiè-
re d’excès de poids et d’obésité,
c’est l’influence néfaste des
mauvaises habitudes alimen-
taires dans l’éducation. En outre,
ce phénomène est relativement
plus présent dans les classes
sociales défavorisées. Les plus
défavorisés affichent un score
nettement supérieur en termes
d’incidence et de prévalence de
l’obésité.
Les enfants obèses peuvent-ils
eux-mêmes jouer un rôle dans
l’approche de leur problème et
dans quelle mesure les médecins
peuvent-ils les aider ?
C’est une question très com-
plexe et la réponse va se situer
entre les deux extrêmes. D’une
part, la responsabilité incombe
totalement à la personne obèse
par son manque d’exercices et
sa mauvaise alimentation ;
d’autre part, l’environnement
joue un rôle important dans l’ap-
parition de l’obésité. Le grand
défi consiste à donner aux per-
sonnes toutes armes néces-
saires pour qu’elles puissent se
défendre dans un environne-
ment obèsogène. Parallèlement,
il faut s’attaquer à l’envi ron -
nement obèsogène de manière à
inciter la personne obèse à bou-
ger et à modifier son comporte-
ment. Par exemple, en créant un
espace de circulation sûr ou en
proposant des alternatives pour
les distributeurs de boissons et
de friandises dans les écoles.
En ce qui concerne l’aide des
médecins, nous devons faire une
distinction entre la prévention
primaire et secondaire mais les
médecins peuvent jouer un rôle
important à ces deux niveaux.
Existe-t-il un lien entre obésité et
dépression ?
On note une corrélation en tout
cas, et les deux phénomènes
interfèrent. Les obèses sont
stigmatisés, brimés et cela
entraîne dans la grande majorité
des cas une image négative de
soi. Il arrive même que les
parents contribuent, incons-
ciemment, à stigmatiser leurs
enfants. L’inverse est également
vrai. La dépression a un impact
négatif sur la combativité de la
personne obèse dans sa lutte
contre les kilos.
Préventif/curatif
Comment jugez-vous les efforts
faits en matière de “ politique
d’alimentation saine” ?
En Belgique, le partage des
compétences au niveau préventif
(communautés) et curatif (fédé-
ral) représente un obstacle
considérable. Une politique
d’alimentation saine suppose
des mesures bien étudiées, bien
réglées, qui s’inscrivent dans
une approche intégrée, holis-
tique. Mais dans sa globalité, il
faut dire que l’implication de
moyens au niveau de la préven-
tion est plus que médiocre, sur-
tout en comparaison avec
l’aspect curatif.
Selon vous, quels rôles jouent
l’offre alimentaire excessive et la
publicité omniprésente sur l’aug-
mentation de l’obésité chez les
jeunes ?
Nous sommes tous envahis par
l’alimentation et la publicité qui
s’y rapporte. Il faut dire que
l’homme moderne n’a plus
aucun effort à faire dans sa
quête de nourriture. Il ne doit
plus bouger, au sens strict, et
n’éprouve nullement le besoin
de changer son comportement.
Vous jouez un rôle-clé dans le pro-
jet européen HELENA. Quel est
l’objectif final de ce projet ?
Le projet HELENA est présent
dans 10 pays européens, dont la
Belgique, et il étudie 3.000
jeunes de 13 à 17 ans sur leurs
habitudes alimentaires et leur
activité physique. L’originalité du
projet est qu’on utilise une seule
et même méthode de recherche.
L’objectif est de formuler des
recommandations et de propo-
ser des alternatives saines en
réponse à la menace d’une épi-
démie d’obésité en Europe. I
Le Prof. Stefaan De
Henauw de l’Uni ver -
sité de Gand combat
l’obésité sur plusieurs
fronts et collabore à une
contre-offensive européen-
ne. Interview.
4
Trois ans après le lanc
HELENA, les premiers
connus : il ressort de la p
de 3.000 jeunes que 27 %
20 % des filles de 13 à
d’un excès de poids ou d’
Le projet HELENA tente d
habitudes alimentaires et
adolescents dans 10 pays
la Belgique. L’objectif est
biais d’une même appro
gique, des informations
base pour toute une série
tions futures.
Quelques résultats frapp
- Seuls 13 % et 16 % des a
gent respectivement 20
au moins 2 fruits par
pour 50 % des jeunes,
se compose à plus de
riches en graisses.
- On note de grandes d
garçons et filles : 58 % d
La première gran
inq
Nous sommes envahis par
l’alim

Bientôt des “ médecins
nutritionnistes “ ?
Médecins généralistes, médecins de préven-
tion (enfants, école, travail), endocrinologues
et chirurgiens sont de plus en plus confrontés
à l’obésité et ses conséquences. Quelle est la
bonne approche Evidence Based ? A quelle
équipe multidisciplinaire faut-il faire appel et à
quel moment ? Quelle est la place du médecin
généraliste et y a-t-il une place pour un géné-
raliste spécialisé dans ce domaine ?
Les universités françaises de Lille, Nancy, Strasbourg, Lyon
et Clermont-Ferrand, proposent une formation postuniver-
sitaire de “Sciences des aliments et nutrition humaine“, à
la faculté de médecine, d’une durée totale de 2 ans.
Physiologie, physiopathologie, diététique, santé publique et
toxicologie sont les grands thèmes de cette formation.
Jusqu’à présent, la formation ne donne pas droit à un diplô-
me reconnu ni en France, ni en Europe. Reste à savoir si
elle est nécessaire et quelle est la place exacte du médecin
“nutritionniste”.
Cette formation vise principalement les médecins généra-
listes qui, dans leur pratique clinique, sont confrontés à la
problématique des troubles alimentaires, sous tous ces
aspects. Au printemps 2008, le Dr Jan Van Emelen, directeur
Research & Innovation, était professeur invité à la faculté de
Lille pour commenter les actions des Mutualités Libres en
Belgique, plus particulièrement la plateforme obésité de
l’assurance complémentaire.
Intérêt et doute en Belgique
L’intérêt pour une collaboration avec les universités belges
est énorme. Les facultés francophones de Belgique et la
Société belge des médecins nutritionnistes, présidée par la
dynamique Anne Boucquiau, sont ouvertes à toute discus-
sion en la matière. Les facultés néerlandophones doutent
encore mais se montrent également intéressées par une
concertation (c’est le cas du Pr De Henauw).
Les formations existantes dans les facultés belges sont
organisées par les facultés d’agronomie et visent principa-
lement les applications industrielles des connaissances.
Encore beaucoup de questions
La discussion s’enrichit d’un intérêt croissant de l’assuran-
ce maladie pour l’obésité. Plusieurs questions se posent
dans ce domaine. Quels sont les prestataires de première
ligne et quel rapport existe-t-il avec les médecins de pré-
vention ? Quelles sont les structures actives en deuxième
ligne, en faut-il une troisième et si oui, qui et comment ?
Quel est le rapport entre un diététicien et le médecin nutri-
tionniste ? Qu’en est-il du financement et de la reconnais-
sance ?
La reconnaissance du diplôme de médecin nutritionniste,
par rapport à un médecin spécialisé en santé publique,
médecine du travail, soins de santé à la jeunesse et autres,
fera davantage l’objet du groupe de travail du conseil scien-
tifique pour maladies chroniques. I
5
ement du projet
s résultats sont
opulation étudiée
% des garçons et
17 ans souffrent
obésité.
de répertorier les
modes de vie des
s européens, dont
t d’obtenir, par le
oche méthodolo-
qui serviront de
de recommanda-
ants :
adolescents man-
0 g de légumes et
jour. Par contre,
leur alimentation
35 % d’aliments
différences entre
des garçons exer-
cent une activité physique modérée à très
physique par jour, contre seulement 39 %
des filles. Par contre, les filles affichent
un meilleur score en matière de connais-
sances sur l’alimentation.
Outre cette étude sur l’état de santé actuel
des jeunes, le projet HELENA a introduit
quelques études d’interventions en vue de
promouvoir l’activité physique et l’alimen-
tation saine. Concrètement, il s’agit d’inter-
ventions, via l’outil informatique, portant
sur une période de 3 mois qui ont montré
des résultats positifs au niveau de l’alimen-
tation saine (en particulier en ce qui
concerne la consommation d’eau, de fibres
et de légumes).
En collaboration avec quelques petites et
moyennes entreprises européennes, le
projet HELENA s’est également penché sur
le développement d’alternatives saines
pour les encas populaires chez les jeunes.
1HELENA signifie Healthy Lifestyle in Europe by
Nutrition in Adolescence
de étude européenne confirme les tendances
uiétantes en matière d’obésité.
mentation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%