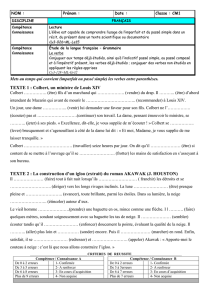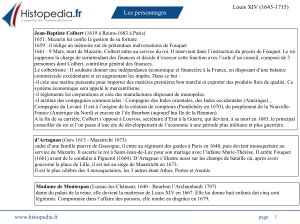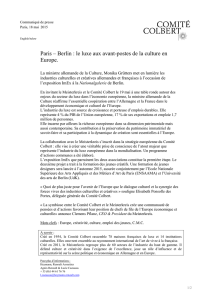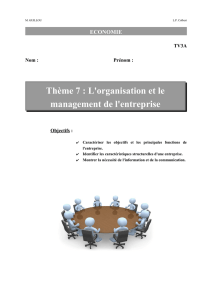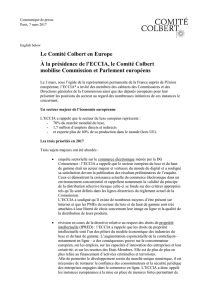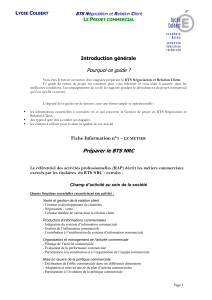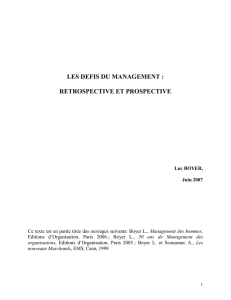Télécharger l`article - Institut de l`entreprise

Colbert est un incompris,et c’est bien
dommage.Presque autant de réfé-
rences sur Google que Keynes ou Marx
et, dans ce fatras, presque toujours des
contresens.Non, Colbert n’a pas inventé
les manufactures et les compagnies de
commerce (il n’a fait que les développer).
Non,Colbert n’était pas protectionniste
(ou en tout cas pas plus que ses contem-
porains). Non, Colbert n’était pas inter-
ventionniste (ou, au moins, pas à toute
heure et en tous lieux). Le principal
apport de Colbert, et non des moindres
dans l’histoire de France,aura été la cons-
truction d’un État moderne dans une
économie en cours de mondialisation1.
C’est là où Colbert peut nous être utile
aujourd’hui. L’environnement n’est, cer-
tes,pas le même.Mais les contraintes qui
s’exercent sur la France sont, à bien des
égards, identiques. Dans une période
électorale d’autant plus stratégique que le
quinquennat qui s’achève est celui des
rendez-vous économiques manqués, il
n’est pas inutile d’interroger le passé
pour éclairer l’avenir.
COMPRENDRE LE
COLBERTISME :CONTINUITÉ
ET CONSTANCE
Mais, pour tirer la «substantifique
moelle » du colbertisme,il faut
commencer par éclairer un certain nom-
bre de points de méthode.Le principal
apport méthodologique de Colbert tient
à sa relation au temps.François
Mitterrand avait le souci de la tempora-
lité (« Il faut laisser du temps au temps »).
En revanche,Jacques Chirac,trop pressé
manifestement, ne l’a pas. Inscrire des
réformes dans la durée,cela se nourrit
d’une triple exigence.Il faut d’abord
savoir anticiper.Quand, en 1995, les pays
développés réunis au sein du GATT se
donnent, par l’accord Multifibres, dix ans
pour s’adapter à l’inéluctable invasion du
textile du Sud, ils font preuve à la fois de
solidarité et de réalisme.Quand, dix ans
après, les mêmes pays développés décou-
vrent avec stupéfaction qu’ils vont per-
dre, pour la seule Europe,plusieurs
millions d’emplois textile en quelques
années,ils font preuve tout à la fois d’hy-
99
Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
##LIVRES ET IDÉES
##CONJONCTURESS
##REPÈRES ET TENDANCES $DOSSIER
Le colbertisme revisité :
une impérieuse nécessité
pour l’avenir
OLIVIER PASTRÉ *
Comparaison n’est pas toujours raison mais un éclaira-
ge historique n’est jamais inutile,surtout quand il s’agit
de la période qui a vu la France devenir la première
puissance mondiale. Colbert, qui fut le héros des livres
d’histoire de la IIIeRépublique, est devenu le symbole
de l’inefficacité besogneuse de l’administration. Une
relecture s’impose pour en tirer notamment des leçons
sur ce que pourrait être une politique industrielle
moderne.
DÉBAT 2007
Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
*Professeur à l’Université de Paris VIII.
1. Olivier Pastré, La Méthode Colbert ou le
patriotisme économique efficace,Perrin, 2006

pocrisie et d’irresponsabilité.Les répon-
ses qu’il faut apporter aujourd’hui sont
celles qu’appellent les questions posées à
l’horizon de 2015 ou de 2026. Pas celles
à l’horizon de 2007 ou de 2009. Alors
que le Commissariat au Plan a été
démantelé par Lionel Jospin et achevé
par Dominique de Villepin, jamais le Plan
n’a été aussi nécessaire. Deuxième exi-
gence,celle de la constance.Lerythme
électoral ne correspond en rien au
rythme des défis géostratégiques.Vouloir
accoler son nom à ce qui ne peut qu’être
une réformette est,au mieux, infantile.
Articuler une modification réglementaire
ou législative dans un schéma d’ensemble
inlassablement expliqué constitue le seul
moyen de préserver l’efficacité réforma-
trice.Deux exemples seulement :en
matière d’éducation et de fiscalité, nous
n’avons fait qu’empiler des oripeaux
pseudo-modernes. La réforme de la fis-
calité est possible comme celle du sys-
tème éducatif. Mais elle ne l’est que dans
la durée.«Bidouiller » l’IRPP ou l’ISF ne
fera qu’ouvrir de nouvelles niches fiscales
dont il est peu probable que les Français
les plus démunis profitent. Au contraire,
annoncer la couleur dès le départ et pro-
poser des réformes graduelles qui, in
fine,permettront de redonner à l’arme
fiscale son pouvoir redistributeur –et
aussi stimulateur de croissance – conduit
à associer les citoyens à un projet
économique d’ensemble qui, seul, fait
accepter les sacrifices temporaires.Te m-
poraire, troisième maître mot et troi-
sième exigence. Gérer le temps et la
durée n’implique en rien la permanence.
Et c’est là où Colbert vient à nouveau à
notre aide.Les aides, les subventions,les
bonifications doivent avoir un rôle d’im-
pulsion et non un statut de rentes. Les
aides aux manufacturesroyales étaient
généreuses mais pas éternelles. Chaque
modification réglementaire se devrait
d’être accompagnée d’un calendrier.
Même le CPE aurait pu être accepté s’il
avait été expliqué et considéré comme
un «second best », lui-même à durée
déterminée…
SAVOIR COMMUNIQUER
Deuxième élément de méthode, la
communication. Nous ne sommes
plus aujourd’hui au XVIIesiècle. Les
médias ont envahi nos vies. Sur le fond,
l’information est, globalement, facteur de
démocratie.Il n’en reste pas moins vrai
que,dans les pays déjà démocratiques,
les méfaits semblent, année après année,
l’emporter sur les bienfaits d’une infor-
mation sans contrôle.Il faut en tirer les
conséquences.«Ne pas dire mais faire»
aurait pu être la devise de Colbert. Le
temps n’est plus aujourd’hui au « never
explain, never complain » de l’aristocratie
britannique.Il n’est pas encore, pragma-
tisme oblige,au«Je dis ce que je fais et
je fais ce que je dis ». Il faut donc trouver
un juste milieu. Il faut faire un peu plus et
communiquer un peu moins. Moins d’ef-
fets d’annonce et plus d’annonces suivies
d’effets. Cela n’a rien de contradictoire
avec la nécessaire pédagogie des réfor-
mes. Bien au contraire. Mais cela conduit
à disqualifier les gesticulations média-
tiques qui n’ont de sens que parce que
certains hommes politiques prennent
leurs concitoyens pour des demeurés.Il
ne faut pas se faire trop d’illusions sur le
caractère opérationnel de cet enseigne-
ment du colbertisme. L’individualisme
libéral qui baigne nos sociétés poussera
toujours les hommes politiques les
moins sûrs de leur pérennité à faire leur
«coming out » dès lors qu’ils auront
déniché une «micro-réforme » aussi
dénuée de risque que de cohérence
d’ensemble.Mais si, au moins, le (ou la)
futur(e) président(e) de la République
pouvait s’engager sur des réformes clai-
rement identifiables et donc susceptibles
d’être «benchmarkées»,cela permet-
trait de mesurer le «faire»sans trop se
préoccuper du «dire».
ÉVITER DE SE DISPERSER
Dernier point de méthode :ne nous
dispersons pas.Colbert a tout
régenté dans le royaume de France mais
s’est contenté de cela. L’ONU,l’OMC,le
FMI n’existaient certes pas de son
vivant. Mais on ne peut manquer d’être
frappé par le fait que Colbert considé-
rait que ce sur quoi il n’avait pas de pou-
voir direct était sans conséquence.En
cela, il se différenciait de Richelieu, à qui
rien n’était étranger.Il est temps que,au
moins pour le quinquennat qui vient, la
France ne masque pas ses propres incu-
ries en allant sauver le reste de la pla-
nète.Nous avons, certes, toujours raison
et la récente taxe sur les billets d’avion
répond à des ressorts d’une générosité
extrême. Mais si, pour cinq ans seule-
ment,nous nous contentions d’être
médiocres.Comme les Hollandais du
XVIIesiècle.Médiocres mais, sinon riches,
au moins avec «un taux d’activité des
25-65 ans » moins porteur d’extré-
misme et d’intolérance.
Voilà donc pour les éléments de
méthode au sens strict. Reste à les appli-
quer à la réalité contemporaine.
Colbert, le retour.Mais le retour rai-
sonné. Il ne sert à rien d’invoquer les
mannes de Colbert à tout bout de
champ sans,au préalable,mesurer ce
que pourrait vraiment être le colber-
tisme aujourd’hui. Dans ce domaine, il
est des thèmes qui ne souffrent aucune
contestation et d’autres, au contraire, où
savoir ce qu’aurait fait Colbert aujour-
d’hui peut susciter des divergences d’ap-
préciation. On peut ici, en progressant,
presque sans discontinuité, aller des thè-
mes les plus aveuglants aux thèmes les
plus problématiques.
RÉHABILITER LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE
Au rang des évidences absolues,
citons, presque pour mémoire,
la politique industrielle.Colbert,
Pompidou :même combat. Georges
Pompidou est l’homme politique français
du XXesiècle dont le gouvernement se
rapproche le plus de la philosophie col-
bertienne.Cela est vrai, en particulier,en
matière de politique industrielle: la
France (et aujourd’hui,devrait-on dire,
l’Europe) n’a aucune chance de s’en tirer
sur le plan économique sans l’affirmation
de son identité industrielle.Les différen-
ces avec le XVIIesiècle,radicales, portent
sur l’objet et les moyens. Concernant
l’objet, il faut commencer par affirmer
haut et fort que l’agriculture ne consti-
tue pas «l’alpha et l’oméga » de la crois-
sance économique.S’il y a des arbitrages
budgétaires à faire –et il y en aura –
c’est par là qu’il faut commencer. Cela
permettra de mettre un terme à une
double injustice.Celle que subissent de
nombreux pays du Sud asphyxiés par la
PAC et aussi celle de nombreux petits
100 Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
##LIVRES ET IDÉES
##CONJONCTURES
##REPÈRES ET TENDANCES $DOSSIER
DÉBAT 2007

agriculteurs français qui voient fondre
leurs subventions alors même que d’aut-
res, électoralement mieux défendus,
conservent les leurs presque à l’iden-
tique.
Mais cela permettra aussi et surtout de
donner la priorité à ce qui est… priori-
taire. Il est clair que l’industrie ne cons-
titue plus aujourd’hui, pour les pays
développés,le principal poumon de la
croissance économique.Ce sont les ser-
vices qui structurent la nouvelle hiérar-
chie productive mondiale.Il convient,
certes, de ne pas abdiquer tout volonta-
risme strictement manufacturier.Mais
l’avenir de la France réside aujourd’hui,
d’abord et avant tout, dans la conquête
de son autonomie dans le secteur des
services productifs. C’est cela qui cons-
titue l’exact pendant de la marine col-
bertienne,avec son exigence de qualité
aussi bien que ses effets structurants
sur le reste de l’économie. Parler de
services productifs est loin d’une quel-
conque «djerbaïsation» touristique et
hôtelière. La vraie bataille se joue dans
la finance,dans les transports et dans les
services informatiques. La perte de
contrôle de Danone n’a pas l’impor-
tance,véritablement stupéfiante,que lui
ont donnée nos politiques. Par contre,
le risque que présente une «descente »
des majors américains sur notre indus-
trie bancaire non mutualiste, rendue
possible par la richesse des uns et par
l’attrait boursier des autres, met en
question le financement même de l’in-
dustrie française.
Voilà pour l’objet. Quant aux moyens, le
diagnostic est simple :ITER d’aujourd’-
hui = Saint-Gobain d’alors.De par l’a-
vancée continue du progrès technique,
l’environnement industriel compte au
moins autant, plus qu’au XVIIesiècle en
tout cas, que l’industrie elle-même.
Colbert avait pressenti l’importance de
la qualité des produits français. Aujour-
d’hui, dans presque tous les secteurs,
celle-ci fait,seule ou presque,la diffé-
rence.Et, en matière de qualité, la diffé-
rence se fait de plus en plus par les
infrastructures et par la R & D. Or,dans
ce domaine,la France et l’Europe se
traînent lamentablement à la remorque
des États-Unis et demain, peut-être, de
la Chine. En terme relatif bien sûr.En
terme absolu, n’en parlons même pas :
les États-Unis créent, chaque année,en
matière de recherche civile,l’équivalent
de notre bon vieux CNRS... L’écart
technologique se creuse jour après jour.
Sans un effort continu dans ce domaine,
sur une dizaine d’années au moins,
notre retard ne pourra plus jamais être
rattrapé.
RECHERCHE ET UNIVERSITÉ
Cet effort ne peut pas être que fran-
çais. Il se doit d’être européen. Mais
le souffle de Lisbonne,qui se promettait
de faire de l’Europe «lenuméro un mon-
dial de l’économie de la connaissance »,
étant de plus en plus asthmatique,la
France se doit de tracer son sillon, seule
si besoin est. Rien de plus facile si la
volonté politique ne fait pas défaut.Le
budget civil de la Recherche ne repré-
sente,après tout, que 10 milliards d’eu-
ros et son doublement en trois ans
n’écornerait que de 29,3% celui des
armées (à supposer que l’arbitrage se
fasse ainsi, ce qui n’est probablement pas
souhaitable). L’effort à consentir ne doit
pas être strictement quantitatif. L’État
français peut aussi parfaitement, sans
attendre la bénédiction de Bruxelles,
améliorer l’organisation de la Recherche,
avec pour priorité l’articulation public-
privé et le lien entre recherche théo-
rique et application industrielle. Il suffit
pour cela de conditionner toute aide
nouvelle à la programmation d’une
recherche de débouchés productifs. Le
résultat ne peut être garanti (a fortiori
en matière de recherche fondamentale)
mais un contrôle ex-post peut parfaite-
ment être mis sur pied. Il est clair qu’une
réforme de la Recherche sans réforme
de l’Université n’aurait aucun sens. Dans
ce domaine,la solution est toute trou-
vée :l’autonomie,accompagnée,bien sûr,
d’un système d’évaluation.Cette réforme
doit se faire sur le mode du volontariat
et non sous forme de la généralisation
immédiate,pour éviter que certains ren-
tiers du monde universitaire ne fassent
croire aux étudiants que c’est la qualité
de l’enseignement qui est menacée.Car
c’est bien du contraire qu’il s’agit :sortir
progressivement l’Université de son sta-
tut – récent – de co-adjuteur de la lutte
contre le chômage est le meilleur moyen
de redonner aux personnels universitai-
res (pas seulement enseignants) leur
dignité et aux étudiants, leur avenir.
À côté de ce premier front, il convient
d’en ouvrir un autre. Celui du contrôle
de nos entreprises. Il n’est plus «politi-
quement correct » de nationaliser,sauf
quand on est latino-américain, pauvre et
détenteur de matières premières qui
intéressent les riches. Cela n’interdit pas
pour autant d’avoir une réflexion sur le
sujet. Le rachat au prix fort des 12 %
d’EDF qui sont dans le public serait une
absurdité industrielle et budgétaire. Et, si
l’on se prononce en faveur de la privati-
sation partielle de Gaz de France au tra-
vers de sa fusion avec Suez, c’est parce
que cette ouverture du capital était
inéluctable mais,aussi et surtout,parce
qu’elle amènera l’État à détenir une par-
ticipation minoritaire au capital d’un
groupe dont un des cœurs de métiers
restera la distribution d’eau aux collecti-
vités. Refusons donc ce qui est «politi-
quement correct » car c’est souvent
économiquement injuste et inepte…
DÉFENSE DES
ENTREPRISES PRIVÉES
Considérons néanmoins que les
nationalisations ne sont pas aujour-
d’hui l’absolue priorité. Reste le contrôle
de «nos » entreprises privées. Au-delà
des mesures visant à permettre aux
entreprises de se défendre, en vigueur
aux Etats-Unis et dans la plupart des pays
européens (« pilules empoisonnées»,
bons de souscription d’actions, clause de
réciprocité…),l’objectif devrait être
qu’au moins une minorité de blocage
reste dans des mains françaises. Non pas
pour empêcher toute opération bour-
sière venant de l’étranger.Mais simple-
ment pour que cette opération ne soit
pas «pliée d’avance ». Dans ce
domaine,deux voies sont possibles qui
doivent être explorées simultanément.
Celle de l’actionnariat individuel d’abord.
Si les Français veulent garder le contrôle
de leur industrie,ils doivent se mobiliser.
Au départ, les Français n’aiment pas le
risque et donc les actions. Il faut les
encourager –y compris fiscalement – à
distraire de la pierre et du livret A une
101
Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
LE COLBERTISME REVISITÉ : UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ POUR L’AVENIR

part suffisante de leur épargne pour évi-
ter qu’il ne reste plus en France que des
résidences secondaires et de l’épargne
sociale en recherche d’emploi… L’épar-
gne salariale doit, dans ce domaine,occu-
per une place centrale.Elle ne constitue
pas une solution à tous les problèmes.
Elle n’est pas sans risque, comme le
scandale Enron l’a montré. Mais elle
constitue un fantastique moyen de
créer de l’affectio societatis et de conso-
lider le «long-termisme » dans la ges-
tion des entreprises (la durée de
détention moyenne des actions est de
six ans et trois mois pour les ménages
contre quatre mois pour les institution-
nels non résidents). Ah, que Jean-
Baptiste aurait aimé l’épargne salariale
pour consolider le capital de ses
Manufactures !
Par ailleurs, l’État dispose de moyens qui
lui sont propres pour consolider le capi-
tal des entreprises françaises. Il peut le
faire indirectement en incitant les inves-
tisseurs institutionnels français à investir
en actions –cotées et non cotées. Pour
financer les projets à venir,la France
doit,par ailleurs, consolider son sys-
tème financier et ne pas l’accabler sous
des charges inutiles, même si elles sont
budgétairement tentantes. En échange
de quoi, la France peut attendre de ses
«institutionnels » qu’ils n’oublient pas
qu’ils sont aussi citoyens. Le finance-
ment en fonds propres des entreprises
françaises, petites ou grandes,devrait, de
ce point de vue,constituer pour eux
une priorité. L’argument selon lequel l’é-
pargne qui leur est confiée doit être
gérée au mieux des intérêts de leurs
clients, et donc sans aucune contrainte,
ne tient pas. Car le placement en
actions (et, pour partie au moins, en
actions françaises) se révèle,sur le long
terme,le placement le plus performant.
Par ailleurs, ces clients sont accessoire-
ment des citoyens français qui dépen-
dent, pour financer leur retraite,d’une
économie compétitive et d’entreprises
financièrement sûres d’elles. Cet argu-
ment vaut aussi pour les «bras armés »
de la puissance publique.Supposons que
l’on ne veuille pas rouvrir le débat sur
les fonds de pension (ce qui paraît
absurde dès lors que l’on n’en fait pas
un substitut pur et simple à la retraite
par répartition). Reste le Fonds de
réserve des retraites qu’il faut abonder
et consolider.Reste la Caisse des
dépôts qui ne consacre,à ce jour,que 24
milliards d’euros aux placements en
actions sur les 134 milliards qui lui sont
confiés en gestion.Reste l’affectation
possible de la vente d’une partie du
patrimoine immobilier de l’État à des
missions de patriotisme économique.
Restent ainsi de nombreuses solutions
pour redonner à l’État, non pas une
force de frappe contraire à l’économie
de marché, mais des marges de manœu-
vre lui permettant de ne pas être
emporté comme un fétu de paille dans
le tourbillon de la mondialisation. Rien
de plus.Rien de moins.
ÉLÉMENT CLÉ DE
LA SAGESSE COLBERTIENNE,
L’ADMINISTRATION
Il n’est point d’État sans une adminis-
tration puissante et efficace.Si la puis-
sance se mesure par le nombre, comme
pour les armées de Louvois, nous som-
mes de plus en plus «louvoisiens ». Mais
Colbert avait une autre vision des cho-
ses. Il n’avait pas,dans ce domaine
comme dans bien d’autres (la marine
exceptée), la mystique du nombre. Son
administration pouvait apparaître plé-
thorique par rapport à celle d’Henri IV
mais, en fait, il en a toujours (budget
oblige) contrôlé la croissance.Par
contre, il était obsédé, là aussi, par la
qualité. Les fonctionnaires français se
devaient d’être les meilleurs. Il est établi
que le salaire au mérite faisait partie du
système colbertien. Dans ce domaine
aussi, la réaction est possible.La LOLF,
rien que la LOLF,toute la LOLF.Cette
loi peut faire basculer,àelle seule,l’ad-
ministration dans l’univers de la respon-
sabilité et donc de l’efficacité. Il n’est pas
question de réduire le nombre de fonc-
tionnaires pour le plaisir de l’esthétique
budgétaire. Il est seulement question de
faire de l’administration une armée non
pas «industrielle de réserve » mais
«administrative de combat».Car la
bataille de la compétitivité et de l’attrac-
tivité se gagnera aussi sur le front admi-
nistratif. Mais qui dit «mobilisation »
doit dire aussi «formation » (formation
qualifiante et non seulement d’adap-
tation), rémunération (pour partie
variable,pour partie indexée sur les
résultats,mais dans une dynamique
haussière) et perspectives de carrière
(l’ascenseur social de la fonction
publique est celui qui est le plus souvent
tombé en panne au cours des dernières
décennies). Il peut paraître un peu naïf
de faire de la LOLF le seul viatique de la
modernisation administrative.Mais
l’exemple de Colbert et de ses inten-
dants est là pour nous montrer qu’une
seule réforme menée à bien de manière
entêtéeet quasi obsessionnelle peut,
par effet d’exemplarité et de capillarité,
faire basculer le corps social dans un
nouvel univers.
IMPORTANCE DES CORPS
INTERMÉDIAIRES
Là où Colbert nous montre aussi le
chemin c’est par l’importance qu’il a
attachée aux corps intermédiaires. Sans
jurandes et sans corporations, il n’y
aurait pas eu de «reconquista » indus-
trielle en France au XVIIesiècle. Ce
besoin de corps intermédiaires se fait
sentir de manière encore plus accen-
tuée aujourd’hui. Si l’on ne comble pas
le fossé entre le corps politique et le
corps social,nous n’avons aucune
chance de mettre en chantier quelque
réforme que ce soit. L’échec du CPE l’a,
une fois de plus,démontré :pas de
réforme,en France comme ailleurs, sans
un minimum de concertation et de
négociation. On ne redonnera pas
confiance en elle à la France à coups
d’article 49-3. De même on n’instituera
pas de réformes dans la durée sans
relais, relais d’opinions mais aussi relais
de suivi et de gestion.La France n’est
pas la Scandinavie et il ne sert à rien de
regretter notre faible taux de syndicali-
sation. Il faut agir.Dans ce domaine,l’in-
citation se révèle plus efficace que le
volontariat et moins répulsive que la
contrainte.Alors pourquoi ne pas, pen-
dant une durée déterminée,moduler la
base des cotisations sociales patronales
en fonction du taux de syndicalisation
(dès lors que serait, en parallèle,mené à
bien une redéfinition de la représentati-
vité syndicale et que serait encouragée
une plus grande ouverture syndicale au
fait international) ?
102 Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
##LIVRES ET IDÉES
##CONJONCTURES
##REPÈRES ET TENDANCES $DOSSIER
DÉBAT 2007

Ce qui est vrai pour les syndicats l’est
aussi pour les associations. La France
n’est pas les États-Unis. Mais, justement,
compte tenu de son retard,la France
peut, à moindres frais, repositionner très
vite les associations dans le jeu social.
Quelques subventions ou, mieux,quel-
ques amendements aux conditions de
financement des associations,et la
France rattrapera une large partie de
son retard sur ce terrain. «L’aggiorna-
mento » des corps intermédiaires ne
doit pas s’arrêter là. Les Chambres de
commerce,le Conseil économique et
social, les assemblées consulaires sont
autant de vecteurs du lien social, et
néanmoins productifs, qu’il est indis-
pensable de mobiliser. En réformant
certains statuts si besoin est. Le gouver-
nement qui disposera le plus vite du plus
grand nombre de relais sera celui qui
pourra faire passer le plus grand nombre
de réformes.Les corps intermédiaires
ne sont pas, pour la plupart d’entre eux,
de droite ou de gauche. L’égalité des
chances est ainsi respectée…
PRODUCTION ET
JUSTICE SOCIALE
Cela débouche tout naturellement
sur la question sociale.Colbert n’a-
vait une fibre sociale développée qu’au-
tant que le social pouvait servir les
intérêts du royaume.Prenons, là aussi,
exemple sur lui. Il avait compris que la
priorité revenait à l’affirmation de la
valeur Travail. Pour qu’un pays soit riche,
il doit produire.To ut ce qui peut décou-
rager la mise au travail doit être proscrit.
Mais Colbert savait que la valeur Travail
ne peut être affirmée que si elle est posi-
tivée.Et la qualité du travail ne peut être
améliorée que si le travail dispose d’un
minimum de sécurité. Colbert aurait
peut-être défilé contre le CPE !
Mais la vraie question du social n’est pas
seulement là.Si la mondialisation est
une fantastique machine à créer des
inégalités, la question qui se pose est
celle de la gestion de celles-ci. C’est là
où la droite et la gauche retrouvent leur
distance.Pour la droite,les inégalités ne
sont que la preuve qu’il y a des gagnants,
et le rôle de l’État se réduit donc à amé-
liorer,ex-post, le sort des perdants. La
gauche,elle,considère que la lutte
contre les inégalités doit être menée
ex-ante et que la prévention doit l’em-
porter sur la réparation. Cette seconde
solution a ma préférence.Même si
le préventif est plus difficile à calibrer de
manière efficace que le curatif, il tourne
résolument le dos au fatalisme. Or,
Colbert était tout sauf fataliste.
Immergé dans une mondialisation
presque totale, Colbert aurait, peut-
être, donné la priorité à ce qui a fait la
force de Louvois :les hommes…
L’ENJEU DÉMOGRAPHIQUE
Enfin,dernier dossier sur lequel le
colbertisme permet de jeter un
regard serein sur notre crise contempo-
raine :celui de la population. L’Europe
périra de ses insuffisances en matière de
renouvellement des générations. Encou-
rageons la natalité (en Italie et en
Espagne plus encore qu’en France) et,
surtout, refusons l’hypocrisie actuelle en
matière de politique d’immigration. Le
déficit démographique de l’Europe se
chiffre à 40 millions à l’horizon de 2020.
Contrôlons mieux l’immigration clan-
destine mais acceptons ce qui est une
réalité aveuglante (et que l’adhésion de
la Tu rquie à l’Union européenne ne
pourra, à elle seule,remettre en cause) :
il faut encourager l’immigration officielle
et non la combattre. Cela passe par un
ciblage plus précis des qualifications
indispensables à la croissance euro-
péenne mais aussi, bien sûr,par la mise
en place de mécanismes de «retour au
pays » comme ont parfaitement su le
faire les États-Unis, dont le taux d’immi-
gration est deux fois supérieur au nôtre
sans que les tensions, inévitables, pren-
nent le dessus sur la «force tranquille »
de l’intégration.
Voilà donc des dossiers pour lesquels il
est simple de discerner ce que Colbert
ferait aujourd’hui. Il en est d’autres, par
contre, où le colbertisme ne nous aide
pas nécessairement à agir.Mais où,à
tout le moins,il nous aide à penser.
Colbert avait une rigueur toute «tri-
chéenne ». Je ne pense pas, pour autant,
que Colbert aurait approuvé la politique
actuelle de la BCE. Certes, il était obs-
édé par l’équilibre budgétaire. Mais il l’é-
tait encore plus par la croissance.La
croissance française de la deuxième
moitié du XVIIesiècle n’a pas répondu à
toutes les attentes du ministre de Louis
XIV. Mais il s’est employé, sans aucun
répit, à la stimuler.Cessons donc de
faire la lutte contre l’inflation «l’alpha et
l’oméga » de la politique économique.
L’inflation a disparu,ou presque,en
Europe.Il faut,certes, rester vigilant.
Mais pas au prix d’une récession, fer-
ment de tous les déséquilibres sociaux,
et donc politiques. Colbert ne nous le
pardonnerait pas…
Là où l’on peut être plus circonspect,
c’est sur les délocalisations. Colbert
n’aurait pas aimé. Mais il aurait reconnu
que nous ne sommes pas les seuls à
délocaliser et que les délocalisations
des autres (et des États-Unis notam-
ment) peuvent constituer un bienfait
pour la France, pour peu que son
attractivité s’améliore (ou, au moins, ne
se détériore pas). Colbert aurait, par
ailleurs,accepté de considérer les délo-
calisations comme un mal nécessaire
pour préserver la compétitivité de l’in-
dustrie nationale.Enfin, il aurait lutté
contre les méfaits des délocalisations
en «upgradant » notre appareil indus-
triel. Colbert se préoccupait moins de
la Chine que de la Hollande.Mais eut-il
dû gérer notre crise du textile (secteur
qu’il connaissait mieux que la plupart
de nos actuels ministres), il aurait assu-
rément fait le pari du «nearshore» et
du transfert de technologie en faveur
des pays du Maghreb pour enrayer l’hé-
morragie industrielle et sociale du tex-
tile français.
LE DÉBAT SUR LE
PROTECTIONNISME
Dans un registre proche, Colbert
serait-il, aujourd’hui, protection-
niste ? Je ne le pense pas. Colbert était
mercantiliste,non pas par incapacité
intellectuelle à percevoir les bienfaits
de l’économie de marché,mais par
nécessité de parer au «plus pressé éco-
nomique » dans un univers caractérisé
par une mondialisation encore balbu-
tiante. Les effets positifs de l’interdé-
pendance d’une économie de marché
généralisée,ferments du libéralisme, ne
103
Sociétal N° 55 !1er trimestre 2007
LE COLBERTISME REVISITÉ : UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ POUR L’AVENIR
 6
6
1
/
6
100%