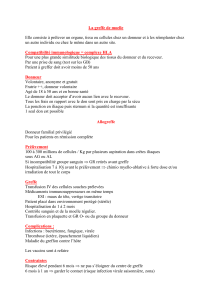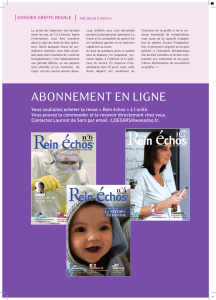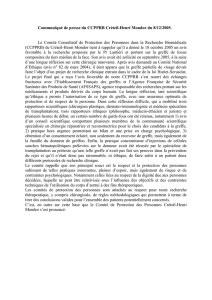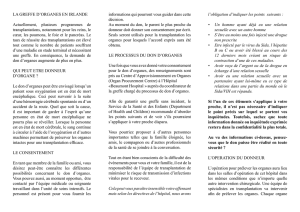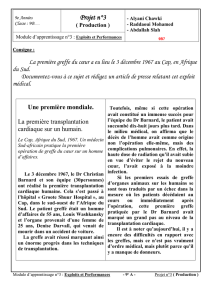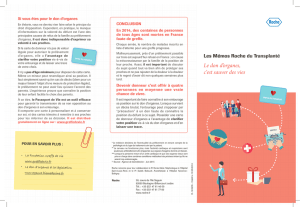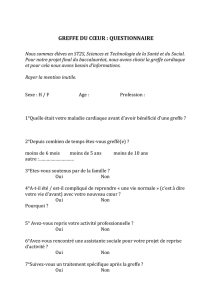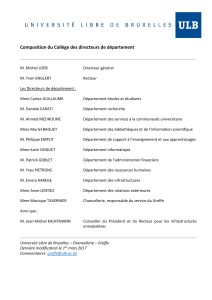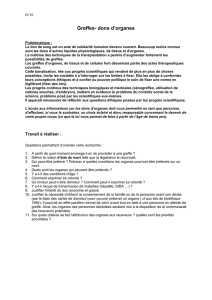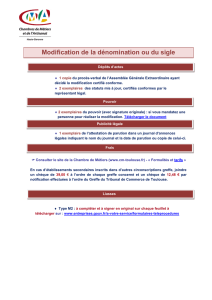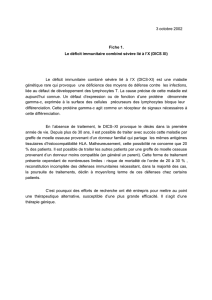santé publique don de vie en ville

LE CAHIER
DE FORMATION
Le traitement
de l’HTA
JUIN 2012 - N° 282- L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE29
Sommaire
Savoir
En France, 11millions d’hypertendus sont sous
traitement. Une bonne connaissance de la pharmacologie
des anti-hypertenseurs paraît indispensable aux Idels
pour mieux accompagner les patients.
Savoir faire
Anti-hypertenseurs et grossesse
Répercussions de l’hypertension et de ses traitements
sur la grossesse.
Surveillance infirmière d’un traitement
anti-hypertenseur
Les principaux points de surveillance clinique
et biologique d’un traitement anti-hypertenseur.
Conseils thérapeutiques au patient hypertendu
Conseils hygiéno-diététiques et gestion des effets
indésirables du traitement.
Contrôler sa tension à domicile
Le respect des bonnes conditions d’utilisation
des autotensiomètres et les erreurs à éviter.
Savoir plus
CAHIERR
ÉDIGÉPARMAÏTENATEKNETZIAN, DOCTEURENP
HARMACIE
ETE
NSEIGNANTEENIFSI
Cahier de
formation n° 47
PRISE EN CHARGE
Le sevrage tabagique . . . . . . . . . . . . . . . . .p
.46
CONSEILS
L’allaitement maternel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p
.48
Le traitement
de l’HTA
Quiz
Quiz
1. Chez un diabétique, les objectifs
tensionnels sont:
a. < 140 – 90 mm Hg;
b. < 130 – 80 mm Hg;
c. < 150 – 90 mm Hg.
2. Les bêtabloquants peuvent être
à l’origine:
a. d’essoufflements;
b. d’œdèmes des membres inférieurs;
c. d’impuissance;
d. de cauchemars.
3. Les IEC et ARA II sont
contre-indiqués pendant la grossesse:
a. vrai;
b. faux.
4. Les IEC et les ARA II sont:
a. hypokaliémiants;
b. hyperkaliémiants.
5. Tous les appareils d’automesure
sont homologués par l’Afssaps:
a. vrai;
b. faux.
Réponses du quiz :
1 - b; 2 - a, c et d; 3 - a; 4 - b; 5 - b
LE POINT SUR
www.espaceinfirmier.com IJuin 2012 In° 282
ACTUALITÉ
Santé et affaires
sociales dans
un grand ministère
DÉBAT
Les maisons de
santé plébiscitées
par les élus locaux?
VOTRE CABINET
Connaître les règles
qui encadrent
le don de gamètes
Santé publique
Don de vie
en ville
*+%"!"*./",-.,"$"

Wolters Kluwer France • 1, rue Eugène et Armand Peugeot, 92856 Rueil-Malmaison cedex • Tél.: 0176733000 – Fax: 0176734852 • Adresse Internet: www.espaceinfirmier.com
Éditeur: Wolters Kluwer France, SAS au capital de 300000000 €, RCS Nanterre 480 081 306 Directeur de la publication: Mickael Koch, Président Directeur Général de
Wolters Kluwer France Associé unique: Holding Wolters Kluwer France N° de commission paritaire: 0217 T 81207 ISSN: 1267-9925 Directeur du pôle Santé:
Rémi Bilbault Directeur de l’infocentre Santé humaine: Thierry Lavigne Directrice adjointe: Anne Boulanger Directrice des rédactions Hôpital/Infirmiers: Sylvie
Gervaise POUR JOINDRE LA RÉDACTION: pour joindre directement votre correspondant, il suffit de composer le 017673 suivi des quatre chiffres qui figurent entre parenthèses à la suite de son nom.
Télécopie: 0176734852 Rédactrice en chef: Candice Moors ([email protected]) • Secrétaire de rédaction: Julie Verdure • Assistante de la rédaction: Élizabeth Darry (41 74) • Maquette réalisée
par: Laure Cartigny • Illustrateur: Franck L’Hermitte • Directeur de production : J.-M. Eucheloup • Fabrication: Céline Bronders • Conception maquette: Frédérick Tallaron (WK France) • Illustration de la couverture:
Jacques Guillet • Photo édito: Philippe Chagnon • Ont collaboré à ce numéro: Geneviève Beltran, Nathalie Da Cruz, Marie-Claude Daydé, Marjolaine Dihl, Christine Fontaine, Anne-Gaëlle Harlaut, Christine Julien,
Géraldine Langlois, Aveline Marques, Laure Martin, Sandra Serrepuy, Véronique Sokoloff, Denis Stora, Maïtena Teknetzian. Photogravure: atelier prépresse - Groupe Liaisons • Imprimerie: CHAMPAGNE, ZI des
Franchises, 52200 Langres. POUR PASSER UNE PAGE DE PUBLICITÉ : Tél.: 0176734126 - Fax : 0176734859 • Directeur commercial: Jean-Christophe Goulemot • Directrice commerciale adjointe:
Corinne Voltz-Rosenthal (42 82) • Directrice de publicité Hôpital infirmiers: Marie-Laure Soucramanien (41 76) • Directrice de clientèle: Astrid Borras (31 48) • Assistante: Souad Aschendorf (41 26) POUR
PASSER UNE PETITE ANNONCE: Fax: 0176734856 • Directrice commerciale de la régie PA: Christine Gautier (35 32) • Directrice PA: Chantal Chiquet (32 48) • Chef de publicité PA: Christelle Moularé
(33 75) • Assistante PA: Muriel Falla (34 68) • Maquette PA: Jean de Dietrich POUR S’ABONNER : Tél.: 0825080800 (n° indigo, 15 cts/minute) - Fax : 0176734857 • Directrice marketing adjointe Santé :
Vanessa Mire Prix au numéro: 14,72 € • Tarif abonnement 1 an: 111 € • Tarif étranger, nous consulter. « Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données personnelles vous
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire (nom de la revue, service diffusion, 1, rue Eugène et
Armand Peugeot, 92856 Rueil-Malmaison cedex) en nous indiquant vos nom, prénom et adresse. » Une brochure “Catalogue 2012 - éditions Lamarre/Professions paramédicales et travail social” est
assemblée sur la 4ede couv.
Demain est un autre jour
Lorsque les jours deviennent des “Journées”, c’est que l’on opère un
glissement du calendrier des Postes avec jolies perruches vers une tout
autre dimension. Et l’on se retrouve porté par le flot médiatique des grandes
causes sans trop se mouiller: sida, diabète, réchauffement climatique...
Nous sommes ainsi faits que les beaux slogans fondent sur nous comme
crème au soleil. À l’automne dernier, L’ILM s’est trouvé convié à Bruxelles
pour un colloque de journalistes européens sur le don d’organes. Dans
tous les pays représentés, l’infirmière coordonnatrice s’impose
comme le visage “humain” de l’activité de greffe, le grand
échangeur entre l’administration, les soignants et la famille.
Dans tous les témoignages aussi, dans toutes les langues,
la même détresse des proches qui ne connaissent pas la position
du potentiel donneur. Parce qu’ils n’en avaient jamais parlé, avant.
L’idée a fait son chemin et nous nous sommes demandé quel rôle
vous jouez, vous, les Idels(1), dans cette grande chaîne du don et de la greffe
en France. Au cours de notre enquête, personne ne nous a ressassé les arguments
d’une prétendue générosité du “oui” en opposition à l’égoïsme du “non”. L’histoire de
chacun détermine son rapport à la mort, à sa propre mort, et au devenir de son corps.
Ce qui nous a profondément marqués, c’est le soulagement des proches lorsqu’ils
sont en mesure de répondre à l’unisson « il était contre, il me l’a dit ». Évitons à tout
prix les « je ne sais pas », ne laissons pas nos proches vivre avec ce doute. Comme le dit
l’un de nos témoins, nous ne sommes pas obligés d’attendre le 22 juin (2) pour en parler.
Non, nous ne sommes pas obligés. Mais l’occasion est belle, alors saisissons-la.
(1) L’infirmière diplômée d’État en mode d’exercice libéral (Idel) est en effet une spécialité francobelge (cf. notre dossier “L’appel du large” paru dans L’ILM n°272).
(2) La 12eJournée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe du 22 juin est distincte de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe de l’OMS
(organisée le 17 octobre depuis 2005) et de la Journée européenne du don d’organes et de la greffe qui abordera sa 14eédition le 20 octobre 2012.
JUIN 2012 - N° 282 - L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE 5
éditorial
CANDICE MOORS
RÉDACTRICE EN CHEF
"&-+,& ( %#

dossier
18 L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE - N° 282 - JUIN 2012
Santé publique
Don de vie
en ville
Encore rarement évoqués entre les murs du cabinet,
le don et la greffe peuvent néanmoins s’aborder lors
des tournées à domicile ou, plus spontanément, dans
les centres de dialyse. Pour le patient greffé ou inscrit sur
liste d’attente, l’accompagnement à domicile demeure
indispensable. Une prise en charge où le partenariat
ville-hôpital reste encore à développer.
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARJOLAINE DIHL ET CANDICE MOORS, ILLUSTRÉ PAR JACQUES GUILLET
(**# )"

JUIN 2012 - N° 282 - L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE 19
Chaque jour, vous
poussez la porte
de dizaines de
foyers, vous béné-
ficiez d’un capital
“confiance” impor-
tant et, pourtant, pas la moindre
petite plaquette d’information
rédigée à votre intention. Au
mieux, on pense à vous comme à
une personne dont les proches
seront mieux préparés que d’au-
tres – on connaît votre disposition
naturelle à sauver des vies – à
accepter le prélèvement de vos
organes “si jamais”.
Il faudra effectivement pas mal de
temps avant que la greffe perde
cette image très hospitalière « de
thérapeutique d’excellence, une
activité un peu isolée, de dernier
recours, un peu coupée de l’amont
et qui assurait seule le suivi des
patients greffés en aval », comme
le souligne la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
(ABM)(1), Emmanuelle Prada-Bor-
denave, au cours de la présenta-
tion à la presse du nouveau Plan
greffe. Principale mesure de ce
Plan 2012-2015: encourager la col-
laboration des professionnels de
santé de l’hôpital et de ville autour
du patient. « La cassure entre les
transplantés et les autres se
constate dès la salle d’attente d’un
cardiologue. Il faut pourtant réap-
prendre à vivre ensemble, ce qui
ne demande aucune dépense sup-
plémentaire. » Il n’est d’ailleurs
pas prévu d’accompagner le Plan
de financements spécifiques ni
pour les réseaux, ni pour l’hôpi-
tal(2).. D’après l’ABM, davantage
que les montants alloués, c’est
«l’évaporation des financements
destinés à l’activité de greffe »,
attribués sous forme de forfaits
aux établissements, qui pose pro-
blème. « Une partie est utilisée
pour combler les déficits. » L’impli-
cation des directeurs d’établisse-
ments, mais aussi des ARS, sem-
ble indispensable pour que l’acti-
vité greffe se développe.
En Lorraine, le réseau Néphrolor a
pris de l’avance. Alors qu’il visait
initialement à fédérer tous les ser-
vices de néphrologie des établisse-
ments hospitaliers de la région
autour des patients souffrants d’IRC
en phase terminale ou préterminale,
il s’est très vite étendu à la ville, en
articulant autour des patients à des
stades d’IRC encore peu avancés
«leur médecin traitant et les profes-
sionnels de santé libéraux: l’Idel, le
diététicien, le psychologue, le kiné-
sithérapeute et le pharmacien. Ils les
suivent au quotidien, les connaissent
bien et seront donc toujours là après
la greffe, qui n’est qu’une des étapes
du parcours de soin. C’est un véritable
apport d’oxygène: avec notre
2000epatient greffé au CHU de
Nancy, on n’imaginerait pas suivre
1400 patients à l’hôpital », résume
sa présidente, le DrMichèle Kessler.
Le même type de réseau existe à Lille
et Bordeaux. Imparable, le suivi
“hors hôpital” du patient transplanté
décharge les services de greffes d’une
partie des consultations. L’heure de
la reconnaissance des professionnels
de ville aurait-elle sonné?
GRANDES OUBLIÉES
Les médecins traitants disposent
d’un décret qui leur cède depuis
2006 la mission d’informer les jeunes
de 16 à 25 ans sur les « modalités de
consentement au don d’organes à
fins de greffe »(3). L’ABM leur réserve
un accès dédié sur son site Internet
et les sociétés savantes, des forma-
tions continues. On en est loin avec
les Idels, qui sont chanceuses si elles
ont bénéficié de quelques heures
de module en Ifsi leur expliquant le
concept de mort encéphalique. C’est
finalement sans surprise que les
Idels entretiennent bon nombre
d’idées fausses, relativisant elles-
mêmes leur rôle dans la chaîne du
don: « Cela ne concerne que les
jeunes, les bien-portants. » Bref,
pas vraiment ce qui compose l’es-
sentiel d’une clientèle il faut bien
l’avouer. Et puis, « c’est
SANTÉ PUBLIQUE DON DE VIE EN VILLE
Témoignage
« Dans le doute, le non l’emporte »
Cristina Malor, ex-infirmière coordonnatrice de prélèvements
à l’hôpital Foch (92), aujourd’hui Idel à Gif-sur-Yvette (91)*
« J’ai travaillé pendant quatre ans au service des greffes
pulmonaires à Foch. À la naissance de mon deuxième enfant,
j’ai revu mon organisation et ai quitté le service à contrecœur.
Pendant un an, je me suis chargée de la coordination des prélèvements d’organes,
toujours à Foch. On m’appelait lorsqu’un donneur était pressenti, pour gérer sa prise
en charge et celle de ses proches, car l’infirmière coordonnatrice est un pilier entre
la réa, le patient et la famille. De l’autre côté, j’étais en contact avec l’ABM qui tient
la liste des personnes en attentes de greffes. J’avais aussi pour mission de sensibiliser
le personnel de l’hôpital, les Ifsi... En réa, on reste avec le donneur jusqu’à la fin
du prélèvement au bloc opératoire, qui peut durer 24 heures. Je m’y étais préparée,
mais, du point de vue humain, on prend quelques claques quand même. On a vu tant
de patients partir faute de greffe, mais là, on découvre une famille sous le choc de
l’annonce du décès d’un proche qui n’a pas l’air d’être mort... La probabilité de pouvoir
donner est seulement de 1%, et là-dessus, la moitié ne le sera pas: dans le doute,
c’est toujours le non qui l’emporte. Aujourd’hui, en libéral, j’en parle sans tabou. »
*Membre du conseil d’administration de l’association Grégory Lemarchal Ensemble contre la mucoviscidose depuis 2007.
DR
(**# )"

« C’est génial de
préparer un bloc
pour une greffe.
Pourtant,
l’idée même
du prélèvement
véhicule encore
une image
pas franchement
positive,
alors que l’un
ne va pas sans
l’autre! »
20 L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE - N° 282 - JUIN 2012
difficile de parler
de la mort avec
une personne
déjà malade, on
n’a pas le temps
de le faire bien,
on ne nous
appelle pas pour
ça ». En témoigne
le parcours de
Michelle Bargin (cf.
L’ILM n°270), Idel à Voiron
(38) et très impliquée dans le
prélèvement de moelle osseuse
à travers l’association qu’elle
préside(4). « Il me paraît plus
compliqué d’aborder le don
d’organes avec un patient que de
l’informer sur le don de moelle, qui
est un don de vie de son vivant,
confie cette dernière. Là, on amène
le patient devant la possibilité de sa
propre mort. »
INFORMER
Ce qui tord le cou aux idées reçues?
Les rencontres. Ce sont finalement
les patients eux-mêmes qui sensi-
bilisent le mieux les Idels à la ques-
tion du don d’organes. C’est ainsi,
en s’attachant à un malade leucé-
mique, après plus de vingt ans
d’exercice, que Michelle Bargin a
eu ce qu’elle qualifie de « déclic ».
Idem pour Hervé Chirpaz, Idel
à Saint-Alban-Leysse (73),
devenu cadre de santé depuis
un an: « J’ai ouvert mon cabi-
net il y a vingt-huit ans.
Lorsqu’un centre de dia-
lyse s’est créé dans la
région, j’ai été immédia-
tement séduit par l’as-
pect technique de cet
acte. Mon approche du
don s’est faite au cours
des échanges avec les
personnes dialysées.
Puis mon cabinet s’est ouvert
à la prise en charge des
malades souffrant de muco-
viscidose et, là encore, le thème du
don s’est imposé dans nos échanges
sans forcément le chercher », raconte-
t-il. Le suivi des patients atteints de
mucoviscidose l’a considérablement
marqué: depuis cinq ans, il est mem-
bre du conseil d’administration de
l’association Grégory Lemarchal
Ensemble contre la mucoviscidose,
du nom de son patient médiatisé
par la Star Academy et décédé alors
qu’il était en attente d’une trans-
plantation de poumon. « On reste
une heure ou une heure et demie au
domicile, le temps que s’écoule la
perfusion d’antibiotiques, parfois
plusieurs fois par jour. Alors on
aborde l’option de la greffe avec le
patient, ses parents. Plus on maîtrise
le sujet, plus on en parle facilement.
J’ai deux enfants et on en parle avec
leurs copains, mes amis, les collègues.
Je m’interdis seulement d’en parler
avec les patients en fin de vie, sauf
si ce sont eux qui me lancent sur le
sujet. » Mais les Idels suivent aussi
bon nombre de malades chroniques.
Un contexte propice, si ce n’est à
sensibiliser le patient, à lancer le
débat avec le conjoint ou les parents
jamais bien loin.
Et si les Idels n’abordent pas toutes
la question du don, elles s’épanchent
plus facilement sur la greffe. Ce
(**# )"
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%