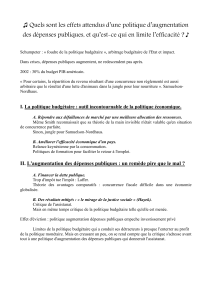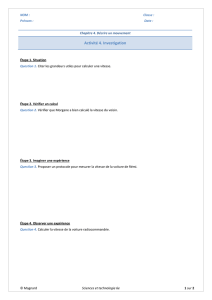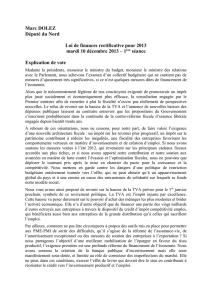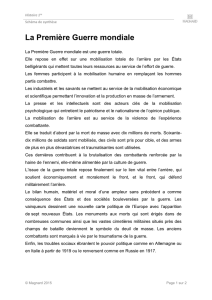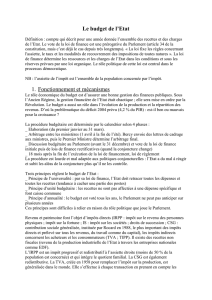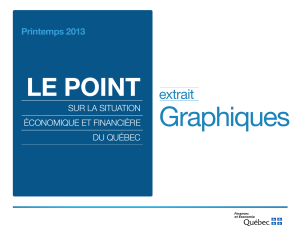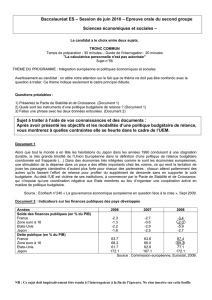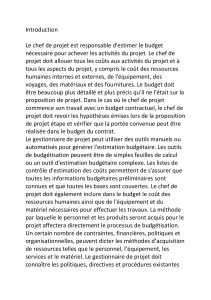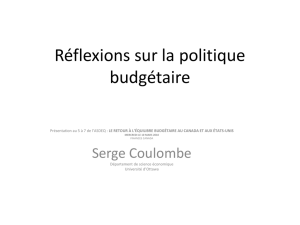Chapitre 6: Les mécanismes du marché

66
• Les trois documents proposés page 156 forment systè-
me, les deux photos illustrant le propos du très libéral L.V.
Mises. Ils ont pour but de rappeler aux élèves que, dans
les économies de marché, les phénomènes d’offre-deman-
de, ne concernent pas seulement les bourses de matières
premières ou de titres: les rémunérations en dépendent
aussi dans une large mesure (on pourra y revenir avec
l’exemple d’Adam Smith), et le prix du travail se forme
comme celui des autres marchandises, ouvrant la porte à
de très fortes inégalités, d’où la nécessité de correctifs,
comme on pourra le voir dans les chapitres suivants.
On a choisi comme vedette Didier Drogba (le foot est un
marché, on utilise souvent le terme de mercato), mais les
élèves pourront rechercher d’autres exemples parmi les
acteurs, les chanteurs, les mannequins et, bien entendu,
les PDG qui en apparence ramèneront plus directement à
la matière économique. Les faibles revenus sont illustrés
par l’image du balayeur. La question est celle posée par
Mises « Qu’est-ce qui fait le prix? ». Du côté de l’offre, il
s’agit ici d’un buteur, type de footballeur dont les spécia-
listes disent qu’il est aussi rare que le diamant (vieil
exemple canonique en économie), d’où son prix (un entraî-
neur estimait que s’il marquait une vingtaine de buts, il
aurait justifié son prix). Mais il ne faut pas oublier le côté
de la demande, les grandes équipes attirent les specta-
teurs, les sponsors publicitaires et les télévisions (les
grandes équipes font l’audimat): ce sont donc bien les
consommateurs qui font en définitive le prix. Le balayeur,
malheureusement pour lui, ne bénéficie pas de cette rare-
té relative d’où une situation moins confortable (on pour-
ra demander aux élèves combien ils sont prêts à payer un
balayeur ou une femme de ménage pour leur domicile).
• La BD a pour but d’attirer l’attention sur le rapport prix
de marché – offre, demande – coût de production, l’en-
treprise qui a des coûts élevés éprouvant d’importantes
difficultés, qu’elle peut parfois contourner par des straté-
gies de différenciation, à l’exemple du dernier heureux
producteur.
Chapitre 6 : Les mécanismes du marché
Utilisation des documents de sensibilisation (pp. 156-157)
Réponses aux questions
I. Le marché: lieu de confrontation de l’offre et de la demande (pp. 158-163)
Document 1
1On peut observer de 1880 aux années 1960-1970 une
stabilité assez remarquable du prix du pétrole, surtout
en dollar constant, y compris pour la période de recons-
truction. On observe une forte poussée du prix au
moment des deux chocs pétroliers (1973-1979) qui
marquent une rupture très nette dans l’évolution des
cours. Jusque-là, les découvertes nouvelles avaient
accompagné la progression de la demande et les pays
producteurs n’avaient pas pu mettre en place une orga-
nisation aussi puissante que l’Opep pour défendre
leurs intérêts face aux compagnies pétrolières déjà
organisées en cartel. Les dissensions au sein de l’Opep,
le recours aux énergies de substitution et les politiques
d’économie d’énergie ont favorisé une retombée des
prix aussi brutale que les hausses précédentes, sem-
blant ouvrir une nouvelle période de stabilité au niveau
de 30 $ le baril. Cependant, le retour de la croissance
à la fin des années 1990 a provoqué l’apparition de
nouvelles tensions sur le marché et, à l’été 2004, on a
retrouvé les chiffres record de 1979 ouvrant peut-être
une période de pétrole beaucoup plus cher avec la
perspective d’un épuisement des réserves à l’horizon
d’une quarantaine d’années.
2La période de l’été 2004 a marqué le retour à des
niveaux de prix comparables à ceux du choc de la fin
des années 1970. Cependant, il s’agit d’une montée
moins brutale dans la mesure où elle ne résulte pas
d’une décision stratégique du cartel mais d’une accu-
mulation de tensions que les opérateurs des marchés
ont intégré dans leurs calculs.
Document 2
3La croissance économique peut se définir comme
l’augmentation continue, sur longue période, de la
production d’une nation ou d’un groupe de nations,
la production étant généralement mesurée à l’aide
d’un indicateur global comme les agrégats de la
comptabilité nationale (PIB ou le PNB).
4La production met en œuvre de nombreuses
machines qui mobilisent une énergie considérable.
Toute augmentation de la production entraîne donc
une augmentation de la consommation d’énergie et
de sa source principale, le pétrole
5La demande a progressé plus vite que prévu en rai-
son de la croissance soutenue de l’économie chinoi-
se, qui pèse considérablement en raison de la masse
qu’elle représente, et de l’économie américaine. Du
côté de l’offre, la marge de progression est très limi-
tée. D’une part, les investissements ont été trop limi-
tés dans la période antérieure, ce qui réduit les pos-
sibilités d’augmentation de la production et du
raffinage. D’autre part, les difficultés géopolitiques
font douter de la capacité de certaines zones à four-
nir toutes les quantités que l’on pourrait en attendre
en l’absence de conflit.
6Une fusion d’entreprises consiste à rassembler au
sein d’une même entreprise les actifs de deux ou plu-
sieurs entreprises. Les compagnies pétrolières sont
parmi les plus grandes entreprises du monde: Exxon,
BP, R.D. Shell, Texaco, Total Fina Elf
Le terme de mégafusion fait référence à la très gran-
de taille de ces compagnies.
© Magnard – 2005

7On peut citer les investissements de prospection pour
trouver de nouveaux gisements, la construction ou
l’extension de raffineries ou le développement des
moyens de transport (navires, oléoducs); ces inves-
tissements permettraient d’augmenter l’offre.
8Les activités pétrolières sont très vulnérables, à l’ima-
ge des oléoducs et des puits (coupures, incendies).
Leur bon fonctionnement suppose donc une assez
grande stabilité politique. Or une partie essentielle de
l’exploitation pétrolière se trouve concentrée dans
une zone géographique politiquement instable, car
épicentre de plusieurs conflits majeurs (Palestine,
Irak, Pakistan-Inde). Les opérateurs sont donc très
attentifs à l’évolution de ces conflits, et la moindre
aggravation déclenche des mouvements spéculatifs
d’assez grande ampleur, de même en sens inverse,
que toute perspective de paix.
Document 3
9Le marché des petites voitures urbaines ou des
grosses cylindrées sportives, le marché des garçons
de café dans une ville
10 Mont-de-Marsan et Saint-Brieuc constituent des mar-
chés différents en raison de leur distance géogra-
phique qui fait qu’aucun café de Mont-de-Marsan ne
constitue un concurrent pour un café de Saint-Brieuc
car aucun consommateur de Saint-Brieuc n’ira se ser-
vir dans un café de Mont-de-Marsan. Une différence
de prix entre les deux villes ne déclenchera donc
aucun transfert de consommateurs.
11 Quel que soit le cours du dollar l’été prochain, vous
débourserez 1100¤pour obtenir vos 1000 $. L’intérêt
d’une telle opération est de vous permettre de
connaître à l’avance le coût de votre voyage, indé-
pendamment des variations de cours.
12 Les marchés à terme offrent la possibilité de décider
immédiatement des conditions d’achat ou de vente
du pétrole, le pétrole n’étant disponible et la tran-
saction n’ayant effectivement lieu qu’à une date futu-
re bien précise.
13 Les marchés à terme sont des marchés où l’on peut
pratiquer des échanges qui sont exécutés ultérieure-
ment aux conditions fixées au moment de la passa-
tion du contrat.
14 On peut dire qu’il existe une infinité de marchés dans
la mesure où il y a une offre et une demande spéci-
fique pour chaque variété de bien (par exemple blé
dur, blé tendre, etc.) ou de service. Comme il existe
une infinité de variétés de biens et de services, on
peut considérer qu’il y a une infinité de marché.
Document 4
15 On peut citer le café et le thé, le vin et la bière… le fro-
mage ou le dessert, le nylon ou le coton, l’électricité
ou le fuel pour le chauffage domestique, etc.
Lorsque le prix d’un bien monte, le consommateur
peut estimer qu’il devient trop cher pour lui (soit
parce qu’il n’a plus les moyens, soit parce qu’il consi-
dère que l’écart avec le substitut ne se justifie pas
par rapport à ses préférences) et reporter ses achats
sur un produit moins cher. Par exemple, si le prix de
la 1re classe augmente de 20 %, on peut se résigner
à voyager en seconde.
16 Ces reports ne sont pas toujours possibles. Les pro-
duits n’ont pas nécessairement des substituts assez
proches, ou les substituts n’existent pas. Par
exemple, le TGV ne constitue un substitut à l’avion
que pour certaines destinations. Par ailleurs, les
consommateurs ne peuvent pas toujours réduire leur
consommation: le représentant de commerce ne peut
se passer de son automobile.
Exercice, p. 160 • Étudier une courbe de demande
1Pour 5¤, la consommation est estimée à 90, pour 30¤,
à 40.
Ce résultat est conforme aux éléments fournis dans le
document 4. À 90¤, les consommateurs peuvent se
procurer avec leur revenu une quantité moins forte
de crème glacée et, dans ces conditions, certains
d’entre eux reporteront leurs achats sur d’autres pro-
duits
2Ce raisonnement s’applique, bien entendu, au pétro-
le ; si le prix continue de s’élever, d’une part la
consommation de charbon et de nucléaire va se déve-
lopper, comme cela a déjà été le cas au cours des
années 1970, et, d’autre part, cela va relancer les éco-
nomies d’énergie.
Document 5
17 On peut citer les sorbets comme substituts très
proches, ou les milk-shakes, ainsi que la multitude de
produits lactés ou non proposés par les firmes de l’in-
dustrie agro-alimentaire. Ces produits sont très sou-
vent présentés dans des conditionnements, comme
les cornets ou des coupes, et conservés dans des
chaînes de froid, qui constituent des produits com-
plémentaires.
Si le prix des produits complémentaires s’accroît, cela
revient à alourdir les coûts d’usage de la crème gla-
cée, et donc à réduire sa consommation. La diminu-
tion du prix des produits substituables produit des
effets identiques. Inversement, l’augmentation du
prix des produits substituables ou la diminution du
prix des produits complémentaires tend à augmenter
la consommation de crème glacée.
18 Si le revenu des ménages s’accroît, ils pourront se
procurer, à prix inchangé, une plus grande quantité de
bien. Graphiquement, pour un même niveau de prix,
on aura donc une quantité demandée plus importan-
te, ce qui se traduit par un point plus à droite sur le
graphique. La courbe de demande se déplacera donc
vers la droite.
19 Si le revenu des ménages diminue, ils pourront se
procurer, à prix inchangé, une quantité moins impor-
tante de bien. Graphiquement, pour un même niveau
de prix, on aura donc une quantité demandée plus
faible, ce qui se traduit par un point plus à gauche sur
le graphique. La courbe de demande se déplacera
donc vers la gauche.
Document 6
20 Les entreprises offrant un produit sur le marché cher-
chent à le vendre et à en obtenir un bénéfice. Il faut
donc que le prix soit supérieur au coût de production.
21 Les coûts de production représentent les sommes que
67
Chapitre 6 : Les mécanismes du marché
© Magnard – 2005

68
doivent débourser les producteurs pour se procurer
les facteurs de production nécessaires pour produire
(main-d’œuvre, machines, matières premières). Les
entreprises cherchent à les réduire pour accroître leur
bénéfice (à prix inchangé), ou baisser leur prix pour
gagner des parts de marché ou faire face à la concur-
rence.
Exercice, p. 161 • Étudier une courbe d’offre
1
2La courbe d’offre est croissante avec le niveau de prix.
En effet, au prix le plus bas, 5¤ici, seules les entre-
prises qui ont un coût inférieur, c'est-à-dire ici les plus
performantes, peuvent offrir. À 10 ¤, des entreprises
qui ont des coûts plus élevés peuvent à leur tour offrir
leur produit sur le marché et viennent s’ajouter aux
précédentes: l’offre augmente donc avec le prix. On
retrouve le même phénomène avec le pétrole.
3L’offre est une fonction croissante du prix. Quand le
prix d’une marchandise augmente (toutes choses
égales par ailleurs), les producteurs tendent à offrir
une quantité plus importante. De même quand le prix
baisse (toutes choses égales par ailleurs), la quanti-
té offerte baisse
Exercice, p. 162 • L’ajustement offre-demande
1Le prix d’équilibre est de 25 ¤, point de rencontre de
l’offre et de la demande.
2À ce prix, on écoulera 50 kilos de crème glacée.
Document 7
22 Dans la mesure où il existe un nombre très élevé de
produits et de caractéristiques des produits, et qu’il
y a autant de marché correspondant, il existe un
nombre quasiment infini de marchés. La notion
d’équilibre général fait alors référence à l’existence
d’une situation où tous ces marchés sont simultané-
ment à l’équilibre. Il existe donc à un moment donné
un ensemble de prix qui assurent l’équilibre sur tous
les marchés. Pour reprendre l’exemple de la bourse
qui comporte autant de marchés que de titres côtés,
à la clôture, les cours qui sont publiés sont les prix qui
assurent l’équilibre sur ces différents marchés.
23 Le commissaire-priseur s’arrête de crier un prix plus haut
ou plus bas lorsque l’offre est égale à la demande.
Application
Document 8
24 La rareté relative du pétrole s’est accrue au cours de
la période: d’un côté, la demande a augmenté forte-
ment, du fait de la croissance forte des pays d’Asie et
des Etats-Unis, et, d’autre part, l’offre, freinée par la
faiblesse des investissements, n’a pas pu suivre. Un
excès de demande est donc apparu sur les marchés,
qui explique la montée du prix selon le modèle du
schéma précédent.
25 L’information transmise par le système de prix est
essentielle pour l’économie car elle constitue une des
bases du calcul économique des agents: on choisit,
par exemple, son mode de chauffage en partie sur la
base des prix du fuel ou de l’électricité. La hausse du
prix du pétrole informe les agents qu’il devient plus
rare et qu’il faut donc l’économiser. Elle rend par
ailleurs rentables des ressources alternatives, comme
le solaire par exemple.
Document 9
26 Ces mouvements de prix signalent que les consom-
mateurs désirent acheter moins de chaussures (leur
prix baisse) et plus de gants (leur prix s’élève), donc
qu’il faut produire plus de gants et moins de chaus-
sures.
27 Ces mouvements de prix affectent les bénéfices et la
rémunération des producteurs. Si le prix des chaus-
sures baisse, les producteurs qui ont les coûts les
plus élevés vont se retirer du marché, ce qui entraîne
une baisse de la production qui « libère » des tra-
vailleurs pour d’autres activités devenues plus ren-
tables puisque leur prix s’élève (ici les gants). Les
variations de prix contraignent donc les producteurs
à quitter des activités devenues moins rentables pour
s’orienter vers les activités plus rémunératrices.
QuantitéPrix
105
2010
3015
4020
5025
6030
7035
Demande > Offre
Demande < Offre
D = O
D = O
Prix augmente
Prix diminue
L’offre
augmente
La demande
diminue
L’offre
diminue
La demande
augmente
Déséquilibres Mécanisme d’ajustement Équilibre
Faites le point
II. Les diverses formes de marché (pp. 164-167)
• informe: voir réponse à la question 25 ;
• rationne: la hausse du prix du pétrole réduit la demande;
• incite: elle entraîne une modification des comporte-
ments: voir réponse à la question 25.
Document 10
28 Si le nombre d’entreprises est très élevé, l’importan-
ce relative de chacune se trouve réduite, ce qui dimi-
nue leur capacité d’influencer le marché.
29 On peut citer toutes les activités soumises à un
nombre limité de licences d’exploitation: chauffeur
de taxi, pharmacie, débit de boisson, bureau de
tabac…
30 Si les produits sont strictement homogènes, tout
écart de prix entre deux points de vente entraînerait
© Magnard – 2005

des déplacements massifs d’acheteurs qui rendraient
impossible le maintien d’un prix plus élevé sur l’un
des points de vente.
31 La pratique de prix élevés permet de réaliser des pro-
fits plus importants qui vont attirer des concurrents.
S’il y a liberté d’entrée sur un marché, ceci va provo-
quer une baisse des prix, soit de manière purement
mécanique, puisque l’augmentation de l’offre, consé-
quence des entrées, pousse les prix à la baisse; soit
par le jeu de la concurrence, les entrants pratiquant
des prix plus bas pour prendre la place des entre-
prises en place.
32 L’exemple pris par A. Smith suppose, d’une part, la
mobilité des travailleurs qui vont passer de la fabri-
cation des chaussures à celles des gants et, d’autre
part, la libre entrée des nouveaux producteurs sur le
marché des gants. Il s’agit donc bien de deux condi-
tions indispensables au fonctionnement du mécanis-
me des prix.
Document 11
33 La productivité mesure la quantité de produit obtenue
par unité de facteur de production. Par exemple, la
productivité horaire indique la production obtenue
pour une heure de travail. Les gains de productivité
représentent l’augmentation de production résultant
des améliorations apportées au processus de pro-
duction, ils permettent d’abaisser les coûts de pro-
duction.
La concurrence pousse à dépasser les autres entre-
prises. Pour cela, il faut parvenir à produire moins
cher (gains de productivité), mieux (la qualité) ou des
produits nouveaux. Ceci résulte la plupart du temps
de la mise en œuvre d’innovations, qui portent soit
sur la fabrication (innovation de processus), soit sur
les produits (innovation de produit).
34 Les entreprises les moins performantes sont celles
qui présentent les coûts les plus élevés, ce qui signi-
fie que, pour une même quantité produite, elles uti-
lisent une quantité de facteurs plus importante ; elles
consomment par exemple plus d’énergie que
d’autres. On peut donc considérer que consommant
plus de facteurs que d’autres, ce supplément de fac-
teur qui leur est nécessaire représente en fait un gas-
pillage de ressources.
Document 12
35 Ce tableau présente une vision de la concurrence qui
repose sur le nombre de participants au marché: plus
ce nombre est élevé, plus la concurrence est forte, le
pouvoir de marché des acteurs dépendant de leur
nombre.
36 Les situations de monopole ou de monopsone sont
très rares car il s’agit d’une configuration de marché
condamnée par les lois. Il existe cependant quelques
monopoles légaux, comme c’était le cas d’EDF qui
était en monopole pour la fourniture d’électricité et en
situation de monopsone vis-à-vis des producteurs
indépendants.
Aujourd’hui, les grandes centrales d’achat de firmes
comme Carrefour ou Walmart aux USA se trouvent
selon les domaines en situation d’oligopsone (agro-
alimentaire) ou d’oligopole bilatéral (pneumatique,
essence)
La situation d’oligopole est très fréquente: électro-
nique (Intel, AMD ; Sony Samsung, Toshiba etc.),
acier, ciment…
Document 13
37 La liberté d’entrée permet d’accroître le nombre de
producteurs, donc la production (la courbe d’offre se
déplace vers la droite); cette augmentation de l’offre,
toutes choses égales par ailleurs, entraîne une bais-
se du prix
38 La baisse du prix des chaussures et la hausse du prix
des gants signalent aux producteurs que les désirs de
consommateurs se sont modifiés : il faut produire
moins de chaussures et plus de gants, ce qui néces-
site le transfért des ressources productives de la
chaussure à la ganterie. La hausse du prix des gants
conduit les entreprises à embaucher des gantiers ou
à augmenter leur salaire. La baisse du prix des chaus-
sures contraint les entreprises à licencier des cor-
donniers ou à réduire leur salaire (prix du facteur tra-
vail), ce qui pousse ces salariés à rechercher des
activités plus rémunératrices (ici la ganterie qui pré-
cisément embauche).
Le facteur travail est donc bien attiré dans certains
emplois (les gants) et écarté d’autres emplois (les
chaussures).
39 Dans le cadre de la CPP, les entreprises sont d’une
taille trop faible par rapport à l’ensemble du marché
pour pouvoir l’influencer. Par exemple, un petit pro-
ducteur de pommes de terre peut augmenter sa pro-
duction de 20 %, les quelques quintaux de plus repré-
sentent un pourcentage trop faible de la production
totale pour faire varier le prix du marché. L’équilibre
du marché est donc indépendant des décisions des
différents acteurs considérés isolément.
40 Il y a efficience lorsque les ressources sont utilisées
de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire
sont produites en utilisant la quantité la plus faible
possible de facteurs de production. En CPP, les agents
ne pouvant agir sur le prix, ne peuvent améliorer leur
situation qu’en abaissant leurs coûts, ce qui les inci-
te aux gains de productivité.
Document 14
41 Pour Hayek, l’information étant radicalement impar-
faite, le modèle de CPP est un état abstrait impos-
sible à atteindre qui ne présente donc que peu d’in-
térêt; il tire de cet état de fait la conclusion que la
situation d’information imparfaite nécessite précisé-
ment des échanges et une circulation de l’informa-
tion permettant aux agents d’adapter leurs compor-
tements aux données recueillies. C’est précisément
selon lui au cours de leur participation au marché que
les agents vont produire et échanger de l’information
nouvelle. Pour lui, c’est donc au niveau de la diffusion
de l’information que le marché se révèle inégalable et
irremplaçable.
42 Le calcul économique néoclassique permet d’at-
teindre une situation optimale sous une hypothèse
d’information parfaite, si celle-ci se révèle impossible,
69
Chapitre 6 : Les mécanismes du marché
© Magnard – 2005

il est impossible de parvenir à cet optimum.
43 C’est sur le marché que les agents révèlent leurs pré-
férences et donc produisent de l’information (lorsque
l’on « fait les magasins », on révèle au vendeur ce qui
nous plaît, quel prix nous sommes prêts à payer, nous
découvrons ce que veulent les autres, s’il y a beau-
coup ou peu d’acheteurs, les conditions que le ven-
deur est disposé à nous accorder…). Cette interaction
acheteur-vendeur peut même produire éventuelle-
ment une information qui n’existait pas auparavant.
C’est pourquoi l’on peut dire que le marché est un
processus de découverte.
Document 15
44 La SNCF correspond exactement à la définition du
monopole d’E. Malinvaud puisqu’elle est seule à four-
nir du transport ferré en face d’un très grand nombre
d’acheteurs.
45 La demande présente les mêmes caractéristiques
dans les deux cas puisqu’il existe un très grand
nombre d’acheteurs. La différence se situe seulement
au niveau de l’offre.
46 Non, car cela risquerait de réduire tellement la
demande que l’opération se révèlerait non rentable:
d’une part, un certain nombre de personnes renon-
ceraient à voyager et, d’autre part, la demande pour-
rait se reporter sur des produits de substition, comme
l’avion ou l’autocar.
Exercice, p. 166 • Calculer le prix de monopole
110 à 10 ¤et 60 à 5 ¤
2Produire 10 « big foot » lui coûte 40 ¤, la vente lui
rapportera 100 ¤: son bénéfice sera donc de 60 ¤.
Produire 60 « big foot » lui coûte 165 ¤, la vente lui
rapportera 300 ¤: son bénéfice sera donc de 135 ¤
3
Le bénéfice maximum est obtenu pour un prix de
vente de 7 ¤qui permet un bénéfice de 175 ¤.
Document 16
47 Ce marché se différencie du marché de CPP du côté
de l’offre où l’on ne trouve plus qu’un petit nombre
d’entreprises, comme on le voit sur le graphique.
48 Ce marché correspond à la définition de l’oligopole
puisqu’il ne comporte plus qu’un nombre limité de
producteurs, chacun occupant des parts de marché
significatives.
49 À partir du moment où chaque entreprise détient une
part importante du marché, une modification de son
comportement d’offre a un impact suffisant pour
modifier l’équilibre du marché et affecte donc la situa-
tion de toutes les autres. Par exemple, si Microsoft
modifie le prix de sa console de jeux, Sony et
Nintendo seront obligés d’en tenir compte et d’ajus-
ter leur comportement.
Document 17
50 Les lessives sont des produits différenciés dans la
mesure où des investissements publicitaires massifs
s’efforcent de conférer à chaque marque une image
spécifique.
51 Le nombre de producteurs et d’acheteurs est le même
qu’en CCP (atomicité) mais cette fois, c’est l’hypo-
thèse d’homogénéité qui n’est plus respectée.
L’élément de monopole tient au fait que les consom-
mateurs préfèreront, pour diverses raisons, une
marque même si elle est éventuellement plus chère
(Mercedes, Sony, Intel, etc.) parce qu’ils considèrent
que le produit de cette marque présente des caracté-
ristiques absentes dans les autres produits.
L’entreprise est donc seule à fournir ce type de pro-
duit et se trouve ainsi en situation de monopole en ce
qui concerne ces éléments, que le consommateur
juge important pour lui. Évidemment cette marge de
manœuvre du producteur vis-à-vis de sa clientèle a
des limites, car les produits des concurrents sont des
substituts proches, et, passé un seuil de différence de
prix, la demande va basculer vers les autres marques.
52 L’entreprise qui a su différencier ses produits dispo-
se d’une clientèle attachée à leurs caractéristiques
réelles ou supposées. Cette clientèle acceptera de
payer un prix plus élevé pour ces caractéristiques
qu’elle ne retrouve pas dans d’autres produits.
53 L’élasticité prix de la demande mesure la sensibilité
de la demande aux variations relatives de prix. Si deux
produits sont considérés comme strictement équiva-
lents, toute augmentation du prix de l’un, le prix de
l’autre restant fixe, se traduit par une forte diminution
de la demande de ce produit. L’élasticité prix est donc
dans ce cas très élevée. Plus les produits seront consi-
dérés comme différents par les consommateurs, plus
faible sera la variation de demande consécutive à la
hausse du prix. La valeur de l’élasticité en sera d’au-
tant plus faible.
Publicité pour Paic: les éléments de différenciation
sont notamment le parfum (citron vert) et l’innova-
tion (plus besoin d’essuyer).
Document 18
54 Deux entreprises assurant l’essentiel de l’offre, il
s’agit d’un oligopole, d’autant que les produits offerts
apparaissent comme très proches puisque le prix
semble être le facteur concurrentiel principal. On est
donc assez proche de l’homogénéité.
55 Le prix apparaît comme l’argument de vente essentiel
puisque les produits sont très proches.
56 La recherche est la solution la plus coûteuse pour les
entreprises, mais comme elle détermine les possibi-
lités d’abaissement des coûts, aucune entreprise ne
peut courir le risque de se voir distancer par l’autre
en arrêtant ou en ralentissant son effort de recherche.
Elles sont donc contraintes par le risque concurren-
tiel de poursuivre leur effort.
Elles pourraient bien entendu s’entendre pour limiter
cet effort, mais il y a toujours dans ces cas-là le risque
que le concurrent triche.
70
Coût totalPrix
4010
709
908
1057
1356
1655
210
Bénéfice
60
110
150
175
165
135
704
Quantité
10
20
30
40
50
60
70
Recette
100
180
240
280
300
300
280
270 – 303 80 240
© Magnard – 2005
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%