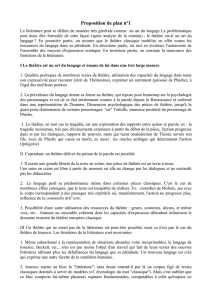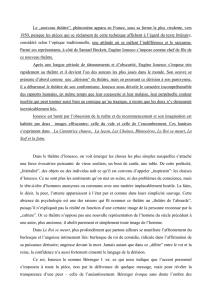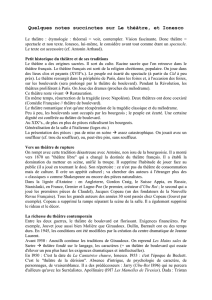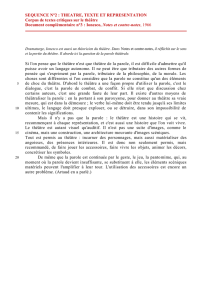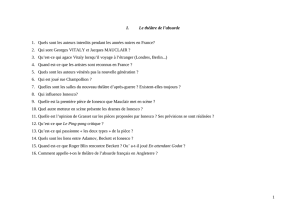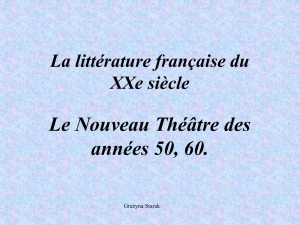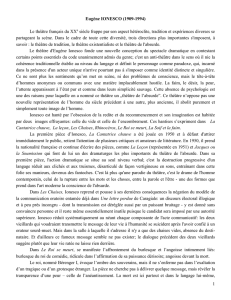Le roi est nu

Le roi est nu
°Pesci), ses cauchemars,
essions, ses fantasm
et
ses limites
Jean Carmet dans le rôle-titre de Ionesco
Le modèle est beaucoup plus fou, beaucoup plus drôle
THÉÂTRE
ION ESCO
de Ionesco
Théâtre national populaire (Villeurbanne).
• C'était il y a trente ans. On découvrait
Ionesco, Beckett, Adamov, la sacro-sainte trilo-
gie du « théâtre de l'absurde ». Depuis, Beckett
a eu le prix Nobel et n'écrit plus que des mono-
logues parcimonieux. Adamov, après avoir vai-
nement tenté d'être communiste, s'est suicidé.
Ionesco est entré à l'Académie pour être bien
sûr d'être français et définitivement échapper à
son pays d'origine, en proie à une tyrannie plus
absurde que ce que leur ancêtre à tous, Alfred
Jarry, avait pu imaginer...
Pour Ionesco, rien n'a pu prévaloir contre
l'angoisse qui le mine. Comme il nous l'a dit
longuement ici même, il y a trois mois (1), il
s'est réfugié dans ses rêves, ses cauchemars plu-
tôt, qui le ramènent à sa jeunesse, à sa famille
défunte, au sentiment de n'avoir rien fait,
d'avoir vécu pour rien.
Il a raconté tout cela, pêle-mêle, dans une
longue pièce parue chez Gallimard, sous le titre
de « Voyage chez les morts », que Roger Plan-
chon vient de monter, en lui adjoignant d'autres
textes de Ionesco, dont « l'Homme aux vali-
ses », qui le peignait déjà en éternel émigré —
(1) Voir « le Nouvel Observateur » n° 946, du 25 décembre
1982.
un Charlot des nouveaux temps... Baptisé
« Ionesco », ce spectacle devient une sorte
d'autobiographie sans fard, le
-
première de ce
genre au théâtre, même l'on sait que Plan-
chon avait déjà interprété une vie d'Adamov, à
travers son théâtre et ses confessions.
Eloge funèbre
D'ailleurs, pour que nul ne s'y trompe, on
amène au début de la pièce deux cercueils
devant lesquels le personnage nommé Ionesco
prononce une espèce d'éloge funèbre. Les deux
disparus se nomment Adamov et Sartre. Ionesco
les a vilipendés de leur vivant. Aujourd'hui, il le
regrette, ne serait-ce-que parce qu'il est lié à eux
par une époque qu'ils ont décrite au même
moment. Avec les défunts, c'est aussi l'instant
que choisit son épouse pour lui annoncer que
Beckett vient d'avoir «
le premier prix de littéra-
ture mondiale ».
Le pauvre « Ionesco » ne
serait-il qu'un raté ? Cette autobiographie va
être celle d'un échec perpétuel, d'une mise à nu
semblable à celle qui dictait à Camus la
Chute » ou à Sartre « les Mots ».
Venons-en au spectacle. Pour jouer le rôle de
Ionesco, Roger Planchon a réussi à ramener à la
scène une vedette de cinéma, Jean Carmet, petit
de taille, au visage malheureux, dont la voix est
la même que celle d'un comédien qui jouait
autrefois Ionesco, Claude Nicot.
Jean Carmet a pris son rôle très au sérieux.
S'il tient la scène tout au long de la soirée, ce
qui est une prouesse, il n'a peut-être pas assez
d'humour. Il s'attendrit trop sur son personnage
pour tout à fait ressembler à son modèle.
Ionesco est beaucoup plus fou, beaucoup plus
triste et beaucoup plus drôle. C'est lui qui aurait
dû jouer son propre rôle... Mais c'est sa faute,
en grande partie, si Jean Carmet n'est pas le
clown triste que nous espérions. Ionesco a
renoncé aux métaphores et aux symboles déri-
soires que, de « Victimes du devoir » au « Roi
se meurt », il avait fait servir aux mêmes plon-
gées dans la culpabilité et les tristesses d'une vie
qui doit finir un jour. Cette fois, il ne transpose
plus. Tout juste se sert-il des liberté que lui
permet, à travers les arcanes du rêve, Son
« Voyage chez les morts », comme -on l'a vu
faire à Max Frisch dans « Triptyque ».
Les policiers qui vérifient à tout bout de
champ l'identité des gens, le consul gâteux qui
pourrait octroyer un visa sauveur, les médecins
et les infirmiers sadiques d'un hôpital où l'on
pratique l'euthanasie pour libérer des lits appar-
tiennent à une réalité déformée, certes, mais
sans ambiguïté possible. Les grands:parents et
les parents que Ionesco se retrouve dans ses
rêves ou aux enfers sont vraiment les siens. Il les
aime et les déteste à la fois. La peur de la Mort
et, plus encore, celle d'un cataclysme mondial
lui font douter de son métier d'écrivain, tout
juste bon à dire cette peur.
Sans ambiguïté
Sa sincérité est si grande qu'on devrait avoir
honte de regretter le temps où, pour dire les
mêmes choses, il inventait des vieillards qui
accumulaient des chaises, une fiancée à trois
nez, un cadavre qui ne cessait de grandir, un roi
qui avait, lui aussi, peur de la mort. En même
temps, Ionesco s'exprime avec une tendresse
qu'on ne perçoit plus guère sur nos scènes ou
nos écrans. Pessimiste et amer, il est plus géné-
reux que bien des idéologues, envers lesquels il a
même renoncé à se montrer agressif.
La transposition .técessaire à tout art théâtral,
- Roger Planchon U a réalisée dans une mise en
scène à grand spectacle dont Carmet-Ionesco
n'est que le protagoniste, le récitant. Un
immense décor — de Thierry Leproust — rappe-
lant un barrage ou une digue abrite une multi-
tude de personnages qu'on dirait sortis d'un
conte d'Hoffmann. Costumés par Jacques
Schmidt et Emmanuel Peduzzi, qui travaillent
aussi avec Chéreau, surgissent un vieux Rou-
main, des pleureuses en longs voiles de deuil,
des dames court-vêtues ou en culotte de cuir.
Celles-ci sont du genre géantes, écrasant de leur
taille et de leurs mamelles le malheureux rêveur.
Les mères en chemise de nuit, une lampe à la
main, se multiplient à l'infini. Les scènes
d'hôpital, de terrorisme sortent tout droit des
films d'horreur ou des bandes dessinées. On voit
même un Christ en robe de femme qui tient une
rose — symbole dérisoire d'un infini que le
Ionesco dé la pièce, «
existant spécialisé »,
évo-
que en vain.
Aucune pièce de Ionesco, jusqu'ici, n'avait
bénéficié d'un tel concours de comédiens con-
nus, de figurants, d'images, de sons, comme si
Planchon s'était chargé d'indiquer les métapho-
res auxquelles Ionesco a renoncé. «
Ce qui doit
être présenté sur un plateau,
dit-il,
doit avoir
l'évidence monstrueuse du réel et des rêves. »
Il
a tenu promesse. Ce grand homme de théâtre, le
plus lucide que j'aie jamais connu, ne laisse rien
au hasard. Sa mise en scène atteint à une sorte
de perfection qu'on est forcé d'admirer sans être
ému autant qu'on le devrait. GUY
DUMUR
Le Nouvel Observateur 93
1
/
1
100%