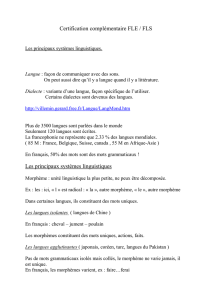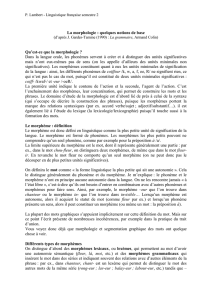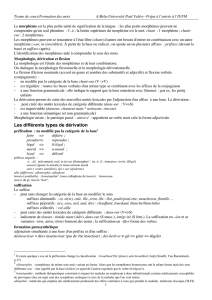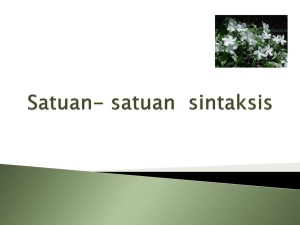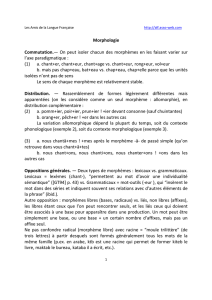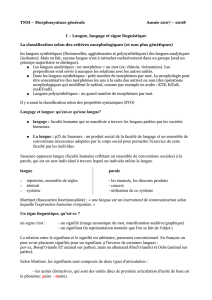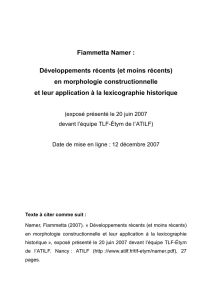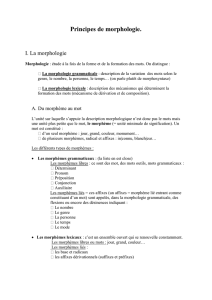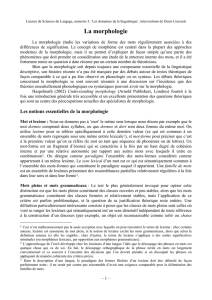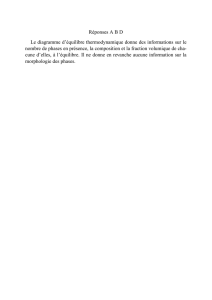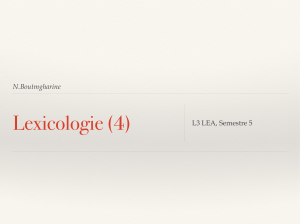Cours 3 - Cours de linguistique théorique et descriptive

1
Morphologie 1
29/09/2010
Cours 3
Ce document a été rédigé à partir de notes prises
durant les cours. Il ne remplace pas le cours du
professeur ni vos propres notes. Envoyez vos
remarques à : coursdelinguistique@yahoo.fr
La linguistique consiste à étudier le langage à travers les langues. Nous
souhaitons appréhender la morphologie qui est un domaine de la linguistique.
Dans le cadre des langues indoeuropéennes, comment la morphologie fait la
différence entre un morphème et un mot ? La morphologie présente des
spécificités. Existe-t-il des méthodes spécifiques qui permettent d’étudier notre
sujet ? La démarche suivie par la morphologie est structuraliste (méthodologie).
Il y a de nombreuses caractérisations de la linguistique (voir cours 2) qui
s’inscrivent toutes dans une dualité. On adopte une approche de type
structuraliste (opp. comparative). L’apport majeur du structuralisme est la
dichotomie qui permet de ne plus prendre un fait comme un élément isolé mais
en relation avec d’autres éléments (axe syntagmatique, axe paradigmatique).
Quand on travaille sur les langues, on regarde :
1. les sons
2. la syntaxe (relation entre les éléments du syntagme ou l’organisation des
mots (les constituants-les groupes) dans une phrase
La morphologie (morpho- et -logie
)
consiste à décrire la structure interne
des mots et étude des règles qui régissent cette structure. C’est la description des
règles régissant la structure interne des mots et de celles qui régissent la
combinaison des syntagmes en phrases. La question est de savoir comment peut-
on mettre en évidence la structure interne d’un mot ? Pour répondre à cette
question, on fera référence au Chap. 6 du livre Problèmes de Linguistique
Générale I, d’É. Benveniste.
On peut définir un lemme (item lexical) comme
l'unité autonome
constituante du lexique d'une langue. C'est une suite de caractères formant une
unité sémantique et pouvant constituer une entrée de dictionnaire. Dans le
vocabulaire courant, on parlera plus souvent de mot, notion qui, cependant,
manque de clarté. On construit des énoncés avec des lemmes, les lemmes sont
faits de morphèmes.
Les lemmes sont constitués de phonèmes assemblés en
morphèmes.
On définira également le lexème comme
le morphème lexical d’un lemme,
c'est-à-dire une unité de sens et de son qui n'est pas fonctionnelle ou
dérivationnelle. Le lexème renvoie à une notion abstraite ou concrète
indépendante de la situation de communication.
C'est un synonyme de radical

2
dans la plupart des cas. Un même lexème est présent dans toutes les formes d'un
même terme fléchissable : aimer, aime, ai aimé, aimions ou aimât sont des
formes différentes d'un même lexème aim-, qui est ici un radical. On parle dans
ce cas d'un lexème lié : il n'existe pas de forme libre du lexème aim- : chacune
est obligatoirement composée d'un radical et d'un morphème.
ex : Différenciation entre lexème et morphème
Soient les mots suivants "chantons", "chantant", "chanteur". Ces 3 mots
partagent le lexème "chant", ils sont différenciés par les morphèmes :
-"ons" : marque la 1ère personne du pluriel de la conjugaison (nous)
-"ant" : marque le participe présent
-"eur" : marque la personne qui réalise l'action de chanter (suffixe -eur/-euse :
chanteur/chanteuse)
Les 3 mots de notre exemple ont en commun le sens contenu dans le
lexème "chant". On part donc de cet élément avant de spécifier le sens de
chacun en identifiant des formes verbales (pour désigner l'action de chanter) ou
des suffixes (pour désigner la personne qui réalise l'action). Le sens étant
essentiellement contenu dans le lexème, le problème est donc de disposer d'un
outil sémantique permettant de le traiter. Le morphème de son côté apporte
"seulement" des précisions de sens par rapport au lexème.
En tant que locuteur d’une langue, stocke-t-on des lexèmes ?
Chaque langue a sa façon d’entrer les unités lexicales dans le dictionnaire.
Par exemple, on n’ira pas cherche le mot en anglais sings dans le dictionnaire.
Ceci s’explique par le fait qu’il y a des paradigmes dans les langues. Ainsi, sur
la forme ou la structure d’un mot, on est obligé de revenir sur la combinatoire de
ce mot ou sa façon d’être lié à un autre élément. Par exemple, en latin, on entre
dans le dictionnaire la 1
ère
personne du singulier d’un verbe et non pas l’infinitif
comme il est le cas dans un dictionnaire de la langue française. La raison en est
qu’il est important de donner les bases des paradigmes d’un verbe qui vont
changer selon le mode, la personne, etc. On peut, pour notre part, essayer de voir
ce que cela donne dans d’autres langues, autrement essayer de voir quels sont les
paramètres qui vont influer sur les verbes.
Lorsqu’on utilise le terme mot (image transcrite pour ceux qui savent), il y a
une ambiguïté. À quelle forme de graphie correspond-t-elle ? Pour arriver à faire
une comparaison entre des mots, il faut aller dans une analyse plus détaillée
c'est-à-dire au niveau minimal ou celui du morphème (École de Prague ?).

3
La résonnance nasale [-on] est un phonème qui est une marque de la
morphologie : on l’appelle un morphe qui peut prendre une (des) valeur(s). Par
exemple, [-ons] marque le pluriel. On manipule le morphe ou la matière
morphologique.
Le morphe est un élément phonique à valeur significative et qui ne peut être
analysé en éléments phoniques significatifs plus petits. C’est la forme apparente
d'un ou de plusieurs morphèmes. Par exemple, dans calculateur, on peut
distinguer deux morphes, calcul- et le suffixe -ateur. Ces deux morphes sont
aussi des morphèmes, car ils ont une certaine indépendance dans la langue. En
revanche, on peut avoir un seul morphe pour deux morphèmes, ou deux morphes
pour un seul morphème :
•
dans chevaux, on comprend bien qu'il y a deux unités abstraites, ou deux
morphèmes, cheval + pluriel.
•
à l'inverse, il y a constitue un seul morphème : dans il y a, il n'a pas de
sens en soi, c'est le groupe il y a qui est sémantiquement pertinent. Mais
ce groupe est composé de trois morphes, qu'on retrouve ailleurs : il, y et a.
Quel chemin doit-on faire pour aller du mot au morphème et du morphème
au mot ?
1
/
3
100%