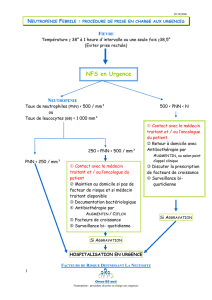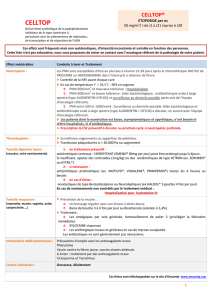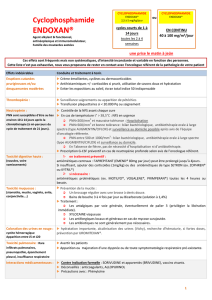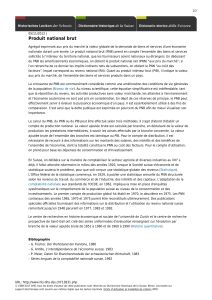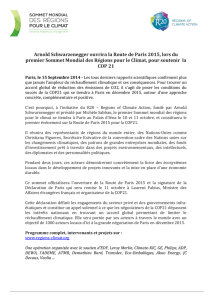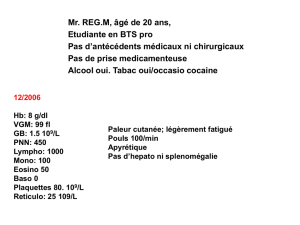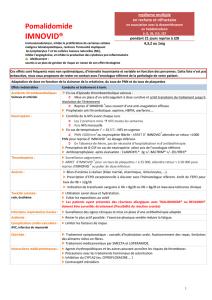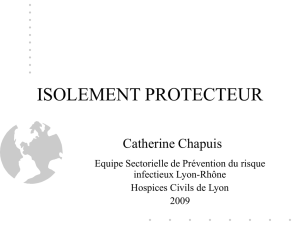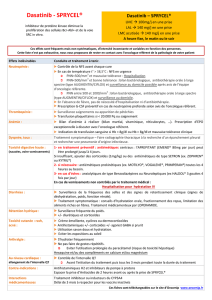Article Syndrome Hyper IgE

1
Le syndrome Hyper-IgE
Joël X. Corberand
Laboratoire d'Hématologie, CHU Toulouse Rangueil
Introduction
Il est probable qu'à l'instar de la Granulomatose Septique familiale, il n'y ait pas une entité moléculaire unique
à l'origine des signes cliniques et biologiques qui permettent de parler de "syndrome Hyper-IgE (HIES) avec
infections récidivantes". L'un des éléments initialement débattu du syndrome était l'existence obligatoire ou non
d'une anomalie de la fonction chimiotactique des polynucléaires neutrophiles (PNN). Bien que cette anomalie ne
puisse expliquer à elle seule la susceptibilité des patients aux infections bactériennes, particulièrement au
Staphylocoque doré, il est justifié de considérer avec attention cette perturbation fonctionnelle des PNN. Le
syndrome HIES figure en effet dans la liste classique des anomalies intrinsèques du chimiotactisme des PNN (Tableau
I).
Tableau I : Classification clinique des déficits cellulaires primaires
du chimiotactisme
(d'après Clark R.A. – Disorders of granulocyte chemotaxis- in Leukocyte chemotaxis, Raven Press, New York, 1978)
1- Syndrome de Chédiak-Higashi
2- Syndrome du leucocyte paresseux
3- Diabète sucré
4- Polyarthrite rhumatoïde
5- Nouveaux-nés
6- Hyper-immunoglobulinémie E
7- Ichtyose congénitale
8- Infection évolutive
9- Hypophosphatémie
10- Brûlures
11- Greffe de moelle
12- Hypogammaglobulinémie
13- Trisomie 21
14- Periodontite juvénile chronique
15- Déficit en alpha-mannosidase
16- Dysfonction de l'actine
17- Cas isolés
_________________________________________________________________
Compte tenu des spécificités biologiques du HIES, seront rappelées en préambule quelques notions sur la
place des PNN dans les systèmes de défense de l'organisme contre les agents infectieux, les particularités de
l'activité migratoire de ces cellules et les effets de l'histamine sur le fonctionnement général des PNN.
Les fonctions du PNN
Parmi les systèmes de défense de l'organisme vis-à-vis des agents pathogènes, le polynucléaire neutrophile
(PNN) occupe une place essentielle :
Il assure principalement la défense anti-bactérienne, surtout des bactéries dites pyogènes, ces dernières étant
ainsi dénommées parce que leur développement provoque une production de pus dont l'une des composantes est
justement la présence de PNN.

2
L'action efficace des PNN repose sur des propriétés intrinsèques à la cellule :
• aptitude à la reconnaissance de messages venant de l'extérieur,
• déplacement spontané et orienté (chimiotactisme),
• possibilité de faire pénétrer à l'intérieur de son cytoplasme une partie de l'environnement (phagocytose),
• activation métabolique conduisant à la production et à l'utilisation d'agent susceptible de tuer des organismes
vivants (production de radicaux actifs de l'oxygène),
• pouvoir de dégradation du matériel tué.
Ces différentes propriétés intrinsèques ne peuvent se manifester pleinement en l'absence d'autres facteurs
impliqués, eux aussi, dans la défense, facteurs sériques tels les immunoglobulines, certaines fractions du
complément, la tuftsine, certaines cytokines produites par d'autres cellules qui sont le support de la réponse
immunitaire (lymphocytes et monocytes-macrophages), facteurs de croissance (G-CSF et GM-CSF).
Dans la cinétique des événements visant à débarrasser l'organisme des agents pathogènes qui ont réussi à
franchir les barrières anatomiques (revêtement cutané et muqueux), les PNN sont les premiers éléments cellulaires à
intervenir, les lymphocytes n'ayant pas à prendre physiquement part à la défense vis-à-vis de ce type de bactéries,
les monocytes n'intervenant que secondairement pour accomplir, dans cette situation, leur rôle d'agents de
nettoyage et de réparation tissulaire (cicatrisation).
En résumé, de façon schématique et imagée, les PNN assurent la défense anti-bactérienne grâce à leur
rapidité d'intervention (aptitude migratoire) et leur voracité (phagocytose et microbicidie).
L'arrivée rapide des PNN sur un site tissulaire envahi par des bactéries est donc essentielle pour empêcher la
prolifération bactérienne et, de ce fait, l'expression d'une infection. De façon pratique, chez un individu normal, il y a
en permanence sur la peau ou les muqueuses des zones qui sont le siège d'une petite réaction inflammatoire sans
évolution purulente ; ces zones expriment le combat victorieux mené par les PNN contre quelque envahisseur dont
on ne connaîtra jamais la nature. En l'absence de PNN, ces mêmes zones seraient devenues le siège d'une infection.
Mais si l'inoculum bactérien est d'emblée important, le rapport initial bactéries/PNN est en faveur des premières et
une infection apparaît cliniquement, l'issue peut encore être spontanément favorable (guérison spontanée d'un
point de folliculite, par exemple) ou son extension peut nécessiter une aide extérieure (antibiotiques) dont le rôle est
alors de remettre le rapport bactéries proliférantes/PNN en faveur de ces derniers.
Ces notions expriment parfaitement le fait que la révélation clinique d'une infection dépend d'une
compétition entre le pouvoir prolifératif des bactéries et le pouvoir d'accumulation des PNN sur le lieu d'inoculation.
Il s'agit d'une véritable course contre la montre. Cette notion est illustrée par des données expérimentales qui
montrent que l'absence de PNN dans un tissu pendant une durée aussi brève que 2 à 4 heures accroît l'infectiosité
d'un inoculum bactérien d'un facteur 105. Ces données expérimentales sont corroborées par les observations
cliniques qui suggèrent une association entre susceptibilité à l'infection et déficit de la réponse chimiotactique des
PNN ches les malades présentant des infections récidivantes sévères.
D'une façon générale, chez un patient porteur d'une anomalie fonctionnelle de ses PNN, quelle qu'en soit la
nature et le mécanisme, les manifestations infectieuses sont très similaires à celles qui surviennent dans les
situations de neutropénie. Ces infections ont tendance à durer longtemps, à mal répondre aux antibiotiques, et à
récidiver. Elles peuvent dues à un large spectre de micro-organismes, où le Staph. aureus domine nettement, mais on
retrouve aussi des bactéries gram-négatives, des champignons tout autant que Staph. epidermidis. Ces infections
touchent le plus souvent les tissus mous (peau, poumons, foie et rein). Les abcès cutanés ou sous-cutanés sont
fréquents, accompagnés d'adénomégalies ou même d'adénites purulentes. Les pneumopathies infectieuses sont
elles aussi fréquentes ; on peut voir des abcès profonds, mais les septicémies sont au contraire rares.
Les infections liées aux déficits fonctionnels des PNN diffèrent quelque peu de celles qui sont secondaires à
d'autres perturbations des systèmes de défense : différentes de celles liées aux agranulocytoses où les lésions sont
de type nécrotique, c'est à dire sans production de pus en raison de l'absence totale de PNN, différentes de celles des
hypogammaglobulinémies où les germes en cause sont plus souvent Streptococcus pneumoniae, Hemophilus
influenzae et les Streptocoques du groupe A. Dans ce cas, les septicémies et les méningites récidivantes sont
fréquentes, alors qu'elles sont rares ches les patients porteurs d'un déficit fonctionnel des PNN.
Chimiotactisme des PNN

3
Rappel physiologique
• le PNN, indépendamment de tout stimulus, est capable de "migration spontanée" ; celle-ci s'effectue "au
hasard", la cellule bougeant par émission de pseudopodes dans différentes directions dans un périmètre réduit
(enregistrements micro-cinématographiques) ;
• ces mouvements spontanés peuvent être accélérés sous l'effet de certaines drogues ; cette accélération sans but
correspond à la "chimiocinésie" ;
• le "chimiotactisme" correspond au déplacement accéléré unidirectionnel de la cellule ; l'orientation de ce
mouvement dépend d'une substance dite chimiotactique dont le PNN remonte un gradient de concentration ;
le déplacement s'interrompant lorsque le PNN est arrivé au point de plus forte concentration.
Les substances chimiotactiques susceptibles d'intervenir dans l'organisme après intervention d'un agent
pathogène sont nombreuses (fractions activées du complément : C5a surtout, C3a, C567 ; agrégats d'Ig ;
fibrinopeptide B ; NCF produit par les mastocytes ; cytokines produites par les lymphocytes activés (IL8) ; produits de
l'acide arachidonique tel le LTB4 ; produits libérés par les plaquettes tel le PF4 ; contenu de cellules lysées : necrotaxis
…) ; l'un des agents chimiotactiques les plus puissants est le f-MLP (formyl Méthionine-Leucine-Phénylalanine) qui
correspond à un produit de dégradation de protéines bactériennes. Ce tripeptide est régulièrement utilisé pour
tester in vitro l'activité chimiotactique des PNN.
L'IL8 mérite une mention particulière, dans la mesure où elle n'agit que sur les PNN (et non sur les monocytes)
et en raison de son action plus large sur les PNN (augmentation de la dégranulation et de l'explosion oxydative,
augmentation de l'expression membranaire des antigènes CD11b/CD18 qui favorise l'adhésion aux cellules
endothéliales).
A l'opposé, d'autres facteurs exercent un effet inhibiteur sur la migration, tel le LIF (Leukocyte Inhibitory
Factor) obtenu à partir de lymphocytes activés qui exerce d'emblée un effet inhibiteur sur les PNN eux-mêmes. Ces
mécanismes régulateurs expliquent l'absence de PNN dans les réactions d'hypersensibilité retardée.
La physiologie du déplacement est complexe et met en jeu les structures et les mécanismes suivants :
• des récepteurs membranaires : pour le complément, pour le fragment Fc des Ig, pour l'IL8, pour le f-MLP
(environ 106 sites/cellule) ; il existe un système complexe de libération des sites fixés impliquant l'internalisation
des récepteurs avec leur ligand, et la libération du récepteur ; c'est ce qui permet à la cellule de se mobiliser à la
façon d'une chenillette jusqu'au point de concentration maxima ;
• des protéines contractiles assurant l'émission des pseudopodes et la rétraction du hyaloplasme, dans une
direction définie : ces protéines sont de type actine (microfilaments) et tubuline (microtubules sur lesquelles
s'ancrent les microfilaments d'actine) qui subissent alternativement polymérisation et dépolymérisation, avec
l'intervention du Ca++, et des nucléotides cycliques AMPc et GMPc à effet antagoniste ;
• la fourniture de l'énergie nécessaire provient du métabolisme glucidique (glycolyse aérobie).
• une activation des mouvements trans-membranaires du Na+ et du K+ ATPase dépendante.
Mesure du chimiotactisme
•in vitro : Deux méthodes sont couramment utilisées. L'une consiste à étudier le passage des PNN à travers un
microfiltre (chambre de Boyden), l'autre étudie la distance parcourue par les PNN à partir d'un puits creusé dans
une fine couche d'agarose (migration sous agarose de Nelson). Dans les deux cas, les cellules sont
préalablement débarrassées des érythrocytes et séparées des cellules mononucléées sur gradient de
Ficoll-Hypaque. Dans les deux cas, les tests sont réalisés en triple, en l'absence (migration spontanée) et en
présence de facteur chimio-attractant (réponse chimiotactique), avec un témoin sain en parallèle. Le rapport des
deux valeurs moyennes ainsi obtenues permet de déterminer l'index chimiotactique. Ces techniques
permettent de réaliser des tests croisés entre malade et sujet sain mettant en jeu les PNN et le sérum activé de
chacun des deux ; on peut ainsi détecter la présence d'éventuels inhibiteurs.
•in vivo : L'activité chimiotactique peut être mesurée in vivo grâce à la technique de la fenêtre de Rebuck et
Crowley avec ou sans utilisation de chambre. Elle consiste à appliquer sur la peau délicatement abrasée un
dispositif permettant de recueillir les cellules qui ont migré : simples lames de verre changées à intervalles
réguliers, ou chambres chimiotactiques dans lesquelles peuvent être placées des solutions, soit neutre, soit
contenant un agent chimiotactique. Ces techniques sont très délicates à mettre en œuvre et fournissent des

4
résultats d'interprétation tout aussi délicate.
Histamine et PNN
L'histamine, dans les systèmes d'étude in vitro et animaux, interfère à différents niveaux de la défense
immunitaire. Elle intervient aussi, dans de tels modèles expérimentaux, sur le comportement fonctionnel des PNN.
A des concentrations de 10-3 à 10-6 M, l'histamine peut inhiber la réponse chimiotactique vis-à-vis de
différents agents dont le sérum activé et le f-MLP, sans exercer d'effet direct sur la mobilité des cellules. Cette
inhibition est associée à une élévation du taux d'AMPc intracellulaire et peut être produite par des antagonistes des
récepteurs H1 et H2. L'effet activateur de l'histamine peut être bloqué par le lévamisole (Solasky®) qui a pour effet
d'augmenter le taux de GMPc intracellulaire ; il peut être aussi bloqué par les antagonistes des récepteurs H2
(metiamide) sans effet des antagonistes des récepteurs H1. Paradoxalement, l'histamine exerce un effet
chimiocinétique dans les mêmes gammes de concentration.
L'histamine exerce encore d'autres effets sur le comportement des PNN, dans des gammes de concentration
de 10-7 à 10-2 M : diminution du potentiel de membrane induit par le f-MLP, de la production d'anion superoxyde et
de peroxyde d'hydrogène (H2O2), de la libération du contenu des granules primaires (béta-glucuronidase), sans
bloquer la fixation et l'internalisation du f-MLP. Cet effet inhibiteur peut, ici aussi, être bloqué par l'antagoniste des
récepteurs H2.
Ces données obtenues in vitro, engagent à suspecter le rôle de l'histamine dans certains états allergiques où
les taux d'histamine pourraient être élevés dans l'organisme, que ce soit dans le sang circulant ou dans les tissus.
Le syndrome Hyper-IgE (HIES) avec infections récidivantes
Les étapes de la découverte
En 1966, DAVIS décrit un syndrome clinique caractérisé par une propension à l'infection staphylococcique
sévère, des lésions cutanées chroniques de type eczéma, une dystrophie unguéale et des "abcès froids" ainsi
dénommés en raison de l'absence fréquente de réaction inflammatoire. Il propose le terme de "syndrome de Job" en
référence au personnage biblique décrit comme couvert de lésions cutanées. Le cadre syndromique est encore
renforcé par le fait que les malades initialement décrits étaient des filles à cheveux roux au teint clair avec un faciès
particulier.
En 1972, BUCKLEY, rapporte le cas de deux garçons qui présentaient une dermatose chronique et des abcès
staphylococciques de la peau, des articulations et des poumons, sévères et récidivants. Ils avaient aussi un faciès
particulier et une dystrophie unguéale. Ces deux malades présentaient en outre des taux très élevés d'IgE, et c'était
la première fois que l'on établissait un rapport entre susceptibilité à l'infection et importante élévation des IgE. On
parle de Syndrome Hyper-IgE (HIES).
En 1973, CLARK décrit le cas d'une patiente qui présente un ensemble de signes où l'on retrouve des abcès
récidivants, une candidose cutanéo-muqueuse (dystrophie unguéale), une hyper-IgE variant de 19 000 à 23 000
ng/ml et un déficit de la réponse chimiotactique des PNN.
En 1974, HILL démontre que les deux patients de DAVIS, à la base de la description du syndrome de Job,
présentent un déficit du chimiotactisme.
En 1973, VAN SCOY rapporte le premier cas familial où une mère et sa fille présentent des abcès
staphylococciques répétés, pulmonaires et rétro-pharyngiens, avec des taux très élevés d'IgE.
Dès lors, les publications se multiplient de malades présentant une susceptibilité à l'infection et une
Hyper-IgE ; chez presque tous, mais pas chez tous, est trouvé un déficit du chimiotactisme tant in vitro qu'in vivo.
Mais cette anomalie peut être d'expression variable dans le temps et nécessiter dans quelques cas des explorations
répétées pour être révélée. Buckley, toutefois, insiste sur le fait que le déficit du chimiotactisme n'est pas un élément
indispensable au HIES. Depuis 1972, certainement plus de 200 cas ont été rapportés dans la littérature
internationale.
Définition

5
Ainsi, peut-on définir le syndrome Hyper-IgE comme un ensemble clinique caractérisé par :
• des infections sévères et récidivantes de la peau et du tractus sino-pulmonaire, principalement
staphylococciques,
• sur fond de dermatose chronique, eczématiforme,
• de début habituellement précoce dans la vie,
avec des anomalies biologiques constantes :
• élévation importante des IgE sériques et
• éosinophilie sanguine modérée,
associées à d'autres anomalies biologiques variables d'une observation à l'autre :
• déficit du chimiotactisme,
• présence d'IgE anti-Staphylococcus aureus et anti-Candida albicans,
• déficit en IgA salivaires totales,
• déficit associé d'IgA anti-Staph. aureus sérique et salivaire,
• anomalie quantitative et fonctionnelle des T lymphocytes.
Il apparaît que le déficit de la fonction chimiotactique des PNN n'est pas une donnée indispensable à
l'établissement du diagnostic.
Tableau clinique
1- sexe : bien qu'initialement décrit chez les filles, les deux sexes sont atteints. Il n'y a pas de facteurs ethniques, des
observations ayant été décrites chez des sujets caucasoïdes, noirs et asiatiques.
2- âge de survenue : en général, les premiers signes apparaissent dans les premières semaines ou premiers
mois de la vie. Mais le diagnostic peut être tardif, chez les adolescents (Hattori, 1993) ou même chez les adultes
(L'Huillier, 1990 ; Nunez, 1992).
3- caractère familial : les cas décrits sont pour la plupart sporadiques, mais de rares observations familiales ont
été rapportées, associant un enfant et l'un de ses parents : mère et fille (Van Scoy, 1975); père et fils (Blum, 1977).
4- dysmorphie faciale :dans plusieurs observations, comme dans la description initiale de Davis, est
mentionnée une légère dysmorphie faciale marquée surtout par un aplatissement de la base du nez.
5- dermatose "de fond" : des lésions cutanées extensives à type d'eczéma apparaissent vers l'âge de 2 mois,
touchant de façon plus marquée la face, les oreilles et le cuir chevelu. Elles peuvent être extrêmement prurigineuses.
6- manifestations infectieuses bactériennes :
Elles sont localisées essentiellement :
• au niveau de la peau sous forme d'abcès, et le tissu sous-cutané sous forme de cellulite avec, souvent, atteintes
des ganglions lymphatiques satellites qui s'abcèdent aussi ; toutes ces manifestations se présentent donc
comme des "abcès froids",
• au niveau des voies aériennes avec aspect de staphylococcie pulmonaire évoluant souvent vers la formation de
volumineux abcès, ou d'abcès de l'espace retro-pharyngé.
D'autres localisations infectieuses, moins fréquentes, sont possibles :
• glandes salivaires, gencives, sinus, oreille moyenne, vagin qui, comme les voies aériennes, impliquent les IgA
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%