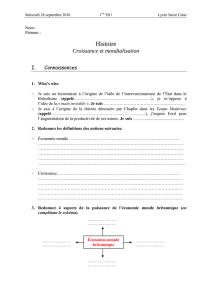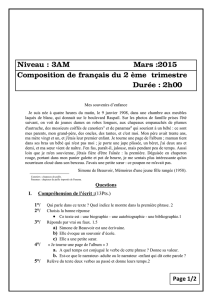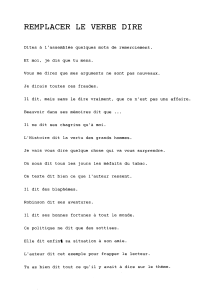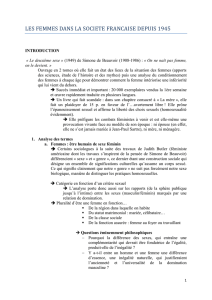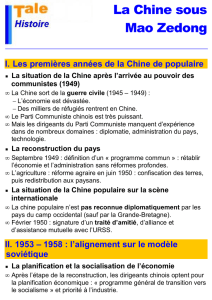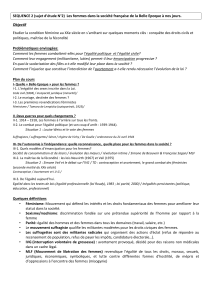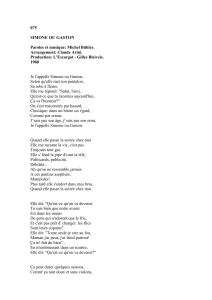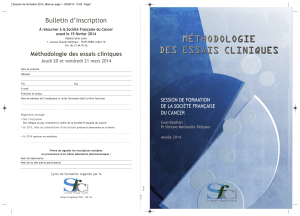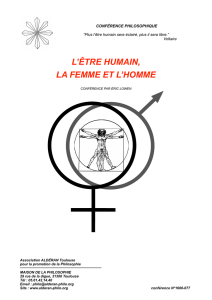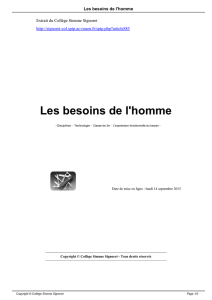femmeB corrige - Les Mémoires d`un Ane Communiste

1
1
« Les femmes, en général, sont moins susceptibles d’abnégation que capables de dévouement. »
J. B***.
« Si les hommes, dans leur vanité, repoussent les meilleurs conseils, les femmes aiment à les solliciter pour ne
point les suivre. »
Ferdinand BAC.
« Quoique les erreurs de la liberté et les écarts du doute aient fait de plus grands ravages parmi les hommes,
l’affaiblissement et l’inobservance des préceptes d’obéissance et des devoirs qu’on puise au sein de l’éducation,
ont porté plus de fruits amers dans la vie morale des femmes. »
Mme BACHELLERY.
« A tout âge on a des raisons de se marier, car les femmes sont nos maîtresses dans la jeunesse, nos compagnes
dans l’âge mûr et nos nourrices dans la vieillesse. »
Françis BACON, 1561-1626.
« Celui qui possède femme et enfants a donné des otage à la fortune ; car se sont des obstacles aux grandes
entreprises, qu’elles soient vertueuses ou malfaisantes. »
Françis BACON, 1561-1626, Du mariage et du célibat.
« L’épouse est une maîtresse pour l’homme jeune, une compagne pour l’âge mûr, une infirmière pour la
vieillesse ; l’homme a donc, à tout âge, un prétexte pour se marier. »
Françis BACON, 1561-1626, Essays, VIII, 1625.
« Les femmes sont de ces places qui veulent être prises de force. Avec elles, on risque beaucoup plus à ne rien
tenter qu’à ne rien réussir. »
Françis BACON, 1561-1626.
« Qui a femme et enfants a donné des gages à la Fortune. »
Françis BACON, 1561-1626, De dignitate et augmentis scientiarum, VI, 5, 1605.
« Si la chasteté des femmes est vertu, c’est à la jalousie qu’on en a l’obligation. »
Françis BACON, 1561-1626, De dignitate et augmentis scientiarum, VI, 17, 1605.
« Le refus d’accorder aux femmes la possibilité d’accéder à un certain nombre de métiers - tout simplement par
peur de leur concurrence - est « appuyé » sur un certain nombre de « considérations » d’allure souvent savante et
qui font sourire aujourd’hui. On invoque le poids moins élevé (en moyenne) du cerveau féminin pour conclure à
de moindres capacités intellectuelles chez les femmes. On fait le compte des génies qu’à produits l’humanité et
on trouve que le nombre des génies masculins l’emporte et de loin sur les femmes célèbres. »
Gilbert BADIA, in La condition féminine, ouvrage collectif sous la direction du CERM, ES, 1978.
« on ne peut pas dire tout et son contraire sur un même objet... surtout lorsqu’il s’agit de la femme. »
Elisabeth BADINTER, in A. L. Thomas, Diderot, Madame d’Epinay, Qu’est-ce qu’une femme? P.O.L., 1989.
« qu’est-ce qu’une femme ? Un animal raisonnable. Bref, un Homme comme tout le monde. »
Elisabeth BADINTER, in A. L. Thomas, Diderot, Madame d’Epinay, Qu’est-ce qu’une femme? P.O.L., 1989.
« Contre femme point ne débattre. »
BAÏF, Mimes, Enseignements et Proverbes, 1576.
« Femme dorée est vite consolée. »
BAÏF, Mimes, Enseignements et Proverbes, 1576.
« Femme qui rit quand elle peut, et pleure quand elle veut. »
BAÏF, Mimes, Enseignements et Proverbes, 1576.
« Morte la fille, mort le gendre. »
BAÏF, Mimes, Enseignements et Proverbes, 1576 ou 97 ?.

2
2
« Nul si fin que femme n’assoie. »
BAÏF, Mimes, Enseignements et proverbes, 1576.
« Au sein de la bande sportive, la femme focalise les fantasmes. Elle affole la troupe qui se déplace. »
Frédéric BAILLETTE, Eloge de la masculinité, in Sport et Virilisme, Frédéric Baillette et Phillipe Liotard,
1999.
« L’infériorité de la femme ne ferait aucun doute, elle serait flagrante et inhérente à sa nature même, inscrite dans
son corps, sa spécificité biologique : sa fonction fécondante, sa mission procréatrice. Cette position d’éternelle
seconde se conjugue sur le mode du manque, elle naîtrait de la dissymétrie génitale. Le désaccord, l’altérité
radicale entre sa constitution et celle de l’homme relèverait d’une évidence visible, d’une dualité intangible. La
femme ne peut être qu’anatomiquement inférieure à l’homme, comme le posait Bellin du Coteau en 1927, et elle
devrait le rester, s’y résigner. Sa fragilité, son déficit musculaire, la rendrait ipso facto inapte à certains travaux,
et restreindrait son champ d’efficacité motrice. »
Frédéric BAILLETTE, La mâle donne, in Sport et Virilisme, Frédéric Baillette et Phillipe Liotard, 1999.
L’institution sportive a été créée par des hommes, pour d’autres hommes, « Les femmes ne feraient que copier,
qu’imiter, qu’ « emprunter les modèles des hommes », des hommes qui auraient la mansuétude de les accueillir,
de les intégrer en prenant les précautions nécessaires tenat compte de la sacro-sainte « spécificité » féminine.
D’une part, leur masculinisation (corporelle et idéologique) serait une punition faite à ces femmes qui
« contestent » leur féminitude. D’autre part, les femmes ne sauraient avoir une vision sportive du monde. En
s’engageant dans la compétition sportive, en revendiquant le droit de concourir, elles s’abrutiraient, adhérant à
des valeurs qui ne sauraient être les leurs. »
Frédéric BAILLETTE, La mâle donne, in Sport et Virilisme, Frédéric Baillette et Phillipe Liotard, 1999.
« Si les femmes sont majoritairement réfractaires ou pour le moins insensibles au spectacle sportif, si, comme le
notait un chroniqueur, elles ont longtemps méprisé le football, c’est notamment qu’elles n’éprouvent aucun
intérêt pour un « jeu » qui ne s’adresse pas à elles et les rebute par la violence qui sourd des gradins. Elles se
sentent en insécurité dans cet environnement hostile chargé en grossièretés, invectives et autres « bousculades »
viriles. »
Frédéric BAILLETTE, Les femmes au service du sport, in Sport et Virilisme, Frédéric Baillette et Phillipe
Liotard, 1999.
« Il suffit que dans l’ordre moral la femme soit semblable à l’homme pour qu’elle doive lui être égale en droit. »
Jules BAISSAC, La femme dans les temps modernes.
« Pour comprendre comment la femme est réellement notre égale, il faut faire abstraction de ses différences
physiques et la considérer dans l’ordre moral. Là, rien ne la distingue de l’homme ; elle a tout ce que nous avons,
rien de plus, rien de moins. »
Jules BAISSAC.
« Si la femme est l’égale de l’homme, il est certain qu’elle ne lui est point semblable. »
Jules BAISSAC.
« Nombreux sont les cas de femmes qui n’éprouvent la sensation ou le désir sexuels qu’après une éducation qui
peut être longue ; cette sorte de condition à la fois naturelle et anti-naturelle est la source de maints
désappointements et de souffrances profondes de la part de la femme, ainsi que d’un malaise familial grave. »
Smith BAKER, The Neuro-psychological Element in Conjugal Aversion, Journal of Nervous and Mental
Diseases, 1892.
« Nous les femmes, devriont donner la priorité à l’essentiel. Pourquoi nous préoccuper de ce que les hommes
n’ont d’yeux que pour l’argent en autant que nous pouvons mettre la main dessus. »
Ivy BAKER PRIEST, Green Grows Ivy, 1958.
« La beauté d’une femme,
La gloire qu’on proclame,
Sont poudre d’un feu de printemps. »
Balint BALASSI, 1554-1594, De l’amour éternel du poète.

3
3
« La femme n’a pas tant de moyens pour se défendre des fausses calomnies comme à l’homme. »
BALTHAZAR DE CATILLON.
« A notre honte, une femme ne nous est jamais si attachée que quand nous souffrons !... »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Après tout, rien de si dangereux qu’une chaise, et il est bien malheureux qu’on ne puisse pas enfermer les
femmes entre quatre murs!... »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Aucune femme n’aime à entendre faire l’éloge d’une autre femme devant elle ; toutes se réservent, en ce cas, la
parole, afin de vinaigrer la louange. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Avec la migraine seule, une femme peut désespérer un mari. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« ... aux hommes supérieurs, il faut des femmes (...) dont l’unique pensée soit l’étude de leurs besoins. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, La peau de chagrin.
« Aussi, en lisant des drames et des romans, les femmes, créatures encore plus susceptible que nous de s’exalter,
doit-elle éprouver d’enivrantes extases. Elle se crée une existence idéale auprès de laquelle tout pâlit ; elle ne
tarde pas à tenter de réaliser cette vie voluptueuse, à essayer d’en transporter la magie en elle. Involontairement,
elle passe de l’esprit à la lettre, et de l’âme aux sens. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Au moment où une femme se décide à trahir la foi conjugale, elle compte son mari pour tout ou pour rien. On
peut partir de là. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Avec son médecin, une femme honnête est, dans sa chambre, comme un ministre sûr de sa majorité : ne se fait-
elle pas ordonner le repos, la distraction, la campagne ou la ville, les eaux ou le cheval, la voiture, selon son bon
plaisir et ses intérêts. Elle vous renvoie ou vous admet chez elle comme elle veut. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« - Avez-vous remarqué, ma chère, que les femmes n’aiment en général que les sots ? - Que dites-vous donc là ?
duchesse ; et comment accorderez-vous cette remarque avec l’aversion qu’elles ont pour leurs maris ? »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Cependant il existe des femmes vertueuses !
Oui, celles qui n’ont jamais été tentées et celles qui meurent à leurs premières couches, en supposant que leurs
maris les aient épousées vierges.
Oui, celles qui sont laides comme la Kaïfakatadary des Mille et une nuits.
Oui, celles que Mirabeau appelle les fées concombres, et qui sont composées d’atomes exactement semblables à
ceux des racines de fraisier et de nénuphar ; cependant, ne nous y fions pas !... »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Ce que les femmes appellent tout haut leur honte, elles le nomment tout bas leur plaisir ; elles le repoussent en
apparence et le désirent en secret ; le vice enfin pour elles est l’éclat, la vertu le mystère. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Ce qui grandit dans les femmes aux yeux des hommes, c’est qu’elles luttent toutes… ou presque, contre une
destinée incomplète. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« C’est bien une douce chose et un bien grand élément de félicité pour une femme que de se savoir tout sur la
terre pour celui qu’elle aime. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.

4
4
« chez l’enfant, la pensée change à tout moment (…). La femme change moins souvent ; mais l’appeler fantasque
est une injure d’ignorant. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Comme l’a si bien exprimé Diderot, l’infidélité est chez la femme comme l’incrédulité chez un prêtre, le
dernier terme des forfaitures humaines ; c’est pour elle le plus grand crime social, car pour elle il implique tous
les autres. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« dans les classes inférieures, la femme est non seulement supérieure à l’homme, mais encore elle gouverne
toujours ».
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Dans l’ordre élevé, la vie de l’homme est la gloire, la vie de la femme est l’amour. La femme n’est égale à
l’homme qu’en faisant de sa vie une perpétuelle offrande, comme celle de l’homme est une perpétuelle action. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Emanciper les femmes, c’est les corrompre. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, La femme de trente ans, 1831.
« En amour, toute âme mise à part, la femme est comme une lyre, qui ne livre ses secrets qu’à celui qui en sait
bien jouer. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« En général les femmes aiment à vivre vite, mais après leurs tempêtes de sensations viennent des calmes
rassurants pour le bonheur d’un mari. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« En général, toutes les femmes se liguent contre un homme marié accusé de tyrannie : car il existe un lien secret
entre elles comme entre tous les prêtres d’une même religion. Elles se haïssent, mais elles se protègent. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« En toute situation, les femmes ont plus de causes de douleurs que n’en a l’homme et en souffrent plus que lui. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Etre jaloux, c’est tout à la fois le comble de l’égoïsme, l’amour-propre en défaut et l’irritation d’une fausse
vanité. Les femmes entretiennent avec un soin merveilleux ce sentiment ridicule, parce qu’elles lui doivent des
cachemires, l’argent de leur toilette, des diamants, et que, pour elles, c’est le thermomètre de leur puissance. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Et voilà bien l’ingratitude des femmes ! S’il y a quelque chose de plus ingrat qu’un roi, c’est un peuple ; mais,
Monsieur, la femme est encore plus ingrate qu’eux tous. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Fiez-vous un peu aux femmes quand il s’agit de juger un homme. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« - Hé ! Monsieur, ne connaissez-vous donc pas le danger qu’il y a de développer chez une femme le goût du
chant, et de la laisser livrée à toutes les excitations d’une vie sédentaire. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Il arrive toujours un moment où les peuples et les femmes, même les plus stupides, s’aperçoivent qu’on abuse
de leur innocence. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Il est souvent inutile d’essayer de tendre des pièges à ces créatures sataniques. Une fois que les femmes sont
arrivées à une certaine volonté de dissimulation, leurs visages deviennent aussi impénétrables que le néant. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.

5
5
« Il n’est peut-être pas indifférent à certains anatomistes de la pensée de savoir que l’âme est femme. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« il n’existe pas de femme, même la plus vertueuse, qui ne se soit trouvée digne d’une grande passion, qui ne l’ait
rêvée, et qui ne croie être très inflammable. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Il n’y a rien qui désunisse davantage deux femmes que d’être obligées de faire leurs dévotions au même autel. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Il y a dans la manière dont chaque femme offre le thé, tout un langage, et elles le savent bien. (…) Les femmes
peuvent se faire là, à volonté, méprisante jusqu’à l’insulte, humbles jusqu’à l’esclavage de l’Orient. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« Il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes! »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Autre étude des femmes.
« Indépendamment d’un mouvement répulsif, il existe dans l’âme de toutes les femmes un sentiment qui tend à
proscrire tôt ou tard les plaisirs dénués de passion. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Instruire ou non les femmes, telle est la question. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« J’ai remarqué depuis que la plupart des femmes qui montent bien à cheval ont peu de tendresse. Comme aux
Amazones, il leur manque une mamelle, et leur cœurs sont endurcis en un certain endroit, je ne sais lequel. »
Honoré
de BALZAC, 1799-1850, Le lys dans la vallée. 1835.
« J’entends des milliers de voix crier que cet ouvrage plaide plus souvent la cause des femmes que celles des
maris ;
Que la plupart des femmes sont indignes de ces soins délicats, et qu’elles en abuseraient ;
Qu’il y a des femmes portées au libertinage, lesquelles ne s’accommoderaient pas beaucoup de ce qu’elles
appelleraient des mystifications ;
Qu’elles sont tout vanité et ne pensent qu’aux chiffons ;
Qu’elles ont des entêtements vraiment inexplicables ;
Qu’elles se fâcheraient quelque fois d’une attention ;
Qu’elles sont sottes, ne comprennent rien, ne valent rien, etc. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« Jusqu’à l’âge de trente ans, le visage d’une femme est un livre écrit en langue étrangère, et que l’on peut encore
traduire, malgré les difficultés de tous les gunaïsmes de l’idiome ; mais, passé quarante ans, une femme devient
un grimoire indéchiffrable, et, si quelqu’un peut deviner une vieille femme c’est une autre vieille femme. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« L’acharnement de certaines femmes contre celles qui ont l’heureux malheur d’avoir une passion prouve
combien la chasteté leur est à charge. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« la confiance et la noblesse trouvent de puissants échos dans le coeur de la femme. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, Physiologie du mariage, 1824-1829.
« La coquetterie ne va bien qu’à la femme heureuse. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850, La femme abandonnée.
« La famille, la plus belles œuvre des femmes ! »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
« La femme a cela de commun avec l’ange, que les êtres souffrants lui appartiennent. »
Honoré de BALZAC, 1799-1850.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
1
/
130
100%