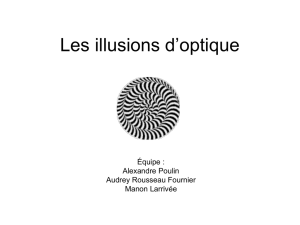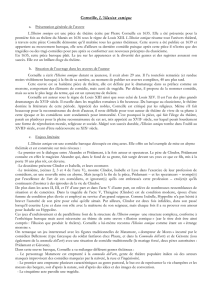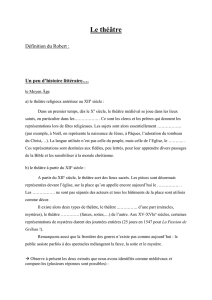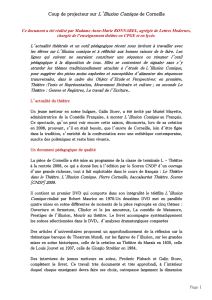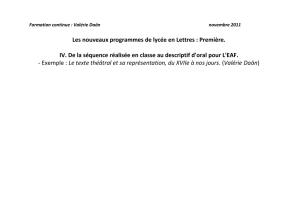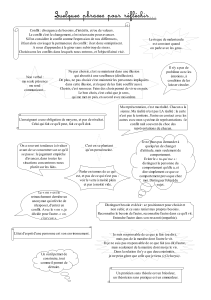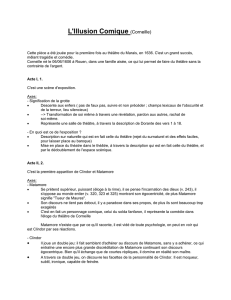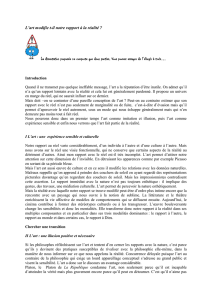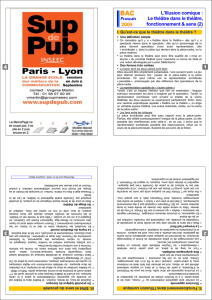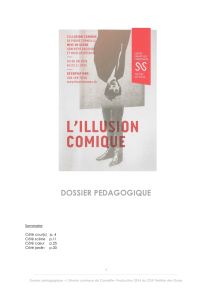L`Illusion comique

Le Théâtre des 2 Rives
présente
L’Illusion comique
de
Pierre Corneille
Mise en scène
Alain Bézu
reprise
au Théâtre des 2 Rives
du 3 au 14 avril et du 8 au 12 mai 2007
48, rue Louis Ricard – 76 000 Rouen, mardis et samedis à 20h30, mercredis,
jeudis et vendredis à 19h30, relâche les dimanches et lundis, tél : 02 35 89 63 41
tournée
15 octobre à fin décembre 2007
Organisation de la tournée :
Jack Salom - Véronique Ray – Delphine Vuattoux
La Gestion des Spectacles
10, rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris
Tél. : +33.1.43.38.60.85 – Fax : +33.1.43.57.76.57
e-mail : contact@lagds.fr , www.lagds.fr

L’Illusion comique
de
Pierre Corneille
mise en scène
Alain Bézu
avec
Vincent Berger
François Clavier
Catherine Dewitt
Philippe Lebas
Emmanuel Noblet
Laure Wolf
Isabelle Wéry
dramaturgie Joseph Danan
scénographie Claire Chavanne
lumières Patrick Chiozzotto
costumes Charlotte Villermet
musiques Monteverdi, Lully, Marin Marais
arrangements Philippe Davenet
assistante mise en scène Karine Preterre
collaboration chorégraphique Christophe Dumouchel
combats réglés par Jérôme Westholm
perruques Annie Marandin
maquillages Marie Baudrais
chapeaux Laetitia Mirault
conception de la marionnette Jean-Paul Dewynter
marionnettiste Alexandre Picard
photographies Jean-François Lange
Organisation de la tournée :
Jack Salom - Véronique Ray – Delphine Vuattoux
La Gestion des Spectacles
10, rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris
Tél. : +33.1.43.38.60.85 – Fax : +33.1.43.57.76.57
e-mail : contact@lagds.fr , www.lagds.fr

A l’issue des 6 semaines de représentations lors de sa création (du 7 mars au 15 avril 2006), le
Théâtre des 2 Rives affiche complet et annonce une reprise de 3 semaines en 2007.
Saluée par la critique, « L’Illusion comique » a été vue par 6 000 spectateurs, soit une
fréquentation exceptionnelle pour ce qui concerne l’art dramatique dans l’agglomération
rouennaise.
Extraits de presse
Une prouesse – C’est très difficile de monter « L’Illusion comique », une œuvre qui semble bête
comme chou si on la résume en deux mots. Un père qui recherche son fils le surprend en train
de vivre des aventures qui le secouent : le jeune homme est plutôt « galant avec le beau sexe »,
puis il est tué ; enfin, il ressuscite. En réalité, ce n’était qu’une illusion puisque le vieillard suivait
sans le savoir les représentations d’une troupe de comédiens. Bien avant Pirandello, c’est une
pièce du théâtre dans le théâtre, donc un jeu de miroirs multiples.
Bézu réalise une mise à nu surprenante et séduisante des sentiments, qui étaient enveloppés
dans le spectaculaire. Les acteurs trouvent dans cette exigence continue de nuances une façon
de changer le relief de leurs personnages. En Matamore, Philippe Lebas sait faire rire sans jouer
les habituels spadassins de la commedia, Catherine Dewitt donne un décalage très heureux aux
deux rôles masculins qu’elle assure, Laure Wolf dégage une émotion immédiate et en même
temps insolite, François Clavier joue le père dans une force sensible qui fuit le pathétique ; enfin,
Vincent Berger, Isabelle Wéry et Emmanuel Noblet mêlent et démêlent joliment les états d’âme.
Là où tant d’autres ont construit une lanterne magique, l’équipe d’Alain Bézu éclaire la pièce à
l’aide d’une lanterne sourde. Et l’on voit mieux dans la clarté de la nuit.
Gilles Costaz, Politis
La distribution est excellente. Le Matamore à accent (Philippe Lebas, épatant), les vifs et
nuancés Dorante, Adraste, Eraste, et même le geôlier interprété par un seul acteur (Emmanuel
Noblet, très juste à chaque fois), la délicieuse Isabelle (Isabelle Wéry, excellente) et les
merveilleuses et touchantes Lyse et Rosine (la seule et superbe Laure Wolf), chacun tient sa
partition avec intelligence. Une très belle soirée, enjouée et forte à la fois, comme l’écriture même
et la pensée de Corneille.
Armelle Héliot, Le Figaro

Cette nouvelle mise en scène est une éclatante réussite qui présente une vision de l’œuvre et
des personnages à la fois fidèle, éclairante et débarrassée des scories des traditions. Jusqu’alors
la référence incontournable était la mise en scène de Giorgio Strehler à l’Odéon. Alain Bézu,
avec son travail impeccable et érudit, en crée une nouvelle.
Marie-Laure Atinault, Le Journal des Spectacles – Webthea
Une comédie dont Alain Bézu fait exploser sur et hors du plateau toutes les richesses grâce à
une mise en scène inventive : la beauté de la langue, la complexité de l’intrigue, l’humour et le
pathétique des dialogues. Cette histoire d’un fils, renié par son père et reconquérant honneur et
affection grâce à son engagement de comédie, se révèle d’une incroyable modernité. Avec des
tirades passées à la postérité, servies par une troupe maniant l’alexandrin à la perfection. Un
bonheur à savourer sur les pas de Corneille
Yonnel Liégeois / La Nouvelle Vie Ouvrière
Les interprètes sont excellents. (…) Ici si tout est théâtre… tout est troublante incertitude. Il y a
dans la manière dont Alain Bézu met en scène « L’Illusion comique » l’accomplissement d’un art.
Une lumineuse simplicité.
A.H., Le quotidien du médecin
Ce que la pièce nous enseigne aujourd’hui
encore c’est peut-être que la réalité ne s’atteint
que par le rêve, que la vie ne se comprend que
par l’illusion de la vie, que pour connaître la vie, il
faut s’aventurer dans la grotte, c’est à dire au
théâtre où les fantômes, les acteurs nous en
disent plus que la vie.
Ma mise en scène de L’Illusion comique gardera
la mémoire du travail accompli sur les comédies :
c’est la même jeunesse insolente et vive en
révolte contre l’autorité des pères, qui est
confrontée aux mêmes questions de la passion,
du désir, de l’inconstance (le change baroque) et
de la liberté, à ce même désir de garder sa
volonté libre de toute contrainte même et surtout
amoureuse. Le spectacle devra manier ces
sentiments divers comme une chorégraphie ; il
devra prendre en charge la langue de ce
Corneille baroque, le poids des mots, parfois leur
étrangeté, la diction de l’alexandrin tourné vers
l’épique ou l’héroïque (certains vers de
Matamore annoncent ceux de Rodrigue), comme
une partition musicale ; j’entends les voix des
acteurs pressentis, j’imagine les timbres
distribués comme pour un opéra : baryton,
basse, ténor, soprano, alto…
Alain Bézu

ALAIN BEZU
Metteur en scène.
Directeur du Théâtre des 2 Rives
Centre dramatique régional de Haute-Normandie.
1974 JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE d'après Diderot (Festival d'Avignon)
1976 MAITRE PUNTILA ET SON VALET MATTI de Bertolt Brecht
1977 LE SALAMANDRES' BUSINESS de Xavier-Agnan Pommeret (C.D.N. de Nanterre)
1978 L'ILLUSION COMIQUE de Corneille (Théâtre de la Resserre/Cité Internationale1980)
1979 LE RETOUR de Pinter (C.D.N. de Bourgogne)
1982 "14-18" d'après d'Henri Barbusse (Théâtre National de l'Odéon, 1982)
1984 MELITE, LA GALERIE DU PALAIS et LA PLACE ROYALE de Corneille (C.D.N. d'Aubervilliers)
1986 VINCENT ET L'AMIE DES PERSONNALITES de Robert Musil (création au Théâtre de l'Athénée)
1987 LA NUIT MEME de Joseph Danan
1988 LE BARBIER DE SEVILLE de Beaumarchais
1990 MEDEA de Jean Vauthier
1991 COMME UNE HISTOIRE D'AMOUR d'Arthur Miller (Théâtre Artistic-Athévains)
1992 LE FILS NATUREL suivi de DORVAL ET MOI de Denis Diderot (Théâtre de l'Est Paris)
1994 FEU LA MERE DE MADAME, LEONIE EST EN AVANCE, ON PURGE BEBE,
MAIS N'TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE !, HORTENSE A DIT"JE M'EN FOUS !"
de Georges Feydeau (Théâtre de l'Est Parisien, septembre-octobre 1995)
1995 ONCLE VANIA d'Anton Tchékhov
1996 LA GRANDE BOUCLE, conception Alain Bézu, Joseph Danan, Rémy Spinneweber
LA NUIT ET LE MOMENT de Crébillon fils (Théâtre de l'Est Parisien, janvier 1998)
1997 PETITE REINE, conception Alain Bézu, Joseph Danan, Rémy Spinneweber
1998 L'ENFANCE DE MICKEY de Joseph Danan
1999 BRITANNICUS de Jean Racine (Théâtre de l'Est Parisien, janvier-février 2000)
1999 GRAND JACQUES, conception Alain Bézu et Philippe Davenet
2001 LA NUIT DES ROIS de William Shakespeare
2002 SOUS L'ECRAN SILENCIEUX de Joseph Danan
2003 ENTRE CHIEN ET LOUP et LE PETIT A LA MERE de Daniel Lemahieu
2005 QUAND NOUS NOUS REVEILLONS D'ENTRE LES MORTS de Henrik Ibsen
2006 L’ILLUSION COMIQUE de Pierre Corneille
1
/
5
100%