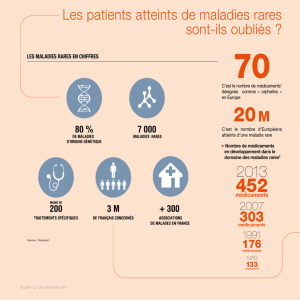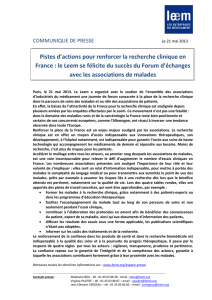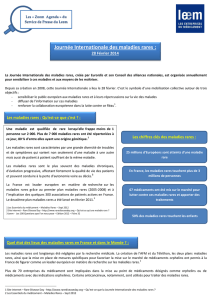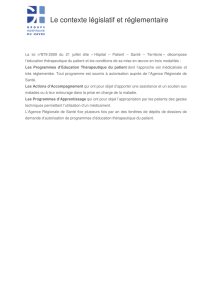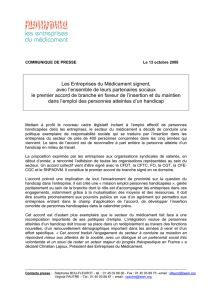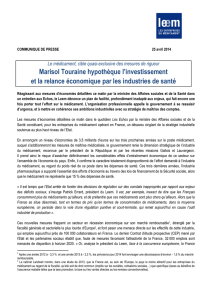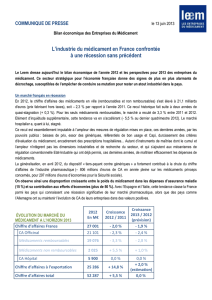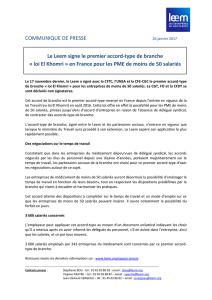Maladies rares

ATELIER D’INFORMATION PRESSE
MALADIES RARES :
un terreau d’innovations pour la médecine de demain
Mercredi 17 février 2016
Intervenants
Les particularités de la recherche scientifique dans les maladies rares
Marina Cavazzana, professeur d'hématologie à l'université Paris-Descartes, directrice du
département de biothérapie de l'hôpital Necker et coordonnateur des centres
d'investigation clinique en biothérapie de l'Inserm.
Les spécificités du développement de molécules innovantes pour les maladies rares
Antoine Ferry, président de CTRS, entreprise du médicament dédiée exclusivement aux
maladies rares.
La très forte implication des associations de malades
Anne-Sophie Lapointe, présidente de Vaincre les maladies lysosomales, membre du
Comité d’éthique de l’Inserm.
La mise en œuvre de méthodes de financement adaptées
Christian Deleuze, président de Sanofi Genzyme France et président du Comité Maladies
Rares du Leem.
Avec la participation de Philippe LAMOUREUX, directeur général du Leem.
Contacts Presse Leem
Stéphanie Bou - 01 45 03 88 38 / 06 60 46 23 08 – [email protected]
Virginie Pautre - 01 45 03 88 87 – vpa[email protected]
Jean-Clément Vergeau - 01 45 03 86 82 – [email protected]

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 17 février 2016
Les industriels du médicament appellent à la mise en place d’un
troisième plan maladies rares
A l’occasion d’un atelier presse consacré au modèle d’innovation que constitue le domaine des
maladies rares, le Leem - par la voix de son Comité maladies rares - a présenté 20 propositions.
Elles constituent l’engagement des industriels du médicament pour les maladies rares et un socle
de réflexions en vue de la mise en place d’un troisième plan maladies rares.
La recherche de traitements pour les maladies rares nécessite de fédérer les associations de malades,
les cliniciens, les chercheurs et les industriels du médicament… Plus encore que pour un médicament
"classique", la mise en commun des compétences de l’ensemble de ces acteurs est essentielle pour
faciliter la compréhension des mécanismes génétiques, la mise au point et l’accessibilité de
traitements personnalisés et innovants dédiés à un très petit nombre de malades.
Terreau de l’innovation médicale, la lutte contre les maladies rares appelle à la mise en œuvre d’un
modèle qui préfigure la médecine du futur : une médecine de précision, connectée, construite sur
des sélections pointues de données et nécessitant une réflexion partagée sur son financement.
C’est pourquoi, les industriels du médicament face à l’urgence du besoin médical –3 millions de
malades en France, 7 000 maladies rares identifiées dont moins de 5 % bénéficient aujourd’hui d’un
traitement– ont élaboré une plateforme de 20 propositions, préambule à une réflexion partagée
avec tous les acteurs de la communauté des maladies rares.
"La France qui a été pionnière dans le champ des maladies rares doit garder son leadership européen
et être aux avant-postes de l’innovation, en faisant en sorte de pousser les réflexions et les décisions
quant à la prise en compte des spécificités liées à cette mosaïque de maladies dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint", déclare Philippe Lamoureux, directeur général du Leem.
"Nous sommes dans une optique de co-construction d’un modèle permettant l’accès de tous au
diagnostic et aux traitements", ajoute Christian Deleuze, président du Comité maladies rares du
Leem. "La mise en place d’un troisième Plan maladies rares serait une opportunité unique de pouvoir
pérenniser les efforts engagés et de s’inscrire dans la médecine du futur".
Retrouvez L’engagement du Leem pour les maladies rares sur : www.leem.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contacts presse : Stéphanie BOU - tél : 01 45 03 88 38 - email : [email protected]

1
DOSSIER DE PRESSE
17 février 2016
MALADIES RARES : UN TERREAU D’INNOVATIONS
POUR LA MEDECINE DE DEMAIN
Les 7 0001 maladies rares répertoriées à ce jour trouvent à plus de 80 % leur origine
dans les "bugs" qui peuvent intervenir dans l’expression de l’information génétique
contenue dans le génome de chaque individu. Erreurs héréditaires ou accidentelles,
ces mutations sont responsables de maladies génétiques2 souvent graves (la moitié
de ces maladies engagent le pronostic vital3), difficiles à diagnostiquer et à soigner.
Les maladies rares concernent plus de 36 millions de personnes en Europe (soit 7,1 %
de la population totale) et 3 millions de personnes en France (4,5 % de la population
totale)4, des chiffres qui masquent une réalité contrastée : prises séparément en
effet, ces maladies touchent des populations extrêmement restreintes, 2/3 d’entre
elles frappant entre 1 et 5 malades5 en France (soit une prévalence de 1 cas pour
10 millions d’individus).
Face à cette mosaïque de maladies, la communauté des maladies rares –malades,
familles, associations, chercheurs, cliniciens, industriels, médecins, autorités de
santé…– s’est engagée dans un formidable effort d’innovations, fondé sur la mise en
commun de l’expertise de toutes les parties prenantes.
Ce nouveau modèle plus ouvert, plus collaboratif préfigure l’évolution de la médecine
du futur : une médecine de précision, connectée, construite sur des sélections
pointues de données et nécessitant une réflexion partagée sur son financement.
Les maladies rares s’affirment ainsi comme un laboratoire d’innovations permettant
d’irriguer les actions et les pistes de recherche initiées sur les maladies fréquentes.
La communauté des maladies rares montre le chemin et innove sur quatre plans :
recherche, développement, partenariat et financement afin de favoriser l’accès
rapide des malades à l’innovation.
ATELIER
PRESSE
Maladies
Rares
Mercredi 17
février 2016
1 Source : http://www.orphanet-france.fr/national/FR-FR/index/a-propos-des-maladies-rares/
2 Si presque toutes les maladies génétiques sont des maladies rares, toutes les maladies rares ne sont pas génétiques. Il y a des maladies
infectieuses très rares par exemple, ainsi que des maladies auto-immunes et des cancers rares. On estime que 80 % des maladies rares sont
génétiques. Source : L’engagement du Leem pour les maladies rares. Janvier 2016. Fiche 1
3 L’engagement du Leem pour les maladies rares. Janvier 2016. Fiche 1
4 Ibid.cité. Fiche 1
5 Ibid.cité. Fiche 1

2
L’innovation en recherche
Poussée par les avancées technologiques de ces dernières décennies, la recherche
sur les maladies rares a fortement progressé, notamment dans ses phases amont,
avec l’identification rapide et peu coûteuse des anomalies génétiques et de leurs
mécanismes.
Le séquençage à haut débit a changé la donne : les nouveaux séquenceurs ont un
débit 1 000 fois supérieur aux premiers séquenceurs des années 90 et sont capables
de traiter en parallèle un très grand nombre de séquences courtes pour un prix de
revient de plus en plus faible : actuellement 400 millions à 1 milliard de paires de
bases par jour pour moins d'un euro par million de paires de base.
Le séquençage à haut débit : le génome d'un individu est composé de 3,3 milliards de
paires de bases (acides nucléiques) contenant une myriade d'informations
essentielles pour la prise en charge des maladies génétiques.
On peut actuellement séquencer de façon routinière des génomes entiers ou un
panel de gènes choisis, d’envisager de systématiser l’identification des mutations et
de décrire chaque maladie en fonction des mutations décelées. C’est aussi un moyen
de diminuer à terme l’errance diagnostique, source de souffrance et de perte de
chance pour les malades. Circonscrire son ennemi est le premier pas dans la lutte
contre ces maladies redoutables, touchant malheureusement de nombreux enfants.
D’autres avancées, la technique des cellules pluripotentes induites (IPs) et la
technique CRISPR permettent quant à elles d’analyser les mécanismes des maladies.
La technique des IPs : récompensée par le prix Nobel de médecine 2012, elle consiste
à prélever n’importe quelle cellule chez un adulte et à la reprogrammer
génétiquement pour la rendre pluripotente, c’est-à-dire capable de se multiplier à
l’infini et de se différencier de tous les différents types de cellules qui composent un
organisme adulte, exactement comme une cellule souche embryonnaire. Ces cellules
sont appelées IPS pour cellules souches pluripotentes induites ("induced pluripotent
stem cells").
Depuis 2007, des centaines de lignées de cellules IPs ont été obtenues à partir de
presque tous les types de cellules adultes capables de se multiplier et sont largement
utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies et tester l’efficacité de molécules
potentiellement thérapeutiques.
ATELIER
PRESSE
Maladies
Rares
Mercredi 17
février 2016

3
CRISPR-cas9 est une technique de génie génétique récompensée par le jury du prix
Breakthrough attribué en novembre 2014 à Emmanuelle Charpentier et Jennifer
Doudna. C’est une technique d’insertion et de suppression de gène issue de
l’ingénierie génétique bactérienne. Chaque séquence CRISPR, qui contient de l'ADN
viral, est transcrite en plus petites molécules intermédiaires, des ARN, qui
contiennent la séquence complémentaire de l'ADN viral. Mais plutôt que d'être
ensuite traduites en protéines, ces ARN vont se lier à une enzyme découpeuse d'ADN
nommée Cas9. Si cette structure rencontre l'ADN viral dans la cellule, l'ARN s'y
apparie et la Cas9 le coupe en deux. Le système permet donc de détecter facilement
une séquence d'ADN donnée, puis de la découper avec précision. On peut par
extension l'utiliser pour supprimer un gène et ainsi découvrir sa fonction ; on peut
aussi éliminer un gène déficient. Il suffit de fabriquer en laboratoire une « ARN guide
» correspondant au gène que l'on souhaite cibler, puis de l'arrimer à une enzyme
Cas9. Cette dernière découpe alors le gène.
CRISPR-Cas9 est une technique simple, rapide (la mise au point d'un CRISPR-Cas9 prêt
à cibler un gène particulier prend une à deux semaines tout compris) et au minimum
dix fois moins coûteux que d’autres techniques concurrentes. En à peine deux ans,
des équipes du monde entier se sont appropriées CRISPR-Cas9 pour modifier le
génome de nombreux types de cellules, tant chez les bactéries que chez les plantes
ou les animaux, avec une extrême facilité. En 2014, la technologie a franchi deux
nouvelles étapes importantes. D'abord, elle s'est révélée utilisable sur des primates.
Ensuite, elle a permis de corriger des maladies génétiques in vivo sur des souris.
Pour obtenir une souris portant une mutation responsable d'une maladie génétique
humaine, il fallait des mois, voire des années. Avec le mécanisme CRISPR-Cas9, ce
délai se trouve raccourci à quelques semaines. Pour la première fois, un accès direct,
facile et précis à l'ADN contenu dans les cellules vivantes devient possible à un grand
nombre de laboratoires. Avant d’utiliser CRISPR-Cas9 sur l'homme, cependant, il
faudra d'abord franchir plusieurs étapes : confirmer que ce système n'induit pas de
lésions dans d'autres régions du génome et optimiser la fréquence à laquelle les
cellules ciblées sont corrigées.
Parallèlement à ces avancées technologiques, la rémission complète des
symptômes de la drépanocytose, chez un adolescent traité par thérapie génique
menée à l'hôpital Necker-Enfants malades de Paris et l'Institut des maladies
génétiques Imagine en 2015, constitue une innovation importante contre une
maladie actuellement sans solution thérapeutique.
La thérapie génique est une sorte d'autogreffe de cellules génétiquement
modifiées. On prélève des cellules souches sur le sujet malade que l’on traite en
laboratoire de façon à y introduire une copie "normale" du gène. Après avoir préparé
le patient avec une chimiothérapie qui amène à la destruction des cellules malades,
on transplante ces cellules corrigées. La thérapie génique a montré son efficacité
dans le traitement d'un certain nombre de maladies, comme les déficits immunitaires
ou certaines formes de maladies métaboliques.
ATELIER
PRESSE
Maladies
Rares
Mercredi 17
février 2016
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%