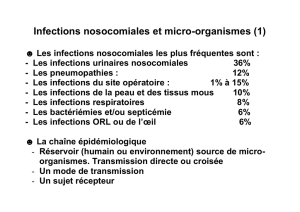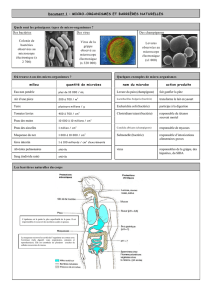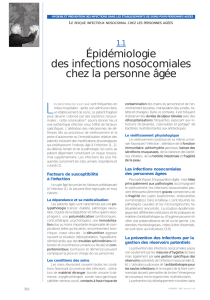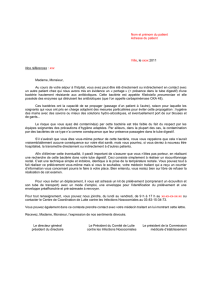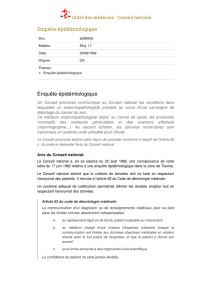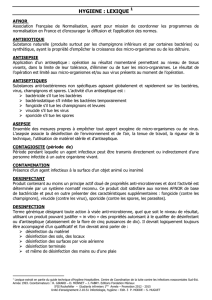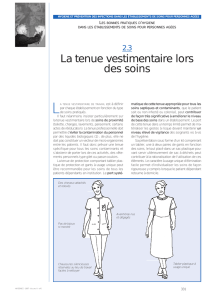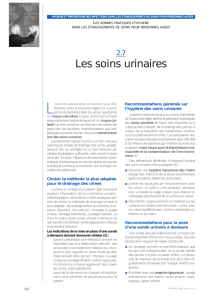La surveillance épidémiologique - CClin Sud-Est

360 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
LES PRATIQUES DE SURVEILLANCE ET D’ÉVALUATION
LA MISE EN ŒUVRE D'UNE SURVEILLANCE épidémio-
logique permet d'établir une fréquence de
base des infections sous forme d’un taux, de
recenser les problèmes infectieux les plus fréquents
afin de décider de mesures de prévention adaptées
et de les évaluer (1).
Le choix des infections à surveiller dépend de
la situation de chaque établissement : soins de
suite, soins de longue durée, type de patients pris
en charge : patients grabataires, postopératoires
etc. Les définitions d’infections nosocomiales
utilisées pour la surveillance doivent spécifiques à
la gériatrie et standardisées. Il est donc recom-
mandé d’utiliser des définitions publiées, ayant fait
l’objet d’un consensus et d’une validation (2,3).
Chaque structure doit établir ses priorités et
adapter son système de surveillance ; il parait es-
sentiel qu’un nombre limité d'indicateurs régu-
lièrement suivis soit disponible. Une surveillance
épidémiologique minimum fait partie intégrante de
la politique de prévention des infections.
La surveillance épidémiologique peut cibler une
ou plusieurs des infections suivantes :
•infections urinaires, en particulier sur sonde,
•infections d'escarre,
•infections muqueuses,
•diarrhées infectieuses,
•nouveaux cas de colonisation, portage, ou in-
fection à bactéries multirésistantes : SAMR,
entérobactéries productrices de ßLSE,
Pseu-
domonas aeruginosa
multirésistant ; dans ce
cas, il peut être intéressant de différencier
les cas importés* d'autres établissements,
des cas acquis* dans l'établissement lui
même.
La surveillance épidémiologique englobe égale-
ment l’investigation des épidémies qui doit être
systématique, afin de recommander au plus tôt les
mesures adéquates de prévention et de comprendre
les situations en ayant permis le développement.
Une surveillance épidémiologique continue peut fa-
voriser le dépistage précoce des épidémies et ainsi
limiter le nombre de personnes atteintes.
Les points essentiels
pour effectuer une surveillance
◆La surveillance se faisant par le calcul d’un taux
d’infection, il faut toujours recueillir les données
permettant d'établir le numérateur et le déno-
minateur.
◆Le questionnaire doit comporter un nombre li-
mité d'items pour qu'une surveillance de rou-
tine soit possible donc efficace :
•renseignements concernant le patient : âge,
sexe, date entrée, service...
•renseignements concernant les facteurs de
risque : sonde urinaire ...
•renseignements concernant l'infection : siège,
micro-organisme, date de début...
◆L’enquête un jour donné (enquête de préva-
lence) est de réalisation assez facile ; l’indica-
teur rapporte le nombre de patients présents in-
fectés au nombre total de patients présents. Il
donne une vue globale du problème de l’infection
nosocomiale et permet de participer aux en-
quêtes nationales mais sa précision reste limitée
pour les établissements de petite taille et il n’est
pas toujours adapté au suivi d’un phénomène
au cours du temps.
Si ce système de surveillance est adopté, il est
recommandé de le compléter par une surveillance
en incidence d’une ou plusieurs types d’infection.
◆La surveillance de l'incidence des infections
nosocomiales exprime le nombre de nouveaux
cas d’infection par unité de temps ou rapportés
à l’exposition à un facteur de risque d’infection.
C’est une surveillance plus précise mais plus
lourde à mettre en œuvre, bien adaptée au suivi
d’un phénomène au cours du temps (4) ; on peut
ainsi disposer des indicateurs suivants sur des pé-
riodes de plusieurs semaines voire plusieurs
mois ou années (5) permettant d’évaluer une po-
litique de prévention :
•nombre d'infections d'escarre pour 1 000 jour-
nées d'hospitalisation,
•nombre d'infections urinaires sur sonde pour
100 journées de sondage,
4.1
La surveillance
épidémiologique

361
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
•nombre de patients ayant acquis une bactérie
multirésistante pour 100 entrants ou 1 000 jour-
nées d'hospitalisation.
◆En fonction des systèmes de surveillance rete-
nus, plusieurs acteurs peuvent être impliqués :
médecin, pharmacien, microbiologiste, hygié-
niste, infirmière.
Les étapes d'une surveillance
épidémiologique des infections
nosocomiales
Bibliographie
1 - Cent recommandations pour la surveillance et la pré-
vention des infections nosocomiales. Bull Epidem. Hebd.
Numéro spécial. Juin 1992 (document en cours de révision
en 1997, nouvelle édition en 1997 ou 1998).
2 - Guide de définition des infections nosocomiales. CCLIN
Paris Nord. Éditions Frison-Roche (1995).
3- MCGEER A, CAMPBELL B, EMORI G,
et al
. Definitions of
infection for long-term care facilities. Am Inf Contr 1991,
19, 1: 1-7.
4 - VERDEIL X, BOCQUET H, CANCE-ROUZAUD A. Surveillance
des infections nosocomiales dans les établissements pour
personnes âgées. Hygiènes 1994, 6: 30-32.
5 - JACKON MM, FIERER J, BARETT-CONNOR E,
et al
. Intensive
surveillance for infections in a three-year study of nursing
home patients. Am J Epidemiol 1992, 135, 6: 685-696.
Les étapes
Définir
les infections à surveiller.
Déterminer
les indicateurs à calculer.
Établir un support
pour le recueil des données.
Recueillir les données de façon
exhaustive et régulière.
Traiter les données.
Calculer des taux d'infection.
Analyser les données avec
un œil critique pour définir
des objectifs d’amélioration
clairs et en nombre limité.
Diffuser les résultats
aux équipes médico-soignantes
en termes clairs et faciles à
comprendre
Mettre en œuvre
les mesures correctives
de prévention adaptée
Poursuivre la surveillance pour
évaluer l'impact de mesures
préventives
La surveillance épidémiologique
OPTIMISER
ETABLISSEMENT X ETABLISSEMENT Y
DONNEES NATIONALES
Utiliser les définitions standardisées d’infec-
tion adaptées à la gériatrie.
Comparer les taux d’infection à ceux d’éta-
blissements de soins à activité équivalente
ou à des données nationales surtout si l’on
dispose de données d’incidence toujours
plus intéressantes que celles de prévalence.
Une informatisation simple facilite le traite-
ment rapide des données et par là même
l’impact de la surveillance épidémiologique.
Le retour d’information des données de sur-
veillance doit être régulier et rapide. Il doit
être l’occasion d’un dialogue constructif
avec les équipes médico-soignantes et non
considéré comme une surveillance sanction.

364 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
AFNOR
Association Française de Normalisation.
Association ayant pour mission de coordonner
les programmes de normalisation en France et d’en-
courager la diffusion et l’application des normes.
antisepsie
Opération au résultat momentané permettant,
au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur
tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-orga-
nismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction des
objectifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NF T 72 101).
antiseptique
Selon AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est
un produit ou un procédé utilisé pour l’antisepsie
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé sont sélectifs, cela doit être précisé. Ainsi, un
antiseptique ayant une action limitée aux champi-
gnons est un antiseptique à action fongicide.
bactéricide
Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les
bactéries dans des conditions définies (AFNOR,
Comité Européen de Normalisation).
bactériostatique
Produit ou procédé ayant la propriété d’inhiber
momentanément les bactéries dans des conditions
définies (AFNOR).
biocontamination
Contamination d’une surface (biologique ou
inerte) ou d’un fluide par des micro-organismes vé-
hiculés par l’air (contamination aéroportée ou aé-
robiocontamination), par des êtres vivants (la conta-
mination par contact avec les mains en est la
modalité majeure) ou par les objets. (Association
pour la Prévention et l’Étude de la Contamination)
biofilm
Ensemble de micro-organismes et de leurs sé-
crétions macromoléculaires qui sont présents sur la
surface d’un matériau (Association pour la Préven-
tion et l’Étude de la Contamination).
bionettoyage
Procédé de nettoyage, applicable dans une zone
à risques, destiné à réduire momentanément la bio-
contamination d’une surface. Il est obtenu par la
combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une éva-
cuation des produits utilisés et des salissures à éli-
miner, de l’application d’un désinfectant.
cas acquis
Le caractère acquis d’une bactérie multirésis-
tante peut être affirmé si un dépistage systéma-
tique à l’entrée dans un service a été réalisé et si
celui-ci est négatif. La découverte d’une telle bac-
térie au cours du séjour plus de 48 à 72 heures
après l’admission chez un patient antérieurement
négatif laisse présumer que la bactérie a été ac-
quise par transmission au cours du séjour.
cas importé
Le caractère importé depuis un autre établisse-
ment d’une bactérie multirésistante peut être af-
firmé si un dépistage systématique à l’entrée du
patient dans le service a été réalisé et si celui-ci est
positif. La découverte d’une telle bactérie chez un
patient moins de 48 à 72 heures après l’admission
laisse présumer que la bactérie a été transmise an-
térieurement par rapport au séjour actuel.
colonisation (colonisé)
Présence d’une bactérie dans un site qui en est
normalement exempt, mais cette bactérie n’est
responsable d’aucun symptôme local ou général
d’infection ; exemple : présence d’une bactériurie
isolée à Staphylococcus aureus dans les urines sans
aucun signe d’infection urinaire.
Lexique

365
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
désinfectant
Produit ou procédé utilisé pour la désinfection,
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi, un
désinfectant ayant une action limitée aux champi-
gnons est désigné par : désinfectant à action fon-
gicide (AFNOR NFT 72 101).
désinfection
◆Opération au résultat momentané permettant
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou
d’inactiver les virus indésirables portés par des mi-
lieux inertes contaminés, en fonction des objec-
tifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NFT 72 101). L’usage du
terme « désinfection » en synonyme de « dé-
contamination » est prohibé.
◆Terme générique désignant toute action à visée
antimicrobienne, quel que soit le niveau de ré-
sultat, et utilisant un produit pouvant justifier
in
vitro
des propriétés autorisant à le qualifier de
désinfectant ou d’antiseptique. Il devrait logi-
quement toujours être accompagné d’un qualifi-
catif et l’on devrait ainsi parler de :
•désinfection des dispositifs médicaux (= du
matériel médical)
•désinfection des sols,
•désinfection des surfaces par voie aérienne,
•et même désinfection des mains ou d’une plaie
(Société Française d’Hygiène Hospitalière et
Comité Européen de Normalisation).
◆Élimination dirigée de germes destinée à empê-
cher la transmission de certains micro-organismes
indésirables, en altérant leur structure ou leur
métabolisme indépendamment de leur état phy-
siologique (CEN)
nettoyage
Opération d’élimination des salissures (particu-
laires, biologiques, liquide,...) avec un procédé fai-
sant appel dans des proportions variables les unes
par rapport aux autres, aux facteurs suivants : action
chimique, action mécanique, temps d’action de ces
deux paramètres et température.
nettoyage-désinfectant
Produit présentant la double propriété de déter-
gence et de désinfection (Société Française d’Hy-
giène Hospitalière).
porteur (portage)
Présence d’une bactérie dans un site où sa pré-
sence est habituelle sans qu’elle soit responsable
d’infection ; exemple : présence de Staphylococ-
cus aureus dans les narines ou dans d’entérobac-
téries dans les selles.
précautions standard
Ensemble des précautions d’hygiène qui s’ap-
pliquent à tout patient sans tenir compte de l’exis-
tence d’une éventuelle infection. Ces précautions
intègrent la protection du personnel vis à vis des li-
quides biologiques, la prévention des accidents
d’exposition au sang et les bonnes pratiques d’hy-
giène visant à limiter la transmission des micro-or-
ganismes hospitaliers lors des soins. Les précau-
tions standard concernent l’hygiène des mains, les
techniques de soins, le nettoyage et la désinfec-
tion du matériel de soins, l’entretien des locaux ,
de la vaisselle et du linge, la prévention des acci-
dents d’exposition aux liquides biologiques dont le
sang. L’application des précautions standard est in-
dispensable à l’efficacité d’une politique de contrôle
des infections nosocomiales.
1
/
4
100%