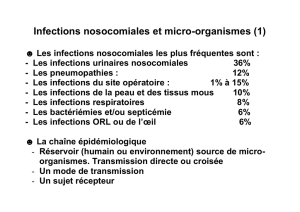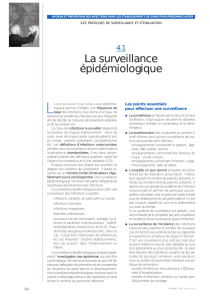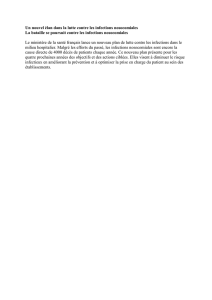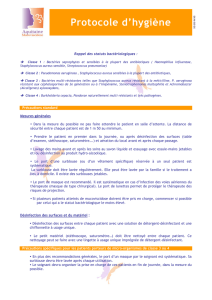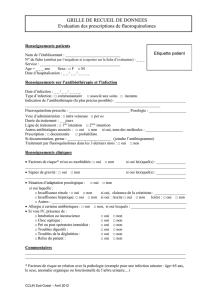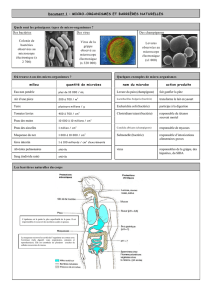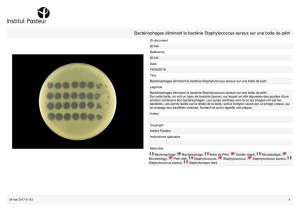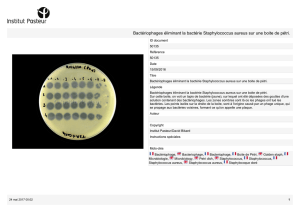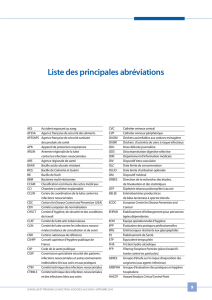Épidémiologie des infections nosocomiales chez la - CClin Sud-Est

316 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
LE RISQUE INFECTIEUX NOSOCOMIAL CHEZ LES PERSONNES AGÉES
LES INFECTIONS DU SUJET AGÉ sont fréquentes en
milieu hospitalier ; après son admission dans
un établissement de soins, ce patient fragilisé
peut devenir colonisé par des bactéries nosoco-
miales ; cette colonisation* pourra donner lieu à
une authentique infection sous l’effet de facteurs
spécifiques. L’altération des mécanismes de dé-
fenses liés au processus de vieillissement et la
perte d’autonomie ou l’immobilisation relative des
patients induisent des modifications physiologiques
qui prédisposent l’individu âgé à l’infection (1, 2).
Au-delà du terrain et de la pathologie, les soins au
patient dépendant constituent un risque nosoco-
mial supplémentaire. Les infections les plus fré-
quentes concernent les sites urinaire, respiratoire et
cutané (1).
Facteurs de susceptibilité
à l'infection
Le sujet âgé accumule les facteurs prédisposant
à l’infection (1). Ils peuvent être regroupés en trois
classes :
La dépendance et sa médicalisation
Les patients âgés sont caractérisés par une po-
lypathologie (cancer, diabète, pathologie vascu-
laire, trouble de la déglutition et reflux gastro-œso-
phagien), une polymédication (antibiotiques,
corticothérapie, psychotropes), une immobilisa-
tion plus ou moins importante responsable de com-
plications telles qu’escarres, encombrement bron-
chique, stase vésicale ; la dénutrition aggrave
souvent la situation (déshydratation, hypoalbumi-
némie) tandis que des troubles sphinctériens (ré-
tention et incontinence urinaire ou fécale) et com-
portementaux (confusion et démence) peuvent
compliquer la prise en charge de ces personnes
Les conditions des soins
Les soins réunissent souvent toutes les condi-
tions favorisant la survenue des infections : utilisa-
tion de matériel étranger (sonde urinaire à de-
meure, oxygénothérapie, sonde naso-gastrique,
cathéter veineux court), contacts à haut risque de
contamination des mains du personnel et de l’en-
vironnement (escarres, manipulation des sondes, toi-
lette et changes). Dans ce contexte, il est fréquent
d’observer des durées de séjour élevées avec des
réhospitalisations fréquentes exposant aux in-
fections récidivantes, colonisation et portage* de
bactéries multirésistantes aux antibiotiques.
Le vieillissement physiologique
Le vieillissement constitue en lui même un ter-
rain favorisant l’infection : altération de la fonction
immunitaire, achlorhydrie gastrique, baisse des
sécrétions muqueuses, de la clairance des bacté-
ries inhalées, de la motilité intestinale et fragilité
de la peau.
Les infections nosocomiales
des personnes âgées
Peu spécifiques à la population âgée, mais liées
principalement aux pathologies accompagnant
le vieillissement, les infections nosocomiales peu-
vent être particulièrement graves compte tenu de
la fragilité des sujets (septicémies, endocardites
ou méningites). Dans le tableau I, sont résumés les
pathologies causales et les micro-organismes ha-
bituellement rencontrés. La situation épidémiolo-
gique des différentes institutions et les pratiques en
matière d’antibiothérapie ou d’hygiène peuvent ré-
véler une prépondérance de tel ou tel germe. Les
données microbiologiques, citées à titre d’exemple,
ne sont donc qu’indicatives (3,4).
La prévention des infections par la
gestion des réservoirs potentiels
La prévention des infections nosocomiales passe
non seulement par les mesures d’hygiène de base
mais également par une gestion spécifique des
réservoirs potentiels de l’infection nosocomiale (5,
6). L’utilisation judicieuse de l’antibiothérapie pour
les seules infections et le respect de la flore com-
mensale doivent permettre de limiter l’émergence
de nouveaux micro-organismes multirésistants.
La prévention du développement microbien dans
1.1
Épidémiologie
des infections nosocomiales
chez la personne âgée

317
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
Tableau I -
Épidémiologie,
facteurs de risque, et
micro-organismes en
cause dans l’infection
du sujet âgé.
ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LA PERSONNE AGÉE
les différents émonctoires peut être obtenue en
restaurant un terrain plus physiologique, notam-
ment en limitant la stase urinaire, bronchique ou di-
gestive. D’un point de vue collectif, les gestes de
soins doivent obéir à des procédures d’hygiène ri-
goureuses. Le tableau II récapitule les moyens de
prévention de l’infection en fonction du site et des
risques individuel ou collectif.
Au total
◆Les infections nosocomiales du patient âgé dé-
pendant concernent le secteur hospitalier et le
secteur médico-social. La politique de préven-
tion suivie dans ces établissements doit s’ap-
puyer sur des principes communs.
◆Les réservoirs naturels de l’infection nosoco-
miale doivent bénéficier d’une approche spéci-
fique basée sur la connaissance des modifica-
tions physiologiques liées au vieillissement
(diminution des barrières naturelles à l’infection),
la lutte contre l’immobilisation ou la stase (uri-
naire, bronchique et stercorale).
◆La politique d’antibiothérapie et la mise en œuvre
de techniques de soins invasifs (sondes urinaire
et naso-gastrique, cathéter) doivent être régu-
lièrement évaluées en terme de bénéfice et de
risque pour le patient et la collectivité.
Les questions sensibles
qui restent posées
La mise en œuvre de l’isolement
(cf. chapitre 3.2)
L’isolement d’un patient infecté est à la base de
la prévention de la diffusion des bactéries multiré-
sistantes. Sa mise en œuvre se heurte à plusieurs
difficultés :
•problème posé par les patients désorientés et
déambulants,
•qualité de vie de la personne âgée si cette me-
sure doit se prolonger au delà de quelques
jours ; des solutions alternatives efficaces res-
tent à déterminer préservant aux mieux les in-
térêts individuels sans pour autant faire courir
des risques à la collectivité.
La décontamination des sites colonisés
(cf. chapitres 3.1 et 3.2)
La colonisation ou le portage de bactéries mul-
tirésistantes ont conduit à proposer des traitements
de décolonisation des sites en cause afin de dimi-
nuer le potentiel de dissémination en réduisant
l’inoculum, de réduire le risque d’épidémies.
L’efficacité de ces stratégies ne fait pas l’objet de
consensus ; elles doivent être mises en œuvre avec
prudence dans le cadre de démarches suivies
et régulièrement évaluées pour limiter l’émergence
de bactéries résistantes (7) ; elles ne constituent
que des mesures d’appoint aux précautions d’hy-
giène de base et d’isolement, en particulier en cas
d’épidémies.
Les sites visés par la décolonisation sont variés,
les protocoles de décolonisation sont fonction du ré-
servoir principal, de l’existence d’un réservoir se-
condaire accessible au traitement et du micro-or-
ganisme. On peut envisager ces différentes
situations après avis spécialisé :
•décolonisation des narines en cas de portage de
Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline
(SARM),
•toilette antiseptique* du revêtement cutané en
complément d’une décolonisation nasale (8),
•la décontamination digestive pour les entérobac-
téries à ßLSE a une efficacité inconstante et son
évaluation en gériatrie reste à faire,
•traitement antibiotique pour stériliser des urines
en cas de bactériurie asymptomatique à germes
multirésistants, en particulier chez le patient sondé
Facteurs de risque
Agents infectieux
en cause
Infection urinaire
- Adénome prostatique
- Vessie rétentionniste
- Instabilité vésicale
(diabète, constipation,
vessie neurologique,
déshydratation)
- Sonde à demeure
- E. coli
- Providencia stuarti
- Pseudomonas
aeruginosa
- Acinetobacter baumannii
- Klebsiella , Enterobacter
sp.
- Staphylococcus aureus
1
Infection pulmonaire
- Reflux gastro-
œsophagien
- Troubles de la déglutition
et fausses routes
- Pathologie bucco-
dentaire
- Pathologie chronique
des voies respiratoires
- Traitement antiacide
- Sonde naso-gastrique
- Tuberculose
- Grippe
- Klebsiella pneumoniae
- Pneumocoque
- Haemophilus influenzae
- Enterobacter aerogenes
- E. coli
- Pseudomonas
aeruginosa
- Virus (grippe)
Infection de la peau et
des parties molles
- Plaies de pression
- Ulcères artériels et
veineux
- Lésions de grattage et
plaies traumatiques
- Conjonctives
-
Staphylococcus aureus
1
- Entérobactéries
-
Pseudomonas
aeruginosa
- Candidoses
- Gale
Infection digestive
- Pathologie iatrogène
(pression antibiotique,
manœuvres
endoscopiques)
- Clostridium difficile
- E. Coli
- Klebsiella pneumoniae
- Virus : Rotavirus,
Coronavirus, Norwalk,
Astrovirus
-
Candida albicans
1- dont
Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM).

318 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
Tableau II - Prévention
de l’infection ou de la
colonisation des sites
à risque.
Bibliographie
1 - CHRISTMANN D. Infections nosocomiales chez le sujet
âgé. Med Hyg. 1990, 48, 3546-3552.
2 - GARNER JS, JARVIS WR, EMORI TG,
et al
. CDC Defini-
tions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988,
16: 128-140.
3 - LEE YL, THRUPP LD, FRIIS RH, and al. Nosocomial in-
fection and antibiotic utilization in geriatric patients : a
pilot prospective surveillance programm in skilled nursing
facilities. Gerontology 1992, 38: 223-232.
4 - MICHEL JP, LESOUR B, CORNE P,
et al
. Prevalence of in-
fections and their risk factors in geriatrics institutions: a one
day multicentre survey. Bulletin of the World Health Or-
ganization 1991, 69: 35-41.
5 - YOSHIKAWA TT, NICOLLE LE, NORMAN DC. Management
of complicated urinary tract infection in older patients.
JAGS 1996, 44: 1235-1241.
6 - MOULIAS R, HOLSTEIN J, MEAUME S. La lutte contre les
infections nosocomiales en gériatrie. Rev Geriatr 1995,
9: 113-118.
7 - BOYCE JM. Treatment and control of colonization in the
prevention of nosocomial infections. Infect Control Hosp
Epidemiol 1996, 17: 256-261.
8 - RÉGNIER B. Contrôle des épidémies de
S. aureus
ré-
sistants à la méticilline : analyse critique et stratégie de maî-
trise. Med Mal Infect 1997, 27, spécial:172-180.
9 - BOYCE JM. Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus
in hospital and long-term facilities: microbiology, epide-
miology and preventives measures. Infect Control Hosp
Epidemiol 1992, 13: 725-737.
ou incontinent (
Staphylococcus aureus
résistant à
la méticilline, entérobactéries sécrétrices de béta-
lactamases à spectre étendu,
Pseudomonas aeru-
ginosa
résistant). Le changement de sonde uri-
naire lors d’un traitement antibiotique peut
contribuer au succès du traitement pour obtenir
une stérilisation des urines.
L’efficacité à long terme des protocoles de dé-
colonisation reste posée : impact sur la résistance
aux antibiotiques, gestion des récidives de portage
ou de colonisation, nombre de prélèvements né-
gatifs à exiger pour confirmer la décolonisation.
La prévention des épidémies
par le dépistage des sujets à risque
Le dépistage des patients a été proposé afin de
prendre au plus tôt les précautions face à un patient
à haut risque infectieux ou porteur de bactérie mul-
tirésistante. Ce dépistage systématique soit à l’en-
trée dans l'unité de gériatrie soit selon un profil de
risques défini (antécédent de portage, antibiothéra-
pie prolongée, sonde à demeure...), soit lors d’une
mutation vers un établissement de court séjour ont
un impact financier non négligeable posant problème
à certains établissements. Ils semblent néanmoins
avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant lorsque
la prévalence des bactéries multirésistantes est éle-
vée (8), ce qui est le cas dans beaucoup d’établis-
sements de soins en France.
ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LA PERSONNE AGÉE
Risque individuel :
facteurs endogènes
Risque collectif :
facteurs
environnementaux
Voies urinaires
- Hydratation
- Lutte contre la stase
- Chirurgie prostatique
- Drainage urinaire clos
- Réduction des indica-
tions et de la durée du
sondage
- Rééducation vésicale
- Antibiothérapie unique-
ment en cas d’infection
haute
- Éviter l’antibiothérapie
prolongée
- Acidification des urines
(Proteus sp)
- Lavage des mains +++
- Asepsie rigoureuse lors
des prélèvements, du
sondage y compris lors
du simple sondage éva-
cuateur
- Ne pas traiter les bacté-
riuries asymptomatiques
chez le sujet sondé (en
dehors des bactéries
multirésistantes pour
lesquelles on adoptera
une stratégie concertée
avec le microbiologiste)
Arbre respiratoire
- Installation du malade en
position semi-assise
- Traitement du reflux
- Réduction du débit de
l’alimentation entérale
- Réduction de la stase
bronchique (kinésithéra-
pie +++)
- Vaccination antigrippale
- Prévenir la dénutrition
- Éviter l’antibiothérapie
prolongée
- Lavage des mains +++
- Asepsie lors des aspira-
tions (sans contact,
sonde stérile) et lors de
la mise en place d’une
sonde naso-gastrique ou
à oxygène
(port de gants)
- Isolement parfois
- Vaccination contre la
grippe des patients et du
personnel
- Vaccination antipneumo-
coccique
Peau et parties molles
- Hygiène cutanée de
base (savon neutre),
- Changes réguliers en cas
d’incontinence (4 à 6 fois
par jour) pour éviter la
macération
- Prévention des plaies de
pression
(support anti-escarres
adapté)
- Mobilisation pluriquoti-
dienne
- Lavage des mains +++
- Dépistage pour un isole-
ment précoce des sujets
positifs en SARM1
- Respect des principes
d’hygiène lors de la toi-
lette du patient dépen-
dant et de la réfection
des pansements.
- Pas d’antibiothérapie par
voie générale sauf en cas
d’infection cutanée exten-
sive ou bactériémique.
- Discuter la décolonisa-
tion cutanée chez le
sujet porteur* de
germes multirésistants.
Appareil digestif
- Éviter l’antibiothérapie
prolongée
- Favoriser le transit
(éviter iléus et stase
stercorale)
- Prévenir la dénutrition
- Lavage des mains +++
- Asepsie lors de la mise
en place et de l’entretien
de sonde naso-gastrique
- Décontamination diges-
tive ponctuelle à discuter
au cas par cas et avec le
microbiologiste pour les
sujets porteurs* d’enté-
robactéries à ßLSE2
- Isolement.
1- SARM :
Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM).
2- ßLSE : béta-lactamases à spectre étendu.

364 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
AFNOR
Association Française de Normalisation.
Association ayant pour mission de coordonner
les programmes de normalisation en France et d’en-
courager la diffusion et l’application des normes.
antisepsie
Opération au résultat momentané permettant,
au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur
tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-orga-
nismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction des
objectifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NF T 72 101).
antiseptique
Selon AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est
un produit ou un procédé utilisé pour l’antisepsie
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé sont sélectifs, cela doit être précisé. Ainsi, un
antiseptique ayant une action limitée aux champi-
gnons est un antiseptique à action fongicide.
bactéricide
Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les
bactéries dans des conditions définies (AFNOR,
Comité Européen de Normalisation).
bactériostatique
Produit ou procédé ayant la propriété d’inhiber
momentanément les bactéries dans des conditions
définies (AFNOR).
biocontamination
Contamination d’une surface (biologique ou
inerte) ou d’un fluide par des micro-organismes vé-
hiculés par l’air (contamination aéroportée ou aé-
robiocontamination), par des êtres vivants (la conta-
mination par contact avec les mains en est la
modalité majeure) ou par les objets. (Association
pour la Prévention et l’Étude de la Contamination)
biofilm
Ensemble de micro-organismes et de leurs sé-
crétions macromoléculaires qui sont présents sur la
surface d’un matériau (Association pour la Préven-
tion et l’Étude de la Contamination).
bionettoyage
Procédé de nettoyage, applicable dans une zone
à risques, destiné à réduire momentanément la bio-
contamination d’une surface. Il est obtenu par la
combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une éva-
cuation des produits utilisés et des salissures à éli-
miner, de l’application d’un désinfectant.
cas acquis
Le caractère acquis d’une bactérie multirésis-
tante peut être affirmé si un dépistage systéma-
tique à l’entrée dans un service a été réalisé et si
celui-ci est négatif. La découverte d’une telle bac-
térie au cours du séjour plus de 48 à 72 heures
après l’admission chez un patient antérieurement
négatif laisse présumer que la bactérie a été ac-
quise par transmission au cours du séjour.
cas importé
Le caractère importé depuis un autre établisse-
ment d’une bactérie multirésistante peut être af-
firmé si un dépistage systématique à l’entrée du
patient dans le service a été réalisé et si celui-ci est
positif. La découverte d’une telle bactérie chez un
patient moins de 48 à 72 heures après l’admission
laisse présumer que la bactérie a été transmise an-
térieurement par rapport au séjour actuel.
colonisation (colonisé)
Présence d’une bactérie dans un site qui en est
normalement exempt, mais cette bactérie n’est
responsable d’aucun symptôme local ou général
d’infection ; exemple : présence d’une bactériurie
isolée à Staphylococcus aureus dans les urines sans
aucun signe d’infection urinaire.
Lexique

365
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
désinfectant
Produit ou procédé utilisé pour la désinfection,
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi, un
désinfectant ayant une action limitée aux champi-
gnons est désigné par : désinfectant à action fon-
gicide (AFNOR NFT 72 101).
désinfection
◆Opération au résultat momentané permettant
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou
d’inactiver les virus indésirables portés par des mi-
lieux inertes contaminés, en fonction des objec-
tifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NFT 72 101). L’usage du
terme « désinfection » en synonyme de « dé-
contamination » est prohibé.
◆Terme générique désignant toute action à visée
antimicrobienne, quel que soit le niveau de ré-
sultat, et utilisant un produit pouvant justifier
in
vitro
des propriétés autorisant à le qualifier de
désinfectant ou d’antiseptique. Il devrait logi-
quement toujours être accompagné d’un qualifi-
catif et l’on devrait ainsi parler de :
•désinfection des dispositifs médicaux (= du
matériel médical)
•désinfection des sols,
•désinfection des surfaces par voie aérienne,
•et même désinfection des mains ou d’une plaie
(Société Française d’Hygiène Hospitalière et
Comité Européen de Normalisation).
◆Élimination dirigée de germes destinée à empê-
cher la transmission de certains micro-organismes
indésirables, en altérant leur structure ou leur
métabolisme indépendamment de leur état phy-
siologique (CEN)
nettoyage
Opération d’élimination des salissures (particu-
laires, biologiques, liquide,...) avec un procédé fai-
sant appel dans des proportions variables les unes
par rapport aux autres, aux facteurs suivants : action
chimique, action mécanique, temps d’action de ces
deux paramètres et température.
nettoyage-désinfectant
Produit présentant la double propriété de déter-
gence et de désinfection (Société Française d’Hy-
giène Hospitalière).
porteur (portage)
Présence d’une bactérie dans un site où sa pré-
sence est habituelle sans qu’elle soit responsable
d’infection ; exemple : présence de Staphylococ-
cus aureus dans les narines ou dans d’entérobac-
téries dans les selles.
précautions standard
Ensemble des précautions d’hygiène qui s’ap-
pliquent à tout patient sans tenir compte de l’exis-
tence d’une éventuelle infection. Ces précautions
intègrent la protection du personnel vis à vis des li-
quides biologiques, la prévention des accidents
d’exposition au sang et les bonnes pratiques d’hy-
giène visant à limiter la transmission des micro-or-
ganismes hospitaliers lors des soins. Les précau-
tions standard concernent l’hygiène des mains, les
techniques de soins, le nettoyage et la désinfec-
tion du matériel de soins, l’entretien des locaux ,
de la vaisselle et du linge, la prévention des acci-
dents d’exposition aux liquides biologiques dont le
sang. L’application des précautions standard est in-
dispensable à l’efficacité d’une politique de contrôle
des infections nosocomiales.
1
/
5
100%