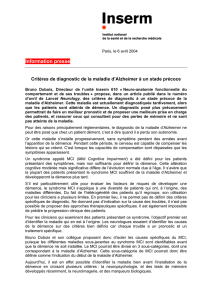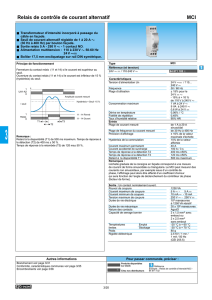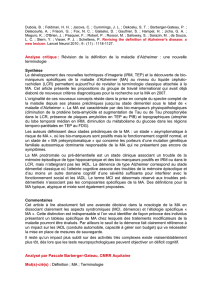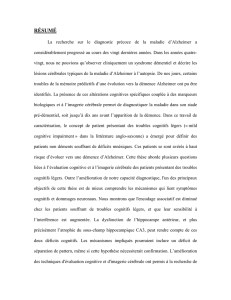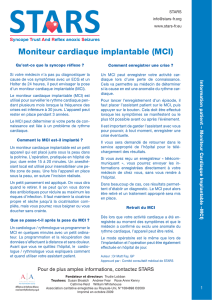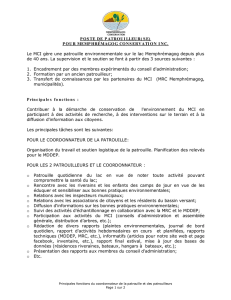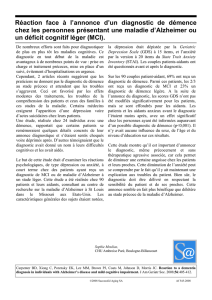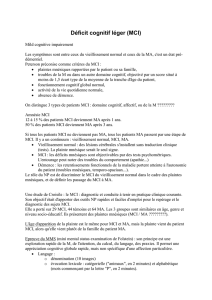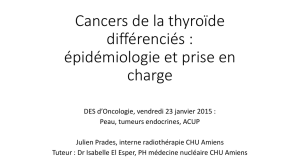Les nouveaux marqueurs de la maladie d`Alzheimer

Document en relation avec la session coordonnée
LES NOUVEAUX MARQUEURS DE LA MALADIE ALZHEIMER,
modérée par le Dr A. Stillmunkes
et présentée par les Dr PJ. Ousset, C. Vincent, P. Payoux, C. Arbus et Jérémie Pariente
Les nouveaux marqueurs de la maladie d’Alzheimer :
vers le diagnostic à un stade prédémentiel de la maladie ?
Blandine Acket, Jérémie Pariente
Unité de Neuropsychologie, CMRR Midi Pyrénées, INSERM U825,
CHU Purpan Toulouse
La maladie d’Alzheimer (MA) comprend une phase présymptomatique et une phase symptomatique. Cette
dernière peut être artificiellement divisée entre une phase « légère » sans retentissement sur la vie quotidienne et
une phase démentielle. Il a souvent été considéré que le MCI (Mild Cognitive Impairment ou Trouble Cognitif Léger)
correspondait à la phase symptomatique prédémentielle de la MA.
Le MCI est un syndrome défini par l’association d’une plainte cognitive, d’un trouble cognitif objectivé par une
évaluation neuropsychologique contrastant avec une autonomie préservée dans la vie quotidienne. Sa prévalence
chez les adultes de plus de 65 ans varie de 3 à 19%. Plus de 50% de ces patients progresseront vers une maladie
d’Alzheimer (MA) à un stade démentiel dans les 5 ans (1). Mais tous les patients étiquetés « MCI » n’évoluent pas
vers une démence de type Alzheimer. Certains restent stables ou s’améliorent, d’autres progressent vers d’autres
maladies neurodégénératives ou non neurodégénératives.
Il serait ainsi pertinent de distinguer parmi les patients « MCI », ceux qui présentent une maladie d’Alzheimer
prédémentielle afin d’optimiser leur prise en charge et la qualité des essais thérapeutiques.
MCI : UNE ENTITE NOSOLOGIQUE REMISE EN QUESTION
En 1997, Petersen et al, ont donné les caractéristiques cliniques et étudié un profil évolutif de patients non
déments, se plaignant de leur mémoire. Ces patients avaient une altération cognitive dans un domaine, un
fonctionnement cognitif non altéré par ailleurs et aucune perte d’autonomie. Le concept de MCI était né. Ces
patients suivis 5 ans étaient à haut risque d’évoluer vers une maladie d’Alzheimer (10 à 15% par an). Rapidement,
ce cadre nosologique a semblé trop hétérogène. Les stades précoces de démence vasculaire et de démence à corps
de Lewy peuvent aussi être précédés d’un MCI. La dépression peut également prendre le masque d’un MCI. Enfin,
les études épidémiologiques révèlent que les performances cognitives de 44% de ces patients se normalisent à un
an de suivi (1).
En 2003, le concept est revisité. Deux sous types de MCI émergent alors : le MCI amnésique et le MCI non
amnésique (2). Malgré cette précision nosographique, une hétérogénéité des groupes de patients persiste. Les taux
de conversion vers une MA diffèrent selon les études qui utilisent la même définition du MCI amnésique (2). Par
ailleurs, seulement 70% des patients présentant un MCI amnésique évoluant vers une démence de type Alzheimer,
ont les critères neuro-pathologiques après autopsie. Ces critères cliniques manquant de spécificité, le recours aux
examens complémentaires s’avère nécessaire afin de permettre un diagnostic étiologique plus précis.

En 2007, fort des progrès effectués dans les outils diagnostics de MA, Dubois et al revisitent les critères
diagnostiques de recherche de Maladie d’Alzheimer. La place des examens complémentaires dans la stratégie
diagnostique de la MA est précisée. Ces nouveaux critères ouvrent la possibilité de poser un diagnostic de MA à un
stade prédémentiel (3). Le concept de MCI vacille.
CARACTERISATION CLINIQUE
Pour Dubois et al, la MA est caractérisée par un profil d’atteinte mnésique spécifique. La mémoire épisodique est
altérée avec des capacités de rappel libre diminuées et faiblement améliorées par l’indiçage sémantique. L’étude
PréAl a comparé la puissance de 11 tests neuropsychologiques pour identifier les patients atteints de maladie
d’Alzheimer prédémentielle parmi 251 patients MCI suivis tous les 6 mois pendant 3 ans. Le test le plus sensible et
le plus spécifique pour le diagnostic de maladie d’Alzheimer est le Rappel libre/Rappel indicé 16 items (RL/RI 16).
75% des patients ayant moins de 40/48 au rappel total évoluent vers une MA à 3 ans contre 8% de ceux qui ont
plus de 40/48. Un autre élément distinctif du RL/RI 16 est le rappel libre avec un seuil à 17/48 qui a une spécificité à
91,8% et une sensibilité 71,2%. Le syndrome amnésique de type temporal médial ainsi décrit permet de distinguer
au sein des patients présentant un MCI dit amnésique ceux souffrant d’une MA à un stade pré-démentiel (4).
Les tests de reconnaissance visuelle permettraient également de préciser les groupes les plus à risque d’évolution
vers un stade démentiel de la MA. Barbeau et al, après avoir développé le DMS 48, ont montré que parmi un
groupe de patients MCI ayant des performances altérées au RL/RI 16 ceux qui échouaient au DMS48 avaient des
profils d’atrophie corticale comparables à ceux atteints de MA à un stade démentiel (5).
On relève par ailleurs un intérêt croissant pour les troubles psycho-comportementaux associés à l’atteinte
cognitive. Anxiété, dépression, irritabilité, apathie peuvent être observés. Cette association accroît le risque
d’évolution vers une MA à un stade démentiel. Palmer et al ont étudié la prévalence de ces troubles chez 232
patients (47 MCI et 185 non MCI) et la relation avec le développement futur d’une MA. 83,3% des patients
présentant un MCI associé à des troubles anxieux, développent une MA à un stade démentiel à 3 ans contre 40 ,9%
des MCI non anxieux et 6,1 % des sujets intacts de troubles cognitifs (6).
CARACTERISATION BIOLOGIQUE
L’analyse du liquide céphalorachidien n’est plus une procédure visant seulement à exclure les diagnostics
différentiels de la MA. Son intérêt s’est récemment accru grâce au développement de biomarqueurs spécifiques,
reflets du processus pathologique central (agrégats de protéines amyloïdes β et hyperphosphorylation de protéines
tau). Hansson et al, ont étudié les résultats de 137 liquides céphalorachidiens prélevés chez des patients présentant
un MCI suivis cliniquement pendant au moins 4 ans. Une combinaison des concentrations de T-tau et d’Aβ42 à
l’inclusion permettait d’obtenir une sensibilité de 95% et une spécificité de 83% pour la détection d’une MA
prédémentielle chez ces patients MCI (7).
Pour certains centres, l’étude de liquide cérébrospinal fait déjà partie des examens réalisés en pratique dans le
bilan d’une possible MA. Les marqueurs actuellement utilisés sont la protéine amyloïde β1-42 (Aβ42), abaissée,
ainsi que la protéine tau totale (T-tau) et la tau phosphorylée (P-tau), augmentées dans la MA (10). Le dosage des 3
types de protéines peut être fait simultanément. Pour le diagnostic de MA, la combinaison de l’Aβ42 et de la T -tau
a une sensibilité haute (85-94%) et une spécificité élevée (83-100%) (3).
Ces dosages ont un intérêt moindre dans d’autres cadres nosologiques (sauf peut être pour la maladie de
Creutzfeldt Jakob où le taux de T-tau est très élevé) bien qu’une étude récente comparant analyse du LCR et
examen anatomopathologique post-mortem ait montré qu’il est possible de différencier la MA des autres maladies
neurodégénératives avec une sensibilité et une spécificité de 80 et 93 % respectivement (8). D’autres marqueurs

sont en développement dans le LCR (isoprostane par exemple) mais également dans le sérum (protéine amyloïde)
ce qui simplifierait la généralisation de leur utilisation.
CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE
L’imagerie cérébrale aide au diagnostic différentiel mais aide aussi au diagnostic positif des maladies
neurodégénératives.
Les lésions neuropathologiques caractéristiques de la MA débutent dans le cortex entorhinal puis s’étendent
progressivement à l’hippocampe puis au lobe temporal avant de toucher l’ensemble des aires associatives. La
morphologie et surtout l’atrophie des parties internes des lobes temporaux intéressent donc de nombreuses
équipes de recherche. En 2007, Devanand et al, ont inclus 139 patients MCI et 63 contrôles, ayant bénéficié d’une
IRM initiale et d’un suivi pendant 5 ans. Cette étude permet de confirmer, qu’un volume de cortex entorhinal et
hippocampique moindre est prédictif d’une conversion en MA à un stade démentiel chez les patients MCI. En
tenant compte de l’âge et des résultats du bilan neuropsychologique, ces paramètres permettent d’avoir un haut
niveau prédictif, intéressant pour ses applications cliniques (9).
L’IRM est donc devenue l’examen de choix dans le bilan d’un trouble cognitif en particulier à un stade prédémentiel
dès que la machine est accessible et que le patient est suffisamment coopérant. L’analyse visuelle simple est
utilisée classiquement. Les analyses quantitatives de l’hippocampe ne sont pas encore accessibles en pratique
clinique quotidienne. La segmentation manuelle des hippocampes est trop subjective et couteuse en temps. Des
procédures de segmentation automatiques sont en cours de validation. D’autres techniques comme la mesure
totalement automatisée de l’épaisseur du ruban cortical sont en cours de validation (10).
La visualisation des plaques amyloïdes in vivo grâce à l’IRM de haut champ reste encore à démontrer.
Enfin, l’IRM permet également d’évaluer une éventuelle composante cérébro-vasculaire aux troubles cognitifs. Ce
sont les séquences en T2 (hypersignaux de la substance blanche), T2* (micro-saignements), T1 (infarctus
constitués) qui sont utiles.
CARACTERISATION METABOLIQUE
La tomographie par émission de positions (PET) et le SPECT (Single photon emission computed tomography) sont
des techniques d’imageries nucléaires. Certains radio-isotopes permettent d’évaluer le débit sanguin (99mHMPAO
ou 133Xe) ou le métabolisme glucidique (18FDG). D’autres, plus récemment développés détectent les dépôts de
protéines amyloïdes ou dégénérescences neurofibrillaires.
L’utilité du 18FDG-PET pour la détection de MA à un stade prédementiel chez les patients MCI, n’a fait l’objet que
d’études comportant un faible nombre de patients, dont le suivi était limité (<3 ans). Sa valeur prédictive positive
dans le diagnostic de MA prédémentielle chez les patients MCI varie de 75 à 84% selon ces études (3). Le SPECT est
plus accessible et moins coûteux. Seules 2 études rétrospectives ont étudié sa pertinence dans le diagnostic de MA
chez les patients MCI.
Les techniques d’imagerie moléculaire offrant un reflet direct du processus pathologique sont en plein essor.
Plusieurs marqueurs spécifiques ont été développés. Le Pittsburgh Compound B (PIB), l’AV-45 marquent les plaques
amyloides tandis que le FDDNP est un marqueur de la dégénérescence neurofibrillaire et de la plaque amyloïde.
L’accessibilité de ces examens reste très limitée en France. Les dernières études présentées à l’International
Conference on Alzheimer Disease à Chicago en Juillet 2008 suggèrent que l’utilisation de ce type d’imagerie
pourrait permettre une avancée notable dans le diagnostic précoce de la MA en pratique clinique. Il faut noter que
certains patients porteurs d’une maladie à corps de Lewy ou d’une dégénérescence lobaire fronto-temporale
« fixent » parfois un de ces traceurs.

CONCLUSION
Le concept de « MCI » est à présent modifié. Ce cadre nosologique reste hétérogène. L’utilisation combinée des
différents outils neuropsychologiques, d’imageries et biologiques permet de préciser le diagnostic étiologique
lorsque les patients se présentent à la consultation à un stade précoce de la maladie. Nous pouvons imaginer dans
un futur proche qu’un patient porteur d’un MCI ayant un liquide cérébro-spinal et une imagerie moléculaire
compatible soit reclassé « MA prédémentielle ». A ce jour, seuls les marqueurs biologiques dans le LCR sont validés.
Les implications de ce changement sont majeures tant à l’échelle individuelle que sur le développement de
nouvelles molécules.
Un diagnostic précoce à un stade prédémentiel nécessitera une information complète pour le patient et son
entourage mais également une prise en charge différente de celle proposée actuellement. Reste à réfléchir aux
implications éthiques d’un diagnostic précoce d’une maladie pour laquelle les options thérapeutiques disponibles
sont à ce jour limitées.
D’autre part, des études spécifiques non biaisées par le cadre hétérogène du MCI deviendraient possibles en
excluant les patients à un stade MCI d’une autre pathologie neurodégénératives. Le développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques entravant le cours de la maladie (anti-amyloïdes, anti-tau, inhibiteurs des gamma-
sécrétases) rendra cette approche indispensable. Parmi les molécules développées certaines sont potentiellement
efficaces mais possiblement dangereuses. Ceci exige un diagnostic précis pour ne faire courir un éventuel risque
qu’aux patients porteurs de la maladie à traiter.

BIBLIOGRAPHIE
(1) Gauthier S, Reisberg B, Zaudig M, Petersen RC et al. Mild cognitive impairment. Lancet 2006 ; 367 :1262-1270.
(2) Petersen RC. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. J Intern Med. 2004;256:183-194.
(3) Dubois B, Feldman HH, Jacova C, De Kosky ST et al Research criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease
revising the NINDS-ADRDA criteria. Lancet Neurology 2007 ;6 :734-746.
(4) Sarrazin M, Berr C, De Rotrou J, Fabrigoule C et al. Amnestic syndrome of the medial temporal type identifies
prodromal AD. A longitudinal study. Neurology 2007 ;69 :1859-67.
(5) Barbeau EJ, Ranjeva JP, Didic M, Confort-Gouny S et al. Profile of memory impairment and gray matter loss in
amnestic mild cognitive impairment. Neuropsychologia. 2008; 46:1009-19.
(6) Palmer K, Berger AK, Monastero R, Winblad B, Bäckman L, Fratiglioni L. Predictors of progression from mild
cognitive impairment to Alzheimer disease Neurology 2007;68:1596–1602.
(7) Hansson O, Zetterberg H, Buchhave P, Londos E, Blennow K, Minthon L. Association between CSF biomarkers
and incipient Alzheimer’s disease in patients with mild cognitive impairment: a follow up study. Lancet Neurol
2006;5:228-34.
(8) Engelborghs S, De Vreese K, Van de Casteele T,Vanderstichele H et al. Neurobiology of Aging 2008 ;29 :1143-59.
(9) Devanand DP, Pradhaban G, Liu X, Khandji A et al. Hippocampal and entorhinal atrophy in mild cognitive
impairment Prediction of Alzheimer disease. Neurology 2007;68:828–36.
(10) Querbes O, Aubry F, Pariente J, Lotterie JA, Démonet JF, Duret V, Puel M, Berry I, Fort JC, Celsis P. Alzheimer's
Disease Neuroimaging Initiative. Early diagnosis of Alzheimer's disease using cortical thickness: impact of cognitive
reserve. Brain. 2009 Aug;132(Pt 8):2036-47.
1
/
5
100%