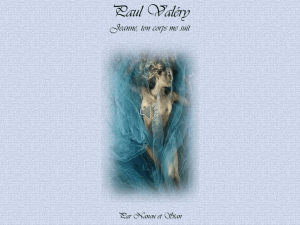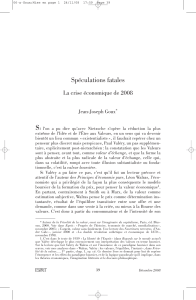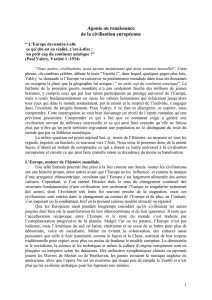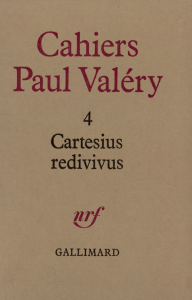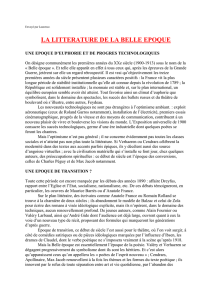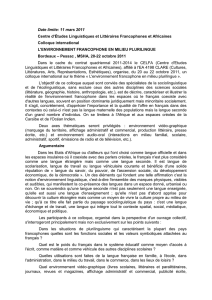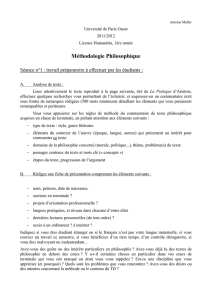Paul Valéry, les philosophes, la philosophie

Paul Valéry, les philosophes,
la philosophie
Textes recueillis et présentés par
Anne
MAIRESSE
BEV -
96 / 97
32e année - Mars / Juin 2004
L'Harmattan
L'Harmattan Hongrie
L'Harmattan 'talla
5-7, rue de l'École-Polytechnique
KOnyvesbolt
Via Degli Artisti 15
75005 Paris
1053 Budapest Kossuth L. 1114-16
10124 Torino
FRANCE
HONGRIE
ITALIE
Centre d'étude du XXème siècle — études vnléryennes
Université Paul-Valéry, Montpellier III

© L'HARMATTAN, 2004
ISBN : 2-7475-7522-5
EAN : 9782747575225

Table des matières
BEV
96 / 97
« Valéry, les philosophes, la philosophie »
Préface : Arme MAIRESSE
Pour quelque philosophie que ce « soi » désigne
3
Nathalie QUINTANE
Sur Teste
9
1" Axe
Marianne MASSIN
Du mythe de l'Inspiration à sa reformulation critique
11
Claude THERIEN
Identité et métissage du moi poétique selon Valéry
27
Benedetta ZACCARELLO
L'ombre de la pensée : individuation de la conscience et irréductibilité de
l'individualité dans la stratégie philosophique des
Cahiers
47
François SICRE
Valéry, penseur de l'impensable
77
Jean
-
Marc GUIRAO
Esquisse d'une théorie de la sensibilité
85
Régine PIETRA
« Ce qui m'intéresse le plus n'est pas du tout ce qui m'importe le plus »
101

2eme Axe
Olivier SALAZAR-FERRER
Benjamin Fondane et l'idéal
111
Philippe MARTY
Monades (Leibniz, Valéry)
129
Jean-Michel REY
Valéry / Nietzsche : Jeux d'esquive
161
Jacques MILLET
Valéry / Freud : petite note sur le
contraffect
165
Marc SAGNOL
Walter Benjamin : Une lecture de Paul Valéry
169
Laurent MARGANTIN
Valéry, Novalis : la question du système
191
Riccardo PINERI
Esthétique et herméneutique des formes : Pareyson lecteur de Valéry
205
Michel DEGUY
Paul Valéry et la culture
241
ANNEXE
Jean THUILE
« Cimetière marin » — Commémoration, mai 1947
261
Jean BELLEMIN-NOËL
Sourires de Valéry dans « Le cimetière marin »
271

Pour quelque philosophie que ce « soi » désigne
Anne
MAIRESSE
Voilà le vice essentiel de la philosophie.
Elle est chose personnelle, et ne veut
l'être »
(CEI,
1164).
Bien que Valéry récuse la philosophie en maints endroits de ses
écrits, on admettra qu'il lui donne paradoxalement, et sans doute
par défaut, une place centrale dans sa réflexion. C'est sur le thème
de Valéry et la Philosophie, sous l'angle de l'esthétique poétique
ou celui de la philosophie des
Cahiers,
que fut convoquée celle de
valéryens de coeur et d'esprit, par hommage ou par emprunt,
formant ici l'important témoignage de sa vivacité et de sa
prégnance internationale en ce numéro double des
Etudes
valéruennes
que nous avons plaisir de présenter.
C'est tout d'abord à l'écrivaine Nathalie Quintane que nous
avons fait appel en lui demandant, à brûle pourpoint, ce que
représentait - pour elle, si jeune - la figure de Paul Valéry. En fin
de volume, c'est un poète et philosophe moins jeune - ce n'est pas
lui faire offense que de le dire ainsi - à qui revient la lourde charge
d'un bilan. Michel Deguy, dont on connaît le culte qu'il voue à
Mallarmé et l'intérêt plus nuancé qu'il porte, en conséquence, à
Valéry, pose le problème de la relation de la philosophie dans la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%