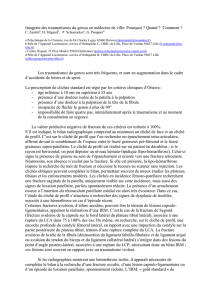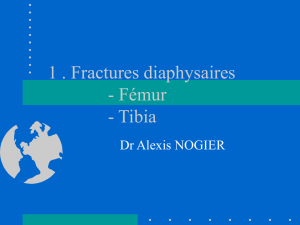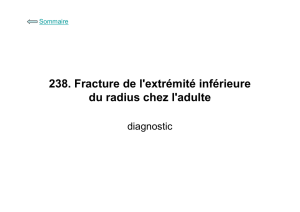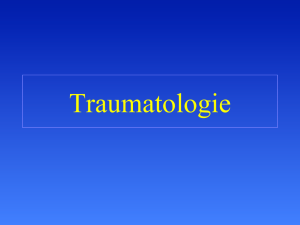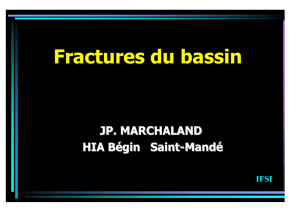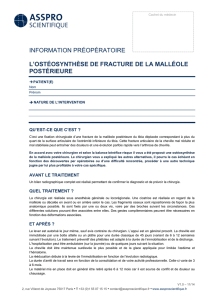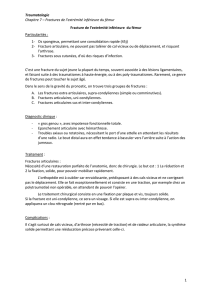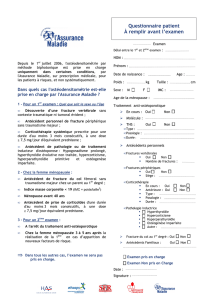chirurgie de l`appareil locomoteur chapitre vii

1
CHIRURGIE DE L’APPAREIL
LOCOMOTEUR
Volume
2
Professeur J.J. ROMBOUTS
et
Professeur Ch.
DELLOYE
CHAPITRE VII : PATHOLOGIE PAR REGION
I. Ceinture scapulaire et humérus
Plan
A. Rappel physiologique
1. Anatomie fonctionnelle de l'épaule
2.
M
ouvements de l'épaule
B. Pathologie traumatique
1. Fracture de la clavicule
2. Luxation acromio-claviculaire
3. Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus
Fracture du col chirurgical
Fracture du col anatomique
4. Fracture de la diaphyse humérale
5. La luxation traumatique de l'épaule
Luxation antérieure
Luxation antérieure récidivante
Luxation postérieure
C. Pathologie non traumatique de l'épaule
1. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
La calcification
La tendinite
La rupture
2. L'épaule gelée ou la capsulite rétractile

2
A. Rappel
physiologique
1. Anatomie fonctionnelle de l'épaule
La ceinture scapulaire est une chaîne articulaire qui arrime le membre supérieur au corps. L'épaule en
est le principal complexe articulaire. C'est la plus mobile des articulations du corps. C'est aussi la
plus exposée à l'instabilité car les pièces osseuses comme telles sont peu congruentes et la stabilité
repose essentiellement sur les ligaments et les tendons. Ce sont les tendons dits de la coiffe des
rotateurs qui sont les plus menacés par l'usure car ils assurent un rôle de coapteurs càd qu'ils
maintiennent la tête humérale contre la glène durant toute l'élévation. Une élévation harmonieuse et,
si nécessaire avec force, requiert un deltoïde normal et une coiffe saine.
Les mouvements complexes de l'épaules sont assurés par l'articulations gléno-humérale, l'acromio-
claviculaire , la sterno-claviculaire et deux plans de glissement que sont la bourse séreuse acromio-
deltoïdienne et la scapulo-thoracique. Cette dernière assure le glissement de l’omoplate sur la paroi
thoracique. Lors de l'élévation, l'omoplate bascule au fur et à mesure de l'élévation du bras. Dans les
180° d'élévation, 120° sont réalisés dans la gléno-humérale et 60° dans la bascule de l’omoplate.
L'épaule est donc une articulation complexe, requérant une synergie articulaire et musculaire. Elle est
donc fragile, menacée à la fois par l'instabilité et l'enraidissement.
2. Mouvements de l'épaule
Abduction-adduction
L'abduction est l'élévation du bras dans le plan frontal (c'est une élévation latérale). Elle est due à la
contraction simultanée du deltoïde et du supra-épineux. Ce dernier "plaque" la tête contre la glène,
évitant l'ascension de la tête humérale. L'amplitude maximale est de 180° (verticale) et résulte de la
mobilisation combinée de la gléno-humérale et scapulo-thoracique, cette dernière fournissant le tiers
de l'amplitude totale (120° + 60°).
L'adduction se fait grâce aux muscles rhomboïde, grand rond, grand dorsal et grand pectoral. Elle est
de 60° maximum.
Antéflexion-extension
L'antéflexion ou élévation antérieure (ou encore antépulsion!) nécessite les muscles deltoïde, coraco-
brachial et grand pectoral puis le trapèze et grand dentelé pour atteindre 180°.

3
L'extension est réalisée par les muscles petit et grand ronds, deltoïde (faisceau postérieur) et grand
dorsal.
Rotations interne et externe
La rotation interne a une course de 60° lorsque la main est placée devant le tronc et de 120°, la main
derrière le tronc. Elle résulte de l'action des muscles grand dorsal, grand rond, sous-scapulaire et
grand pectoral. Elle peut être évaluée par la position de la main par rapport à une vertèbre (par ex.
RI = D7).
La rotation externe atteint 60° environ et est due aux muscles infra-épineux et petit rond.
Autres mouvements
L'élévation antérolatérale (ou élévation tout court !) est une référence internationale fort utilisée.
C'est une abduction dans le plan de l'omoplate càd une abduction située entre l’abduction pure et
l'antéflexion. Elle est beaucoup utilisée car la plupart du temps, sa valeur représente la valeur
moyenne de l'antéflexion et l'abduction.
La circumduction est un mouvement complexe combinant tous les mouvements élémentaires de
l'épaule et qui permet au bras de faire 360°. On ne le mesure pas en pratique mais on parle de
mouvement complet ou incomplet.
B. Pathologie traumatique de l’
épaule
1. Fracture de la clavicule
Généralités
Il s'agit d'une fracture fréquente chez l'enfant (chute à vélo). Elle se situe la plupart du temps au
tiers moyen. Le déplacement est constant, le fragment interne étant attiré par le sterno-cléido-
mastoïdien.
Examens
Une radiographie de face est suffisante pour affirmer le diagnostic.
Lésions associées
Le pédicule vasculaire sous-clavier, le plexus brachial et la plèvre peuvent être concernés par le
traumatisme ou par un des fragments osseux. Par ailleurs, la clavicule étant sous-cutanée,
l'ouverture de la peau reste possible.
Traitement

4
Il est conservateur dans la très grande majorité des cas. Bandage en anneaux ou en 8 ou Dujarrier.
Chez l'enfant, il sera gardé 15 à 21 jours et chez l'adulte 4 à 6 semaines. Une ostéosynthèse par
plaque et vis peut être discutée lorsqu'il y a souffrance de la peau ou irritation du plexus sous-jacent
ou encore en cas d'incompatibilité avec une longue immobilisation (ex : indépendant).
2. La luxation acromio-claviculaire
Généralités
Cette luxation résulte souvent d'un accident de sport. On distingue 3 stades d'intensité croissante.
Anatomopathologie et traitement
On distingue les trois stades classiques d'une entorse.
I : entorse du ligament acromio-claviculaire. Ce ligament est un renforcement de la capsule
supérieure. A ce stade, il a été distendu. Douleurs localisées. Bras en écharpe à titre antalgique
pour 8 jours.
II : subluxation. Déchirure du ligament acromio-claviculaire. Petit diastasis de l'interligne et décalage
des surfaces articulaires. Saillie modérée ou absente.
M
ême traitement.
III : véritable luxation articulaire avec déchirure du ligament acromio-claviculaire mais aussi des
ligaments coraco-claviculaires qui relient solidement la clavicule à l’omoplate par l'apophyse
coracoïde. La couverture musculaire peut parfois être également atteinte. Radiologiquement, la
luxation est évidente. Cliniquement, la saillie de la clavicule sous la peau peut être importante. Une
pression au doigt de l'extrémité distale de la clavicule efface cette saillie : c'est la classique "touche de
piano". En cas de doute, des clichés dynamiques peuvent quantifier le déplacement.
Le traitement du grade III est soit conservateur soit chirurgical. La préférence est actuellement
donnée au traitement conservateur car les études prospectives ont montré une normalisation plus
rapide avec le traitement conservateur. Appareil de Dujarrier pour 15-21 jours. Le patient doit être
averti de la persistance de la saillie cutanée dans ce cas.
Le traitement chirurgical s'adresse plus volontiers aux séquelles (douleurs) et une stabilisation
secondaire peut être proposée dans ces cas.
3. Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus

5
a) Fracture du col chirurgical
Le trait de fracture passe en dessous des tubérosités. Elle est soit engrenée soit non engrenée. Elle
résulte d'une chute directe ou plus souvent, sur le coude ou la main. L'ostéoporose est un facteur
favorisant. Une luxation peut être associée plus rarement.
Clinique
Le patient tient son avant-bras avec la main du côté valide et la tronc incliné du côté invalide.
L'impotence est totale. Une ecchymose brachio-thoracique (dite de Hennequin) est un signe de
confirmation mais tardif.
Imagerie
Un cliché de face et au moins un cliché avec le profil de l'omoplate et si possible un dernier avec un
profil axillaire. Ceci afin de ne pas méconnaître une luxation-fracture. L'imagerie permettra de
classer la fracture soit selon le mécanisme lésionnel (fracture par abduction ou adduction soit suivant
le nombre de fragments).
Traitement
80 % de ces fractures sont peu ou pas déplacées et ne demandent qu'une immobilisation limitée à
15-21 jours dans un bandage de Dujarrier. Ce temps court est observé pour éviter un
enraidissement de l'épaule chez les personnes de plus de 40 ans. En effet, laisser l’épaule
immobilisée plus longtemps provoquerait une raideur importante qui serait très gênante longtemps.
Chez les enfants, le temps d'immobilisation sera de 6 semaines avec la plupart du temps, une
immobilisation par plâtre thoraco-brachial.
En cas de déplacement (20 %), une réduction avec ou sans ostéosynthèse percutanée sera réalisée.
Complications
• Lésions associées du plexus brachial.
• Nécrose céphalique (rare si pas de luxation associée).
• Capsulite rétractile (enraidissement).
b) Fracture du col anatomique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%