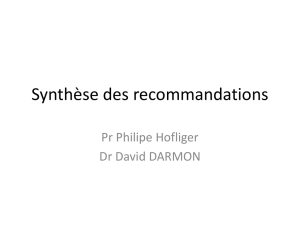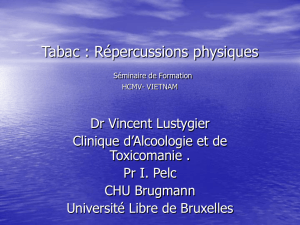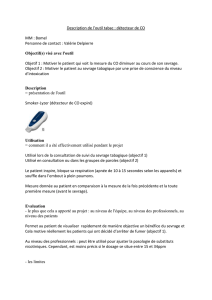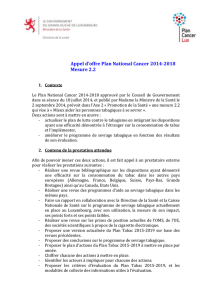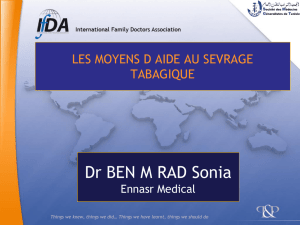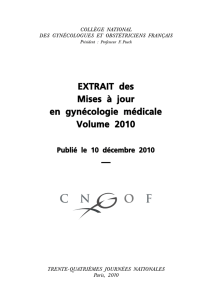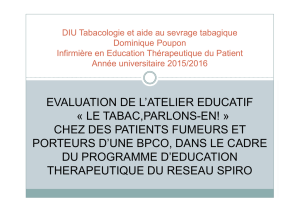La conduite du sevrage tabagique

Mini-revue
La conduite du sevrage tabagique
Philippe Guichenez
*,1
, Jean Perriot
2
, Patrick Dupont
3
, Jean-Luc Reny
4
, Isabelle Clauzel
1
, Charly Cungi
5
,
Anne-Marie Clauzel
6
1
Centre de tabacologie, centre hospitalier, 2 rue Valentin Haüy, 34525 Béziers cedex
2
Dispensaire Emile Roux, 11 rue Vaucanson, 63100 Clermont-Ferrand
3
Centre de Tabacologie, hôpital A. Chenevier, 94000 Créteil
4
Département de médecine interne, centre hospitalier, 2 rue Valentin Haüy, 34525 Béziers cedex
5
Psychiatre, 10 rue Gantin, 74150 Rumilly
6
Association « Vivre sans fumer », 109 rue Marc Rigal, 34070 Montpellier
La prise en charge du tabagisme a récemment progressé du fait
d’une meilleure connaissance des mécanismes neuropsycho-
pharmacologiques de la dépendance tabagique, de l’optimisa-
tion de la prescription des traitements médicamenteux et d’une
meilleure codification des modalités de la prise en charge
globale. La place des substituts nicotiniques est optimisée avec
l’association possible de plusieurs substituts en cas de forte
dépendance et la réduction de la consommation dans une
démarche d’arrêt ultérieur. Le bupropion et les inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine ont trouvé leur place dans la straté-
gie thérapeutique. L’apport des thérapies comportementales et
cognitives (TCC ) est essentiel dans le cadre de l’augmentation
de la motivation, de l’analyse fonctionnelle permettant de pro-
poser des stratégies comportementales et cognitives personnali-
sées. De même, les TCC sont un plus dans la prévention de la
rechute qui est la règle en cas de tabagisme. De nouvelles
molécules vont venir enrichir l’arsenal thérapeutique pour amé-
liorer encore la prise en charge souvent difficile des candidats
au sevrage tabagique.
Mots clés :sevrage, motivation, trouble anxiodépressif, substitution
nicotinique, bupropion, thérapie comportementale et cognitive
Toute dépendance résulte de la rencontre entre une substance aux
effets psycho-actifs, un individu ayant une vulnérabilité personnelle
et un environnement socioculturel. Tout comportement est un savoir
acquis (appris), organisé (renforcé) et entretenu (maintenu) en fonc-
tion de son utilité perçue par le fumeur [1, 2].
L’utilisation prolongée du tabac résulte d’un apprentissage renforcé par deux
types de mécanismes positifs et négatifs.
Renforcements positifs : les effets psycho-actifs de la nicotine sont à l’origine
des sensations bien décrites par les fumeurs : plaisir, détente, stimulation
intellectuelle, effets thymorégulateurs. Le fumeur cherchera ces effets en repro-
duisant son comportement.
Correspondance et tirés à part :
P. Guichenez
Sang Thrombose Vaisseaux 2006 ;
18, n° 3 : 136-48
STV, vol. 18, n° 3, mars 2006
136
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Renforcements négatifs : ils s’installent rapidement (en-
tre quelques dizaines de minutes et quelques heures d’absti-
nence) et sont constitués de sensations désagréables dues
au manque de nicotine : irritabilité, colère, troubles de
concentration ou humeur dépressive. Ces effets désagréa-
bles disparaissent rapidement après quelques bouffées
d’une cigarette.
Trois types de dépendance peuvent être décrits :
–la dépendance comportementale, liée à la pression et aux
interactions sociales ;
–la dépendance psychique liée aux effets psychotropes des
produits contenus dans la fumée ;
–la dépendance physique rapidement installée, qui impli-
que une forte pulsion à fumer de type « craving » et un
syndrome de manque [2].
Évaluation d’un candidat au sevrage
Prochaska et Di-Clemente ont étudié les facteurs en jeu à
l’arrêt du tabac et ont proposé un modèle de changement
transthéorique qui décrit les étapes et les processus naturels
par lesquels passe tout fumeur avant l’arrêt complet [3]. Ils
ont décrit un cycle comprenant plusieurs phases (figure 1).
–La phase de préintention (précontemplation) :lefu-
meur est dit « heureux », il ne se pose pas de question à
propos de son tabagisme. Il n’y a pas de démarche de
changement vis-à-vis de cet état et il existe de nombreuses
résistances.
–La phase d’intention (contemplation) : le fumeur est
indécis, il se pose des questions sur son comportement
tabagique, tout en reconnaissant son problème. Ce n’est pas
le moment pour arrêter de fumer. À cette étape, le fumeur
est ambivalent : il voudrait continuer à fumer, tout en évi-
tant les risques associés.
–La phase de préparation : le fumeur envisage l’arrêt et
étudie les moyens d’y parvenir avec ou sans aide extérieure.
Il va dépasser son ambivalence et prendre une décision.
–La phase d’action : arrêt avec mise en place d’un nou-
veau comportement ; l’individu a pris confiance en ses
capacités à réussir un sevrage. Son ambivalence vis-à-vis
Où se situe le désir de changement ?
Prochaska et Di Clemente
1. Précontemplation : je n’ai aucun
problème
2. Contemplation : j’ai un problème,
je ne suis pas prêt à m’en occuper,
mais je récolte des informations
3. Décision : je veux résoudre mon
problème et je cherche une stratégie
4. Action : j’applique ma décision et
m’engage dans la réalité du
changement
5. Consolidation : je maintiens ma
décision et crois fortement en
l’avenir
6. Rechute : soit je repars, soit
j’abandonne pour l’instant
Thérapeutique
Motivation
6
Rechute
1
Précontemplation
2
Contemplation
3
Décision
4
Action
5
Consolidation
Figure 1.Où se situe le désir de changement ?
STV, vol. 18, n° 3, mars 2006 137
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

du tabagisme est moins marquée et les avantages à arrêter
apparaissent supérieurs aux avantages à poursuivre.
–La phase de maintien : permet d’accéder à la réussite de
l’arrêt.
–La phase de rechute : les rechutes sur le long terme sont
fréquentes. Selon Marlatt et Gordon, la rechute est la règle
et non l’exception [4]. Il y a, en moyenne, quatre rechutes
avant l’arrêt définitif. Il existe souvent des petites décisions
apparemment sans rapport avec la rechute (Apparently irre-
levant decisions) mais favorisant l’exposition à une situa-
tion à haut risque, comme par exemple se retrouver systé-
matiquement confronté à des fumeurs. Il existe
parallèlement un effet de violation de l’abstinence avec
deux risques : minimisation et maximalisation, le fumeur
se dit alors « si j’en prends une ce soir, c’est pas grave » ou
au contraire « j’en ai fumé une, c’est la catastrophe ». Au
médecin de savoir pondérer par son discours honnête et
marqué d’empathie les erreurs d’interprétation du patient.
Le rôle du médecin : analyse à travers
le modèle PADIM (tableau 1)
Les étapes du changement qui font passer un sujet de l’état
de fumeur à non-fumeur peuvent être comprises à travers ce
modèle qui reprend les besoins nécessaires de l’individu
pour évoluer dans un processus de changement [5].
L’entretien motivationnel
Cette technique proposée par Miller et Rollnick repose sur
la psychologie de la motivation [6]. C’est un style relation-
nel qui s’oppose au style confrontationnel. Les 5 principes
de l’entretien motivationnel sont : exprimer de l’empathie,
développer la conscience des contradictions, éviter de dé-
battre, composer avec la résistance, renforcer le sentiment
d’efficacité personnelle. Les entretiens motivationnels
aident le patient à prendre conscience du caractère problé-
matique de ses comportements, à explorer son ambivalence
et ses contradictions, à déterminer quels changements il
souhaite entreprendre tout en respectant et en renforçant
son sentiment de liberté de choix, à prendre la décision
d’accomplir ce changement, et à faire le choix des moyens
pour atteindre les objectifs auquel il aspire. Le but est de
mobiliser les ressources du changement propres au patient
et de favoriser les bénéfices à long terme par rapport aux
bénéfices à court terme. Le praticien doit manifester de
l’empathie, encourager le patient à développer ses propos,
ne pas forcer sa résistance et renforcer son sentiment d’effi-
cacité personnelle, à travers une écoute active. À cette
dernière, s’ajoutent des questions ouvertes plutôt que fer-
mées, une écoute en « écho » basée sur le principe de la
reformulation et du résumé. Le patient sera interrogé sur ses
croyances en ses propres capacités à s’arrêter. On lui donne
la possibilité de reconnaître ses difficultés et ses pensées
ambivalentes. L’objectif est d’augmenter et de soutenir la
motivation du patient, en ayant permis au fumeur d’être
concentré sur son problème. Quelques exemples de ques-
tions ouvertes : « J’aimerais que vous me parliez de votre
tabagisme, comment s’est-il installé, comment vous voyez-
vous sans fumer » [6].
Quatre axes de réflexion :
pour faire pencher la balance
–Quels sont les effets positifs de la cigarette : comment les
obtenir autrement ?
–Quelles sont les difficultés prévisibles déjà vécues à l’ar-
rêt : comment les réduire ?
–Quels sont les effets négatifs de l’usage de la cigarette et
de sa poursuite : quand vont-ils disparaître ?
–Comment renforcer les effets bénéfiques de l’arrêt ?
Tableau 1.Étapes du changement selon le modèle PADIM
Les étapes du changement Les positions du fumeur
Posséder l’information « J’ai entendu dire que le tabac est mauvais pour la santé »
Adhérer à l’information « Je suis d’accord avec le fait que le tabac est mauvais pour la santé »
Décider le changement « J’ai pris la décision d’arrêter de fumer »
Initier le changement « Je viens d’arrêter de fumer »
Maintenir le changement « Je ne suis plus fumeur depuis longtemps »
Objectifs Stratégies thérapeutiques
Posséder l’information Information et éducation du fumeur
Adhérer à l’information Entretiens motivationnels
Décider le changement Entretiens motivationnels
Initier le changement Thérapeutiques de sevrage médicamenteuses et/ou cognitivo-comportementales
Maintenir le changement Prévention des rechutes
STV, vol. 18, n° 3, mars 2006
138
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

L’évaluation tabacologique
L’intervention s’adapte aux besoins du patient et se struc-
ture en trois phases successives : la consultation initiale, de
sevrage et de suivi qui doit être prolongée actuellement
pendant environ un an [7]. Lors de la consultation initiale,
les tabacologues utilisent souvent un dossier spécifique de
l’Institut national pour l’éducation et la santé (INPES), bien
adapté à la prise en charge du sevrage. L’évaluation tabaco-
logique doit comprendre plusieurs aspects.
Évaluation de la situation tabagique
Une reconstitution de l’histoire du tabagisme (ancienneté,
consommation, antécédents d’arrêt et circonstances de re-
prise, pathologie somatique impliquant le tabagisme, anté-
cédents psychiatriques, co-dépendances (alcool, cannabis),
tabagisme environnemental, contexte socioprofessionnel)
est réalisée [7]. Cette évaluation permet aussi de savoir dans
quels stades décrits par Prochaska et Di-Clemente se trouve
le patient (figure 1).
Évaluation de la motivation
Il est possible d’utiliser l’échelle Q-MAT en quatre ques-
tions ou de Richmond [7], ce qui permet de faire une rapide
et fiable évaluation de la motivation du patient pour une
prise en charge immédiate de l’arrêt ou pour un entretien
motivationnel. Cela permettra une prise de décision ulté-
rieure. L’échelle de De maria et Grimaldi permet de
prévoir les difficultés de l’arrêt [7].
Évaluation du niveau de dépendance physique
L’instrument de mesure de référence de la dépendance
tabagique est le questionnaire de Fagerström [2] :
–score de0à2:lesujet n’est pas dépendant à la nicotine. Il
peut souvent arrêter de fumer sans avoir recours à des
substituts nicotiniques ;
–score de3à4:lesujet est faiblement dépendant à la
nicotine ;
–score de5à6:lesujet est moyennement dépendant à la
nicotine ;
–score de7à10:lesujet est fortement ou très fortement
dépendant à la nicotine.
Évaluation de la dépendance
psychocomportementale
Cette évaluation repose sur l’analyse clinique, les échelles
visuelles analogiques ou différents tests notamment le test
de Horn, le test de Gilliard 1998. Les patients les plus
dépendants ont, le plus souvent, des niveaux élevés de
dépendance pharmacologique et psychocomportementale,
associant fréquemment des troubles anxiodépressifs et des
codépendances [7]. Ils ont accumulé les échecs dans leurs
tentatives d’arrêt antérieures, leurs conditions socio-
économiques sont souvent précaires [7].
Évaluation du niveau d’anxiété et de dépression
Il est évalué par la recherche d’antécédents de troubles
anxieux et/ou de dépression, notamment d’état dépressif
majeur. Il est dépisté sur les signes de ces pathologies selon
les critères du DSM IV et on en évalue l’intensité avec le
test HAD (hospital anxiety depression scale) [7]. Si ce test
est perturbé avec notamment un score d’anxiété et/ou de
dépression supérieur ou égal à 8, le bilan peut être complété
par d’autres tests notamment le questionnaire de Beck en
13 items (BDI : Beck depression inventory – forme abré-
gée) et la « mini-interview » structurée (DSM IV) permet-
tant de mieux préciser les troubles anxieux fréquemment
associés au tabagisme [8]. Des tests d’identification des
tempéraments affectifs d’Akiskal et Hantouche et le test de
Angst [7, 9] permettent de discerner des troubles bipolaires
dans leur forme atténuée ou majeure. Ces troubles sont très
fréquents chez les consultants des centres spécialisés en
tabacologie [7-9].
Dimension de personnalité et tabagisme
Tous les individus ne sont pas égaux devant la dépendance
et de nombreuses études montrent l’implication dans les 2
sexes, chez les adultes et les adolescents de l’extraversion
et du névrosisme (modèle de personnalité d’Eysenck), de la
recherche de sensations, de la recherche de nouveauté [10].
Utilisation des marqueurs biologiques
du tabagisme
En pratique tabacologique, le CO dans l’air expiré, témoin
de la profondeur de l’inhalation permet ultérieurement de
valider un arrêt et de renforcer la motivation du patient qui a
arrêté. Il faut noter le temps écoulé entre la dernière ciga-
rette et la mesure du CO expiré. Le dosage de la cotinine
urinaire aide à fixer et à adapter la posologie de la substitu-
tion nicotinique. Ce dosage a un intérêt particulier chez les
patients les plus dépendants, chez les patients ayant une
cardiopathie ischémique et les femmes enceintes pour les-
quelles l’adaptation posologique doit être la plus précise
possible [11].
Stratégie de prise en charge
La date d’arrêt est toujours choisie par le patient lui-même.
Un arbre de décision a été récemment proposé (figure 2)
STV, vol. 18, n° 3, mars 2006 139
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

[2]. Une prise en charge conjointe au préalable des codé-
pendances (alcool, cannabis), des troubles de l’humeur et
d’éventuelles pathologies psychiatriques associées est in-
dispensable. Certaines situations de vie (psychologiques ou
environnementales) temporairement précaires peuvent
conduire à différer l’arrêt du tabac [7]. En cas de motivation
insuffisante ou de comorbidité rendant le sevrage trop diffi-
cile, il peut être proposé une réduction temporaire de la
consommation de tabac aidée par des substituts notamment
oraux (concept de harm reduction). Une telle stratégie
permet d’augmenter la motivation, la confiance en soi (self
efficacity) et de faire baisser le CO dans l’air expiré, voire
d’induire des arrêts spontanés marqués d’abstinence défini-
tive.
Fumeur motivé
Evaluation de la
dépendance
(test de Fagerström)
Evaluer le terrain, les comorbidités,
le risque d'effets indésirables
et de pharmacodépendance
Outils d'aide à la motivation
ou thérapie cognitivo-comportementale
ou accompagnement psychologique
+
traitement pharmacologique de la dépendance
Dépendance moyenne et forte
Traitement nicotinique
de substitution (TNS) Bupropion LP
Prévention des rechutes
Outils d'aide à la motivation
ou d'accompagnement psychologique
ou thérapie cognitivo-comportementale
±
automédication (TNS)
Prévention des rechutes
Dépendance faible
Figure 2.Prise en charge du sevrage tabagique : prise de décision.
STV, vol. 18, n° 3, mars 2006
140
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%