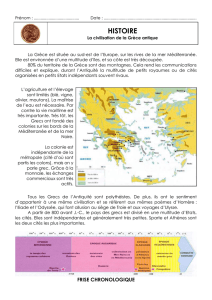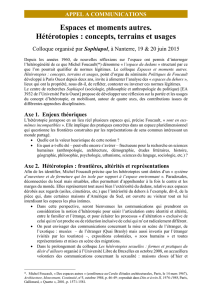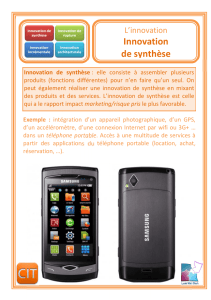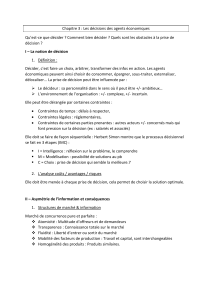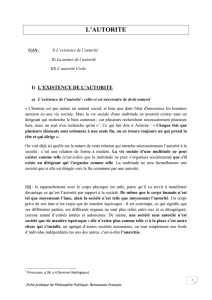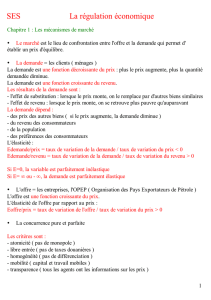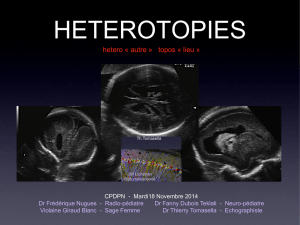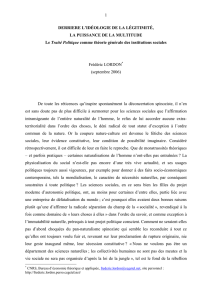Rlaboration de la question de la politique

Réélaboration de la question de la politique
Article 11. Multitudes et hétérologies
Par Christian Ruby*
Par l’effet de ces considérations, il devient clair
que la théorie politique n’a pas à se pencher
spécialement sur les plus hautes charges de
l’Etat pour les valoriser (les conquérir, les
« avoir »), comme on l’a cru longtemps :
« Comment devient-on pharaon ? Comment
devient-on pontifex maximus ? Comment
devient-on raja ? Comment devient-on césar,
consul, sénateur, imperator ? Comment faut-il
vivre, pour entrer dans l’histoire tel un
Metternich, un lord Marlborough ou un
Bismarck ? Quelles formes d’ascension
conduisent aux fonctions de gouverneur, de
président, de chancelier ? » (Sloterdijk, Dans le
même bateau, op.cit.). Certes, il existe de
nombreux ouvrages fort intéressants portant
sur l’éducation des princes (Fénelon, Les
aventures de Télémaque, 1699) et le
comportement des dirigeants, voire sur
l’éducation des courtisans (B. Gracian,
L’homme de cour, 1646), il convient de les lire.
Ils énumèrent à l’évidence des paramètres qui
énoncent clairement que le champ de la
politique est un champ de force sur lequel il est
essentiel de se situer en usant d’habileté, de
ruse, de mensonge parfois. Mais la
concentration sur cet « athlétisme d’Etat »
contourne l’essentiel. Non seulement, dans la
plupart des cas, les « grands » n’ont pas fait
autre chose que de « se donner la peine de
naître » (Beaumarchais, Mariage de Figaro,
Acte V, sc. 3), mais la politique qui nous
intéresse devrait avoir pour ressort le principe
de l’égalité.
Il reste qu’il est caractéristique de ces
démarches qu’elles ne cessent de reconduire la
politique à l’idée selon laquelle la cité doit être
une et identique, conduite par un « chef » ou
organisée en un corps politique (un peuple
unifié, évidemment, s’il est « corps »).
Explorons brièvement cette métaphore adoptée
depuis longtemps pour traduire le grec Politeia
renvoyant à l’ensemble des citoyens de plein
droit dans une constitution donnée (Aristote,
Politiques, IV, 13, 7). Mais dans son usage
technique (moderne), cette métaphore du corps
– qui veut énoncer le principe d’unité du
peuple : concorde des membres, convergence
dans un tout, statut des éléments relatifs à leur
place, hiérarchie et solidarité des membres -
exprime une réflexion de la politique et peut
prendre soit un sens organique, soit un sens
mécanique. Hobbes, par exemple, pense

Léviathan (ce dieu artificiel) comme union d’une
âme et d’un corps, sur le modèle de l’humain.
Dans cette métaphore, il introduit l’idée selon
laquelle le souverain est l’âme, l’âme domine et
peut sortir du corps. Tandis que chez
Rousseau, il s’agit, avec la même métaphore,
de penser l’origine du « corps politique » (CS, I,
6), en fondant en droit l’autorité légitime de
l’Etat souverain et de lui donner une figure
unifiée.
Reconnaissons, cependant, que cette
métaphore a eu l’avantage, durant de longues
années, de faciliter l’opposition entre
« communauté » et « corps politique » :
Rousseau, rappelons-le, refuse de céder la cité
aux communautés au profit du corps politique
(le corps politique instaure la déliaison des
communautés, il délie les subordinations de fait
au sein d’une liaison sans cesse réinventée).
La question demeure pourtant de savoir si avec
cette métaphore, qui est celle du peuple même,
on ne dit pas à la fois trop de choses et
finalement des choses politiquement
dangereuses. Par exemple, que, dans ce corps,
l’âme (les chefs, les penseurs, les cadres) doit
dominer ; que ce corps doit se soumettre au
pouvoir (qui l’investit mais auquel parfois il
résiste).
N’est-ce pas ce pourquoi cette notion est
soumise de nos jours aux feux de la critique
qui, dans le même temps qu’elle récuse l’idée
de peuple, cherche à instaurer la fécondité d’un
autre concept, celui de multitude (Foucault,
Virno, Negri, Michael Hardt, Rancière, …) ?
Nous avons souligné que ce dernier concept
existe déjà dans la théorie politique classique. Il
s’agit d’un terme employé par Machiavel et par
Spinoza. Dans le Traité des autorités
théologico-politiques, ce dernier explique que la
crainte de la puissance de la multitude
constitue la limite de la puissance souveraine.
En quoi il oppose la puissance (potentia) et le
pouvoir (potestas), comme il oppose la
multitude et le peuple. Il importe au législateur
démocrate de savoir que le pouvoir politique ne
doit rien être d’autre (ou ne devrait rien être
d’autre), dans ce régime, que la puissance de
la multitude qu’il rassemble.
En vérité, autour de ce concept, tout un
contexte polémique se déploie. Tandis que
Hobbes, nous l’avons précisé, se méfie de la
multitude qu’il laisse franchement en dehors de
toute décision politique au profit d’un « peuple »
qui n’est que représentation, Rousseau prétend
que l’acte d’association transmute la multitude
en peuple (CS). Par le contrat, la multitude est
réunie en un corps (CS, I, 7, p. 363).
Globalement, toutefois, autour de la multitude,
se concentrent plutôt l’idée d’une masse
informe (Hegel, Principes de la philosophie du
droit, 1821, Paris, Puf, 2000, § 262, 264, 303,
Rem) ou l’idée de foule plus ou moins
immaîtrisable. Au demeurant, le capitalisme
mondialisé a tendance à réduire les anciens
collectifs de travail et le salariat à des formes
de dispersion du travail en multiples infiniment
divisés et mutilés (stratégies de contrôle et de
déterritorialisation). Ce que Gilles Châtelet
traduit dans des phrases plus percutantes :
« les neurones sur pied jouiront certes d’une
existence plus confortable que les serfs ou les
ouvriers des filatures, mais ils n’échapperont
pas facilement au destin de matière première
autorégulable d’un marché aussi prédictible et
aussi homogène qu’un gaz parfait, matière
offerte aux atomes en détresse mutilés de tout
pouvoir de négociation pour louer leur mentale,
cervelle par cervelle » (Vivre et penser comme
des porcs, Paris, Exils, 1998).
Mais justement signalons non moins que les
théories politiques contemporaines, si elles font
de la multitude un concept central et polémique
à l’égard des politiques définies comme
démocratiques, ni ne confondent la multitude
avec le simple multiple, ni ne cèdent à la
confusion entre la multitude et la diversité ou la
différence (cf. Walter Benn Michaels, La
diversité contre l’égalité, Paris, Raisons d’agir,
2009), ni ne donnent la multitude pour le
dernier cri de toute théorie sociale et politique.
Certes, ce concept permet de relever des
phénomènes importants et constamment
laissés de côté : multiplicité des projets de vie,
multiplicité des langues, multiplicité des

trajectoires, … Mais il ne vise pas à laisser
chacun entonner le refrain de la dispersion
infinie qui a permis à un publicitaire de muer en
slogan la maxime d’Epicure : « Pour vivre
heureux, vivons cachés », ni répétons-le, à
substituer la célébration de la diversité
(ethnique, culturelle, sexuelle) à la politique de
l’égalité (qui comporte aussi celle de la
discrimination positive, ou celle des droits
civiques).
Il reste que la multitude n’est pas en soi une
forme politique. Elle n’est pas non plus une
promesse. Elle est d’abord le moteur et le motif
d’une polémique contre l’un fermé, enfermé,
identitaire. Et elle n’est qu’ensuite le nœud d’un
nouveau problème : comment penser, à partir
de liens immanents, une politique à partir de la
multitude ?
Ici entrent en jeu les « hétérotopies » (hétéro-
topos, lieux autres) ou « hétérologies » (des
collectifs relevant d’autres logiques) dont
beaucoup parlent de nos jours. Par ce terme,
les philosophes contemporains désignent,
contrairement aux utopies et aux disciplines qui
les caractérisent, des lieux réels et localisables,
lesquels peuvent faire fonction de « contre-
emplacements » de l’existence et dessinent des
espaces « absolument autres » pour des
collectivités.
Dans une conférence prononcée au Cercle
d’études architecturales, le 14 mai 1967,
publiée en 1984, dans Architecture,
Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984,
Foucault, après avoir expliqué que « nous
sommes à l'époque du simultané, nous
sommes à l'époque de la juxtaposition, à
l'époque du proche et du lointain, du côte à
côte, du dispersé. Nous sommes à un moment
où le monde s'éprouve, je crois, moins comme
une grande vie qui se développerait à travers le
temps que comme un réseau qui relie des
points et qui entrecroise son écheveau »,
reconnaît, nous l’avons vu, la place que les
utopies ont occupée dans notre culture : « Il y a
d'abord les utopies. Les utopies, ce sont les
emplacements sans lieu réel. Ce sont les
emplacements qui entretiennent avec l'espace
réel de la société un rapport général d'analogie
directe ou inversée. C'est la société elle-même
perfectionnée ou c'est l'envers de la société,
mais, de toute façon, ces utopies sont des
espaces qui sont fondamentalement
essentiellement irréels ». Mais, c’est pour
mieux préciser qu’à côté des utopies se sont
toujours dessinés d’autres lieux, différents, que
l’on peut qualifier d’hétérotopies : « Quant aux
hétérotopies proprement dites, comment
pourrait-on les décrire, quel sens ont-elles? On
pourrait supposer, je ne dis pas une science
parce que c'est un mot qui est trop galvaudé
maintenant, mais une sorte de description
systématique qui aurait pour objet, dans une
société donnée, l'étude, l'analyse, la
description, la « lecture », comme on aime à
dire maintenant, de ces espaces différents, ces
autres lieux, une espèce de contestation à la
fois mythique et réelle de l'espace où nous
vivons; cette description pourrait s'appeler
l'hétérotopologie ».
Il existe, ajoute-t-il, plusieurs principes de
fonctionnement des hétérotopies :
- La déviation : il s’agit de l’hétérotopie
dans « laquelle on place les individus dont le
comportement est déviant par rapport à la
moyenne ou à la norme exigée. Ce sont les
maisons de repos, les cliniques psychiatriques ;
ce sont, bien entendu aussi, les prisons, et il
faudrait sans doute y joindre les maisons de
retraite, qui sont en quelque sorte à la limite de
l'hétérotopie de crise et de l'hétérotopie de
déviation, puisque, après tout, la vieillesse,
c'est une crise, mais également une déviation,
puisque, dans notre société où le loisir est la
règle, l'oisiveté forme une sorte de déviation ».
- La proximité repoussante : ces
cimetières, par exemple, où se « constituent
alors non plus le vent sacré et immortel de la
cité, mais l' « autre ville », où chaque famille
possède sa noire demeure ».
- La juxtaposition : où « l'hétérotopie a
le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel
plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui
sont en eux-mêmes incompatibles. C'est ainsi

que le théâtre fait succéder sur le rectangle de
la scène toute une série de lieux qui sont
étrangers les uns aux autres; c'est ainsi que le
cinéma est une très curieuse salle
rectangulaire, au fond de laquelle, sur un écran
à deux dimensions, on voit se projeter un
espace à trois dimensions; mais peut-être est-
ce que l'exemple le plus ancien de ces
hétérotopies, en forme d'emplacements
contradictoires, l'exemple le plus ancien, c'est
peut-être le jardin ».
- Le fonctionnement en hétérochronies :
« L'hétérotopie se met à fonctionner à plein
lorsque les hommes se trouvent dans une sorte
de rupture absolue avec leur temps traditionnel;
on voit par là que le cimetière est bien un lieu
hautement hétérotopique, puisque le cimetière
commence avec cette étrange hétérochronie
qu'est, pour un individu, la perte de la vie, et
cette quasi-éternité où il ne cesse pas de se
dissoudre et de s'effacer ».
- La compensation : « Ou bien elles ont
pour rôle de créer un espace d'illusion qui
dénonce comme plus illusoire encore tout
l'espace réel, tous les emplacements à
l'intérieur desquels la vie humaine est
cloisonnée. Peut-être est-ce ce rôle qu'ont joué
pendant longtemps ces fameuses maisons
closes dont on se trouve maintenant privé. Ou
bien, au contraire, créant un autre espace, un
autre espace réel, aussi parfait, aussi
méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est
désordonné, mal agencé et brouillon ».
Parce que nous n’avons guère de raison de
demeurer enfermé dans cette pensée politique-
là, nous pouvons aussi déplacer un peu l’angle
du commentaire et poursuivre l’analyse en
relevant des fragments de pratiques politiques
qui témoigneraient de nos jours de l’intérêt pour
la question de la multitude. Si le pouvoir
protestataire, dans sa représentation classique
(le pouvoir de dire « non ! »), et dans sa version
révolutionnaire, ne semble plus à l’ordre du
jour, d’autres pratiques du temps – il faudrait
alors analyser en fonction de quelles conditions
– se tournent vers des conceptions politiques
assez différentes.
Elles se distribuent, comme nous l’avons déjà
indiqué, entre l’affirmation qu’il convient
désormais d’apprendre à ne pas obéir, ne pas
consentir, ne pas soutenir (c’est la leçon
apprise de La Boétie), celle selon laquelle on
résiste mieux aux agressions de ce qui est en
répliquant sans cesse « je préfèrerais ne pas »
(I would prefer not to, dit Barthelby dans le
roman de Hermann Melville), et celle qui
s’inspire des théories de Thoreau ou du
philosophe américain Stanley Cavell : « Je
refuse qu’on parle en mon nom ». Rancière ne
fait-il pas remarquer que le sens actuel de la
politique devrait se trouver surtout dans
l’affirmation d’un « je suis capable », bien plus
sûrement politique que toute adhésion à un
parti. Quand, Michel Foucault de son côté voit
se déployer une politique dans l’apprentissage
par chacun (« éthique de soi aidant ») de la
capacité à affirmer la vérité de soi-même.
Une politique de la multitude dessine donc un
principe de lutte, ici et maintenant, toujours
possible et mieux assumé à plusieurs que tout
seul : critique des identifications, position de
trajectoires, refus des figures incorporées, refus
des nostalgies, mais aussi, lutte contre
l’ignorance des institutions (y compris
politiques) dont on ferait mieux d’apprendre
l’usage afin de mieux les déjouer et les obliger
à déplacer les frontières qu’elles instaurent.
© Présence et Action Culturelles – Analyse – 2009/11
* L’auteur : Christian Ruby, Docteur en philosophie, enseignant
(Paris). Derniers ouvrages publiés : L’interruption, Jacques
Rancière et la politique, Paris, La Fabrique, 2009 ; Devenir
contemporain ? La couleur du temps au prisme de l’art, Paris,
Editions Le Félin, 2007 ; L’âge du public et du spectateur, Essai
sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne,
Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ; Schiller ou l’esthétique
culturelle. Apostille aux Nouvelles lettres sur l’éducation
esthétique de l’homme, Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ;
Nouvelles Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme,
Bruxelles, La Lettre volée, 2005.
1
/
4
100%