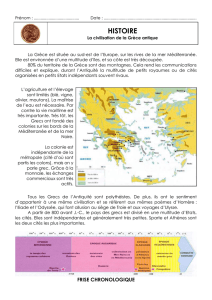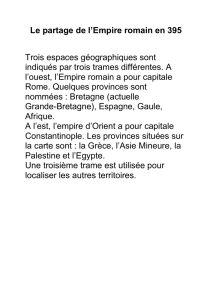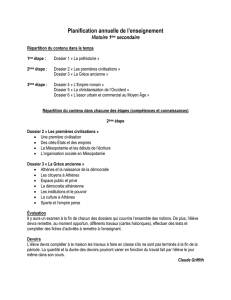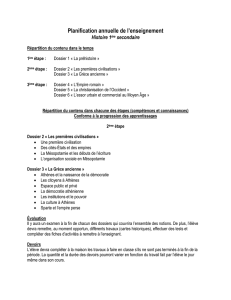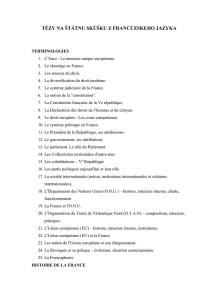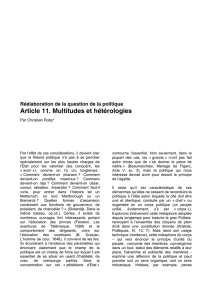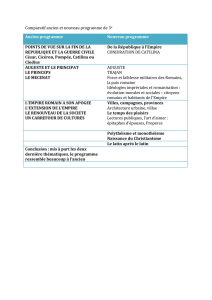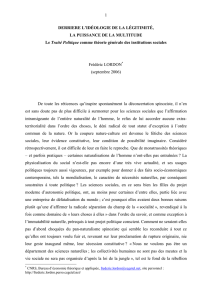La MuLtItude L`eMPor taIt Sur L`eMPIre

i la multitude l’emportait sur l’Empire (1),
on ne pourrait pas dire pour autant
qu’elle serait au pouvoir, parce que la
multitude est par essence dissolution du
pouvoir et mise en place de nouvelles
institutions. On pourrait en revanche imaginer que
la phase d’opposition entre l’Empire et la multitude
que nous traversons serait achevée, et que ce serait
donc la fin du capitalisme. Dans cette nouvelle
société, les singularités articulées au sein de la mul-
titude s’organiseraient pour gérer le commun (2).
À rebours des sombres scénarios d’anarchie totale ou
de lutte de tous contre tous, je crois plutôt à une orga-
nisation de la multitude proche des canons de la
démocratie traditionnelle, mais décidée à imposer
réellement la liberté et l’égalité de tous, sans excep-
tion : plus personne ne devrait être laissé sur le bord
de la route. Il s’agirait donc d’élaborer une constitution
démocratique qui serait non seulement
formelle, mais substantielle, ce qui serait
impossible sans une redistribution de la
propriété. Il faudrait envisager une répar-
tition de tous les biens, et des valeurs liées
à ces biens. On serait obligé de rompre
avec les fondements capitalistes de l’indi-
vidualisme propriétaire (l’accès à la propriété comme
condition nécessaire de survie et de sécurité) et de
l’individualisme patrimonial (le désir d’accumulation
des richesses financières). Sur la base d’un principe
d’égalité au sein du commun, on redistribuerait tous
les biens qui sont des conditions absolues de la pro-
duction sociale (comme les logements), mais aussi
ceux qui sont liés à la capitalisation financière (fonds
de pension ou allocations de retraite). La répartition
des biens possédés et/ou construits ensemble se ferait
de façon ouverte, transparente, égalitaire : s’il est par
exemple possible de partager entre tous des contenus
mis en ligne sur Internet et enrichis en permanence
par la collaboration de tous avec tous, on ne voit pas
pourquoi tout le monde ne pourrait pas participer plus
généralement à la distribution démocratique du
commun. La figure institutionnelle qui assumerait la
gestion du commun ne serait pas nécessairement
étatique, l’enjeu central n’étant plus de nationaliser
les richesses, mais, à l’opposé, de les diviser en parts
égales. Il y a une différence fondamentale entre le
public (étatique, nationalisé) et le commun (géré
et de l’individuel (l’individu, ce n’est pas la singularité :
un individu ne s’agence jamais avec les autres pour
construire du commun ; tout au plus accepte-t-il de se
lier aux autres pour éviter le pire, ou pour son propre
intérêt), en faveur d’une forme de production globale
et commune. Dans ce climat de crise généralisée, les
gouvernements sont déjà forcés de prendre des déci-
sions révolutionnaires engageant les richesses de leurs
citoyens. Mais la solution ne réside ni dans les subven-
tions aux banques ni dans leur nationalisation. Imagi-
nons plutôt une démocratisation de la richesse. C’est
pourquoi je suis pour l’instauration d’un revenu uni-
versel (sur la base d’un principe d’égalité), ou pour la
construction d’une communauté des richesses.
Dans le commun, il n’existerait pas de propriétaires
ni de discriminations liées à des critères de race, de
sexe, de genre, de nationalité, de religion… Toutes
les identités auraient le droit d’exister en tant que
telles, en se mêlant, en s’articulant, en s’entrelaçant
librement, dans un rapport qui ne deviendrait pas
négatif parce qu’il n’impliquerait jamais l’effacement
des singularités ainsi mises en rapport. La multitude,
ce n’est pas l’effacement des différences, c’est leur
permanence, y compris dans les expériences de
métissage et d’enrichissement mutuel. Dans un
régime de démocratie multitudinaire, l’institution de
la famille (qui est à un niveau moléculaire, je crois,
la forme où le pouvoir se construit) ne serait légitime
que dans les cas où elle serait librement choisie. En
aucun cas elle ne serait déterminée par des législa-
tions spécifiques en faveur d’un modèle plutôt que
d’un autre. La communauté prendrait en charge
l’éducation des enfants ; il n’y aurait ni restrictions
ni tabous concernant les préférences de genre, les
modèles culturels propres à tel ou tel monde, les
démocratiquement par tous et pour tous). Il ne s’agi-
rait pas d’un communisme imposé par le haut, mais
d’un commun géré par le bas.
La forme de représentation politique choisie par la
multitude est une vraie question. Je crois que la
démocratie participative est un modèle très hypo-
crite, dont les limitations effectives ne sont pas
claires : les expériences concrètes (surtout en Amé-
rique latine) qui en ont tenté la mise en œuvre ont
été des échecs. Il est presque impossible de faire par-
ticiper la base aux décisions du sommet, de mettre
en place un processus de décision ascendant. Le sys-
tème du vote me semble donc plus efficace que celui
des débats participatifs, bien que les nouveaux
moyens de communication laissent envisager un
renouvellement des formes de la représentation.
Les éventuelles forces de désagrégation présentes dans
la société « multitudinaire » seraient contrôlées et
éventuellement sanctionnées par une instance spéci-
fique, comme dans toute démocratie. Le maintien des
grands pouvoirs de la démocratie actuelle – législatif,
exécutif et judiciaire – ne serait pas en contradiction
avec une organisation multitudinaire de la gestion du
commun. La démocratie doit être ordonnée, elle est
toujours associée à des formes institutionnelles spéci-
fiques. L’anarchie ne peut pas avoir d’existence
concrète. Les singularités s’organisent en commu-
nautés, non pour éviter la guerre, mais pour construire
de l’ordre, de la solidarité, de l’entraide, de la coopé-
ration. La différence entre Hobbes et Spinoza est en
ce sens essentielle : conformément aux idées du pre-
mier, les hommes ne souhaitent ni l’anarchie ni le
désordre ; mais, comme l’affirme avec plus de finesse
le second, ils veulent aussi éviter la solitude. La mul-
titude, c’est cela : le désir de construire le commun.
Dans l’Empire, la force de production réelle est détenue
par le capital financier (les banques). Dans une société
multitudinaire, il y aurait une expropriation du privé
représentations dominantes – il suffirait que les prin-
cipes d’égalité, de liberté et de respect soient vérifiés.
Dans un monde multitudinaire, l’important serait en
effet de saisir l’élément culturel susceptible de porter
au plus haut point la liberté des singularités dans la
richesse de leurs relations réciproques. Quand je dis
« élément culturel », je crois que le libre et universel
accès aux savoirs et à la formation est le seul moyen
de construire de la démocratie véritable, et que c’est
aussi le seul rempart contre les effets de domination
culturelle de telle ou telle classe, de telle ou telle
civilisation, de telle ou telle histoire… Or, que cette
liberté et cette égalité soient soutenues par une pen-
sée de l’immanence ou au contraire par des présup-
posés transcendants/religieux n’a pour moi qu’une
importance très relative. Historiquement, les trans-
cendances et les métaphysiques de tout poil n’ont
hélas ! que très rarement soutenu les luttes pour la
liberté, l’autonomie et l’égalité. Mais il n’y a pour moi
que des leçons d’histoire, et non des vérités absolues
ou des idéaux : rien n’existe en dehors de la forme
sous laquelle nous décidons quelque chose et des
déterminations au sein desquelles notre liberté
intransitive et puissante choisit de décider, donc de
construire. Ce n’est qu’a posteriori que l’on peut défi-
nir l’idéal que l’on recherche : en mesurant le chemin
parcouru et en relançant plus loin l’indignation devant
l’injustice, c’est-à-dire aussi la passion du commun
”
1
/
1
100%