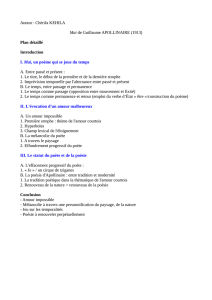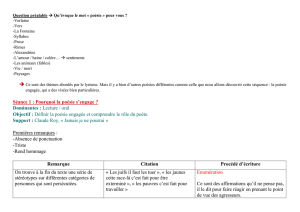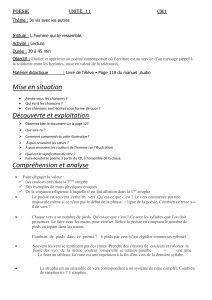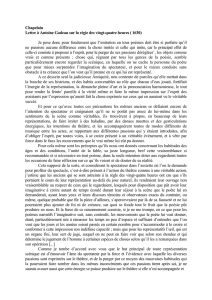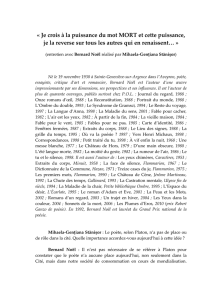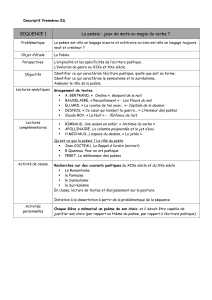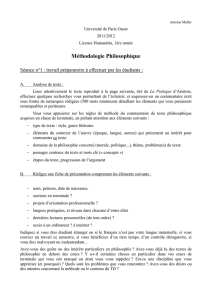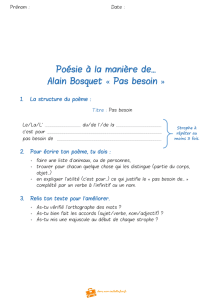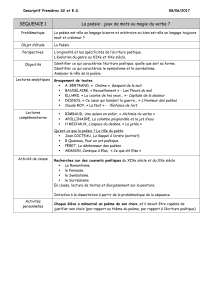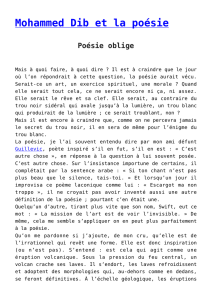Télécharger

CORRIGÉ
333
PRÉPARATION
Tenir compte de la question
• « Journal intime » : il faut que vous récapituliez avant tout les caractéristi-
ques de ce genre autobiographique : quels indices formels ? quelle teneur ?
• « poétique » : vous incite à être attentif aux diverses caractéristiques de la
poésie, dans sa forme, mais aussi dans ses thèmes.
• « pouvoirs de la poésie » : il faut aller au-delà du sens premier du poème
et dégager ce que Musset veut faire comprendre – et applique dans son
poème même – sur le pouvoir transfigurateur de la poésie.
45_FRA060028_34C.fm Page 333 Mardi, 1. août 2006 2:19 14
© H A T I E R

CORRIGÉ
334
ORAL • SUJET 45
Trouver les axes
• Utilisez les pistes que vous ouvre la question, mais composez aussi la
« définition » du texte.
• Utilisez les éléments de la question et de la « définition » pour trouver des
axes ou des idées directrices.
Dans chaque axe, introduisez un mot de la question.
PRÉSENTATION (PLAN DÉTAILLÉ)
Introduction
• Poètes en prison (se référer au corpus) : souvent inspirés par leur déten-
tion (êtres sensibles) ; un thème d’inspiration pour « soigner son mal »
(cf. Verlaine : « Mes prisons »).
• En même temps, pouvoir d’évasion et de transfiguration de la poésie qui
permet d’être ailleurs (poète voyageur).
• Musset : poète romantique, donc en révolte, refuse le service de la Garde
nationale à trois reprises. Ici, deuxième expérience de prison.
• « Le mie prigioni » (en italien : Musset très attaché à l’Italie ; vogue de « Le
mie prigioni » de Silvio Pellico, le carbonaro) rend compte de la « tristesse »,
du mal-être, mais, au fil du poème, l’état d’âme et la prison elle-même se
transfigurent : le poète les a faits siens (« mie »).
I. Une chronique de prison, le journal d’un prisonnier
1. Un lieu bien réel : la réalité carcérale
a) Bâtiments carcéraux
• Décrits comme si on y entrait, toujours en relief en fin de vers, vocabulaire
de la « prison » (v. 2) : « porte », « cachot », « fenêtre », « muraille », « toit »
(deux fois), « mur nu », « cachots ». Mouvement d’entrée, d’enfermement,
puis d’élargissement, puis de réenfermement.
Poème en vers réguliers (genre) romantique (mouvement) qui res-
semble à un journal intime (genre approché) qui décrit (type de texte :
descriptif) la vie en prison (thème), un peu pathétique, lyrique (regis-
tres), pittoresque (adjectif) pour donner une idée de la vie carcérale et
pour apaiser son mal, pour mettre en valeur les pouvoirs de la poésie
(buts de l’auteur).
45_FRA060028_34C.fm Page 334 Mardi, 1. août 2006 2:19 14
© H A T I E R

CORRIGÉ
335
ORAL • SUJET 45
• Enfermement rendu par le choix du vers : octosyllabe, suivi d’un vers de
quatre pieds : Musset a coupé son alexandrin comme s’il n’avait pas sa
place, comme pour mieux l’enfermer.
b) Occupations
• Passivité (« je suis », verbe d’état) et ennui (« on bâille ») ; plutôt état d’âme
qu’occupation : « bouder à la fenêtre ».
• Pour tromper l’ennui, activité nocive (« en fumant »).
• Passivité de la sensation (« on aperçoit » # regarder).
• Puis plus rien… (devient simple observateur).
2. Le temps qui s’écoule et qui dure
a) Les repères, notations de temps
• « depuis une semaine », « de grand matin » (v. 18), « rayons de l’automne »
(valeur symbolique de l’automne, saison romantique).
• Du « matin » au « réseau d’or », image qui connote le coucher du soleil ou
de l’année (cf. « automne »).
• Adverbe : « tout doucement » (v. 16) ; impression de lenteur, avec rime
intérieure sourde en « ou » et sonorités dentales « t » et « d », et douceur de
« c (= ss) », « m ».
• Les verbes : le présent et les verbes d’état (« je suis ») ; verbes comme
« commence à » (v. 15).
b) Le vocabulaire
• L’expression : « séjour tranquille ».
• L’adjectif « long » utilisé deux fois, même s’il qualifie des distances, prend
une résonance temporelle (par contamination) ; sa répétition donne l’impres-
sion de monotonie. Même chose pour « plat et monotone » en groupe binaire
statique (pas de mouvement fluide ni d’émotion forte).
c) La versification fluide
• La régularité des strophes, par les enjambements (v. 1-2 ; 6-7… voir
notamment strophe 7, d’un seul trait).
• Les vers pairs, rythme régulier.
3. Le contraste avec le « dehors » met en relief les conditions
de détention
• Dedans : « très chaud » (idée d’excès, d’inconfort) ; solitude.
• Dehors : « le soleil », « les rayons », opposé à l’absence de couleur (« mur
nu »).
45_FRA060028_34C.fm Page 335 Mardi, 1. août 2006 2:19 14
© H A T I E R

CORRIGÉ
336
ORAL • SUJET 45
• Les êtres du dehors : « les gens » (pluriel qui s’oppose au singulier, marque
de solitude) ; « ceux à qui ce séjour tranquille / Est inconnu » (pluriel encore ;
met en relief que le prisonnier est oublié…).
• L’activité : « font la lessive », oppposé à l’oisiveté.
II. Un journal mais… intime : l’expression du mal-être
et le lyrisme
1. Une réflexion sur la langue : un cliché revivifié qui reprend
tout son sens
Part d’un cliché, d’une comparaison galvaudée (« Triste comme la porte
d’une prison ») et lui redonne vie ; elle reprend sens pour celui qui en fait
l’expérience.
• Les guillemets présentent l’expression comme un cliché (reprise d’une
conversation banale) ; cf. le « on dit » : pronom indéfini + un verbe de parole
on ne peut plus plat.
• Les vers 3 et 4 la revivifient et lui redonnent son sens plein par : la pré-
sence du « je », le modalisateur (qui implique réflexion et non répétition
machinale) « crois », l’exclamation vigoureuse « que le diable m’emporte »
qui l’intensifie ; « on a raison » implique une réflexion et non plus un banale
prise de parole vidée de son sens.
2. Sous le signe du regret : le mea culpa de Musset
• Regret d’abord, (« il vaut mieux… »).
• Référence à sa situation particulière : « monter sa garde » (rappel de son
délit).
3. « Je » et « on » : Musset, frère de tous les prisonniers
et porteur de leur mal-être
a) La perte d’identité ?
« On » = « je » (sauf au 1er vers). Sensation que, tout en restant soi, on est
anonyme, on perd son identité (on n’est pas les « autres » du dehors, qui
n’ont pas fait l’expérience de la prison, v. 25-26, qui « ignorent »).
b) Le lyrisme
• Une 1re personne qui jalonne tout le texte : beaucoup d’occurrences
d’indices de la 1re personne, sous toutes ses formes (pronoms, adjectifs
possessifs : v. 3, 5, 6, 9, 13…) ; souvent en début de vers ou de strophe
(v. 9, 13, 29) ➞ lyrisme.
• Un retour sur soi, qui implique la réflexion : pronom réfléchi « (cru) moi-
même », « je crois » ; verbe pronominal (« je m’aperçois »).
45_FRA060028_34C.fm Page 336 Mardi, 1. août 2006 2:19 14
© H A T I E R

CORRIGÉ
337
ORAL • SUJET 45
• Vocabulaire des sentiments ou leurs manifestations : « triste » ; « avec
peine » ; « bouder » ; « bâille »…
III. Les pouvoirs de la poésie, la transfiguration poétique
Inopiné, mais en fait progressivement amené, un « coup de théâtre » :
• signalé par le « pourtant » (v. 33) ;
• conforté par les négations : « n’ont rien (de triste) » (v. 37), qui fait écho, en
inversion, à « Triste comme une prison » ➞ magie de la poésie.
1. La prison transfigurée : elle devient tableau,
une fête pour les yeux
• Les sens, un tremplin vers la transfiguration ; la poésie est peinture.
– Vocabulaire de la vue prédominant : « paraître » ; « perspective » ; « aper-
çoit » ; « avoir vu ».
– De véritables tableaux : le vocabulaire graphique de la peinture.
– Différents plans : « perspective » ; « le lointain » (arrière-plan) ; « d’abord »
(1er plan).
• La transfiguration se marque aussi par le passage de la comparaison
(« comme la porte »…) à la métaphore, magie de la poésie : « rayons / un
réseau d’or ».
• L’effet de surprise est ménagé par l’enjambement et le renvoi du COD
(« réseau d’or ») en dernier vers de la strophe 9 (même mouvement de
surprise et d’attente dans l’enjambement « A d’imprévu » à la strophe
précédente).
2. Du « je » au « poète », à l’« artiste » : Musset redevient poète,
retrouve son regard et son identité de poète
• Après l’expérience de la prison, on n’est plus le même (moi d’autrefois
différent de moi prisonnier).
• En poète impénitent, il transfigure tout ce qu’il voit : de simples graffiti
deviennent des « vers »…
• Du « je » au « on » à « peintre », « poète, artiste » : l’identité retrouvée à
travers la composition du poème.
3. L’humour ? Le sérieux sous l’humour ?
a) L’humour
• Ton (faussement ?) détaché, prosaïque (conversation de rue) et moralisa-
teur des deux premières strophes.
• Des euphémismes quelquefois doublés de périphrases (« séjour tranquille »).
• Périphrase « spectacle suprême » (ironie ?).
45_FRA060028_34C.fm Page 337 Mardi, 1. août 2006 2:19 14
© H A T I E R
 6
6
 7
7
1
/
7
100%