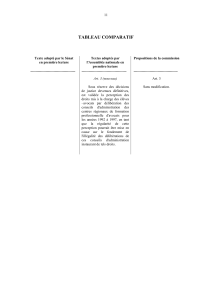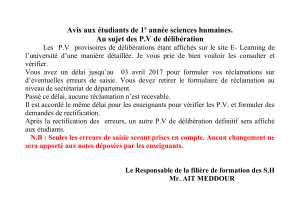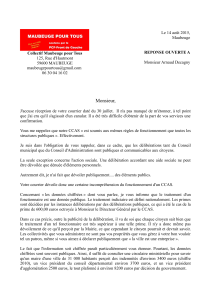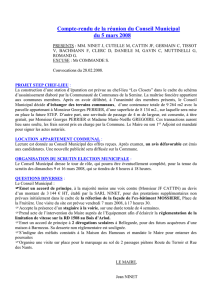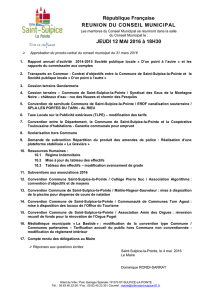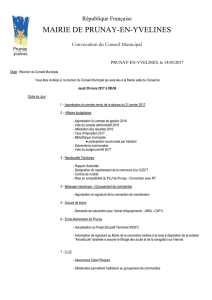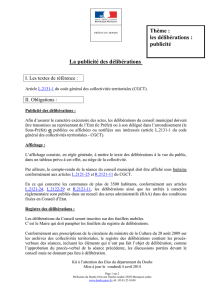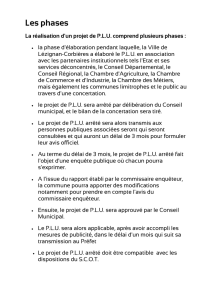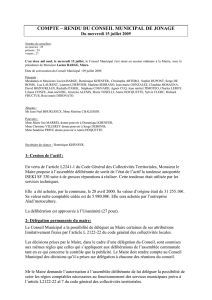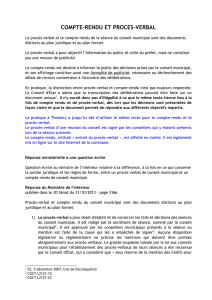Télécharger le compte

Point juridique sur le conseil municipal : les
règles relatives aux délibérations
Compte rendu de la réunion téléphonique du 8 juillet 2014
Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en
développement territorial, expert associé à Mairie-conseils, qui l’anime. Elle est présentée par Alban
PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils. Certains
participants ont posé des questions, qui sont retranscrites dans ce compte rendu avec leurs réponses.
Vous trouverez en annexe un diaporama envoyé aux participants pour aider à suivre l’exposé

LISTE DES PARTICIPANTS
Structures
Noms des structures
Départements
Communauté de communes
Vallée de Kaysersberg
68
Communauté de communes
Pays d’Olmes
09
Commune
Etalans
25
Commune
Ravilloles
39
Commune
Luz-Saint-Sauveur
65
Communauté de communes
Val de Drôme
26
Commune
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
69
Commune
Bréval
78
Commune
La Répara-Auriples
26
Communauté de communes
Centre Médoc
33
Cette réunion a été organisée par Mairie-conseils avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en
développement territorial, expert associé à Mairie-conseils. Animée par Isabelle FARGES, elle est
présentée par Alban PERRIN, juriste au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairie-
conseils.

Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux
délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts –
Téléchargeable sur
www.mairieconseils.net
Rubrique Téléconférences, Comptes rendus
3
PRESENTATION
ALBAN PERRIN, JURISTE AU SEIN DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES DE
MAIRIE-CONSEILS
Introduction
Deux rappels préalables concernant le champ d’intervention du conseil municipal et, par conséquent,
de ses délibérations.
Tout d’abord, le conseil municipal est compétent pour les affaires concernant la commune, à
l’exception des matières pour lesquelles il aura mis en place une délégation de pouvoir au profit du
maire. S’il y a une délégation de pouvoir au maire, le conseil municipal ne peut plus intervenir, ni
délibérer. Cette règle a été rappelée par une réponse ministérielle au Sénat (QE n°13728, J.O. Sénat
du 26 août 2010).
Par ailleurs, le conseil municipal ne peut délibérer que sur des questions qui sont mentionnées dans
l’ordre du jour joint à la convocation. Ainsi, les décisions qui seraient adoptées dans le cadre de
questions diverses, ou qui n’auraient pas fait l’objet d’un point précisé à l’ordre du jour, sont
susceptibles d’être annulées.
Nous traiterons le sujet en trois parties :
− les modalités de décision du conseil municipal, avec les modes de scrutin, puis le vote des
délibérations, et notamment les notions de suffrages exprimés et de majorité absolue et enfin
la notion de conseillers intéressés,
− la formalisation de ces décisions,
− et l’opposabilité des décisions, c’est-à-dire de l’entrée en vigueur des délibérations.
Le vote des délibérations
Les modes de scrutin
Il existe trois modes de scrutin, à savoir un scrutin ordinaire, et deux types de scrutins formels
donnant lieu à votes effectifs.
Le mode de scrutin ordinaire a été mis en évidence par une décision du Conseil d’État, qui précise
que « l’adoption d’une délibération n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote effectif, dès lors que
l’assentiment de la totalité des conseillers ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté
par le maire ou le président de séance » (CE, 22 janvier 1960, Fichot). Cela signifie qu’il n’est pas
forcément nécessaire de recourir à un vote effectif tel qu’un scrutin secret ou un scrutin public, pour
délibérer.
Ainsi, une délibération peut résulter du simple assentiment de l’ensemble ou de la majorité des
conseillers. Il s’agit par exemple du cas d’un maire qui soumettrait une question et demanderait quels
conseillers votent « pour » puis « contre » sans les compter et en établissant la majorité « à l’œil ». Si
les conseillers ayant voté en faveur de la question soumise sont plus nombreux que ceux qui ont voté
contre, la décision est alors adoptée. Le recours à un vote formel à main levée ou par assis-debout
avec comptage des voix n’est pas nécessaire. La décision résulte du simple assentiment de la
majorité. Cela dit, ce type de mode non-formel fait généralement l’objet d’un minimum de
formalisme, qui correspond souvent à la main levée ou à l’assis-debout.
Les votes effectifs ou votes formels, sont prévus à l’article L2121-21 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT). Ce texte définit le scrutin public et le scrutin secret. Il précise
également les modalités de recours à ces types de scrutins.

Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux
délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts –
Téléchargeable sur
www.mairieconseils.net
Rubrique Téléconférences, Comptes rendus
4
Il est recouru à un scrutin public lorsque le quart des membres présents le demande. Le scrutin
public se matérialisera par un vote nominatif. Par exemple, le maire appellera successivement
chacun des conseillers présents par son nom, en lui demandant d’exprimer son vote. Le secrétaire de
séance procédera alors à l’inscription du nom des votants et du sens de leur vote. Un vote nominatif
peut également consister en la production de bulletins nominatifs. Dans ce cas, chaque conseiller se
munit d’un bulletin, sur lequel il écrit son nom et le sens de son vote, l’ensemble des bulletins étant
ensuite transmis au secrétaire de séance, qui les répertorie et en reporte le contenu sur le procès-
verbal de la séance.
En résumé dans le cas d’un scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote sont indiqués sur
les délibérations. Dans le cas d’un scrutin public, il est demandé aux conseillers municipaux de se
prononcer publiquement sur une délibération.
Le second type de vote effectif correspond au scrutin secret. Il est, en principe, obligatoire de
recourir à ce scrutin pour les cas de nomination ou de présentation, c’est-à-dire dans toutes les
situations pour lesquelles le conseil municipal est tenu de désigner une personne. Cependant, le
CGCT prévoit des exceptions. Ainsi, le conseil municipal pourra décider, à l’unanimité, de s’exonérer
de cette formalité du vote au scrutin secret pour une nomination ou une présentation, à condition
qu’aucun texte n’ait expressément prévu la désignation au scrutin secret, ce qui est par exemple le
cas pour l’élection du maire. En effet, la disposition du CGCT relative à l’élection du maire prévoit
expressément que cette élection se déroule au scrutin majoritaire à trois tours, et au scrutin secret. Il
est impossible de déroger au scrutin secret dans ce cas. Il est enfin recouru au scrutin secret
lorsqu’un tiers des membres le demande.
Lorsque deux types de scrutins sont demandés simultanément, le scrutin secret l’emporte. Lors d’une
précédente réunion téléphonique, relative au droit de l’opposition, j’avais rappelé que, lorsqu’une
majorité demande un scrutin public, l’opposition peut contrarier la majorité et demander un scrutin
secret, qui l’emportera toujours.
Le vote des délibérations.
Le vote des délibérations est soumis à deux principes. Tout d’abord, les délibérations sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité absolue correspondant à plus de la moitié des
suffrages exprimés. Par ailleurs, En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante sauf en cas de scrutin secret. En effet, elle ne peut être prépondérante puisque son
vote est alors secret.
S’agissant du calcul de la majorité absolue, celle-ci nécessite de réunir plus de la moitié des suffrages
exprimés. Seuls les votes « pour » ou « contre » sont considérés comme exprimés et comptabilisés.
Les votes blancs, les votes nuls et les abstentions ne sont pas comptés. Le refus de prendre part au
vote d’une délibération sera considéré comme une abstention, de même que le retrait d’un conseiller
intéressé.
Prenons l’exemple d’un conseil municipal comprenant quinze membres. Le jour de la réunion, treize
membres en exercice sont présents. Deux des treize conseillers sont intéressés par une délibération
relative à l’octroi d’une subvention à une association. Le vote de la subvention conduit à cinq
abstentions, quatre « contre », et deux « pour ». Cinq abstentions et deux conseillers intéressés
représentent sept suffrages non exprimés. Il reste par conséquent six suffrages exprimés. Pour que la
subvention soit votée, plus de la moitié de ces six suffrages aurait dû voter « pour ». En d’autres
termes, plus de trois membres du conseil municipal auraient dû voter « pour ». La subvention n’est
pas accordée. Si les suffrages exprimés avaient représenté trois « pour » et trois « contre », et dans
l’hypothèse d’un scrutin public, la voix du président, c’est-à-dire la voix du maire, aurait été
prépondérante. Si le président avait voté « pour », il aurait fait basculer la majorité en faveur de
l’octroi de la subvention. Dans le cas d’un scrutin secret, aucune majorité n’aurait pu être dégagée. En
l’absence de majorité en faveur de l’octroi d’une subvention, cette dernière n’aurait pas été accordée.

Les rendez-vous juridiques |Compte-rendu du 8 juillet 2014 sur le conseil municipal : les règles relatives aux
délibérations- Mairie-conseils Caisse des dépôts –
Téléchargeable sur
www.mairieconseils.net
Rubrique Téléconférences, Comptes rendus
5
Ce dernier exemple illustre l’intérêt du scrutin secret pour des conseillers municipaux qui
s’opposeraient à une délibération.
La notion de conseillers intéressés
Cette disposition prévue à l’article L2131-11 du CGCT, précise que « sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit
en leur nom personnel, soit comme mandataires ». En d’autres termes, lorsque des conseillers, qui
seraient intéressés aux affaires faisant l’objet de délibérations en conseil municipal, prennent part au
vote ou influencent le vote de ces délibérations, ces dernières devront être considérées illégales. Pour
éviter cet écueil, il convient de s’assurer que ces conseillers intéressés, et susceptibles d’influencer le
vote, ne prennent pas part aux débats ni aux délibérations.
Pour qu’un conseiller soit considéré comme intéressé à une affaire du conseil municipal, il faut que
l’intérêt de ce conseiller soit distinct de celui de la généralité des habitants de la commune. Dans le
cas d’une révision de PLU, qui transformerait en zones constructibles un certain nombre de terrains,
parmi lesquels figureraient un ou plusieurs terrains appartenant à l’un des conseillers municipaux,
l’intérêt du conseiller municipal dans cette révision serait avéré. Cependant, cet intérêt ne se
distinguerait pas de celui de l’ensemble des habitants, qui sont tout autant concernés par la
modification du PLU.
L’intérêt peut être détenu de manière directe, ou en tant que mandataire, ou pour un proche.
La notion de conseiller intéressé doit être distinguée de la prise illégale d’intérêt mais jamais
dissocier. Pour schématiser, la prise illégale d’intérêt constitue un délit pénal, prévu par le Code
pénal qui interdit à une autorité publique de se servir de ses pouvoirs pour s’attirer des avantages.
Néanmoins, les deux notions doivent toujours être envisagées ensemble. Celle de conseiller intéressé,
prévue à l’article L2131-11 du CGCT, entraîne l’annulation de la délibération. Or un conseiller
intéressé peut également être soumis aux dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. S’agissant
d’un délit pénal, la prise illégale d’intérêt concernera uniquement le conseiller. La notion de prise
illégale d’intérêt est prévue à l’article 432-12 du Code pénal.
Pour en savoir plus voir la réunion sur la notion d’élu intéressé à une délibération du conseil municipal.
Vous en trouverez le compte rendu sur le site de Mairie-conseils, ce document ayant été mis en ligne le
24 octobre 2013.
S’agissant de la conduite à tenir lorsqu’un conseiller est intéressé à une affaire, et dans la mesure où
la délibération risque d’être annulée, il conviendra de s’assurer que le conseiller ne prend pas part au
vote de la décision qui le concerne, ou dans laquelle il possède un intérêt. En outre, si le conseiller est
susceptible d’influencer les débats, il est préférable qu’il ne prenne pas part aux débats, ni aux
travaux préalables à la prise de décision. La jurisprudence tend à élargir la notion de conseiller
intéressé. Elle considère en effet facilement que le conseiller possède une influence sur la prise de
décision. En vue d’éviter toute difficulté et de sécuriser ses délibérations, il vaut mieux qu’un
conseiller intéressé personnellement ne prenne part ni aux débats, ni aux délibérations.
MAGALI MOYNAT, SECRETAIRE DE MAIRIE - COMMUNE DE RAVILLOLES
Que se passe-t-il lorsqu’un conseiller intéressé dispose d’un pouvoir pour s’exprimer au nom
d’un autre conseiller ?
ALBAN PERRIN
La situation est identique. Le conseiller ne peut pas voter, y compris pour la personne qu’il
représente. En effet, le mandat impératif n’existe pas en droit français. Ainsi, un conseiller qui aurait
reçu un mandat de voter ne peut pas recevoir de consignes de vote. Dans l’hypothèse où un premier
conseiller municipal donnerait un pouvoir à un second conseiller municipal, le premier ne pourrait
pas obliger le second à voter dans un sens donné. Dès lors qu’un conseiller municipal dispose d’un
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%